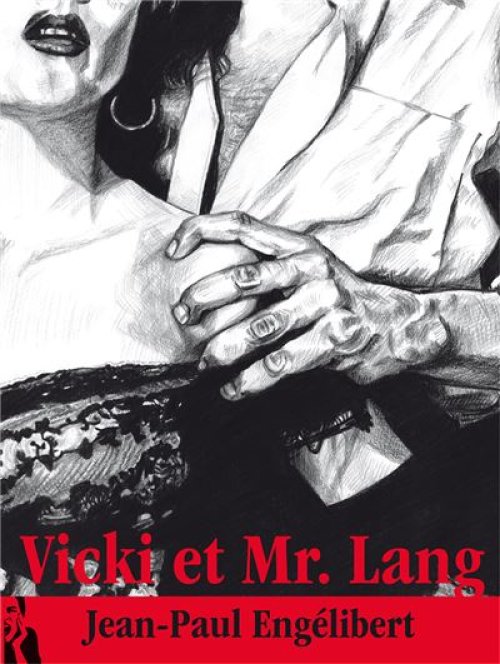1.
Dans ce numéro qui tente d'appliquer l'intermédialité à la notion d'œuvre, on constate que, sans toujours l’expliciter, de nombreuses œuvres se construisent en interaction avec leur milieu intermédial de création et de diffusion, à de multiples niveaux.
Mais ce qui, pour nous, est de l'ordre du constat et concerne rarement toute l'œuvre, devient dans votre roman un véritable principe de création : l'intermédialité en est le principe même puisque la fiction se compose de plans narratifs appartenant à d'autres médias ainsi qu'aux œuvres des autres : vous superposez la fiction de Fritz Lang élaborant son film (storyboard, scènes de tournage, description de plans), la fiction du film lui-même, mettant en scène Vicki, l'héroïne de l'histoire, la fiction évoquant la vie de l'actrice qui joue Vicki, la fiction de La Bête humaine de Renoir, dont Human Desire est le remake américain et dont certaines scènes sont évoquées à leur tour, la fiction du roman de Zola, etc. Tout se passe comme si l'espace fictionnel de votre roman cherchait à se dissoudre dans la transfictionnalité… A quel désir ou plaisir particulier répond chez vous une telle dissolution de l'œuvre dans l'inter-œuvre ?
Ce qui m’a d’abord donné envie d’écrire ce roman, c’est un désir très simple : je voulais parler d’un personnage et, plus précisément, sauver Vicki. Dans le film de Lang, elle est perçue d’emblée comme une femme fatale, celle que les spectateurs identifient comme coupable de tous les crimes qui s’enchaînent parce qu’elle semble entraîner les hommes dans une spirale criminelle. Toute la culpabilité se condense sur elle. Je voulais lui offrir un autre statut, la voir différemment et peut-être, par ricochet, voir le film autrement.
Pour cela, il fallait repartir à la source, revenir au roman de Zola. Dans La Bête humaine, tous les personnages portent en eux une part de culpabilité : chacun est un meurtrier en puissance, qu’il passe à l’acte ou non. Cette idée me semblait fondamentale. Elle ouvrait la possibilité de reconstruire Vicki autrement, de lui redonner du relief et de l’humanité, un tremblement, une fragilité.
Cette reconstruction passait nécessairement par une réinterprétation, mais d’un personnage qui est lui-même déjà une interprétation : Vicki vient d’un film qui est le remake d’un autre film, lui-même adapté d’un roman. J’étais donc face à une métafiction au troisième degré, et c’est cette stratification qui m’a intéressé. La transfictionnalité n’est pas un décor : elle est au cœur du projet. Elle oblige à repasser par toutes les étapes de la construction du personnage, dans une sorte de reconstruction littéraire qui dialogue constamment avec les hypotextes.
Au départ, je pensais simplement raconter le film, mais je me suis rendu compte très vite que cela ne présentait pas un grand intérêt. Le résultat aurait été une paraphrase du film, ou aurait risqué de ressembler à un scénario déguisé en roman, ce que je voulais absolument éviter. Le modèle de Cinéma de Tanguy Viel — par ailleurs un très bon roman, dans lequel le narrateur qui revoit obsessionnellement le même film — m’indiquait précisément la voie à ne pas suivre.
Pour donner de la profondeur à la fiction, il fallait au contraire ouvrir l’espace narratif et introduire dans le roman la préparation du film et son tournage. Entrelacer ces trois plans — le filmv réalisé, son tournage et la fiction du roman — me permettait de faire dialoguer la création et ce qui la rend possible. La fiction et le milieu dans lequel elle naît se mettent alors à se répondre en miroir. Alors ce que vous appelez l’inter-œuvre n’est plus seulement un constat abstrait, mais un principe actif de création.
Ce qui m’intéressait, dans cette dissolution apparente de l’œuvre dans cet inter-œuvre, c’était précisément l’effacement des frontières entre fiction et réalité. Cet effacement n’affaiblit pas la réalité : au contraire, il ouvre un espace où les régimes de vérité circulent.
Tout ceci revenait à prendre au sérieux l’intermédialité en la plaçant au niveau même de la fabrique romanesque. J’avais le sentiment que cette circulation — entre œuvres, entre médias, entre versions — appelait un plaisir particulier : celui de voir comment une fiction peut se construire à partir d’autres fictions sans jamais se refermer sur elle-même, mais au contraire en s’ouvrant à un « inter-œuvres ».
2.
Dans le même temps, une partie des personnages est réelle. En se constituant comme inter-œuvre, le roman se constitue aussi en exofiction, c'est-à-dire en histoire utilisant un personnage qui a existé, pour lui faire vivre une aventure créatrice (le tournage du film) invérifiable (elle ne peut qu'être inventée puisqu'elle relève de la vie psychique du personnage, sur lequel nous n'avons pas de document). Pourquoi était-il important que le héros de l'histoire soit un personnage réel et connu de tout amateur de cinéma ?
Si j’ai choisi de faire de Fritz Lang le héros du roman, c’est d’abord parce que le cinéma est l’art que je connais le mieux. Il a toujours été un moteur pour mon écriture. Culturellement, c’est l’art populaire du XXᵉ siècle — Godard le rappelait souvent — et c’est aussi, pour beaucoup de lecteurs, un réservoir mythologique : les acteurs ont été de véritables figures héroïques et les réalisateurs des légendes. Dans la mémoire cinéphile, l’image de Lang, avec son monocle et son passé d’exilé allemand à Hollywood, demeure très présente, même si elle s’est un peu estompée aujourd’hui. On se souvient encore du réalisateur de M le Maudit, de Fury, de The Big Heat, de Mabuse. Partir d’un personnage aussi identifiable me permettait d’activer tout cet imaginaire.
C’est pourquoi, il était essentiel que le héros soit un personnage réel, qui véhicule toute une mythologie avec laquelle je pouvais jouer. On sait beaucoup de choses sur Lang, mais rien — absolument rien — de ce qu’il a pu ressentir, imaginer, rêver pendant le tournage de Human Desire. Cette part de sa vie était un territoire vierge. C’est là que l’exofiction peut travailler : dans cette articulation entre le documentable et l’inventé, entre la mémoire du cinéma et la liberté du roman.
D’autre part, partir du tournage de Human Desire me donnait accès à un matériau historique qui s’est révélé riche. Je devais situer le film dans son contexte immédiat, c’est-à-dire la carrière de Lang, mais aussi dans un environnement plus large : Hollywood en 1953, l’ombre du maccarthysme finissant, et sur un autre plan, les acteurs.
Car cette question rejoint la dimension de l’inter-œuvre en ce que Human Desire n’est pas seulement le remake de La Bête humaine ; c’est un film qui dialogue avec le film précédent de Lang, The Big Heat, tourné avec les deux mêmes stars, Glenn Ford et Gloria Grahame, et qu’on ne peut pas regarder sans penser au destin de celle-ci. C’est toute cette constellation de films, de rôles et de vies qui nourrit l’exofiction du roman.
Je ne pouvais pas raconter l’histoire de Vicki — une femme victime des hommes, d’un système patriarcal, bref d’une violence structurelle — sans m’intéresser à l’actrice qui l’incarne. Or, le parallèle entre l’actrice et son personnage est immanquable. Sur le plateau, Lang a mené la vie dure à Gloria Grahame. Au départ, il ne voulait pas l’engager : il aurait préféré confier le rôle à Rita Hayworth, mais il a aussi pensé à Barbara Stanwyck et à Joan Bennett. Ce sont les producteurs qui lui ont imposé Gloria Grahame, et le tournage avec elle a été conflictuel dès le départ.
Gloria Grahame était connue pour varier son jeu pendant les répétitions sans tenir compte des indications du réalisateur. Cela rendait Lang furieux. Je suis parti de quelques anecdotes racontées par les biographes pour imaginer leur relation. Cette tension me semblait la meilleure porte d’entrée possible pour une fiction qui, précisément, cherche à raconter ce qui ne peut pas être documenté.
Lang avait déjà tourné avec Gloria Grahame, dans The Big Heat, l’année précédente. Elle y incarnait Debbie Marsh, un personnage inoubliable : une jeune femme à la fois insouciante et séduisante que son compagnon, un gangster emporté et violent, défigure dès sa deuxième scène. Par la suite, on ne la voit plus que la moitié du visage masquée sous un pansement : une femme en deuil d’elle-même. Ce rôle faisait écho, pour moi, à celui de Vicki. Violée par Owens avant le début du film (puisqu’on suppose que c’est bien ce qui s’est passé), mariée à un homme qu’elle n’aime sans doute pas (le film ne le rend pas aimable en tout cas), Vicki n’a jamais été heureuse. Mais lorsqu’elle rencontre Jeff, elle entrevoit la possibilité de recommencer sa vie. Debbie et Vicki sont victimes des hommes, mais pendant un moment, Vicki a pu rêver à une seconde chance.
Quant à Gloria Grahame, son histoire semble épouser celle de ses personnages. Au moment où elle tourne avec Lang, elle sort d’une rupture douloureuse avec Nicholas Ray et elle vit une relation orageuse et violente avec Cy Howard, qui rêve pour elle d’une grande carrière de star. Mais ça n’arrivera pas, dès le milieu des années cinquante, elle se retrouve prise au piège d’un système hollywoodien qui la broie.
Il y a donc un va-et-vient permanent entre la fiction et sa genèse, ou son milieu natal, que j’ai voulu perceptible dès le titre, qui associe le nom du personnage et celui du metteur en scène. J’ai tenu à ce que Vicki précède Lang, parce qu’elle reste le personnage principal pour moi. Le fait de l’appeler par son prénom, qui est d’ailleurs un diminutif, alors que Lang garde son patronyme, indique aussi l’attachement affectif que je voulais préserver, alors que Lang est mis à distance par le « Mr » qui reproduit la manière dont la production s’adresse à lui. Pourtant, au fil de l’écriture, je me suis aperçu que Lang prenait de plus en plus de place. Je l’avais introduit tard, mais il offrait une instance capable de juger le film et son tournage d’une manière que le narrateur ne pouvait pas assumer. Toutes les pensées que je lui prête, y compris ses colères et ses contradictions, sont attestées dans ses entretiens. Le personnage de Lang portait en lui une tension dramatique formidable, et on sait que le tournage de Human Desire a été difficile. Lang était en soi une source de tension narrative, et je devais maintenir un équilibre avec Vicki pour que l’un ne prenne pas le pas sur l’autre.
On m’a demandé pourquoi je n’entrais pas dans les pensées de Gloria Grahame alors que je le fais pour Lang. Cela tient à la structure même du roman et du film : Gloria devait être un double de Vicki, or Vicki, dans Human Desire, demeure un mystère. Si j’entrais trop dans ses pensées, je trahissais cette opacité, qui est essentielle à la force du personnage et à la vision de Lang. Je ne voulais pas non plus en faire une innocente mélodramatique. Accéder à sa conscience serait revenu à figer ce qui, dans ses silences et ses mensonges, reste multiple et indécidable. Le droit au silence, le droit à ne pas dire, confère à Vicki une épaisseur psychologique que Gloria, paradoxalement, ne peut pas avoir. Gloria s’abolit dans son personnage : elle incarne un rôle voulu par d’autres, un rôle qui lui est imposé par la fiction et par l’industrie du cinéma. Vicki, au contraire, garde ses zones d’opacité, ses secrets, et c’est cette part d’incertitude qui la rend plus complexe.
3.
Dans les années 1980-1990 la médiation intermédiale aurait été mise au compte d'une autoréférence de la création mettant réflexivement en scène ses propres médium ou dispositif. L'effet produit par votre livre est très différent : en décrivant des scènes de storyboard, des plans à organiser, des scènes de projection (comme celle de La Bête humaine de Renoir), la technicité semble davantage nous immerger dans la fiction que nous en faire sortir (pas d'effet "méta"). Est-ce parce qu'aujourd'hui les médias, avec leurs supports et dispositifs ne se cachent plus ? Quelle fécondité accordez-vous à cette technicité, qui aurait pu rendre le roman assez austère, ce qui est exactement le contraire ici ?
En effet, le jeu de l’autoréférence m’intéresse moins que le jeu avec la réalité. Décrire des dessins de Lang ou raconter la manière dont il travaille sur le plateau, c’est montrer comment on fabrique une fiction. C’est donc métafictionnel, mais pas postmoderne : la fiction ne s’autonomise pas de ses conditions de production, c’est même le contraire. Le cinéma est très propice à cette entreprise, parce qu’un film se construit par étapes successives. De plus, en racontant la préparation et le tournage du film, je pouvais le réécrire. J’ai pu me livrer à des transformations discrètes de scènes, à des décalages qui sont des moyens de m’approprier le film. Il s’agissait de ne surtout pas refaire un scénario : il fallait éviter à tout prix l’imitation plate, la paraphrase, l’adaptation romancée.
Une autre contrainte s’est imposée très vite : ne jamais commenter. J’ai beaucoup travaillé Human Desire avec mes étudiants, mais je ne voulais pas introduire dans le roman la voix du critique. Cela m’obligeait à écrire un récit où le narrateur devait être le plus effacé possible. J’ai laissé apparaître quelques « je » pour signaler sa présence, mais il s’agissait de ne produire aucun jugement moral, esthétique ou politique. La narration devait rester dans une zone d’indétermination, presque de neutralité.
J’ai donc élaboré mon récit en entrelaçant deux histoires : celle que raconte Human Desire et celle de la conception et de la fabrication de Human Desire. Mais c’est après coup que j’ai compris combien cette dynamique de dédoublement irriguait le projet. J’espère qu’en effet ce n’est pas austère.
Quant au fait que les médias ne se cachent plus, vous avez raison. Ils sont devenus l’environnement naturel de nos vies et de notre culture. Ce sont les médias qui fabriquent la mythologie des images, qui construisent les figures de stars, les gestes, les objets du regard. Nous vivons au milieu d’images, et nous avons besoin de parler de notre rapport à elles. Mais, pour pouvoir en parler sans s’y perdre, il faut aussi parler de la façon dont les images se fabriquent.
C’est pour cela que la technicité — storyboard, découpage, projection, organisation des plans — est si présente dans mon roman. Elle pourrait sembler austère, mais pour moi, elle est une manière d’entrer dans la fiction, et non d’en sortir. Là où, dans les années 1980-1990, l’intermédialité était souvent comprise comme une forme d’autoréférence ou de réflexivité visible, qui mettait à distance son propre médium, j’ai voulu faire quelque chose de presque inverse : faire sentir de l’intérieur comment une image naît, comment un plan se compose, comment un film se construit.
J’ai voulu parler de notre manière de fabriquer les images parce que Lang lui-même est un cinéaste profondément métacinématographique. Il ne cesse de réfléchir au cinéma à travers ses films. C’est visible dès Fury : toute la fin du film est un commentaire sur le rôle du cinéma dans la construction du réel. Dans Le docteur Mabuse, c’est la vision cinématographique qui est interrogée. While the City Sleeps, qu’il réalise après Human Desire, est encore une réflexion sur la télévision et sur les nouveaux médias de son époque. Il n’est pas étonnant que Godard l’ait considéré comme un maître : Lang est un cinéaste qui pense le cinéma, qui pense les dispositifs, qui pense les images, et qui les pense politiquement.
Cette dimension méta m’a accompagné tout au long du livre, mais j’ai cherché à la dissimuler. Je voulais éviter le commentaire, comme je voulais éviter de faire un récit théorique ou un roman à thèse. Il fallait que la dimension réflexive circule dans la fiction sans l’interrompre. En ce sens, la technicité devient un outil pour raconter, pas un moyen de s’élever au-dessus du récit.
Je crois que la technicité était d’autant plus importante que, dans mon livre, je mêle constamment fiction et réalité. Je ne voulais écrire ni un document, ni simplement raconter une histoire. La fiction repose sur un fond documentaire très fort, mais elle le met en mouvement par des scènes de tournage, des notations techniques, des gestes de mise en scène. Cette matière technique devient un langage romanesque, une manière de décrire ce qui, autrement, resterait abstrait.
Et il y a une autre raison : parler de Lang, c’est forcément parler de la société du spectacle. Notre époque n’a peut-être jamais été autre chose qu’un ensemble d’images et de récits. La dernière page du livre — que j’ai à peine transformée — provient presque mot pour mot d’un article de Lang des années 1920. Ce qui m’a frappé, c’est que Lang pensait déjà, à cette époque, au rôle du cinéma allemand dans la formation de l’esprit moderne, à la manière dont les images fabriquent des esprits, des comportements, des affects.
Reprendre cette page et l’intégrer au livre, c’était une manière de faire sentir que la réflexion sur les médias ne nous éloigne pas de la fiction, mais qu’elle nous y plonge davantage. Elle fait partie du monde de Lang, du monde des films, du monde des images que nous habitons.
En somme, j’accorde beaucoup de fécondité à cette technicité parce qu’elle permet de faire tenir ensemble la réflexion et la narration. La technique ne met pas à distance : elle crée un espace où la fiction peut se déployer, où les personnages existent, où l’on comprend comment un film advient. Et c’est ce geste-là, pour moi, qui permet de raconter une histoire qui soit vraiment une histoire de cinéma — une histoire faite d’images, de machines et d’humains.
4.
Dans votre livre, quels rapports entretiennent fiction et document ?
Au départ, je voulais écrire une fiction, précisément pour sortir de l’écriture universitaire. Il n’était pas question d’écrire un document, ni de faire de la littérature documentaire. Je tenais à ce que le livre soit immédiatement identifié comme une fiction. Mais en même temps, cette fiction repose sur une documentation très importante : pratiquement tout ce que je raconte s’appuie sur elle. J’invente bien sûr les dialogues, j’invente les pensées et les raisonnements que j’attribue à Lang, mais je ne laisse jamais l’invention devenir arbitraire. Tout doit rester vraisemblable.
La plupart des situations inventées sont en réalité démarquées d’anecdotes authentiques, que je déplace ou que je transforme légèrement. Par exemple, la scène dans la loge de Gloria Grahame s’inspire très directement de récits réels, même si je la reconstruis pour les besoins de la fiction. Mon intention n’était donc pas de reproduire le réel, mais de bâtir une fiction dans laquelle tout demeure plausible. Il y avait pour moi une exigence de rigueur : tout ce qui est vérifiable devait tomber juste — ou bien être volontairement faux, mais de façon tellement évidente que le lecteur comprenne qu’il s’agit d’une licence romanesque.
C’est le cas, entre autres, quand j’ai décidé que Lang verrait l’océan depuis sa terrasse de Beverly Hills. C’est matériellement impossible : l’océan est bien trop loin. Mais je voulais absolument qu’il le voie. Je me suis offert ce droit d’invention assumée, parce que cette image avait pour moi une nécessité narrative. C’est le genre de déplacement que j’accepte dans le roman : un léger écart qui reste signifiant, qui ne met pas en péril la cohérence documentaire du reste.
Lang est un personnage mythique, et il a déjà été utilisé par d’autres auteurs de fiction. Un roman graphique lui a été consacré il y a deux ans. Ce statut faisait presque partie des exigences du projet : à partir du moment où j’avais besoin d’un réalisateur, j’avais besoin de ce réalisateur-là. Sa légende a produit sa propre littérature, avec ses inventions, ses contradictions, ses zones d’ombre. Je pouvais donc jouer avec cette légende. J’ai repris des éléments fabriqués par Lang lui-même — car il a activement construit son propre mythe — mais je me suis aussi inspiré des biographies qui le contredisent, ce qui me permettait de maintenir une distance critique tout en nourrissant la fiction.
Dans le roman, j’ai voulu troubler la frontière entre fiction et non-fiction. Je paraphrase en effet une histoire authentique — je colle autant que possible à ce que le spectateur voit du film — mais dès que je décris la construction du film, j’entre dans un espace plus fictionnel, celui de la conscience de Lang. Il y a là un chiasme qui me semble intéressant : plus je suis proche des images existantes (fictionnelles), plus je suis du côté du document ; plus je décris leur fabrication intérieure (réelle), plus j’entre dans la fiction. Le roman se construit entièrement dans cet aller-retour. J’ai voulu troubler la frontière entre fiction et non fiction. Quand je raconte le film, je ne fais que paraphraser une histoire authentique en collant le plus possible à ce que le spectateur voit. En revanche quand je décris la construction du film je suis plus dans la fiction car dans la conscience de Lang.
5.
Vicki et Mr Lang met en roman un film de Lang, allemand émigré aux USA ; l’exergue du roman est emprunté au livre de Sebald Les Emigrants. Que dire de la question de l’exil, de la migration ? L’exergue est-il en rapport avec la biographie de Lang ? Est-ce aussi une histoire de transfert culturel (pas seulement médial) ?
La question de l’exil et du transfert culturel est importante dans mon livre, même si elle n’est pas traitée frontalement. Elle traverse le roman parce qu’elle traverse la figure de Lang lui-même. L’exergue emprunté aux Émigrants de Sebald n’est pas un simple ornement : il rappelle que Lang crée loin de son pays, dans une situation d’exil qui n’est pas seulement géographique, mais psychique, culturelle, linguistique.
Hollywood, dans les années 1930 à 1950, est un lieu façonné par les exilés : des dizaines d’artistes européens y ont travaillé, pas uniquement dans le cinéma. Lang s’y inscrit, mais il n’y est jamais pleinement chez lui. Il souffre de sa condition d’Allemand immigré : son accent, sa réputation d’homme autoritaire, cassant, « prussien » — même si, en réalité, il était viennois. Il voulait devenir le cinéaste immigré le plus américanisé : il a appris l’anglais en arrivant, il s’est immergé dans la littérature populaire américaine, il est allé rencontrer les Indiens, il a cherché à comprendre l’Amérique de l’intérieur. Mais ces efforts n’ont jamais été reconnus, ou pas à la hauteur de ce qu’il espérait. Ce semi-échec, accumulé au fil des années, l’a progressivement convaincu de revenir en Allemagne. Au moment où commence le roman, en 1953, il peine à monter ses projets, et son retour devient une possibilité très réelle.
Ce rapport compliqué à l’exil est indissociable de son cinéma. La sensibilité européenne reste présente même dans ses films hollywoodiens. Il n’a jamais oublié ce qu’il avait été dans le cinéma européen jusqu’en 1934, et ses films américains portent toujours la marque de ce double ancrage. C’est là que le transfert culturel devient un élément essentiel de son personnage : Lang travaille avec le système hollywoodien et contre lui, avec un souvenir de l’Europe omniprésent. Il connaît Zola, par exemple, et tient à maintenir dans Human Desire l’idée zolienne que tous les personnages sont des assassins potentiels, que le mal est en chacun. Mais cette idée est difficilement acceptable pour ses producteurs — et même pour Glenn Ford, qui interprète Jeff, l’équivalent du Lantier de Zola et Renoir.
La comparaison avec Renoir permet aussi de mesurer cette différence culturelle. Le cinéma de Renoir est un cinéma humaniste : il laisse des moments de grâce à ses personnages, des instants de plénitude où une humanité se donne. La scène de La Bête humaine où Lantier rejoint Séverine à la gare de triage se déroule la nuit, sous l’orage, dans une attente inquiète ; Séverine est là avant Lantier ; ils se jettent dans les bras l’un de l’autre ; un fondu au noir très pudique signifie au spectateur la scène d’amour, qui ne sera pas montrée ; la pluie cesse et après cette ellipse les deux amants sortent enlacés au soleil du matin — c’est une scène d’une délicatesse extraordinaire.
Chez Lang, la même scène n’est ni délicate ni heureuse : elle est angoissée. Les amants s’embrassent dans l’angoisse d’être vus, et la lumière qui éclaire leur baiser vient d’un projecteur qui les poursuit jusque dans leur refuge. Il y a du jugement dans cette scène, une violence, un désir brut qui n’ont rien de renoirien. La différence est immédiate : Renoir donne une chance aux personnages ; Lang les condamne. Je ne pouvais pas ne pas inscrire cette différence dans le roman, car elle est constitutive de la rencontre entre deux visions du monde et deux cultures : l’Europe d’avant-guerre et les Etats-Unis d’après-guerre.
Quant à Sebald, il intervient précisément à cet endroit : écrire depuis l’exil, être défini par le déplacement, par la perte de sa langue, de son pays, de son cinéma — c’est quelque chose qui lie Lang à toute une génération d’artistes européens passés par Hollywood. L’exergue rappelle cette expérience. Lang crée à distance de l’Allemagne, mais sans jamais s’en défaire. L’exil est un prisme à travers lequel il pense le cinéma, la violence, la culpabilité.
Le roman parle donc de migration et d’exil non seulement parce que Lang est un exilé, mais aussi parce que son cinéma est un lieu de passage entre deux cultures. C’est une histoire d’intermédialité, bien sûr, mais aussi d’interculturalité : entre l’Europe et l’Amérique, entre Zola et Hollywood, entre la tradition humaniste renoirienne et la brutalité morale de Lang. La question du transfert culturel, pour moi, fait partie de la définition même du personnage, et donc du roman. Elle est indissociable de sa manière de filmer, de penser les récits, et de lutter contre les dispositifs qui voudraient lisser ou américaniser sa vision.
6.
De Zola à Renoir, de Renoir à Lang, de Lang à Vicki et Mr Lang : c’est-à-dire d’un roman à un film, à un autre film, puis à nouveau au roman : renouez-vous avec Zola ? constitue-t-il une présence cachée de votre roman ?
Je n’ai pas voulu renouer avec Zola. D’abord parce que Zola n’est pas mon romancier préféré. La Bête humaine contient des éclats que j’aime beaucoup, mais son écriture est trop descriptive pour que j’y trouve un véritable modèle. Quand je me suis demandé si je devais intégrer des citations du roman de Zola dans Vicki et Mr Lang, je me suis rapidement rendu compte que mon écriture était trop éloignée de la sienne pour que cela fonctionne. Finalement, il n’en reste que quelques fragments, deux ou trois petites phrases que j’ai conservées comme des marqueurs — des signes d’origine, presque des balises — mais rien de plus.
Cela dit, la question ne se résume pas à un problème de style. Dès que l’on travaille sur un ensemble de versions, d’adaptations et de relectures successives, les choses deviennent beaucoup plus complexes. Il n’y a jamais de correspondance exacte entre Zola, Renoir, Lang et moi ; ce sont des œuvres qui se déplacent, qui se modifient, qui se reconfigurent au contact les unes des autres et à la finon ne sait plus très bien à qui attribuer quoi. Quand je fais cours sur des œuvres ayant connu plusieurs adaptations, je me rends compte que je ne parviens plus à me souvenir si tel détail vient du roman, du film de Renoir ou de celui de Lang par exemple.
À force de naviguer d’une adaptation à l’autre, les versions finissent par se dissoudre les unes dans les autres. Elles se recomposent dans notre mémoire en une seule grande fiction, flottante, éclatée, mais cohérente dans sa propre logique. L’auctorialité se dilue : ce qui surnage, ce ne sont ni les signatures, ni les intentions, ni les origines, mais quelques scènes, quelques images, parfois un fragment de phrase. Pour le cinéma, ce sont souvent des images très fortes, qui prennent la place de l’écrit. À partir de ces survivances, de ces noyaux, le cinéma comme la littérature recomposent une fiction nouvelle.
Zola, dans ce processus, est presque oublié — non pas parce qu’il n’est plus là, mais parce que les adaptations ont pris sa place dans l’imaginaire collectif. Les films imposent une option unique, une image dominante, et c’est elle qui finit par déterminer la manière dont on se souvient de l’histoire. On ne sait plus d’où viennent les éléments ; les limites de l’œuvre deviennent flottantes.
Ce que je fais dans Vicki et Mr Lang procède de cette logique : je m’inscris dans une chaîne, mais cette chaîne ne suppose pas une co-auctorialité. Elle produit plutôt un phénomène de dissolution des origines. Je n’ai pas collaboré avec Zola — je me situe dans un espace où les œuvres se répondent, où elles se transforment, où elles se recouvrent mutuellement. Le roman est le dernier segment d’une longue série de transformations, et ce que j’assume, c’est précisément cette circulation, ce glissement, cette dérive de l’auctorialité.
7.
Imaginez-vous une adaptation cinématographique de votre roman ?
Je n’y ai pas pensé pendant que j’ai écrit le livre. Ce serait compliqué car la reconstitution historique serait chère mais je serais très heureux si un réalisateur était intéressé.
8.
Ce qui reste finalement de votre livre, c’est de l’écriture, plus que de l’image. Une des choses frappantes, c’est le choix d’une écriture au présent. Est-ce un élément qui fait cinéma ? Fait surgir le fantôme du cinéma dans le texte ? Ce choix qui confère un étonnant effet de présence (par rapport à l’imparfait zolien) constitue-t-il un élément favorable à la conversion médiale ?
Le choix d’écrire au présent s’est imposé très tôt ; c’est même la première décision que j’ai prise. Je savais que je ne voulais pas construire une Vicki qui se souviendrait, a posteriori, de ce qu’elle avait vécu plus jeune. Il fallait prendre le personnage au moment même où elle traverse les événements, dans la conscience immédiate de l’action. Le présent permet cela : il supprime la distance, il crée un effet de présence très fort, presque de première personne.
Ce choix est étroitement lié à ce que le cinéma a de spectral. Le cinéma est un art des fantômes : filmer, c’est capter des présences qui ne sont déjà plus là, fixer des corps qui ne vivent plus, des gestes devenus des survivances. Dans un récit où il est question d’assassinat, cette idée de présence-fantôme prenait encore plus de sens. Le présent verbal permettait de faire surgir cela dans le texte, comme si les personnages, les gestes, les images passaient à travers le roman avec la même tension que dans un film.
J’ai aussi joué avec l’ekphrasis, dont on a pu dire qu’elle était caractérisée par le présent, mais de manière assez discrète. On l’oublie souvent, mais Lang était peintre à l’origine, et son rapport à la peinture est très important, même s’il le dissimule dans ses films. Je glisse cette dimension à la toute fin du roman, dans le souvenir d’un tableau aujourd’hui disparu : un Schiele qui s’appelait Résurrection, et qui était accroché dans la villa berlinoise que j’évoque. Le tableau a été perdu, il n’en reste que des traces. Le souvenir du tableau, cette image manquante, m’a permis d’articuler la question du présent et celle du fantôme : une image qui revient alors qu’elle n’existe plus, une absence qui devient présence dans le texte.
Il y a dans le livre beaucoup de citations, explicites ou dissimulées. Le texte est écrit avec d’autres textes, avec des citations filmiques et littéraires. Je prête à Lang une culture littéraire et philosophique qu’il avait peut-être — on sait qu’il fréquentait Adorno à Los Angeles — mais qui, de toute façon, m’intéressait romanesquement. Ces citations agissent comme des strates fantômes, elles aussi : elles surgissent, elles disparaissent, elles reviennent au détour d’une phrase, comme des plans superposés.
Au début, je voulais faire entrer Lang dans le roman par le doute. J’aimais l’idée qu’il commence le tournage sans être sûr de ce qu’il fait — ni de ce que les autres attendent de lui. Je l’introduis donc dans l’histoire avec une forme de réticence, de soupçon, face à lui-même autant que face aux producteurs ou aux acteurs, avec lesquels il est en conflit. Il y a là un jeu d’interpolations — entre doute, présence, flashbacks, souvenirs — qui crée une sorte de structure en cercles.
Le flashback final, le détour, est construit comme un fantôme du tournage : quelque chose qui a été vécu et qui revient autrement, dans un autre régime d’images, presque dans un autre temps.
On m’a demandé si cette réflexion sur le doute, la présence, les fantômes, valait pour l’histoire elle-même, pour le livre que le lecteur a entre les mains. Oui, peut-être, mais je considère cela comme un bénéfice secondaire. Je ne voulais pas attirer l’attention sur la dimension réflexive. Je voulais seulement que le présent fasse sentir la vibration du film — qu’il donne l’impression que les images du roman et celles du cinéma se croisent, se superposent, se hantent mutuellement.
9.
Dans quelle mesure s’agit-il d’un roman de la réparation : au départ, tout est malentendu et empêchement. Tout cloche dans cette histoire : c’est pas la bonne actrice, pas le bon scénario…
Je n’ai jamais pensé ce roman en termes de réparation. Ce n’était absolument pas mon objectif de départ. Ce que je voulais, c’était sauver l’honneur de Vicki : lui rendre une part de dignité narrative qu’elle n’a ni dans le film, ni dans la manière dont on parle habituellement d’elle. C’était cela, le geste initial.
Par ailleurs, Lang est un personnage qui m’a fasciné parce qu’il est probablement le cinéaste le plus critique que je connaisse vis-à-vis de sa propre œuvre. Dans ses entretiens, il n’a de cesse de remettre en cause ce qu’il a fait, de regretter certaines décisions, d’exprimer des doutes très forts. Cette attitude extrêmement sévère envers lui-même m’a permis de dramatiser son personnage : de le montrer obsessionnel, insatisfait, malheureux — parfois même au bord du grotesque, ce qui introduit une forme d’humour ou de décalage dans l’histoire. C’est un obsessionnel, oui, mais ce côté légèrement disproportionné lui donne du relief.
Ce qui compte pour moi, c’est que les personnages sont empêchés. Ils se heurtent à des conflits qui les traversent, mais qui ne sont jamais purement externes : ce sont des conflits qui s’intériorisent, qui prennent racine dans leurs contradictions les plus intimes. Et ce sont aussi des conflits idéologiques. Chez Lang, ils deviennent très visibles : les désaccords esthétiques ou politiques qu’il a avec Hollywood ne sont pas seulement des oppositions professionnelles, mais des tensions qui affectent sa manière d’être et de créer.
Ces conflits, ces empêchements, donnent une résonance intérieure à tout ce qui se joue entre les personnages. Ils permettent au roman de faire apparaître non seulement les tensions du tournage ou les tensions fictionnelles, mais surtout les tensions morales et psychiques qui structurent ces figures.
Donc, si l’on veut absolument parler de réparation, ce serait une réparation très indirecte : pas une réparation des faits, ni des biographies, mais simplement la possibilité de redonner une profondeur, une complexité, un espace d’écoute à des personnages qui, autrement, seraient écrasés par leur fonction dans le film. Pour moi, le roman n’est pas un correctif, mais une manière de faire entendre autrement ces voix empêchées.
10.
Même une fois le roman lu, Vicki et Mr Lang reste un titre énigmatique car on ne sait pas ce que recouvre le "et".
Le titre Vicki et Mr Lang reste énigmatique parce que je voulais justement laisser planer un doute sur ce que recouvre ce « et ». Il ne s’agit pas simplement d’une relation entre deux personnages. Ce « et » met en tension deux êtres qui, en principe, n’ont rien à voir l’un avec l’autre : un personnage fictif et un homme réel ; une jeune femme et un vieil homme ; une actrice et un cinéaste ; une figure de cinéma et une figure de légende. Tout les sépare, et pourtant j’avais envie de les coordonner, de créer une sorte d’attraction entre eux, une tension qui n’a rien d’évident.
Le « et » m’est venu en pensant à une petite nouvelle de J. M. Coetzee, He and His Man, dans laquelle Robinson, revenu en Angleterre, rencontre Defoe. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c’est que celui qui semble réel, c’est Robinson, alors que celui qui paraît le plus fictif, c’est Defoe. Il y a là un renversement vertigineux : la créature paraît plus incarnée que le créateur.
Dans mon roman, quelque chose d’analogue se produit : le personnage le plus fictif, c’est Lang. J’entends par là que Lang est un personnage saturé par sa propre légende, par les récits qu’il a faits sur lui-même, par les récits que les autres ont produits sur lui, et par l’image que ses films ont laissée dans l’histoire du cinéma. Cette accumulation produit une forme d’irréalité. Il y a chez lui une dimension de fiction qui vient de l’extérieur — de Hollywood, des biographies, des entretiens, de son propre travail de mythologie personnelle.
À l’inverse, Vicki, qui est pourtant un personnage de fiction, demeure beaucoup plus incarnée. Elle ne s’invente pas elle-même : elle se plie à ce que les autres lui donnent, elle s’abolit presque dans son rôle, dans l’espace qu’on lui assigne. C’est ce renversement qui m’intéressait : Lang, le personnage réel, devient le plus fictif ; Vicki, le personnage fictif, devient la plus réelle.
C’est aussi un moyen de troubler les frontières entre fiction et non-fiction. Je reprends ici, d’une certaine manière, une distinction d’ordre anthropologique : il ne s’agit pas de dire que la réalité se dissout dans la fiction, mais plutôt que la réalité se tisse de discours fictionnels. Lang, avec son histoire, son statut de star du cinéma classique, ses légendes contradictoires, est déjà une fiction en soi. Vicki, au contraire, est produite par le film, mais c’est une fiction qui demeure ouverte, qui peut être habitée par d’autres significations, d’autres récits, d’autres interprétations.
Le « et » du titre sert à faire tenir ensemble ces deux irréalités différentes : celle d’un personnage fictif devenu plus réel que réel, et celle d’un homme réel devenu presque entièrement fiction. Le roman se construit dans cet entre-deux, dans cette tension presque oxymorique entre deux incomparables — et c’est précisément cette coordination improbable qui m’intéressait.
L'inter-œuvre
5|2025 - sous la direction de Philippe Ortel et Vérane Partensky
L'inter-œuvre
Expérimentations contemporaines
Pratiques de la performance littéraire
Éclatement et hybridation
Instapoésie : une convergence des pôles ?
Internes de Grégory Chatonsky
Palimpseste, mosaïque, connexion
Peut-on parler d’« inter-œuvre » dans l’Antiquité romaine ?
L'œuvre mosaïque : quelques cas d’interauctorialité à la Renaissance
« Only Connect », A Humument (1966-2016) de Tom Phillips en tant qu’inter-œuvre
L'œuvre intermédiaire
De Madame Bovary à Gemma Bovery : un diptyque inter-œuvre ?
Du texte à l’œuvre murale : reconquérir l’Histoire, restaurer une aura
Personnages-théories et théories-mondes dans les fictions scientifiques