Enjeu politique et idéologique du Séminaire XI
Entre 1953 et 1979, Lacan a tenu un séminaire de psychanalyse, dont le rayonnement a largement dépassé le seul cercle des psychanalystes. Par ce séminaire, Lacan s’est imposé comme une figure majeure de la french theory. Sur les vingt-cinq séminaires tenus, quinze ont été publiés aux éditions du Seuil, par Jacques-Alain Miller. Pour les autres, des transcriptions circulent.
En 1964, Lacan ouvre son séminaire non plus à Sainte-Anne, qu’il a dû quitter sous la pression de l’Association internationale de psychanalyse, mais, sous le patronage de l’École des Hautes Études, à l’École normale supérieure. Claude Lévi-Strauss est intervenu en sa faveur et vient assister à la première séance. L’historien Fernand Braudel, Robert Flacelière, directeur de l’École normale supérieure apportent leur soutien à ce séminaire qui menaçait d’être censuré.
Mais que s’y passe-t-il de si important, de si dérangeant, pour qu’un simple séminaire, séminaire de recherche théorique destiné à un petit cercle de psychanalystes français, suscite tant d’émois et de prises de position ?
Ce qui est en jeu, c’est l’héritage de Freud, disputé entre l’école « comportementaliste » américaine, soucieuse d’expliquer simplement les phénomènes et d’apporter des traitements efficaces aux malades, et l’école française que dirige Lacan, beaucoup plus ambitieuse sur le plan théorique, mais plus prudente et même sceptique quant à l’effet thérapeutique immédiat de la cure. Lacan clame son mépris pour les naïvetés des comportementalistes, qui lui reprochent un discours sectaire, qui se serait peu à peu détourné de l’enseignement du fondateur.
Lacan riposte en proposant comme sujet du séminaire de 1964 « les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse » : inconscient, répétition, pulsion, transfert constituent les quatre grandes découvertes de Freud, que Lacan mobilise pour dénoncer les dérives et les simplifications de l’école américaine. Mais ce retour aux fondements ne trompe personne et Lacan lui-même s’en moque1 : la réinterprétation lacanienne des fondements de la psychanalyse est une véritable mise à jour structuraliste, une transposition des découvertes faites au tournant du XIXe et du XXe siècle dans le langage et avec les outils théoriques de la linguistique (Saussure, Jakobson) et de l’anthropologie structurale (Lévi-Strauss).
I. L’inconscient
L’inconscient structuré comme un langage : une formule piégée ?
C’est dans cet esprit que Lacan avait lancé une formule restée célèbre, qu’il convoquera à plusieurs reprises dans ce Séminaire XI :
« La majorité de cette assemblée a quelques notions de ce que j’ai avancé ceci — l’inconscient est structuré comme un langage — qui se rapporte à un champ qui nous est aujourd’hui plus accessible qu’au temps de Freud. Je l’illustrerai par quelque chose qui est matérialisé sur un plan assurément scientifique, par ce champ qu’explore, structure, élabore Claude Lévi-Strauss, et qu’il a épinglé du titre de Pensée sauvage2. »
L’enjeu est là, attendu par le public du séminaire, et même entendu avant même que Lacan ne s’exprime : il s’agirait de proposer une modélisation linguistique de la psychanalyse, d’utiliser l’approche structurale de la langue pour analyser l’inconscient, de présupposer dans l’inconscient une structure, et une structure qui serait celle du langage.
Pourtant, Lacan ne se réfère pas ici à Saussure, mais à Lévi-Strauss, assis devant lui pour lui apporter sa caution scientifique et permettre la tenue du séminaire malgré l’interdit de l’Association internationale de psychanalyse. L’inconscient n’est pas un langage ; il est structuré comme un langage ; et il ne s’agit pas de n’importe quel langage, mais de celui de la « pensée sauvage » des tribus primitives qu’étudie Lévi-Strauss, avec leurs mythes et leurs systèmes de parentés : une pensée d’images et de réseaux, non de discours et de lignes. Ce langage auquel l’inconscient emprunterait sa structure est un langage d’avant le langage, un langage des fondements.
Lacan ne délivre donc pas la parole attendue : comme Derrida, comme Foucault, il met bien sûr en œuvre la méthode structurale, mais, dans le même temps, il la critique radicalement, il la déconstruit. Cette critique se déploie en deux temps : d’abord par la remise en question de la causalité linéaire, aristotélicienne (cet enchaînement des causes qui définit le discours logique, et delà la rationalité de notre langage) ; puis par l’introduction d’un paradigme alternatif au discours, celui du visible, de son appréhension phénoménologique, et de la pulsion scopique qui s’y manifeste.
La clocherie de la causalité
Il faudra donc penser l’inconscient comme un langage sans causalité, ou autrement dit un langage dont la causalité est perturbée, ou encore un langage qui n’aurait rien à voir avec l’enchaînement d’un discours ordonnée. Mieux : ce langage là est le vrai langage, dont l’autre, celui du beau discours qui enchaîne les raisons, n’est qu’une surface, un leurre, une tromperie.
« chaque fois que nous parlons de cause, il y a toujours quelque chose d’anticonceptuel, d’indéfini. Les phases de la lune sont la cause des marées — ça, c’est vivant, nous savons à ce moment-là que le mot cause est bien employé. Ou encore, les miasmes sont la cause de la fièvre — ça aussi, ça ne veut rien dire, il y a un trou, et quelque chose qui vient osciller dans l’intervalle. Bref, il n’y a de cause que de ce qui cloche.
Eh bien ! l’inconscient freudien, c’est à ce point que j’essaie de vous faire viser par approximation qu’il se situe, à ce point où, entre la cause et ce qu’elle affecte, il y a toujours la clocherie.
[…] Dans cette béance, il se passe quelque chose. Cette béance une fois bouchée, la névrose est-elle guérie ? Après tout la question est toujours ouverte. Seulement la névrose devient autre, parfois simple infirmité, cicatrice, comme dit Freud — non pas cicatrice de la névrose, mais de l’inconscient. » (p. 30-31)
L’objectif du psychanalyste, c’est la recherche des causes de la névrose du patient. Mais même lorsqu’il trouve une explication, ça cloche toujours un peu. Non que l’analyse soit mal faite, le cas douteux ou plus compliqué : mais toute recherche des causes rencontre ce problème que l’explication, très abstraite (les phases de la lune, les miasmes, le trauma), ne colle pas avec le symptôme, immédiat, concret (la marée, la fièvre, la névrose). Entre la cause et la conséquence, il y a comme un trou, une béance, un quelque chose qu’on ne comprend pas.
C’est ce trou que l’analyse essaye de comprendre. Et c’est dans ce trou que se manifeste l’inconscient, à vif, comme une blessure. L’analyse tente de reboucher le trou en clarifiant les causes. Mais ce trou, il en reste toujours quelque chose, une cicatrice, qui montre qu’à cet endroit l’inconscient a été à vif, a manifesté la clocherie de la causalité.
La névrose n’est pas guérie : on a reproché à Lacan cette prudence, cette humilité. La psychanalyse n’est pas un procédé magique pour guérir les névrosés. Il s’agit plutôt d’essayer d’expliquer les choses, sans prétendre jamais parvenir à les expliquer complètement : dans l’explication, il restera toujours de la clocherie.
Il faut mettre en parallèle ce questionnement lacanien de la causalité dans la cure psychanalytique avec la déconstruction de l’origine dans De la grammatologie de Derrida. Pour Derrida, qui lui-même retravaille les développements de Husserl dans L’Origine de la géométrie, la linguistique saussurienne s’est développée à partir d’un présupposé qu’il dénonce, le présupposé classique, rousseauiste, de l’origine des langues : l’humanité aurait inventé des langues, de plus en plus abstraites, puis une écriture pour transcrire ces langues, écriture conçue elle-même comme un système de signes de plus en plus abstrait. Mais la langue n’a pas du tout préexisté à l’écriture, qui elle-même n’est pas du tout une transcription transparente de la langue. Tout est écriture, l’écriture est toujours déjà là, avec sa logique propre qui diffère de celle de la langue, et fait travailler, entre les deux, un différance. Cette différance qui déconstruit l’idée même d’origine et établit, entre la langue et l’écriture, une perturbation logique, une sorte d’articulation impossible et en même temps un principe d’organisation, ne procède-t-elle pas de la même démarche intellectuelle que la clocherie de la causalité lacanienne, qui déconstruit l’origine de la névrose, et la transparence de la névrose par rapport à cette origine, en lui substituant l’image du trou, de la béance, puis de ma cicatrice ?
A partir de l’interrogation linguistique sur les rapports de la langue et de l’écriture, Derrida étend son investigation, avec Lévi-Strauss et Rousseau, au fonctionnement même de la pensée, qui ne procède pas par déductions mais par manques et par suppléments. Ces manques, ces béances, ces clocheries qui habitent non seulement toutes les formes du discours, mais, de là, toutes les structures sociales, sont comblés, bouchés tant bien que mal par des suppléments, c’est-à-dire des éléments de fonctionnement hétérogènes, qui, par leur hétérogénéité même, ne viennent pas seulement à la place de ce qui manquait, mais en plus. Le modèle du supplément, c’est l’écriture : quand le langage fait défaut (la personne n’est pas là pour le dire, la mémoire défaille), l’écriture lui supplée (on lit la parole des absents et des morts, on consigne contre l’oubli), mais dénature, déplace ce qu’elle prétend fixer ; parole artificielle, parole morte, parole à laquelle on ne peut répondre. Derrida repère ce modèle chez Rousseau, notamment dans sa critique de la corruption des mœurs par le développement des sciences et des arts, et chez Platon, où Socrate dénonce dans le Phèdre, avec le mythe de Thot, l’invention de l’écriture comme corruption de la mémoire et perte de la présence.
Cette logique derridienne du supplément (l’écriture suppléant la parole vive, la technique suppléant la nature), Lacan va la développer à partir d’un tout autre paradigme, celui de l’écran.
L’écran lacanien
En psychanalyse, l’origine qu’il s’agit de déconstruire, ce n’est pas l’origine de la, ou des langues, mais l’origine, ou ce que Freud désigne plus savamment comme l’étiologie des névroses. Si le patient est névrosé, c’est qu’il a subi un traumatisme, un trauma, un choc dont il ne s’est jamais remis. Ce choc, Lacan le définit fondamentalement comme rencontre avec le réel, et reprend pour cela le mot grec employé par Aristote dans la Physique : τύχη3.
Qu’apporte la référence à Aristote ? Dans la Physique, Aristote articule tuchè, la rencontre de deux objets, le choc (pour Lacan le trauma), à automaton, la force d’inertie, le fait que le mouvement se poursuit de lui-même, automatiquement : pour Lacan, la répétition. Le monde physique d’Aristote différencie les mouvements qui se perpétuent sur leur lancée de ceux qui bifurquent, naissent, se transforment à partir du hasard d’une rencontre.
Tuchè, c’est donc l’origine, la cause qui déclenche chez le patient le mécanisme de la répétition : une phobie, un cauchemar, une situation qui se répète interminablement pour le patient, toujours comme par hasard, et constitue sa névrose. Le problème, c’est qu’entre l’origine qui expliquerait tout, donc l’élucidation apporterait la guérison, et la névrose elle-même, il y a toujours la clocherie de la causalité.
« La fonction de la tuché, du réel comme rencontre — la rencontre en tant qu’elle peut être manquée, qu’essentiellement elle est la rencontre manquée — s’est d’abord présentée dans l’histoire de la psychanalyse sous une forme qui, à elle seule, suffit déjà à éveiller notre attention — celle du traumatisme.
N’est-il pas remarquable que, à l’origine de l’expérience analytique, le réel se soit présenté sous la forme de ce qu’il y a en lui d’inassimilable — sous la forme du trauma, déterminant toute sa suite, et lui imposant une origine en apparence accidentelle ? […] au sein même des processus primaires, nous voyons conservée l’insistance du trauma à se rappeler à nous. Le trauma y reparaît en effet, et très souvent à figure dévoilée. Comment le rêve, porteur du désir du sujet, peut-il produire ce qui fait surgir à répétition le trauma — sinon sa figure même, du moins l’écran qui nous l’indique encore derrière ? (p. 65-66)
Cette « insistance du trauma » dans le rêve et dans le fantasme est illogique, comme un morceau de réel coincé dans le matériau imaginaire, pris dans ses rets. Le trauma est à l’origine de cette production névrotique et en même temps il est en quelque sorte ce qu’elle produit, ce qu’elle figure : dans la chaîne causale, il est à la fois une origine et un aboutissement.
En fait, à vrai dire, nous n’accédons pas au trauma proprement dit, mais à ses représentations, à ses figures : ce que nous voyons dans le rêve, dans le récit du patient, dans la névrose qui se développe, c’est « du moins l’écran qui nous l’indique encore derrière ». L’écran désigne le trauma, mais le cache en même temps ; l’écran supplée ce qui devrait se trouver là comme trauma, mais se manifeste plutôt comme béance, trou, clocherie de la causalité.
Mais ce trou et ce supplément ne sont pas désignés ici comme des artefacts logiques (des contradictions dans le raisonnement) ; ils sont figurés dans l’espace, comme une scène avec son paravent : derrière le paravent, l’écran, quelque chose se passe et se repasse, qu’on ne voit pas, et que l’écran qui le cache finit par désigner.
La notion d’écran va devenir la notion centrale du Séminaire XI, car elle permet d’introduire une nouvelle pulsion à laquelle Lacan va donner une importance décisive, la pulsion scopique. Mais, si le mot n’apparaît pas avant, l’idée en a été préparée au Séminaire VIII sur le transfert (1960-1961), à partir de l’analyse d’un tableau d’Antonio Zucchi représentant Psyché.
Psyché, ou l’angoisse de castration : l’aphanisis
Jacopo del Zucchi, Psyché découvre Éros, 1589, huile sur toile, 173x130 cm, Rome, Galerie Borghèse
C’est un véritable topos iconographique : Zucchi a représenté le moment où Psyché, en proie au doute et à l’angoisse après les insinuations calomnieuses de ses sœurs, approche une lampe à huile du corps de son amant endormi, malgré l’interdiction formelle qu’il lui a faite. Au lieu du monstre que ses sœurs lui ont fait craindre, elle découvre le corps parfait d’Eros, mais laisse tomber une goutte d’huile bouillante qui la trahit.
Zucchi introduit quelques variantes dans la scène. Tout d’abord, il arme Psyché d’un sabre, à la manière de Judith s’apprêtant à décapiter Holopherne dans sa tente, un épisode biblique très populaire également chez les peintres maniéristes. Ensuite, ce n’est pas le visage d’Eros que Psyché fixe du regard, mais son sexe, que le peintre a dissimulé derrière un vase de fleurs. Enfin, à y regarder de près, les fleurs ne dissimulent rien : Eros n’a pas de pénis.
Dans ce tour de passe passe maniériste, Lacan voit la figuration même du complexe de castration, qui n’est pas, comme on l’exprime parfois naïvement, la hantise du pénis coupé, mais, plus subtilement, le mouvement de regarder le pénis à l’endroit où il manque, et, par ce mouvement, la prise de conscience que la fonction phallique, c’est cette disparition, ce qui disparaît à l’endroit où il était apparu, ce qui apparaît et disparaît. Lacan donne à cette apparition-disparition, qui caractérise la fonction phallique, un nom grec : ἀφάνισις (aphanisis, littéralement disparition). Parce que le pénis manque là où on le regarde, il cesse de se définir comme une chose du réel pour devenir une fonction4, et par là introduire le registre symbolique. L’endroit du manque est désigné par le bouquet, qui lui fait écran au moyen d’une figure, d’une composition, de la composition du bouquet :
« Ce symbole, Φ, la dernière fois et bien des fois avant, je l’ai désigné brièvement, je veux dire d’une façon rapide et abrégée, comme symbole à la place où se produit le manque de signifiant. […] Voyez ce bouquet de fleurs, là au premier plan. Sa présence est faite pour recouvrir ce qui est à recouvrir, et dont je vous ai dit que c’était moins le phallus menacé de l’Éros […] que le point précis d’une présence absente, d’une absence présentifiée.
[…] C’est là que surgit le privilège de Φ entre tous les signifiants. […] Ce signifiant est toujours caché, toujours voilé. […] Le rapport innommé, parce que innommable, parce que indicible, du sujet avec le signifiant pur du désir se projette sur l’organe localisable, précis, situable quelque part dans l’ensemble de l’édifice corporel5. »
Il s’agit toujours de la même clocherie de la causalité, ramenée à un rapport originaire, « du sujet avec le signifiant », ou autrement dit au rapport que chacun d’entre nous entretient avec le langage, rapport dont l’origine remonte au moment où la parole est sortie de notre corps, comme expression corporelle de notre désir. Le désir est un mouvement vers ce qui manque, et la première expression du manque, dont toutes les autres seront dérivées, est celle de l’organe du plaisir en tant qu’il ne donne pas tout le temps satisfaction, qu’il manque. Le premier signifiant désigne ce manque premier, qui est le manque de signifiant : il vient pour dire qu’il n’y a pas de mot pour le dire.
Ce moment est celui du complexe de castration, et c’est ce que représente l’épisode de Psyché : Psyché, en grec l’âme, affronte la vue d’Eros, en grec le désir. Psyché c’est le sujet découvrant, produisant Φ.
Il est bien question ici de signifiant, d’une origine à partir de laquelle embrayer le déploiement des chaînes signifiantes. Mais c’est un tableau qui en détermine non exactement la logique, mais plutôt la topologie : derrière l’écran du vase de fleurs, l’œil surprend l’aphanisis phallique, le sexe en tant qu’il est ce qui disparaît, ce qui manque et d’où naît le désir.
II. La répétition
Fonction scopique : l’enjeu épistémologique6
Le tableau n’est pas seulement une métaphore, un instrument pédagogique dans l’exposé des « concepts fondamentaux ». Le tableau traduit le changement de paradigme : au moment même où la logique du signifiant se répand et se généralise comme principe de modélisation dans l’ensemble des sciences humaines, y compris la psychanalyse, cette logique est elle-même contaminée, retournée, déplacée du langage vers l’image, et dans le cadre de la psychanalyse d’une conception du patient comme porteur, producteur de discours constituant le matériau d’analyse privilégié, vers une conception du patient comme pris dans un tableau, faisant tableau, s’inscrivant, dans l’espace, dans une topologie à laquelle on accède d’abord par le regard.
Il n’est pas sûr que ce déplacement soit pleinement conscient et assumé de la part de Lacan. Tout commence avec cette modélisation du complexe de castration par la Psyché de Zucchi. En apparence, il s’agit de reformuler la découverte freudienne de l’Œdipe à la lumière du structuralisme : l’enjeu du complexe n’est plus présenté comme le rapport du fils à son père, mais comme l’accès au signifiant, par l’intermédiaire de Φ, le signifiant de l’absence de signifiant, le bouquet qui fait écran au sexe manquant d’Eros. Mais au-delà de cette reformulation par le signifiant, ce n’est pas seulement un tableau qui est convoqué (plutôt qu’un mythe, ou qu’une tragédie), mais dans ce tableau un regard, le regard de Psyché, l’âme, de toute âme, de tout sujet, porté sur le corps d’Eros, le corps du désir, en tant que dans ce corps du désir il manque quelque chose. Le regard est le moteur du complexe de castration, il définit le processus par lequel le sujet accède au signifiant ; il définit le dispositif dans lequel émerge Φ, c’est-à-dire le tableau, le bain d’images, le manque dans ce bain, à partir duquel une parole, un discours advient.
Ce n’est donc pas seulement la circonstance de la mort de Maurice Merleau-Ponty (mai 1961) et de la parution posthume, pendant ce séminaire de 1964, de son dernier ouvrage inachevé, Le Visible et l’invisible, qui motive conjoncturellement ce que Lacan désigne comme une digression dans son exposé des quatre concepts fondamentaux7. Dès le séminaire sur le transfert, et même avant lui avec l’expérience dite du « Bouquet renversé »8, le paradigme visuel est introduit au cœur de la modélisation, et la fonction scopique mise en avant comme fonction motrice de toutes les autres, ou plus exactement comme fonction à partir de laquelle accéder à la compréhension de toutes les autres. La digression annoncée s’avère constituer un véritable basculement épistémologique.
Avec Psyché, le regard constituait un événement unique, figurait un changement de stade dans l’évolution du sujet, l’accès au complexe de castration. Ici, dans le Séminaire XI, le regard devient la figure même de la répétition : non plus d’un accident, d’un événement, mais du fonctionnement même du sujet dans le temps long en tant que, dans le sujet, toujours une névrose est au travail. Pour expliquer la répétition, Lacan reprend une anecdote rapportée par Freud dans Au delà du principe de plaisir (1920)9.
Le fort-da : définition de l’objet a
Freud observe que son petit fils Ernst, âgé d’un an et demie, a pris l’habitude de jouer avec une bobine reliée à un fil. Il jette cette bobine loin de lui en prononçant o-o-o-o (pour fort, va-t-en en allemand, ou dort, parti), puis il la ramène avec un joyeux a-a-a, que Freud interprète comme da, [viens] ici, ou [elle est revenue] ici.
Notez le point de départ de l’analyse : Freud interprète un phénomène apparemment incompréhensible en ramenant du son, des onomatopées, à du langage, à un discours articulé, qui va permettre d’introduire un système d’oppositions ; ce qui est loin s’oppose à ce qui est près, ce qui échappe au contrôle à ce qui est repris en mains. La modélisation linguistique est ce qui permet d’enclencher le processus d’interprétation.
Pour Freud, l’enfant, par ce jeu de la bobine, répète sous une forme atténuée, acceptable, plaisante même, l’expérience malheureuse, inquiétante, angoissante, du départ de sa mère, vécue non comme une absence temporaire, mais comme une disparition absolue (il n’y a peut-être rien derrière la porte de la chambre), et même comme une auto-mutilation : il n’y a pas encore, en effet, de séparation nette, dans l’esprit de l’enfant, entre le corps de la mère et son corps propre. Sur le départ réel de la mère, l’enfant n’a pas de prise ; sur le départ de la bobine dans le jeu, l’enfant est le maître.
La forme que prend le jeu est d’autant plus remarquable qu’Ernst se contente bien souvent de la première partie du jeu, du fort. Il n’est pas besoin du retour de la bobine pour se rassurer : la répétition seule de la perte, voulue et non subie par l’enfant, ouvre la voie d’une maîtrise du trauma, du choc, de la tuchè. Bientôt, le jeu de la bobine est remplacé, durant les longues absences de la mère, par un autre jeu, avec le miroir. L’enfant se place devant lui, puis s’accroupit de façon que son image quitte la glace : il se fait disparaître lui-même. Ce petit manège confirme que l’angoisse face au départ de la mère recouvre une angoisse plus profonde, où l’intégrité même de l’enfant, comme sujet, se trouve menacée ; un peu de l’enfant part avec la mère ; l’angoisse que doit conjurer la répétition est l’angoisse de la castration.
La répétition manifeste ici son ambivalence : au delà du principe de plaisir, la pulsion de mort pousse le sujet vers sa propre destruction, qui est l’entropie ultime, le retour à la stabilité de l’inanimé. Mais, à rebours, la répétition est mise en œuvre comme ressource du sujet pour conjurer l’angoisse de la castration et préserver, ou réparer sa structure de sujet :
« Freud, lorsqu’il saisit la répétition dans le jeu de son petit-fils, dans le fort-da réitéré, peut bien souligner que l’enfant tamponne10 l’effet de la disparition de sa mère en s’en faisant l’agent — ce phénomène est secondaire. Wallon le souligne11, ce n’est pas d’emblée que l’enfant surveille la porte par où est sortie sa mère, marquant ainsi qu’il s’attend à l’y revoir, mais auparavant, c’est au point même où elle l’a quitté, au point qu’elle a abandonné près de lui, qu’il porte sa vigilance12. La béance introduite par l’absence dessinée13, et toujours ouverte, reste cause d’un tracé centrifuge14 où ce qui choit, ce n’est pas l’autre en tant que figure où se projette le sujet, mais cette bobine liée à lui-même par un fil qu’il retient — où s’exprime ce qui, de lui, se détache dans cette épreuve, l’automutilation à partir de quoi l’ordre de la signifiance va se mettre en perspective15.
[…] S’il est vrai que le signifiant est la première marque du sujet16, comment ne pas reconnaître ici — du seul fait que ce jeu s’accompagne d’une des premières oppositions à paraître17 — que l’objet à quoi cette opposition s’applique en acte, la bobine, c’est là que nous devons désigner le sujet. A cet objet, nous donnerons ultérieurement son nom d’algèbre lacanien — le petit a. » (p. 72-73)
On remarque tout de suite dans le développement de l’analyse lacanienne, le changement du principe de modélisation par rapport à Freud : ce qui compte, ce n’est plus la prise de contrôle du réel par la parole, ce n’est plus la vocalisation par l’enfant et l’interprétation par l’analyste du fort-da derrière le o-o-o / a-a-a. Lacan repère un dispositif de surveillance, ce que l’enfant fixe du regard : l’enfant fixe du rien, et ce rien symbolise la mère disparue, la bobine tombée. Cette symbolisation à partir d’un manque, d’une absence, constitue le premier maillon de la chaîne signifiante, le point d’accès pour l’enfant au langage, Φ.
Mais déjà Φ n’est plus l’important. Ce qui compte, c’est ce que Φ instaure, l’enfant comme sujet, placé devant un objet disparu, chu, devant un manque à la place de cet objet. Cet objet, c’est l’objet a. Il entre dans ce que Lacan désigne comme son algèbre, c’est-à-dire la série de formules quasi mathématiques qui représentent, dans le langage de la pensée sauvage, les structures ou plutôt les dispositions fondamentales de l’inconscient. Ici :
$ ⇄ a
Autrement dit : l’œil de l’enfant fixe l’endroit où l’objet de son désir a disparu. Cet objet se définit alors comme apparition-disparition de l’objet du désir, autrement dit comme objet petit a. a est ce qui existe d’abord sur le schéma : ce statut a de l’objet fixé par l’œil de l’enfant constitue l’enfant comme sujet, conscient d’exister séparément de la mère, $. Une relation s’établit alors, à rebours, de a vers $ : $ à son tour, non comme œil, mais cette fois comme sujet séparé, regarde a.
L’objet a va dès lors devenir le concept fondamental dans la théorie lacanienne, à la place de la répétition. Or qu’est ce que ce a, sinon le supplément de Derrida, et qu’est-ce que la réinterprétation lacanienne du fort-da, sinon sa modélisation comme dispositif de surveillance, dont Foucault, délibérément ou non, s’inspirera pour penser la prison dans Surveiller et punir ?
La répétition s’ordonne comme un dispositif dans lequel le sujet organise sa coupure d’avec lui-même : coupure, ou autrement dit schize, ou encore Spaltung. D’un côté, il se constitue comme $, sujet séparé ; de l’autre, il place l’objet a hors de sa vue, en position de disparition. L’enjeu est le contrôle et la normalisation du corps, dont Foucault ne décrira plus tard qu’une variante démesurément grossie dans la discipline scolaire, militaire, hospitalière et pénitentiaire qui, soumettant les corps à l’exercice, les reconnaît et respecte comme sujets, mais les sépare de leur singularité dévoyée, indisciplinée, malade, les isole en cellule, les (r)amène à la règle commune.
Priorité au réel : le rêve de l’enfant qui brûle
L’invention de l’objet a marque donc d’abord un déplacement dans la modélisation de l’inconscient et de la répétition : l’ancien modèle structural et linguistique est peu à peu parasité par une modélisation visuelle et iconique, qui place la pulsion scopique au centre de toutes les pulsions.
Mais on n’assiste pas seulement à un changement de paradigme (du langage vers l’image) dans la modélisation. On ne recherche plus la même chose : l’objet de la psychanalyse se déplace du désir vers le réel. Analysé par Freud, le petit Ernst, par la bobine ramenée à lui grâce au fil, accomplissait dans le jeu son désir de ramener sa mère à lui. Pour Lacan, la bobine ne ramène pas la mère, mais, en tant qu’objet a, la désigne comme absente et indique ce trou dans la représentation : où elle est, la mère n’est pas.
A l’origine de ce que l’inconscient produit, dans le rêve, dans la névrose, dans le jeu, l’objet a ne désigne pas ce que le sujet désire (déjà une figure, un discours, l’expression d’une demande), mais la béance du réel, la réalité du manque. Ce qui compte dans l’analyse, ce n’est pas une hypothétique satisfaction imaginaire du désir par un artefact ; c’est cette réalité qui se trouve derrière a et désignée par lui.
Dans cette perspective, Lacan réinterpète le rêve de l’enfant qui brûle, évoqué par Freud dans La Science des rêves (Traumdeutung) :
« Rappelez-vous ce malheureux père, qui a été prendre, dans la chambre voisine où repose son enfant mort, quelque repos […] et qui se trouve atteint, réveillé par […] la réalité même d’un cierge renversé en train de mettre le feu au lit où repose son enfant.
Voilà quelque chose qui semble peu désigné pour confirmer ce qui est la thèse de Freud dans la Traumdeutung — que le rêve est la réalisation d’un désir.
[…] La question qui se pose, et qu’au reste toutes les indications précédentes de Freud nous permettent ici de produire, c’est — Qu’est-ce qui réveille ? N’est-ce pas, dans le rêve, une autre réalité ? […] que l’enfant est près de son lit […], le prend par le bras, et lui murmure sur un ton de reproche, […] Père, ne vois-tu pas que je brûle ?
Il y a plus de réalité, n’est-ce pas, dans ce message, que dans le bruit, par quoi le père aussi bien identifie l’étrange réalité de ce qui se passe dans la pièce voisine. Est-ce que dans ces mots ne passe pas la réalité manquée qui a causé la mort de l’enfant ? » (p. 68)
L’enjeu du rêve n’est pas le désir du père, mais la réalité immédiate de l’incendie, et derrière elle la réalité médiate de la fièvre et de la mort de l’enfant : « je brûle »(ich verbrenne) peut se comprendre au propre, avec le début d’incendie provoqué par le cierge, et au figuré, comme le front brûlant de l’enfant rongé par la fièvre avant de mourir, et qu’alors le père n’a pas secouru. Ce que le père rêve donc d’abord, ce sont ses quatre vérités.
Mais là où Freud repère une condensation par le mot « je brûle », un mécanisme linguistique donc, Lacan va insister sur le dispositif visuel du rêve, qui interpose entre le père endormi et la chambre attenante où débute un incendie la vision de l’enfant debout devant lui et lui secouant le bras. Derrière, il y a l’Autre, l’enfant mort, inaccessible ; devant, cette vision est l’objet a du rêve, image de l’enfant, vivante, familière, poignante, qui renvoie à cette réalité qu’il n’est plus là, que le père ne le voit pas, ne l’a pas vu.
C’est une vision, une figure donc, d’où jaillit le signifiant du rêve (« Père, ne vois-tu pas que je brûle ? ») ; mais c’est en même temps un éblouissement, de la lumière, du feu qui aveugle et barre le regard du père : apparition du signifiant et disparition de l’image, aphanisis.
« le rêve, nous le voyons maintenant comme l’envers de la représentation — c’est l’imagerie du rêve, et c’est occasion pour nous d’y souligner ce que Freud, quand il parle de l’inconscient, désigne comme ce qui le détermine essentiellement — le Vorstellungsrepräsentanz, […] le tenant-lieu de la représentation.
[…] La place du réel, qui va du trauma au fantasme — en tant que le fantasme n’est jamais que l’écran qui dissimule quelque chose de tout à fait premier, de déterminant dans la fonction de répétition — voilà ce qu’il nous faut repérer maintenant. […] l’autre réalité cachée derrière le manque de ce qui tient lieu de représentation — c’est le Trieb, nous dit Freud. » (p. 70-71)
Le réel (la mort de l’enfant) constitue l’objet du rêve ; pour autant, le rêve n’en assure pas la représentation, tout au contraire ; il en exprime le caractère scandaleux et innommable. Le rêve produit un supplément de représentation, Vorstellungsrepräsentanz : c’est l’enfant qui brûle. Encore ce supplément se manifeste-t-il comme manquant : « Père, ne vois-tu pas que je brûle ? » Le père qui rêve se rêve ne l’ayant pas vu, et derrière ce « manque de ce qui tient lieu de représentation », se met en rapport avec « quelque chose de tout à fait premier », le Trieb, autrement dit la pulsion, qui n’est pas l’expression d’un désir, mais ce qui du réel se manifeste au sujet comme poussée.
Entre le sujet rêvant et l’objet du rêve, s’intercale un écran, comme le bouquet entre Psyché et Eros, comme la bobine chue entre Ernst et la porte par où sa mère a disparu. L’écran, la vision du rêve, l’objet a, est une interface : derrière lui, depuis le réel, la poussée de la pulsion ; devant lui, depuis le sujet, cet aveuglement, ou éblouissement, qui paralyse la vue.
III. La pulsion
Le regard comme objet a : Les Ambassadeurs de Holbein
Pour imager l’ambivalence fonctionnelle de cet écran, son rôle de séparation dans le double mouvement du regard, Lacan recourt à un tableau qui va devenir l’emblème du Séminaire XI. Ce sont Les Ambassadeurs de Holbein, conservés actuellement à la National Gallery de Londres.
Hans Holbein, dit le jeune, Les Ambassadeurs, 1533, huile sur bois, 206x209 cm, Londres, National Gallery
Holbein est un peintre allemand qui travaille à Londres, à la cour de Henri VIII. En 1533, il reçoit commande de Jean de Dinteville pour ce tableau qui était destiné au château de Polisy. Il s’agit d’un double portrait en pied de Jean de Dinteville et de Georges de Selve. Le premier, ambassadeur de François Ier auprès de Henry VIII de février à novembre 1533, richement vêtu, arbore la médaille de l’ordre de Saint-Michel ; à droite, Georges de Selves, évêque de Lavaur et ambassadeur auprès du pape, était venu rendre visite à Jean de Dinteville dans le cadre d’une mission de médiation entre l’Angleterre et Rome, qui refusait son agrément au mariage du roi d’Angleterre avec Anne Boleyn.
C’est un tableau d’apparat, qui fait étalage de la magnificence des personnages, dans la lignée des manifestations de puissance du Camp du Drap d’Or (1520) : le riche pavement ici représenté avait été réalisé en 1268 pour l’abbaye de Westminster par un artiste romain, Odoricus. Les objets disposés sur les deux étagères du fond récapitulent les sciences du quadrivium humaniste : la musique (luth, flûtes, partition de cantiques), l’arithmétique (traité de Peter Apian, 1527), la géométrie et l’astronomie (globe terrestre, horloge solaire cylindrique, quadrant blanc mesurant l’altitude à partir de l’ombre, cadran solaire polyédrique, torquetum). Utime rafinement : la date de la rencontre est indiquée par l’horloge solaire cylindrique posée à droite sur l’étagère supérieure, 11 avril 1533 à 9h30 (ou 10h30).
Pourtant, au premier plan de cette exhibition somme toute assez convenue, Holbein a ajouté un objet étrange, que le spectateur a d’abord bien du mal à identifier :
« Comment-se fait-il que personne n’ait jamais songé à y évoquer… l’effet d’une érection ? […] Comment ne pas voir ici, immanent à la dimension géométrale — dimension partiale dans le champ du regard, dimension qui n’a rien à voir avec la vision comme telle — quelque chose de symbolique de la fonction du manque — de l’apparition du fantôme phallique ?
[…] Commencez à sortir de la pièce où sans doute il vous a longuement captivé. C’est alors que, vous retournant en partant — comme le décrit l’auteur des Anamorphoses18 — vous saisissez sous cette forme quoi ? — une tête de mort.
[…] Tout cela nous manifeste qu’au cœur même de l’époque où se dessine le sujet et où se cherche l’optique géométrale, Holbein nous rend ici visible quelque chose qui n’est rien d’autre que le sujet néantisé, […] l’incarnation imagée du moins phi [(-φ)] de la castration, laquelle centre pour nous toute l’organisation des désirs à travers le cadre des pulsions fondamentales. » (p. 102)
L’anamorphose de Holbein est une tête de mort dont la perspective a été déformée. On comprend le message, qui est celui de toutes les peintures de Vanités : les ambassadeurs représentent les puissances de ce monde et en font éclater la magnificence ; mais si puissants soient les puissants, la mort est plus puissante qu’eux. Le message est peut-être non seulement moral et spirituel, mais politique, au moment où Henri VIII, souverain temporel, défie le pape : c’est vers l’évêque de Lavaur que pointe le crane.
A ce message délibéré, rhétoriquement cadré, Lacan oppose cependant une seconde lecture qui, dans le même esprit que sa réinterprétation du rêve de l’enfant qui brûle, déplace l’accent de la mécanique, de la structure discursive de la représentation (une vanité) vers l’effet visuel immédiat et la réalité que cet effet sollicite pour l’œil : sans plus nous préoccuper de perspective déformée, ni de contexte politique ou religieux, que voyons-nous immédiatement ? Ni crane, ni même os de seiche, mais une érection, l’obscénité comique, irrépressible, d’un pénis en pleine action !
Entre l’œil du spectateur et l’objet de la représentation, les ambassadeurs, ce crane-pénis fait écran, dans sa double fonction que Lacan caractérise ailleurs comme aphanisis : du réel, l’écran renvoie vers l’œil l’expérience d’une béance, d’un manque, d’une disparition (la tête de mort), qui initie le complexe de castration et définit celui qui regarde comme sujet. Depuis le sujet au contraire, l’écran introduit, vers l’objet, la poussée, l’orientation du regard désirant, et le jeu du phallus que porte la fonction scopique.
Dans ce va-et-vient fondamental du regard (l’œil voit moins phi, la béance de l’aphanisis, qui à son tour le constitue comme sujet regardant, $, qui à son tour circonscrit de son regard et désigne un objet), le pivot du processus est l’objet a, c’est-à-dire, dans Les Ambassadeurs, l’anamorphose. Je la vois, mais elle me regarde, et c’est conscient de son regard que je regarde le tableau. Le premier temps du « je la vois » n’est pas encore du regard : c’est ce que Lacan désigne comme l’apparition du fantôme phallique dans la dimension géométrale.
La dimension géométrale
Qu’est-ce que la dimension géométrale ? Le terme n’est pas très courant, et pourrait résonner comme un néologisme lacanien. Il n’en est rien. On devine un lien avec la géométrie et on en est tenté d’en déduire un peu rapidement que la dimension géométrale permet de repérer les objets dans l’espace. C’est en fait un petit peu plus subtil.
La notion de plan géométral relève des expériences et se rencontre dans les méthodes pour établir la perspective. On la rencontre dans les traités au moins à partir du XVIIIe siècle. D’Alembert, à l’article Géométral de l’Encyclopédie (1757), écrit :
« On appelle ainsi la représentation d’un objet faite de maniere que les parties de cet objet y ayent entre elles le même rapport qu’elles ont réellement dans l’objet tel qu’il est ; à la différence des représentations en perspective, où les parties de l’objet sont représentées dans le tableau avec les proportions que la perspective leur donne. » (VII, 626)
Autrement dit, le plan géométral est une représentation de l’espace en deux dimensions, mais sans la déformation qu’implique une représentation en perspective. C’est le degré zéro de la représentation : une carte, un schéma, une projection orthographique. D’Alembert renvoie notamment à l’article Perspective, où le chevalier de Jaucourt, plus vague, écrit :
« on appelle plan géométral un plan parallele à l’horison, sur lequel est situé l’objet qu’on veut mettre en perspective. »
Le plan géométral est donc une surface au sol sur laquelle on reporte point par point les proportions réelles de l’objet, sa modélisation géométrique, avant de les déformer dans un second temps pour produire, pour l’œil, un effet de perspective. Jean-Henri Lambert insiste sur ces deux étapes :
« dans la plus part des Cas, on dessine géometriquement les figures, qu’on veut peindre, avant que de pouvoir les mettre en perspective. Au moien de ce plan géometral ces regles sont universelles, & dans les cas moins compliqués elles admettent diverses reductions, qui abregent le travail. Mais outre qu’elles ne sufisent pas, pour peindre des Objets quelconques indépendamment du plan géometral, elles exigent nombre de lignes superflues, dont on souhaiteroit de se voir débarassé » (La Perspective affranchie de l’embaras du plan géometral, Zuric, chez Heideggueur et Comp., 1759, §4, p. 3).
Le plan géométral, c’est la structure objective de l’objet en soi, avec ses proportions internes gouvernées par les règles universelles de la géométrie. Ce que la déformation perspective y introduit, c’est la subjectivité d’un point de vue, c’est-à-dire, dans le champ visuel, la dimension du sujet qui est à l’origine du regard. Contre la lourdeur mécanique, l’« embarras » du plan géométral, avec ses « lignes superflues », Lambert promeut les raccourcis intuitifs, l’intelligence immédiate et sensible de la perspective, autrement dit les prérogatives du sujet regardant.
Le géométral, ce n’est donc pas directement le réel, mais sa modélisation structurale, mécanique, automatique. Comment Lacan s’approprie-t-il cette notion, dans l’héritage critique des Lumières ?
Il en retient deux éléments : tout d’abord, le géométral définit une représentation de l’objet avant sa mise en perspective ; il établit donc le visible, mais l’établit du dehors, en amont de ce que, comme sujet, je regarde. Ensuite, le géométral définit, sur le plan où il en reporte les proportions, une structure géométrique de l’objet. A cette structure pré-visuelle, objective, lourde, illisible, Lacan va opposer l’approche phénoménologique du visible, intuitive, immédiate et immergée, dans laquelle définir la dialectique du sujet et du scopique, du je vois et du ça me regarde. C’est cette dialectique qui l’intéresse, parce que par elle, que chacun d’entre nous peut appréhender dans son expérience quotidienne du regard, on accède au complexe de castration et, de là, au fonctionnement général de l’inconscient, de la répétition et de la pulsion.
Le géométral se tient en dehors, en amont de cette dialectique : par la dimension géométrale, Lacan désigne ce qui, dans le regard, ou juste avant le regard, n’est pas lacanien.
Du géométral au scopique : retournement « en doigt de gant », chiasme du visible
Ce qui est assez unique dans l’anamorphose des Ambassadeurs, c’est qu’elle fonctionne à la fois dans la dimension géométrale et comme mise en œuvre de la fonction scopique, ou, autrement dit, à la fois comme objet en soi et comme objet déformé, et cela à différents niveaux : dans son aspect d’abord, on peut la voir comme un os de seiche ou comme une tête de mort ; dans la dynamique de sa forme ensuite — comme apparition-disparition, et donc déformation, ou comme néantisation, et donc fixation, immobilisation. Mais Lacan ne s’arrête pas à cette polarité structurale de la forme et de l’informe, du formel et du déformé. Il insiste plutôt sur un mouvement :
« Commencez à sortir de la pièce où sans doute il vous a longuement captivé. C’est alors que, vous retournant en partant […] vous saisissez sous cette forme quoi ? — une tête de mort19. »
On ne reste pas immobile au musée face à un tableau, ni dans la vie face à ce qui fait tableau. On en sort, on se retourne en partant et on y revient, mais sous un autre angle. Le tableau nous captive, nous le quittons, nous y revenons pour le regarder d’un autre point de vue. C’est dans le mouvement de cette réversion que se révèle le sens de l’anamorphose, une chose illisible, puis une tête de mort, un plan géométral, puis un plan en perspective, l’expérience de l’aphanisis, puis le complexe de castration.
Lacan étaye cette modélisation du regard comme réversion par l’analyse phénoménologique qu’en propose au même moment le livre posthume de Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l’Invisible.
« Dès que je vois, il faut que la vision soit doublée d’une vision complémentaire ou d’une autre vision : moi-même vu du dehors, tel qu’un autre me verrait, installé au milieu du visible […]. Celui qui voit ne peut posséder le visible que s’il en est possédé, s’il en est, […] s’il est l’un des visibles, capable, par un singulier retournement, de les voir, lui qui est l’un d’eux. (Le Visible et l’invisible, « L’entrelacs – le chiasme », Tel Gallimard, pp. 177-178.)
Merleau-Ponty renverse ici une modélisation multiséculaire du regard comme rais lumineux partant du sujet regardant vers l’objet regardé. Ce rais, sur lequel se fonde toute la lyrique pétrarquiste, maniériste et précieuse (le regard de la Dame comme une flèche, le cœur de l’amant percé par l’œil de la Dame, le rais qui le prend dans ses rets…) est une contre-vérité physique dénoncée au moins depuis le XVIIe siècle : on sait depuis Descartes que l’œil n’envoie aucun rayon, que la vision s’établit à partir de la lumière qui entre dans l’œil. Merleau-Ponty insiste sur ce temps préalable pour le sujet du regard, cette pré-conscience qu’il baigne dans le visible, qu’il est installé dans un milieu qui le regarde. Sa phrase mime stylistiquement le mouvement indéfini des réversions : ça me regarde / je vois / je suis donc moi aussi un ça qui regarde / de là on me voit, et ainsi de suite…
A ce mouvement, Merleau-Ponty donne un double nom : l’entrelacs — le chiasme. Le chiasme est cette figure de rhétorique qui consiste à enchaîner deux propositions de telle sorte que les deux termes clefs de la première se retrouvent dans la seconde, mais dans un ordre inversé qui en modifie le sens. Par exemple, dans Le Neveu de Rameau, Diderot fait dire au philosophe :
« N’en déplaise au ministre sublime que vous m’avez cité, je crois que si le mensonge peut servir un moment, il est necessairement nuisible a la longue ; et qu’au contraire, la verité sert nécessairement a la longue, bien qu’il puisse arriver qu’elle nuise dans le moment. »
Temps court et temps long sont disposés dans la phrase d’abord dans un sens, ensuite dans l’autre, pour renverser l’argument cynique du neveu, que la fin justifie les moyens. Désarçonné par son interlocuteur, le philosophe accuse d’abord le coup, avant de passer à la contre-offensive, de lui retourner l’argument. Modéliser comme chiasme le mouvement d’émergence du regard, depuis la déception géométrale qui blesse l’œil jusqu’à l’intention subjective qui se porte vers l’objet, permet de signifier cette contre-offensive, qui va de la dépossession à la repossession, de la néantisation à l’affirmation du sujet. Mais cette modélisation est une modélisation linguistique, qui explique le regard comme si c’était du langage, qui définit son mouvement comme une articulation du discours.
En accolant au chiasme l’entrelacs, Merleau-Ponty prépare la transition vers le nouveau paradigme, visuel : un entrelacs, c’est du dessin, un mouvement de formes, l’opération d’un nœud20 : ∝. A côté de l’entrelacs, Lacan adjoint le retournement en doigt de gant, qu’il a trouvé dans une note de Merleau-Ponty :
« Lisez, par exemple, cette note concernant ce qu’il appelle le retournement en doigt de gant, pour autant qu’il semble y apparaître — voir la façon dont la peau enveloppe la fourrure dans un gant d’hiver — que la conscience, dans son illusion de se voir se voir, trouve son fondement dans la structure retournée du regard. » (p. 95-96)
Au chiasme et à l’entrelacs, le modèle du retournement en doigt de gant ajoute une dimension supplémentaire de la réversion : la surface extérieure du gant se retrouve à l’intérieur, son dehors — au dedans. De la même manière, dans l’émergence du sujet dont le regard mime et répète le processus, l’intériorité de la conscience se constitue à partir de ce qui lui vient de l’extérieur, comme matériau visible, comme matériau du réel, comme matériau pour l’inconscient21. En chacun de nous, le dedans a commencé par être un dehors : c’est là l’enjeu de ce que Lacan désigne comme « structure retournée du regard », mais qui déjà n’est plus une structure, car pris dans un mouvement qui la pose et la défait, sortant de la modélisation géométrale, pour se manifester à la fois comme apparition et comme disparition, forme et déformation, réversion et intention.
Schématisation
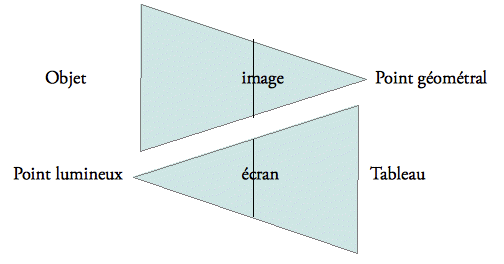
Pour le regard, le Séminaire XI met en place une structure et dans le même temps déconstruit l’idée même de structure. C’est dans la perspective structurale que Lacan synthétise sous la forme d’un schéma cette conception du regard comme objet a, et de la réversion qui introduit la schize de l’œil et du regard. Mais la déconstruction visuelle du paradigme linguistique perturbe la lisibilité du schéma et laisse bien souvent, il faut le dire, le lecteur perplexe. Lacan présente ce qu’il a dessiné au tableau comme un « petit schéma triangulaire, fort simple » (p. 105) destiné à « rappeler en trois termes l’optique utilisée dans ce montage opératoire qui témoigne de l’usage inversé de la perspective » (p. 106) : autrement dit, c’est le fonctionnement de l’anamorphose.
En fait, ce n’est pas un, mais deux triangles qui nous sont proposés, et deux fois trois termes. Nous allons comprendre progressivement que l’anamorphose est ce qui est désigné à gauche d’abord comme objet, puis comme point lumineux, ce qui est un peu déroutant face aux Ambassadeurs de Holbein. Mais Lacan est en fait déjà passé à l’exemple suivant, de la boîte de sardines flottant à la surface des vagues alors qu’il était sorti en mer avec des pêcheurs bretons (voir p. 110). La boîte, comme la tête de mort déformée, regardent Lacan qui les fixe de l’œil ; elles le regardent d’abord comme un simple objet géométral ; puis elles le prennent au piège, le captivent comme « point lumineux », ou plus généralement comme point de fascination, comme piège du regard, comme « ça montre » (p. 88).
La disposition tête bêche des deux triangles permet de décomposer en deux temps la structure retournée du regard. Avant le retournement, on n’est pas encore dans la vision : « le petit schéma permet de remarquer aussi qu’une certaine optique laisse échapper ce qu’il en est de la vision. » Le premier triangle définit donc la dimension géométrale. Entre le premier et le second triangle, Lacan évoque une prise au piège : « le sujet qui nous intéresse est pris, manœuvré, capté dans le champ de la vision ». Il faut comprendre que c’est ce champ de la vision, ou autrement dit le champ scopique, que modélise le second triangle.
A droite, d’abord à la pointe, puis à la base du triangle, se trouve le spectateur, le sujet regardant. Au début, en haut sur le schéma, il n’est pas encore un sujet, et donc il n’est pas encore un point de vue. Il est un simple « point géométral », placé à une certaine distance, géométriquement mesurable, de l’objet regardé. Puis, lorsque le processus de la vision se met en branle, l’œil regardant entre dans le tableau, est pris par lui, à la fois dépossédé (le père perdant son fils dans « Père, ne vois-tu pas que je brûle ? »), néantisé (nous sommes tous mortels, tu vas mourir, dit la Vanité des Ambassadeurs) ou moqué (la remarque de Petit-Jean, « Tu vois, cette boîte ? Tu la vois ? Eh bien elle, elle te voit pas ! », p. 110). Par « Tableau », sur le schéma, il ne faut donc pas comprendre la toile peinte, l’objet-tableau, mais la fonction qui est à l’œuvre dans le regard quand le piège se referme sur l’œil et qu’émerge le sujet : « Ce n’est évidemment pas pour rien que nous avons nommé tableau, la fonction où le sujet a à se repérer comme tel. » (p. 115)
Au centre du triangle, l’image, puis l’écran, désignent d’abord l’iris de l’œil, où l’image vient s’imprimer depuis l’objet, où elle est ensuite interceptée, bloquée, lorsque le sujet se constitue, avec ses blessures et ses défenses. Une des raisons du caractère déroutant du schéma tient donc à ceci que le sujet regarde l’objet de la droite vers la gauche, et non, comme on le représente traditionnellement par convention, de la gauche vers la droite. Par cette inversion, Lacan a voulu signifier que c’est de l’objet que part le regard, que s’engage le processus de la vision, le sujet n’émergeant que comme instance seconde, prise dans le « faire tableau » du dispositif.
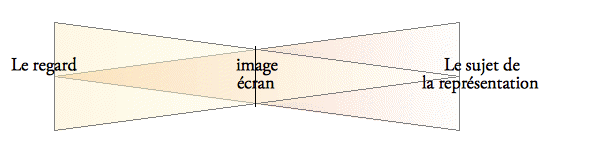
Le second schéma, au début du chapitre IX « Qu’est-ce qu’un tableau ? », est obtenu par la superposition des deux triangles du premier, et figure le dispositif global du regard (p. 121).
Ici aussi, tous les termes sont disposés de façon à déconcerter nos habitudes. « Le regard » ne désigne surtout pas le sujet regardant, mais ce qui, depuis l’objet, depuis l’Autre, émerge comme regard. Réciproquement, le « sujet de la représentation » n’est certainement pas le sujet du tableau (les ambassadeurs dans Les Ambassadeurs par exemple), mais le sujet qui fait l’expérience du complexe de castration par la mise en œuvre, depuis son œil, de la fonction scopique. Le sujet est désigné comme « sujet de la représentation », parce que ce n’est pas un spectateur hors du tableau, place en face de lui et le regardant, mais parce que c’est lui qui fait tableau à être regardé par ce qui l’entoure, que c’est lui qui entre dans le tableau par le jeu de réversion qu’introduit l’entrelacs du regard.
Notes
Voir les plaisanteries sur le fondement comme pudendum, c’est-à-dire en latin sur le sexe en tant qu’on en a honte.
Jacques Lacan, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Séminaire XI, Seuil, 1973, Point, 1990, p. 28. La référence à Lévi-Strauss et à La Pensée sauvage était amorcée p. 22 ; Lacan revient à la formule de l’inconscient structuré comme un langage p. 211, 220, 227.
Prononcer tukhè, bien que Jacques-Alain Miller transcrive tuché. Le mot en grec signifia à la fois hasard et rencontre.
On distingue en psychanalyse le pénis, qui est l’organe matériel, qu’on peut voir, du phallus, qui est la fonction de cet organe, fonction abstraite, à la fois imaginaire et symbolique.
Jacques Lacan, Le Séminaire, livre VIII, Le Transfert, Seuil, 1991, chap. XVII, « Le symbole Φ », p. 278-287.
Par enjeu épistémologique, j’entends ce qui touche au fonctionnement même de la science (ici : des sciences humaines), c’est-à-dire la manière dont une science produit ses outils théoriques. Pour le dire plus concrètement, l’enjeu, c’est de savoir si on fabrique des outils à partir des catégories et des modes de fonctionnement du langage et du discours (épistémologie structuraliste : une syntaxe, une taxinomie, un système de différences) ou si on fabrique des outils à partir des situations et des dispositifs visuels (épistémologie post-structuraliste : ce qui fait tableau, l’écran, le regard).
« Ne nions pas que c’est à l’intérieur de l’explication de la répétition que cette digression sur la fonction scopique se situe — induite sans doute par l’œuvre qui vient de paraître de Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l’Invisible. » (Chap. VII, p. 92. Voir déjà p. 83.)
L’expérience du « Bouquet renversé » consiste à placer un vase vide sur une table, et un bouquet de fleurs tête en bas sous la table. Si l’on place un miroir convexe derrière la table, le vase vide apparaît comme contenant les fleurs au spectateur qui se place devant la table. L’expérience a été décrite par H. Bouasse en 1934 dans Optique et photométrie dites géométriques. Lacan l’évoque dans le Séminaire sur Les écrits techniques de Freud (1953-54), puis dans son commentaire sur le rapport de Daniel Lagache (Écrits II, 1960). Il met en relation explicitement ce bouquet avec le bouquet de la Psyché de Zucchi au Séminaire VIII sur le Transfert. Il y revient longuement au Séminaire X sur l’Angoisse pour définir l’objet a, et enfin, au Séminaire XI, dans le chapitre XI, « Analyse et vérité » : voir p. 162 et le schéma.
Freud, Au delà du principe de plaisir, Petite bibliothèque Payot, chap. 2, p. 52.
Tamponne : amortit, atténue.
Henri Wallon (1879-1962), psychologue et neuropsychiatre français, spécialiste des enfants. Il a écrit notamment Les Origines du caractère chez l’enfant, Boisvin, Paris, 1934, 6e éd., PUF, coll. Quadrige, 2009, et Les Origines de la pensée chez l’enfant, PUF, Paris, 1945, rééd. 1963, coll. Quadrige, 1989.
L’enfant ne regarde pas la porte par où la mère pourrait revenir ; il regarde la porte où la mère a disparu. Ce qu’il regarde, c’est ce rien, cette béance, cette aphanisis. C’est le même regard que celui de Psyché vers l’absence de sexe d’Eros.
L’absence de la mère est dessinée, ou figurée par l’encadrement de la porte, qui en constitue le signe, comme dans Psyché le bouquet constitue le signe de ce que, derrière, le pénis manque.
Le tracé de la bobine qui part en dehors de l’enfant, qui choit, tombe loin de lui.
Le jeu de la bobine permet à l’enfant de prendre conscience, par le regard, de l’aphanisis, de l’apparition-disparition du phallus, par quoi se met en place le complexe de castration, et avec lui l’accès au signifiant (« l’ordre de la signifiance »).
L’enfant ne se perçoit comme sujet, comme être séparé de la mère, qu’à partir du moment où il commence à parler (il accède au signifiant). Il y a là un paradoxe : la parole ne vient pas de l’enfant, mais de ce qui l’entoure ; le signifiant vient à l’enfant par le regard qu’il porte sur cette béance face à lui, la mère qui manque, la bobine tombée. Les premiers signifiants prononcés par l’enfant, le o-o-o et le a-a-a du fort-da, sont les premières marques qu’il devient un sujet, et se perçoit comme tel. Le sujet naît hors de lui et vient en lui par la parole.
Fondamentalement le jeu ne consiste pas à ramener la bobine, mais à empêcher la bobine de (re)paraître. L’opposition à paraître, c’est la prise de possession, de contrôle de l’aphanisis.
« Un singulier objet, pareil à un os de seiche, flotte au-dessus du sol : c’est l’anamorphose d’un crâne qui se redresse lorsqu’on se place tout près, au-dessus, en regardant vers la gauche. […] Un sens caché et une solennité pèsent lourdement sur toute la scène. », Jurgis Baltrušaitis, Anamorphoses, ou Thaumaturgis opticus, Flammarion, 1984, repris dans Les Perspectives dépravées, tome 2, « Anamorphoses », Flammarion, collection Champs-Art, 1996, p. 128.
Voir également p. 107.
Le nœud jouera un rôle essentiel dans la modélisation lacanienne, notamment de la dernière période. Pour Lacan, les différents niveaux, ou dimensions dans lesquels le sujet est pris (réel, symbolique et imaginaire, à quoi s’ajoutera le symptôme) ne sont pas superposés, mais noués (nœud borroméen). Le langage même se développe non selon une structure syntagmatique, mais comme chaîne signifiante, où la ligne du signifiant croise à rebours celle de la demande (du désir) et s’y noue en point de capiton.
Ailleurs, Lacan le formule avec le paradigme linguistique : « Si le sujet est ce que je vous enseigne, à savoir le sujet déterminé par le langage et la parole, cela veut dire que le sujet, in initio, commence au lieu de l’Autre, en tant que là surgit le premier signifiant. » (Séminaire XI, chap. 15, §4, p. 222)
Référence de l'article
Stéphane Lojkine, « De la chaîne signifiante à l’entrelacs du visible : le tournant du Séminaire XI sur Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse », cours d’initiation à la french theory, université d’Aix-Marseille, avril 2012
Littérature et Psychanalyse
Archive mise à jour depuis 2019
Littérature et Psychanalyse
Le Master LIPS
Séminaire Amour et Jouissance (2019-2021)
Amour et Jouissance
Jouir et Posséder
Vers l'amour-amitié
Les signifiants du désir
50 nuances de Grey
Duras, la scène vide



