L'Œil révolté - La relation esthétique
Par relation esthétique, nous entendons ici la relation que le spectateur entretient avec l’œuvre d’art, œuvre peinte, mais aussi bien gravée, sculptée, dessinée ou tissée. L’étude du modèle théâtral, qui identifie la toile peinte à la scène dramatique, nous a fourni au chapitre précédent une première caractérisation de cette relation, insistant sur sa profonde et radicale dissymétrie : le spectateur voit sans être vu ; les protagonistes de la scène, quant à eux, demeurent absorbés et il leur est interdit de s’adresser au spectateur. Cette dissymétrie définit ce qu’on appelle la théorie du quatrième mur et justifie que, dans la relation esthétique, on distingue un sujet regardant et un objet regardé.
Si ce dispositif scénique demeure tout au long des Salons le modèle de référence pour caractériser non seulement la relation esthétique, mais le fonctionnement interne de toutes les œuvres étudiées de façon un peu détaillée, force est de constater cependant qu’il est lui-même critiqué et, on peut le dire d’emblée, dépassé. Nous avons insisté sur le rapport ambivalent que la critique picturale de Diderot entretient avec le théâtre : la référence au modèle théâtral est presque toujours, chez lui, une dépréciation.
Concurremment à ce modèle, Diderot en expérimente un autre, où écran et dissymétrie tombent, et la différence du sujet à l’objet est remplacée par une circulation. La relation esthétique devient alors circuit et suppose, dans la vue offerte à l’œil, comme dans ce que l’œil restitue comme image, un processus de réversion par lequel, en quelque sorte, la fonction du sujet est retournée en fonction de l’objet, et vice-versa. On touche ici à la dimension la plus intime de la révolte de l’œil qui se joue dans les Salons. Nous montrerons, à partir des deux textes clefs où Diderot a poussé le plus loin sa réflexion sur ce modèle concurrent, « L’Antre de Platon » et la « Promenade Vernet », que cette révolte engage beaucoup plus que la seule relation esthétique : par elle, Diderot met en place le dispositif dialogique à partir duquel il écrira désormais sa philosophie et esquisse les bases d’une pensée politique.
I. Corésus et Callirhoé : la fin de la scène
L’année 1765 marque en quelque sorte pour Fragonard le début de sa carrière parisienne, au retour d’un long séjour à l’étranger, d’abord en Italie (1756-1761), puis en Hollande (1761-1765) : c’est cette année en effet qu’il décide de solliciter son agrément à l’Académie royale de peinture. Fragonard choisit un sujet rare, pour ainsi dire jamais représenté en peinture avant lui 1 : c’est l’histoire de Corésus et Callirhoé, que Pausanias rapporte dans son Itinéraire de la Grèce (VII, 21, 1) 2. On ne connaît pas d’autre source antique pour cette légende : la Callirhoé de Chariton d’Aphrodisias, un roman alexandrin contemporain de Pausanias, n’a aucun rapport avec l’histoire qui nous intéresse 3.

Fragonard est agréé le 30 mars, « avec applaudissements » selon Wille 4, « avec une unanimité et un applaudissement dont il y a peu d’exemple » selon Marigny 5. Cochin, secrétaire de l’Académie, propose de faire acheter le tableau par le roi pour qu’il soit tissé aux Gobelins, et de commander au jeune peintre un pendant.
Si l’on met de côté les résurgences de la fable antique à la Renaissance 6, on connaît au dix-huitième siècle l’histoire de Corésus et Callirhoé par un opéra, composé en 1712 par Destouches sur un livret de Pierre Charles Roy, qui a connu un certain succès : il est rejoué en effet de 1731 à 1743, puis en 1773 7. Cet opéra fait lui-même suite à une tragédie d’Antoine de La Fosse, représentée en 1704 8. Roy résume ainsi l’argument, dans la préface du livret :
Coresus, grand Prêtre de Bacchus dans la Ville de Calydon, aima passionément la jeune Callirhoé. Il se flatoit de l’épouser ; mais il n’en reçût que des mépris, & les témoignages d’une haine, dont il se trouva si blessé, qu’il en demanda vangeance au Dieu qu’il servoit. Cette vangeance fût prompte & terrible. Tous les Calydoniens se sentirent saisis d’une yvresse qui les armoit les uns contre les autres, & contr’eux-mêmes. On eût recours aux Oracles, pour sçavoir la cause & le remede de tant de malheurs. On apprit que la colere de Bacchus en étoit la source ; qu’elle ne pouvoit estre arrestée amoins que Coresus ne luy immolât Callirhoé, ou quelqu’un qui s’offriroit pour elle. Personne ne se presenta. Elle attendoit à l’Autel le coup fatal, lorsque Coresus la sauva en se sacrifiant luy-même.
Le tableau de Fragonard représente ce sacrifice, que Roy caractérise, avec les catégories de la Poétique d’Aristote, comme « la Catastrophe » de la pièce 9.
Le quart de tour du Corésus
On n’accède pas directement à la scène du Corésus et Callirhoé de Fragonard. Dans l’espace de la toile, un second espace est ménagé et délimité, par l’estrade recouverte d’un tapis rouge en bas, par les deux lourds pieds de colonne à gauche et à droite, qui encadrent le lieu du sacrifice.
Cet espace restreint où se déroule la scène proprement dite du sacrifice est donc exposé à nos yeux en retrait, retrait souligné à droite par l’étrange avancée que fait l’estrade au devant de la colonne 10 et par la nature morte du premier plan : complètement à droite, une urne de faïence bleue et un linge blanc jeté sur elle ; puis, en progressant vers la gauche, un récipient de bronze destiné à recevoir le sang du sacrifice ; enfin, au milieu du premier plan, le jeté désordonné des franges d’or du tapis rouge.
Les éléments de la nature morte sont dispersés, disloqués, amalgamés à quelques cailloux erratiques, deux à droite, un au centre, peut-être encore un sur la gauche. La puissance du moment pictural a fait voler en éclats la vanité pacifiante du premier plan. De même, le retrait de l’estrade est compensé par l’avancée de Corésus, dont le pied droit dirigé vers le bord de l’estrade annonce la tirade tragique, le grand air d’opéra, l’instant de gloire sur la scène : point de temps faible ici ; le peintre a choisi le moment paroxystique de la catastrophe.

On touche ici à l’ambiguïté générique de cette scène de sacrifice. Comme sacrifice, elle s’adresse aux Calydoniens rassemblés à l’entrée du temple et peints à gauche sur la toile ; comme scène, elle vise le spectateur externe du tableau, devant elle et non à sa gauche. Cette ambiguïté est celle de la scène dramatique en général, dont on se souvient que l’intérêt doit se rapporter aux personnages et non au spectateur, dont l’effet est pourtant bien destiné au spectateur, et non aux personnages 11. La scène picturale gère ce paradoxe par le quart de tour qu’elle imprime au dispositif : l’instant d’avant, Corésus et Callirhoé faisaient face à leur public, à gauche. Mais c’est vers nous que Callirhoé s’évanouit, vers nous que Corésus, au moment de la sacrifier, se retourne pour se poignarder. Pourtant, ils ne nous regardent pas : l’évanouissement de la jeune fille, l’ombre de la mort pour le jeune prêtre, voilent et ferment leurs yeux. Le retrait d’estrade établit entre nous et la scène du sacrifice le mur invisible de leur absorbement. Corésus et Callirhoé se détournent de l’assistance face à laquelle ils sont venus accomplir le rituel du sacrifice, pour se replier dans le drame intérieur, dans l’espace intime de leurs amours malheureuses, pour lesquelles il ne saurait y avoir de public.
Quant au public représenté à gauche sur la toile, il est bien gêné pour voir une scène qui est dérobée à ses yeux : la lourde colonne de gauche, le muret qui, derrière elle, barre l’accès à l’estrade, le prêtre aux vêtements blancs écartant les bras pour empêcher quiconque de s’approcher, le jeune homme agenouillé devant Callirhoé, font obstacle au regard, à la participation, à la communion des spectateurs. Sur la gauche, le recul effrayé de la mère en bas reproduit le geste imaginé par Timanthe pour Agamemnon face au sacrifice d’Iphigénie : elle se voile le visage, se soustrait à l’insoutenable vision.
En se détournant de l’assistance à gauche pour s’offrir par effraction à notre regard de spectateurs impudiques, Corésus et Callirhoé transforment le rituel public du sacrifice en scène théâtrale, virtuellement privée. La coupure sur la toile entre les spectateurs peints dans l’espace vague et l’espace restreint de l’estrade rouge, matérialisée par la colonne de gauche, est remplacée par la coupure immatérielle qui sépare l’espace réel où nous nous trouvons, spectateurs du tableau et extérieurs à lui, de l’espace fictif où évoluent les acteurs. Cette coupure immatérielle est signifiée par leurs yeux fermés, par le retrait de l’estrade et par la nature morte qui, au premier plan, vole théâtralement en éclats, signifiant par la mort à laquelle elle renvoie 12 l’exclusion du spectateur constitutive de la relation esthétique.
Le Corésus et Callirhoé de Fragonard n’est donc pas seulement le morceau d’agrément d’un jeune artiste qui sacrifie aux conventions d’un genre académique, la peinture d’histoire, pour obtenir la reconnaissance de l’institution. Fragonard dit la fin du genre. Il met en scène la mort de la performance que sauve in extremis son détournement théâtral. Le quart de tour opéré par les deux personnages principaux et souligné par les trois acolytes (les deux de gauche avancent, tandis que celui de droite recule) place le spectateur dans un espace disjoint de l’espace public, relégué à gauche, et emmure l’histoire dans le secret de ces quatre yeux fermés. Corésus n’exhibe pas au spectateur lecteur l’histoire exemplaire de sa fin. Il s’exhibe comme corps pour se soustraire comme regard.
Entre caverne et peinture
Pour commenter ce tableau, le moins qu’on puisse dire est que l’entrée en matière de Diderot n’est pas enthousiaste :
Il m’est impossible, mon ami, de vous entretenir de ce tableau ; vous savez qu’il n’était plus au Salon, lorsque la sensation générale qu’il fit, m’y appela. C’est votre affaire d’en rendre compte ; nous en causerons ensemble ; cela sera d’autant mieux que peut-être découvrirons-nous pourquoi après un premier tribut d’éloges payé à l’artiste, après les premières exclamations le public a semblé se refroidir. Toute composition dont le succès ne se soutient pas manque d’un vrai mérite. (P. 423 ; DPV XIV 253.)
Diderot part d’un double défaut : venu au Salon après que le tableau en avait été ôté, il prétend ne pas l’avoir vu 13 ; d’ailleurs, « après un premier tribut d’éloges », le tableau ne s’est pas soutenu devant le public. Diderot a fait défaut ; le tableau a fait défaut. Ce double défaut ouvre dans le texte un manque à « remplir », introduit donc une logique du supplément :
Mais pour remplir cet article Fragonard, je vais vous faire part d’une vision assez étrange dont je fus tourmenté la nuit qui suivit un jour dont j’avais passé la matinée à voir des tableaux et la soirée à lire quelques Dialogues de Platon.
Le rêve vient s’ajouter à la visite au Salon et à la lecture de Platon, de sorte que les trois usages de l’œil, sensible ou géométral (« voir »), intelligible ou symbolique (« lire »), et imaginaire (« vision ») se trouvent superposés : un dispositif se met en place.
Le texte pose une demande, « cet article Fragonard » que Grimm réclame à Diderot, et ne prétend y répondre qu’indirectement, par le détour « d’une vision assez étrange ». Le détour instaure la tension discursive : un circuit de la parole est lancé, disposé autour d’un centre absent, désigné par le double défaut liminaire du Corésus et Callirhoé qui « n’était plus au Salon » et « manque d’un vrai mérite ».
Le compte rendu du rêve est doté d’un titre, L’Antre de Platon et débute par une longue description du dispositif platonicien 14 : assis dans « une longue caverne obscure » le narrateur se rêve enchaîné « parmi une multitude d’hommes, de femmes et d’enfants » et, « la tête bien prise entre des éclisses de bois », forcé de regarder en direction « d’une toile immense » tendue en face de lui. Derrière lui, divers personnages exposent « de petites figures transparentes et colorées » devant « une grande lampe suspendue », construisant et projetant ainsi des scènes entières sur la toile, selon le procédé de la lanterne magique 15.
Un tel dispositif n’a rien à voir a priori avec la scène du suicide de Corésus peinte par Fragonard. Toute l’entreprise de la fiction diderotienne va consister pourtant à amalgamer les deux espaces, la caverne de Platon d’une part, instituée comme condition de possibilité de la représentation (c’est sur sa paroi que le Corésus doit se projeter), le temple de Fragonard d’autre part, qui constitue sa fin : une fois la peinture réalisée dans la caverne, cette dernière peut disparaître.
Revisitée par Diderot, la caverne platonicienne se présente d’abord comme une machine à scènes :
Par derrière nous, il y avait des rois, des ministres, des prêtres, des docteurs, des apôtres, des prophètes, des théologiens, des politiques, des fripons, des charlatans, des artisans d’illusions 16 et toute la troupe des marchands d’espérances et de craintes. Chacun d’eux avait une provision de petite figures transparentes et colorées propres à son état, et toutes ces figures étaient si bien faites, si bien peintes, en si grand nombre et si variées, qu’il y en avait de quoi fournir à la représentation de toutes les scènes comiques, tragiques et burlesques de la vie.
Ces charlatans, comme je le vis ensuite, placés entre nous et l’entrée de la caverne, avaient par derrière eux une grande lampe suspendue, à la lumière de laquelle ils exposaient leurs petites figures dont les ombres portées par dessus nos têtes et s’agrandissant en chemin allaient s’arrêter sur la toile tendue au fond de la caverne et y former des scènes, mais des scènes si naturelles, si vraies que nous les prenions pour réelles, et que tantôt nous en riions à gorge déployée, tantôt nous en pleurions à chaudes larmes, ce qui vous paraîtra d’autant moins étrange qu’il y avait derrière la toile d’autres fripons subalternes, aux gages des premiers, qui prêtaient à ces ombres les accents, les discours, les vraies voix de leurs rôles. (P. 424 ; DPV XIV 254.)
Comme chez Platon, l’enjeu de la caverne n’est pas ici la question esthétique de l’imitation. La fabrication des images sur la toile par « la troupe des marchands d’espérances et de craintes » ne répond en rien à un quelconque souci d’imitation du réel. Clairement, sa visée, qui engage toutes les institutions sociales, politiques, religieuses, universitaires, est une visée idéologique.
Le dispositif de la caverne « forme des scènes », autrement dit formate le réel, et en distribue au peuple un flux télévisuel 17 continu, couvrant tout le spectre des genres dramatiques, « scènes comiques » pour le genre moyen, « tragiques » pour l’élevé, « burlesques » pour le bas. La typologie des scènes, la hiérarchie des genres est en même temps une réduction symbolique du monde : modélisation formelle et asservissement des peuples procèdent d’un même mouvement. Diderot ne décrit donc pas un tableau ; il produit un flux, non seulement un flux d’images fondues l’une dans l’autre, mais des images qui se manifestent comme flux, qui thématisent le flux.
Aujourd’hui qu’il s’agit de tableaux, j’aime mieux vous en décrire quelques-uns de ceux que je vis sur la grande toile ; je vous jure qu’ils valaient bien les meilleurs du Salon. Sur cette toile tout paraissait d’abord décousu ; on pleurait, on riait, on jouait, on buvait, on chantait, on se mordait les poings, on s’arrachait les cheveux, on se caressait, on se fouettait ; au moment où l’un se noyait, un autre était pendu, un troisième élevé sur un piédestal ; mais à la longue tout se liait, s’éclaircissait et s’entendait. Voici ce que je vis s’y passer à différents intervalles que je rapprocherai pour abréger. (P. 425 ; DPV XIV 155.)
Entre le support, la toile, et la caractérisation du contenu, décousu, une affinité de texture s’établit, un réseau connotatif par quoi s’établit le court-circuit de l’image. Après le fil du discours défait, décousu, s’impose la surface de la toile, à partir de laquelle une nouvelle continuité s’impose : « tout se liait, s’éclaircissait et s’entendait ». Ce nouveau lien, qui se substitue au fil décousu du langage, est le lien du flux iconique.
« On pleurait, on riait, on jouait, on buvait, on chantait » : la bacchanale de Calydon ressemble étrangement à la description des prisonniers enchaînés dans la caverne, dont « la plupart buvaient, riaient, chantaient ». Ici aussi une différenciation tombe. Chez les spectateurs comme sur la scène, parmi les regardants comme parmi les regardés, la même bacchanale est à l’œuvre. Le fantasme d’une perversion sexuelle généralisée (« on se caressait, on se fouettait » esquissant un rituel sado-masochiste 18) s’y superpose à l’ancienne allégorie des aléas de Fortune opposant le pendu et le noyé à l’homme élevé sur un piédestal.
Ce n’est pas là le premier acte d’une histoire de Corésus et de Callirhoé. Ce qui se manifeste n’est pas d’ordre narratif. Diderot donne à ressentir un brouillage généralisé, marqué par la confusion de l’ordonnance, des actions et des figures. Le point de départ du flux d’images, la condition de possibilité de ce flux, est une déconstruction radicale et méthodique du dispositif d’effraction scénique, envisagé à ses trois niveaux constitutifs.
Ni narration, ni tableau
C’est à partir de ce brouillage iconique initial que va se mettre en place ce qui tiendra lieu, non du tableau de Fragonard, mais du récit dont ce tableau représente la catastrophe. Le déploiement du rêve sous la plume de Diderot devrait prendre la forme d’une narration : c’est du moins une narration qu’a lue et décodée la critique diderotienne, qui rapproche les cinq (ou six ?) tableaux que Diderot fait défiler sur la toile de son antre platonicien des cinq actes de la tragédie de La Fosse, ou de l’opéra de Roy et Destouches 19. Mais précisément le texte n’est pas cette narration : insidieusement, il dispose les éléments visuels de ce qui n’est pourtant pas un tableau selon le protocole descriptif que les Salons ont progressivement mis en place, protocole qui entend ici épouser le processus même de la création artistique : « Ah ! si j’étais peintre ! j’ai encore tous ces visages-là présents à mon esprit », s’exclamera plus loin Diderot 20. Sujet, figures, action : c’est là la marche du texte, pour lequel l’histoire n’est qu’un substrat, le substrat de toute scène d’histoire peinte.
Le sujet donne les circonstances de la scène. Ce n’est déjà plus l’histoire, mais sa décomposition en ses éléments visuels fondamentaux :
D’abord ce fut un jeune homme, ses longs vêtements sacerdotaux en désordre, la main armée d’un thyrse, le front couronné de lierre, qui versait d’un grand vase antique des flots de vin dans de larges et profondes coupes qu’il portait à la bouche de quelques femmes aux yeux hagards et à la tête échevelée. Il s’enivrait avec elle, elles s’enivraient avec lui, et quand ils étaient ivres, ils se levaient et se mettaient à courir les rues en poussant des cris mêlés de fureur et de joie. Les peuples frappés de ces cris se renfermaient dans leurs maisons et craignaient de se retrouver sur leur passage ; ils pouvaient mettre en pièce le téméraire qu’ils auraient rencontré, et je vis qu’ils le faisaient quelquefois. Eh bien, mon ami, qu’en dites-vous ?
Grimm. Je dis que voilà deux assez beaux tableaux, à peu près du même genre. (Suite du précédent.)
Grimm, non pas le Grimm des ajouts avec astérisque 21, mais un Grimm posé par Diderot lui-même dans son texte, prend la responsabilité de désigner ce mécano visuel comme « tableaux 22 ». Le séquençage du texte de Diderot en tableaux est donné ainsi comme une sorte de mise en forme après coup, de normalisation pour le public de la Correspondance littéraire, Diderot anticipant le travail de Grimm. Point d’acte dramatique, ni d’épisode romanesque ici : une image se fabrique sous nos yeux et devient le support d’un jeu dialogique entre Diderot et un Grimm fictif, c’est-à-dire entre une pensée intime de l’image et sa verbalisation publiable, qui appellera cela des tableaux. Le fondu enchaîné de cette image en travail produit le trajet de la bacchanale. Diderot glisse presque insensiblement de la scène d’intérieur, où « un jeune homme » (une narration le désignerait comme Corésus) s’enivre avec des femmes, à la scène d’extérieur, où la troupe des bacchantes se répand dans les rues. Longueur des phrases et parataxe miment stylistiquement le flux iconique, que thématise d’abord le vin versé, puis les femmes répandues dans les rues. Le drapé même qui habille le jeune prêtre, « ses longs vêtements sacerdotaux en désordre », participe de ce flux. C’est une image qui s’impose (« ce fut »), puis, à la faveur des imparfaits, glisse, se répand et passe.
Sur ce qui est toujours la même « toile immense », « la toile de la caverne » 23, vient ensuite la caractérisation des figures :
Diderot. En voici un troisième d’un genre différent. Le jeune prêtre qui conduisait ces furieuses était de la plus belle figure ; je le remarquai et il me sembla, dans le cours de mon rêve, que plongé dans une ivresse plus dangereuse que celle du vin, il s’adressait avec le visage, le geste et les discours les plus passionnés et les plus tendres à une jeune fille dont il embrassait vainement les genoux et qui refusait de l’entendre.
L’histoire dont procèdent ces images raconterait ici la déclaration d’amour de Corésus à Callirhoé et le refus de celle-ci. La figure (le corps), le visage et les gestes du jeune prêtre donnent à voir l’équivalent de son discours, selon la norme de la scène picturale la plus classique. À l’espace restreint de cette scène de déclaration s’oppose alors l’espace vague de la ville, depuis lequel la vengeance de Bacchus frappe l’ensemble de la communauté des Calydoniens :
Tandis que ce prêtre sollicitait inutilement la jeune inflexible, voilà que j’entends tout à coup dans le fond des habitations des cris, des ris, des hurlements, et que j’en vois sortir des pères, des mères, des femmes, des filles des enfants. Les pères se précipitaient sur leurs filles qui avaient perdu tout sentiment de pudeur, les mères sur leurs fils qui les méconnaissaient, les enfants de différents sexes mêlés, confondus, se roulaient à terre ; c’était un spectacle de joie extravagante, de licence effrénée, d’une ivresse et d’une fureur inconcevable.
Une fois encore, l’enchaînement logique du récit est élidé, et les deux espaces picturaux sont donnés comme concomitants (« Tandis que…, voilà que… »). L’articulation manquante se lit chez Pausanias :
Après avoir mis en œuvre tout ce que l’amour suggere aux amans, soins, prieres, supplications, voyant que tout étoit inutile, enfin il eut recours à Bacchus, & embrassant sa statuë il le pria de lui être favorable. Le dieu exauça son ministre : aussi-tôt les Calydoniens furent frappez d’une espece d’yvresse qui les mettoit hors d’eux-mêmes, & qui en faisoit mourir plusieurs 24.
De même, dans l’opéra de Destouches, la scène 5 de l’acte II montre Corésus, enflammé d’une fureur vengeresse, engageant ses prêtres à saccager la ville ; dans la tragédie d’Antoine de La Fosse, c’est à la scène 6 de l’acte II le récit d’Arbas, serviteur du père de Callirhoé, qui rapporte l’invocation du jeune prêtre et, aussitôt en réponse, la manifestation du dieu, « une épaisse vapeur » qui se répand du temple dans la ville 25. Le prêtre de Diderot, lui, ne sollicite rien, sa prière éconduite et la catastrophe collective sont simplement juxtaposées. L’action centrale, décisive, du récit, fait défaut, selon une logique qui est celle de l’image et du rêve, où la parataxe se substitue à la syntaxe.

Cependant, du flux visuel émerge un jeu différentiel opposant le couple du premier plan au tumulte du « fond des habitations ». Cette disposition spatiale se substitue aux articulations de l’histoire. On la retrouve dans la séquence suivante qui pose, après les circonstances et les figures, l’action de la scène :
Diderot. Au milieu de ce tumulte, quelques vieillards que l’épidémie avait épargnés, les yeux baignés de larmes, prosternés dans un temple frappaient la terre de leurs fronts, embrassaient de la manière la plus suppliante les autels du dieu, et j’entends très distinctement le dieu, ou peut-être le fripon subalterne qui était derrière la toile, dire : Qu’elle meure, ou qu’un autre meure pour elle.
Parce que Bacchus a déchaîné la peste bachique dans Calydon, les vieillards invoquent le dieu pour savoir comment se délivrer du fléau. Bacchus leur répond que Callirhoé doit mourir, ou une autre victime à sa place. L’événement majeur du récit serait ici l’invocation à Bacchus, la sollicitation de son oracle : c’est l’événement qui manque dans le tableau, comme manquait l’invocation vengeresse de Corésus dans la séquence précédente.

Chez Diderot, la réponse du dieu ne répond à aucune question, et les vieillards ne se réunissent pas dans le temple à cause du tumulte dans la ville, mais au milieu de celui-ci : la disposition spatiale supplée l’enchaînement logique. Ce qui compte, c’est la persistance du jeu différentiel entre la scène proprement dite de supplication (de Corésus à Callirhoé, puis des vieillards à Bacchus) et l’espace vague du déchaînement (de la bacchanale, puis de la peste) 26.
Après l’énoncé des termes de l’oracle, nous voici arrivés au seuil du tableau de Fragonard proprement dit. L’oracle est l’énoncé textuel sur lequel la scène de Fragonard est construite. Diderot a déjà parcouru le sujet, les figures et l’action de la toile ; il va réitérer ce parcours, en substituant au sujet, dont toute cette description préliminaire constitue désormais l’équivalent, l’ordonnance du tableau, qui peut désormais être fixée, mais qu’il nous invite à considérer comme le résultat du processus d’émergence qu’il a décrit :
J’étais dans une extrême impatience de connaître quelle serait la suite de cet oracle funeste, lorsque le temple s’ouvrit derechef à mes yeux. Le pavé en était couvert d’un grand tapis rouge, bordé d’une large frange d’or ; ce riche tapis et la frange retombaient au-dessous d’une longue marche qui régnait tout le long de la façade. […] De chaque côté de la partie du temple que je découvrais, deux grandes colonnes d’un marbre blanc et transparent semblaient en aller chercher la voûte. […] Je voyais la lueur rougeâtre des brasiers ardents, et la fumée des parfums me dérobait une partie de la colonne intérieure. Voilà le théâtre d’une des plus terribles et des plus touchantes représentations qui se soient exécutées sur la toile de la caverne, pendant ma vision. (P. 426 ; DPV XIV 257-8.)
Le temple n’est pas simplement ouvert à la vue ; il est posé dans le battement de l’ouverture et de la fermeture, qui est le battement même de l’œil à la fois interdit et sollicité d’entrer dans la scène. Le temple laisse voir du dehors son intérieur ; mais « une longue marche qui régnait tout le long de la façade » rappelle l’existence d’un mur invisible, et en trace sur la toile la ligne horizontale, tandis que la fumée de l’encens contribue à dérober ce qui semblait d’abord ouvert à l’exposition.
Après l’horizontale, viennent les lignes verticales. À strictement parler, Diderot change le format du tableau de Fragonard, dont il fait une scène toute en hauteur. Point de « voûte » chez Fragonard, qui n’a peint que les bases des deux colonnes. Le candélabre n’y atteint pas, en conséquence, « le chapiteau de la colonne », et Corésus en touche quasiment le sommet. Les moyens du texte ne sont décidément pas ceux de l’image. Il n’importe : une fois posées les lignes horizontales et verticales de la scène, on obtient, en elle, le carré qui délimite « le théâtre » de la représentation, autrement dit son espace restreint 27.

Vient alors la description des figures, d’abord un acolyte à « l’air triste », puis un prêtre à « la tête tout à fait penchée », puis Corésus : « la douleur avait fait une impression profonde sur son visage ». Quant à Callirhoé, « la pâleur de la mort couvrait son visage » ; « elle avait le visage tourné vers ciel, ses yeux étaient fermés » (p. 427 ; DPV XIV 259-260). Ce ne sont que caractères de têtes, à partir desquels, dans un troisième temps, pourra se cristalliser l’action proprement dite
« Le ciel brillait de la clarté la plus pure ; le soleil semblait précipiter toute la masse de sa lumière dans le temple et se plaire à la rassembler sur la victime, lorsque les voûtes s’obscurcirent de ténèbres épaisses qui s’étendant sur nos têtes et se mêlant à l’air, à la lumière, produisirent une horreur soudaine. A travers ces ténèbres je vis planer un génie infernal, je le vis : des yeux hagards lui sortaient de la tête ; il tenait un poignard de la main, de l’autre il secouait une torche ardente ; il criait. C’était le Désespoir, et l’Amour, le redoutable Amour était porté sur son dos. » (P. 428 ; DPV XIV 260.)
Diderot commence par évoquer la lumière : le point focal de la représentation, où elle vient se concentrer, est la poitrine de Callirhoé, ou plus exactement chez Fragonard son téton gauche dénudé, à l’intersection des deux diagonales, décentrées vers la droite, qui structurent l’ensemble de la composition. La lumière et donc l’œil du spectateur se précipitent, se rassemblent vers ce téton objet du désir 28, au moment où l’action véritable de la scène se trame plus haut, dans le renoncement à cet objet.
L’allégorie de l’action précède celle-ci : Diderot décrit le génie du Désespoir, qui annonce le suicide de Corésus, accompagné d’un Cupidon vengeur, qui en donne la cause. L’allégorie envahit l’espace scénique au moment où la lumière se retire. C’est dire que l’allégorie n’est paradoxalement pas visuelle, que c’est une image donnée à lire faute de voir. Les ténèbres, mais aussi les yeux hagards du génie, des yeux qui ne voient pas, « produisirent une horreur soudaine » : la profondeur perspective de la scène se défait au profit d’un effet de masse : l’image fait sens dans l’horreur et l’aveuglement, elle porte atteinte au sujet et établit par là la relation esthétique.
Par les répétitions, Diderot sait donner à son récit la scansion hallucinée du cauchemar : « je vis planer un génie infernal, je le vis » ; « l’Amour, le redoutable Amour ». L’« horreur » ouvre à un autre usage de l’œil, non plus au regard, mais à la vision. Le Désespoir s’impose, enveloppe et menace comme une vision, comme un fantôme. Diderot parlera plus loin de « simulacres », et de « ces fantômes intéressants et sublimes ».
Diderot, qui sait si bien ailleurs être lapidaire, dilate ici au contraire le temps, décompose les moindres mouvements, déployant dans toute son intensité le moment de l’action proprement dite :
A l’instant, le grand-prêtre tire le couteau sacré, il lève le bras ; je crois qu’il en va frapper la victime, qu’il va l’enfoncer dans le sein de celle qui l’a dédaigné et que le Ciel lui a livrée ; point du tout, il s’en frappe lui-même. Un cri général perce et déchire l’air. Je vois la mort et ses symptômes errer sur les joues, sur le front du tendre et généreux infortuné ; ses genoux défaillent, sa tête retombe en arrière, un de ses bras est pendant, la main dont il a saisi le couteau le tient encore enfoncé dans son coeur. (Suite du précédent.)
C’est ici le moment du quart de tour scénique. Fragonard semble avoir contrevenu au principe, qui peu à peu s’impose, de l’instant prégnant, en montrant Corésus « le couteau… encore enfoncé dans son cœur » 29. Mais la projection virtuelle de la scène peinte à la scène imaginée par le spectateur est ici portée par l’histoire même, qui nous invite à superposer le sacrifice de Callirhoé, finalement évité, à celui de Corésus, qui l’indique par défaut. Le geste de Corésus est un geste permis parce que dérouté de sa trajectoire attendue, et par là fondamentalement anti-théâtral : par lui, Corésus se dérobe au théâtre qu’on attend de lui, exactement comme Suzanne se soustrait aux vieillards, ou Péro aux geôliers de Cimon.
Le couteau de Corésus perce sa poitrine, comme le cri de l’assistance perce l’air, comme le génie du Désespoir criait en tenant un poignard à la main : coup et cri s’équivalent ; le moment du tableau est le moment d’une équivalence idéale entre les moyens de la poésie et de la peinture, poussées l’une et l’autre aux limites de leurs moyens 30. Diderot rétablit alors le système des regards, dont le réseau restaure l’espace de la représentation :
Tous les regards s’attachent ou craignent de s’attacher sur lui ; tout marque la peine et l’effroi. L’acolyte qui est au pied du candélabre a la bouche entrouverte et regarde avec effroi ; celui qui soutient la victime retourne la tête et regarde avec effroi ; ces deux prêtres âgés dont les regards cruels ont dû se repaître si souvent de la vapeur du sang dont ils ont arrosé les autels, n’ont pu se refuser à la douleur, à la commisération, à l’effroi, ils plaignent le malheureux, ils souffrent, ils sont effrayés ; cette femme seule appuyée contre une des colonnes, saisie d’horreur et d’effroi, s’est retournée subitement ; et cette autre qui avait le dos contre une borne s’est renversée en arrière, une de ses mains s’est portée sur ses yeux, et son autre bras semble repousser d’elle ce spectacle effrayant ; la surprise et l’effroi sont peints sur les visages des spectateurs éloignés d’elle. (Suite du précédent.)
Diderot recourt encore, avec le mot « effroi », au procédé de répétition psalmodique qui substitue à la syntaxe la propagation rythmique du sens. Il met ainsi en évidence le caractère exemplaire, dans le Corésus et Callirhoé, de cette mise en abyme du regard du spectateur. Les acolytes, les prêtres, les femmes donnent à voir sur la toile ce regard ; il l’anticipent ; ils le préfigurent et, en quelque sorte, ils le formatent. Interdit, saisi d’effroi, l’œil du spectateur est pris au piège, anéanti. Mais les personnages n’ont ce regard qu’au terme d’un retournement : le premier acolyte « retourne la tête » ; une femme « s’est retournée subitement » ; une autre « s’est renversée en arrière ». Ce retournement accompagne le quart de tour de Corésus, qui s’est détourné du sacrifice pour se suicider. Mais il dit aussi, symboliquement, le refus par le spectateur de l’image qui lui est présentée. La toile programme ainsi la révolte de l’œil. L’effroi peut alors se renverser en compassion (« ils plaignent le malheureux, ils souffrent »), fovbo" en e[leo", et la compassion à nouveau en effroi : « ils souffrent, ils sont effrayés ». Adhérer à l’image ou s’en détourner, accepter la scène ou se révolter contre elle : c’est dans ce suspens que s’installe la relation esthétique.
Le regard du père
Apparaît alors une figure inattendue :
mais rien n’égale la consternation et la douleur du vieillard aux cheveux gris, ses cheveux se sont dressés sur son front, je crois le voir encore, la lumière du brasier ardent l’éclairant, et ses bras étendus au dessus de l’autel : je vois ses yeux, je vois sa bouche, je le vois s’élancer, j’entends ses cris, ils me réveillent, la toile se replie et la caverne disparaît. (Suite du précédent.)
Ce n’est pas le suicide proprement dit qui interrompt le rêve, mais l’apparition de ce vieillard dont la vision (le verbe « voir » est employé quatre fois) devient si insoutenable qu’elle « replie » la toile de la représentation. Pourquoi ce personnage secondaire chez Fragonard 31 produit-il tant d’effet chez Diderot ? On songe à un autre tableau de vieillard, produit dans un tout autre contexte :
Son image sera toujours présente à ma mémoire ; il me semble que je le vois dans son fauteuil à bras 32, avec son maintien tranquille et son visage serein ; il me semble que je l’entends encore. […] C’était en hiver. Nous étions assis autour de lui, devant le feu, l’abbé, ma sœur et moi. (II, 484 ; DPV XII 465.)
Il s’agit du début de l’Entretien d’un père avec ses enfants, rédigé probablement en 1770, mais relatant la dernière visite de Diderot à son père, en 1754 33, avant sa mort en 1759 : Diderot souffrit beaucoup de ne pas pouvoir se trouver au chevet de son père et le voyage à Langres qu’il fit pour régler la succession fut une épreuve. L’image obsédante du père tant aimé et contre lequel il s’était tant révolté demeura en Diderot jusqu’au voyage à Langres de 1770, qui fut pour lui l’occasion de payer sa dette de fils par l’écriture de l’Entretien.
L’image idéale et sereine du père, le beau vieillard devant le feu dont Diderot nous dit que la voix comme la figure le hantent 34, semble s’être répercutée, défigurée dans le cauchemar de 1765, ravivée peut-être par l’évocation du poignard du Désespoir, puis du couteau sacré. On comparera « je crois le voir encore », en 1765, avec « il me semble que je le vois », en 1770 ; mais le feu de cheminée est ici un « brasier ardent », et le ton de la conversation entrecoupée par la rêverie remplace le « cri général » du Corésus.
La scène de Fragonard entre en résonance avec une scène diderotienne intime. On oublie que le sacrifice doit laver l’offense faite par Callirhoé à Bacchus en la personne de son prêtre, lorsqu’elle s’est refusée à lui ; on retient que Bacchus désapprouve le choix de Corésus, comme le père de Diderot avait désapprouvé son mariage. Mais ce père autoritaire est aussi un père aimant. Tout se passe comme si Fragonard fournissait à Diderot la scène de la douleur de son père face au mauvais choix de son fils préféré, et la mort du père comme une conséquence de l’échec de son couple 35. Par condensation, Diderot voit en rêve, dans sa propre mort, la mort de son père, à laquelle il n’a pas assisté en 1759 ; le fils meurt aux yeux du père, payant le prix de ce que, dans la scène réelle, le père n’est pas mort aux yeux du fils 36.
Voilà le dernier coup qui me restait à recevoir ; mon père est mort. Je ne sais ni quand ni comment. Il m’avait promis, la dernière fois que je l’ai vu, de me faire appeler dans ses derniers instants. Je suis sûr qu’il y a pensé, mais qu’il n’a pas eu le temps. Je n’aurai vu mourir ni mon père, ni ma mère. Je ne vous cacherai pas que je regarde cette malédiction comme celle du ciel. (9 juin 1759.)
Quant au défaut interne, cette défaillance que le tableau de Fragonard thématise par le sacrifice dévoyé, on peut l’identifier au défaut d’image de Diderot arrivé à Langres pour le partage des biens du père. Face à la scène des ultima momenta du père, Diderot a fait défaut. Mais sur la scène langroise, Diderot fait encore défaut, comme image défaillante du père : le philosophe ne vaut pas le coutelier, malgré la ressemblance physique.
Quand je passe dans les rues, j’entends des gens qui me regardent et qui disent : C’est le père même. Je sais bien qu’il n’en est rien, et que, quoi que je fasse, il n’en sera rien. Un de nos grands vicaires avait plus de raison peut-être, lorsqu’il me disait : Monsieur, la philosophie ne fait point de ces hommes-là. (Lettre à Grimm du 14 août 1759.)
Denis n’est pas de cette étoffe d’homme dont était son père ; Corésus comme Denis ne sont pas à la hauteur du couteau sacré, ce couteau dont Denis a refusé d’être l’artisan dans l’atelier de son père coutelier.
Dans le dialogue qu’il imagine avec Grimm au sujet de son rêve, ce dernier fait justement remarquer l’indifférenciation sexuelle des protagonistes du sacrifice :
Grimm. […] Nous avons seulement observé dans le tableau que les vêtements du grand-prêtre tenaient un peu trop de ceux d’une femme[.]
Diderot. Attendez ; mais c’est comme dans mon rêve.
Grimm. Que ces jeunes acolytes, tout nobles, tout charmants qu’ils étaient, étaient d’un sexe indécis, des espèces d’hermaphrodites.
Diderot. C’est encore comme dans mon rêve. (P. 430 ; DPV XIV 263.)
Fragonard peint les corps de Corésus et de Callirhoé baignés et réunis dans la même tache lumineuse, alors que l’histoire, à tout moment, les sépare et les oppose. L’effet général d’androgynie tient non seulement à la grâce féminine des visages et des vêtements des personnages, mais aussi à la création de ce corps mixte au cœur de la toile, Corésus et Callirhoé fondus en une masse unique, leurs visages symétriquement identiques alors que l’une revient de la mort, que l’autre y tombe.
Cette androgynie n’est pas assumée directement par Diderot, mais par son interlocuteur. C’est du dehors, par le jeu du dialogue, que cette dépression masculine peut être dite. Le dispositif de l’Antre de Platon dit cette dépression, et identifie du même coup le geste de Corésus à une protestation virile.
La relation esthétique : une relation politique
On comprend mieux, au terme de ce parcours, comment Diderot a exploité le dispositif de la caverne platonicienne pour rendre compte du Corésus et Callirhoé de Fragonard : tout d’abord la projection d’un flux virtuel d’images sur la toile tendue devant les prisonniers, au lieu de l’image fixe du tableau peint, l’a fasciné. Non seulement ce flux permettait de rendre compte de la charge onirique du Corésus, et de ses résonances les plus personnelles pour le philosophe mais, déconstruisant la structure classique de la scène, il exprimait ce qui, pour Diderot, était en train de se jouer dans l’art contemporain, notamment autour de Chardin et de Vernet, à l’avant-garde 37 de la peinture post-scénique.
Du coup, la forme même du dispositif de la caverne pose problème. Diderot a-t-il songé au rapprochement entre sa théorie du chapitre XIX du Discours de la poésie dramatique 38 et le mur platonicien depuis lequel les « marchands d’illusion » projettent leurs images ?
« entre le feu et les prisonniers il y a un chemin par en haut ; tout du long (παρ´ἤν), imagine un muret bâti en contrefort (τειχίον παροκωδομημένον), de la même façon que pour les montreurs de marionnettes, devant leur public, on installe les cloisons (πρόκειται τὰ παραφράγματα) au-dessus desquelles ils montrent leurs merveilles. » (514b 39.)
Ce mur disparaît dans le texte de Diderot, qui ne pose aucune séparation entre les « figures transparentes » que manipulent les « charlatans » devant « une grande lampe suspendue » (p. 424) et les prisonniers de la caverne.
Quelle est dès lors la motivation profonde de ce dispositif énigmatique ? S’il s’agissait de légitimer par une référence prestigieuse sa théorie dramatique de la représentation, pourquoi Diderot ne le faisait-il pas explicitement, soit dans le Discours de la poésie dramatique, soit dans l’article Fragonard de 1765 ? Toutes les lectures modernes de cet article orientent l’interprétation vers ce modèle théâtral, oubliant que, de 1758 à 1765, il s’est défait, que la scène est ici déconstruite, non seulement par Diderot, mais déjà par Fragonard, et que le séquençage du récit en tableaux y fonctionne comme un simple leurre, livré en pâture et comme par dérision à Grimm. « L’Antre de Platon » n’est pas la transposition d’un texte à l’écran.
Peut-être convient-il donc, pour comprendre les enjeux de ce dispositif, de se reporter à ce qui motive l’allégorie platonicienne dans le texte même de La République, où l’allégorie de la caverne n’est pas une allégorie esthétique, mais politique. Ce qui intéresse Socrate dans cette caverne n’est pas la position des prisonniers qui y sont enfermés, mais le trajet de ceux qui, échappant à leurs chaînes, parviennent jusqu’à la contemplation du soleil, qui est la connaissance des idées, puis quittant cette contemplation, retournent auprès de leurs anciens compagnons de captivité. Si le premier trajet, de l’obscurité vers la lumière, peut se comprendre comme une quête métaphysique de la vérité, purement individuelle et herméneutique, le trajet de retour nous ramène à la question centrale de La République, qui est politique :
après qu’ils seront montés et auront bien regardé le Bien, pas question […] qu’ils refusent de redescendre parmi ces prisonniers (παρ´ἐκείνους τοὺς δεσμώτας) ni de partager les châtiments et les récompenses qui se donnent parmi eux, les plus vils comme les plus nobles. […] Si la loi forme de tels hommes dans la cité, ce n’est pas pour que chacun ensuite aille se tourner du côté qu’il veut, mais pour les utiliser au maximum à assurer la cohésion de la république (ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως). (519d-520a 40.)
L’allégorie de la caverne décrit la formation des futurs dirigeants de la cité idéale : issus du peuple, de ses erreurs et de ses illusions, ils devront revenir au peuple et partager sa condition, si douloureux et mortifiant cela soit-il, car c’est la condition du bon gouvernement. L’aller et retour de la projection des ombres à la contemplation du soleil définit donc le circuit d’une relation dont l’enjeu est la constitution même de la république.
Dans le contexte des Salons, commencés dans la mortification des échecs de l’Encyclopédie, cette allégorie n’est pas sans résonance : regarder la peinture, c’est bien sûr faire l’expérience de cet aller et retour de la technique picturale à l’idéal du peintre et, dans cet aller et retour, défaire l’ordonnance du tableau pour refaire la cohésion du sujet, lien contre lien. Mais ce circuit de la relation esthétique est aussi, par l’œil, une expérience de la révolte où se joue le lien politique.
En témoignent ces dernières remarques, que Diderot place prudemment dans la bouche de Grimm :
Et puis un intérêt unique. De quelque côté qu’on portât les yeux, on rencontrait l’effroi : il s’élançait du grand prêtre, il se répandait, il s’accroissait par les deux génies, par la vapeur obscure qui les accompagnait, par la sombre lueur des brasiers. Il était impossible de refuser son âme à une impression si répétée. C’était comme dans les émeutes populaires où la passion du grand nombre nous saisit avant même que le motif en soit connu. (Pp. 430-1 ; DPV XIV 264.)
Le flux iconique qui précipite l’œil du bas vers le haut de la toile, de la lumière des corps blancs affaissés vers les ténèbres du Désespoir, est en même temps l’onde sensible de la révolte. Regarder la toile, c’est participer au grand frisson de l’émeute. Si l’irruption sur scène du regard effrayé et compatissant du père produit la vision d’une défection radicale de soi, la honte et la mort aux yeux du père, elle constitue en même temps, « avant même que le motif en soit connu », le ressort puissant d’une révolte contre la loi. L’atteinte intime qui envahit le spectateur prépare le retournement et la distanciation face à l’image, c’est-à-dire non seulement l’acte fondateur de toute représentation, mais la révolte constitutive de toute pensée.
II. Les scènes de la nature : une dissémination positive
La dimension politique de la relation esthétique diderotienne, qui n’est qu’esquissée dans « l’Antre de Platon », trouve sa formulation complète deux ans plus tard dans la « Promenade Vernet » du Salon de 1767. Le rapprochement des deux textes est immédiatement commandé par la réitération du procédé, puisque à nouveau Diderot prétend substituer au compte rendu attendu des tableaux vus au Salon un autre texte et une autre expérience, qui ne fera retour qu’in extremis vers la peinture. De la même façon que la scène de Fragonard, par le quart de tour qu’elle imprimait au sacrifice et par l’anti-théâtralité du suicide de Corésus, déconstruisait la scène d’histoire classique, c’est ici le paysage qui dissémine l’ancienne structure et en quelque sorte la retourne contre elle-même. Mais, de même que le Corésus ne prend sens pour Diderot que comme trajet depuis l’histoire de Pausanias jusqu’au face à face intime avec le père et avec la loi, de même le parcours des sites de Vernet a sa progression introspective et philosophique : le mécanisme spatial de la relation esthétique, éprouvé dans la promenade face à la nature, ne s’accomplit que dans le dialogue de Diderot avec l’abbé, son cicerone en promenade, dialogue d’abord esthétique, puis politique, où l’on retrouvera finalement le même enjeu, la loi, et le même interlocuteur, Socrate.
Tout commence donc comme en 1765 :
J’avais écrit le nom de cet artiste au haut de ma page, et j’allais vous entretenir de ses ouvrages, lorsque je suis parti pour une campagne voisine de la mer et renommée par la beauté de ses sites. Là, tandis que les uns perdaient autour d’un tapis vert les plus belles heures du jour, les plus belles journées, leur argent et leur gaieté ; que d’autres, le fusil sur l’épaule, s’excédaient de fatigue à suivre leurs chiens à travers champs ; que quelques-uns allaient s’égarer dans les détours d’un parc, dont heureusement pour les jeunes compagnes de leurs erreurs, les arbres sont fort discrets ; que les graves personnages faisaient encore retentir à sept heures du soir la salle à manger, de leurs cris tumultueux sur les nouveaux principes des économistes, l’utilité ou l’inutilité de la philosophie, la religion, les mœurs, les acteurs, les actrices, le gouvernement, la préférence des deux musiques, les beaux-arts, les lettres et autres questions importantes dont ils cherchaient toujours la solution au fond des bouteilles, et regagnaient, enroués, chancelants le fond de leur appartement dont ils avaient peine à retrouver la porte, et se remettaient dans un fauteuil, de la chaleur et du zèle avec lesquels ils avaient sacrifié leurs poumons, leur estomac et leur raison pour introduire le plus bel ordre possible dans toutes les branches de l’administration ; j’allais, accompagné de l’instituteur des enfants de la maison, de ses deux élèves, de mon bâton et de mes tablettes, visiter les plus beaux sites du monde. Mon projet est de vous les décrire, et j’espère que ces tableaux en vaudront bien d’autres. (P. 594 ; DPV XVI 174-5.)
Ses ouvrages, ses sites 41 : d’emblée, le pluriel annonce la dissémination. Le lieu même, « une campagne voisine de la mer », n’est pas homogène. À la multiplicité des sites correspond la bigarrure du lieu depuis lequel Diderot écrit, où l’on reconnaît la société du Grandval, chez le baron d’Holbach 42. La scène du château se défait en table de jeu, partie de chasse, galanteries dans le parc et propos de table ; la promenade, faisant défiler les sites, défera de même le tableau en points de vue éclatés et changeants. La bigarrure de la société du château préfigure en quelque sorte la dissémination de la scène peinte en paysage, c’est-à-dire en scène vidée et éclatée. Le château lui-même est posé comme non lieu, préparant aux non lieux des sites parcourus : « je suis parti pour une campagne », « là », « un tapis vert », « à travers champs », « les détours d’un parc », « la salle à manger ». Toutes les métonymies possibles sont déployées pour ce château qui n’est jamais nommé que par ses dépendances ou ses parties 43.
Fuyant la scène sociale du château, Diderot va vers les « sites », les « tableaux », les « scènes » que lui offre la nature : l’extériorité vague de la promenade ne servira pas de cadre à la scène d’un récit dans le château. La polarité scénique normale (une scène dans un lieu, une campagne autour), s’inverse, livrant le récit au vague d’une déambulation indéterminée, que marque la répétition de ce « j’allais », employé absolument et à l’imparfait :
Nous voilà partis. Nous causons. Nous marchons. J’allais la tête baissée, selon mon usage ; lorsque je me sens arrêté brusquement, et présenté au site que voici. (P. 594 ; DPV XVI 175.)
Le site fait scène 44, une scène théâtralement marquée par le temps d’arrêt qu’elle provoque : « la surprise du premier coup d’œil », le temps d’arrêt 45, rééditent en la naturalisant la surprise de l’amour pétrarquiste 46. Diderot décrit dans ce premier site 47 une disposition très particulière des rochers :
A ma droite, dans le lointain, une montagne élevait son sommet vers la nue. Dans cet instant, le hasard y avait arrêté un voyageur debout et tranquille. Le bas de cette montagne nous était dérobé par la masse interposée d’un rocher ; le pied de ce rocher s’étendait en s’abaissant et en se relevant, et séparait en deux la profondeur de la scène. (Suite du précédent.)
Séparée en deux, la scène fait jouer l’un contre l’autre un espace proche et un espace lointain. À l’interface de ces deux espaces, le regard absorbé d’un spectateur qui ne se sait pas vu marque l’articulation scopique du dispositif. Interposition, séparation qui dérobe, sont ici les maîtres mots qui perpétuent le dispositif d’écran et la logique d’effraction dans une scène qui paraissait a priori totalement désertée, vidée, déconstruite.

La peinture contre la nature : un sublime matérialiste
D’abord entraîné par son cicerone, Diderot s’est vite repris de son admiration première :
C’est sans contredit une grande chose que cet univers. Mais quand je le compare avec l’énergie de sa cause productrice, si j’avais à m’émerveiller, c’est que son œuvre ne soit pas plus belle et plus parfaite encore. C’est tout le contraire, lorsque je pense à la faiblesse de l’homme, à ses pauvres moyens, aux embarras et à la courte durée de sa vie, et à certaines choses qu’il a entreprises et exécutées. (P. 596 ; DPV XVI 178.)
Ici se prépare le paradoxe philosophique qui justifie l’ensemble du dispositif de la Promenade Vernet : si les tableaux de Vernet ne sont admirables que parce qu’ils imitent bien la nature, l’imitation est plus admirable que la nature même car elle est une production de l’homme. L’abbé ne peut que se scandaliser d’une telle opinion, profondément irréligieuse. Il se tait pourtant d’abord, tout à son admiration :
Nous allions par des sentiers étroits et tortueux, et je m’en plaignais un peu à l’abbé. Mais lui se retournant, s’arrêtant subitement devant moi et me regardant en face, me dit, avec exclamation, “Monsieur, l’ouvrage de l’homme quelquefois plus admirable que l’ouvrage de Dieu ! monsieur !“ (P. 597 ; DPV XVI 179.)
L’abbé n’énonce pas son point de vue mais, avec ironie et indignation, celui de son antagoniste. Non seulement nous lisons sous la plume de Diderot les paroles de l’abbé incorporant la parole de Diderot, mais surtout l’abbé marquant face à Diderot un arrêt accompagne donc cet énoncé qui n’est pas de lui du geste, de l’attitude même qu’avait eue d’abord Diderot, spectateur suspendu d’admiration face au site que lui présentait son cicerone.
L’enjeu philosophique du premier et du second site est bien celui-là : Diderot se promenant dans les montagnes à la rencontre des scènes sublimes que lui offre la nature réitère le voyage de Saint-Preux dans les montagnes du Valais 48 et la promenade d’Émile avec son précepteur au coucher du soleil 49, ou plus exactement il leur répond ; l’ensemble de la « Promenade Vernet » est imprégné de Rousseau, rentré d’Angleterre depuis mai 1767. Diderot marque son arrêt émerveillé devant les sites ; mais c’est ensuite l’abbé qui répercute cet arrêt face à Diderot, un arrêt non plus émerveillé, mais indigné : la contemplation béate, l’effusion stupéfaite devant le paysage n’a qu’un temps, que relaye un dialogue opposant celui qui croyait au ciel et celui qui n’y croyait pas 50.

La mésaventure d’un tourbillon de poussière venant offusquer la vue de l’abbé viendra à propos appuyer la démonstration : la sublime exaltation qu’avait déclenchée le paysage se retourne, se renverse en douleur et en aveuglement. L’abbé se voit forcé par la nature même de prendre la posture de l’aveugle, posture qui est aussi bien celle du fanatique chrétien aux yeux bandés dans La Promenade du sceptique que celle de son antagoniste, Saunderson l’athée, dans la Lettre sur les aveugles, deux façons convergentes en fait de barrer le discours de la foi.
L’« épais tourbillon de poussière » n’intervient pas ici indifféremment : il y a toute une littérature du tourbillon, qui remonte à Descartes 51 et dont les Entretiens sur la pluralité des mondes de Fontenelle (1686) font leur miel :
Ce qu’on appelle un Tourbillon, c’est un amas de matière dont les parties sont détachées les unes des autres, et se meuvent toutes en un même sens ; permis à elles d’avoir pendant ce temps-là quelques petits mouvements particuliers, pourvu qu’elles suivent toujours le mouvement général 52.
Le tourbillon n’introduit pas un désordre dans la nature ; il n’est pas « une image passagère du chaos, suscitée fortuitement au milieu de l’œuvre merveilleux de la création » (p. 602 ; DPV XVI 186). C’est tout au contraire le modèle de représentation et d’explication de l’univers, modèle matérialiste très ancien, qu’on rencontrait déjà chez Lucrèce, sous la forme du clinamen 53. Ce qui fait désordre dans l’œil aveuglé de l’abbé manifeste un autre ordre, l’ordre matérialiste, tourbillonnaire, en un mot révolté, de la nature. Pour que cet ordre se manifeste, un aveuglement est nécessaire, c’est-à-dire l’interposition d’un écran, l’écran des corpora caeca du tourbillon. À l’écran des rochers, puis des nuages interposés dans le paysage, correspond l’écran du tourbillon dans le dialogue, disséminant, et par là renforçant un même dispositif. Le corps de l’abbé, son œil aveugle, porte donc le contenu de la parole de Diderot, ou plus exactement reçoit l’atteinte, la blessure idéologique que produit cette parole 54.
« Une espèce de pont » : interception et réversion scopique
L’écran interposé revient de façon récurrente au cours de la promenade 55. On est tenté, dans un premier temps, d’identifier, dans le premier site, « Le bas de cette montagne nous était dérobé par la masse interposée d’un rocher » (p. 595), avec, dans le second site, le trajet de Diderot et de l’abbé « dans un lointain fort au-delà des montagnes que nous avions grimpées et qui nous le dérobaient » (p. 598). C’est bien le même jeu de l’écran, qui dérobe puis expose, ou ne dérobe que pour mieux exposer. Mais la disposition des lieux a changé. Dans le trajet, par la promenade, le site se dévoile, mais le tableau se défait, son lointain devenant proche : à la progression, qui est à la fois celle du texte et de la promenade, se superpose l’échange, la littérale interversion du premier et de l’arrière-plan. :
Après une marche assez longue, nous nous trouvâmes sur une espèce de pont, une de ces fabriques de bois hardies et telles que le génie, l’intrépidité et le besoin des hommes en ont exécutées dans quelques pays montagneux. Arrêtés là, je promenai mes regards autour de moi et j’éprouvai un plaisir accompagné de frémissement. […] Devant moi, comme du sommet d’un précipice, j’apercevais les deux côtés, le milieu, toute la scène imposante que je n’avais qu’entrevue du bas des montagnes. J’avais à dos une campagne immense qui ne m’avait été annoncée que par l’habitude d’apprécier les distances entre des objets interposés. Ces arches que j’avais en face il n’y a qu’un moment, je les avais sous mes pieds (p. 599).
Le pont délimitait jusqu’ici un horizon ; il constitue désormais un seuil 56.

Depuis le pont s’ouvre le nouveau point de vue, panoramique (« je promenai mes regards autour de moi »), et se dessine le cercle de la nouvelle scène circonscrite par le trajet de la promenade, cette « chaîne de montagnes dont j’occupe le sommet, et qui forment avec celles que j’ai quittées un amphithéâtre en entonnoir » 57.
La réversion dans le paysage du proche et du lointain, de l’en deçà et de l’au-delà, s’accompagne d’une autre réversion qui touche au cadre énonciatif même de la Promenade Vernet, comme en témoigne la sortie du second site :
Le jour commençait à tomber ; nous ne laissions pas que d’avoir du chemin à faire jusqu’au château. Nous gagnâmes de ce côté, l’abbé faisant réciter à l’un de ses élèves ses deux fables, à l’autre son explication de Virgile, et moi, me rappelant les lieux dont je m’éloignais, et que je me proposais de vous décrire à mon retour. Ma tâche fut plus tôt expédiée que celle de l’abbé. A ces vers, Vere novo, gelidus canis cum montibus humor liquitur, et Zephyro putris se gleba resolvit, je rêvai à la différence des charmes de la peinture et de la poésie, à la difficulté de rendre d’une langue dans une autre les endroits qu’on entend le mieux. (P. 601 ; DPV XVI 185.)
« Au retour du printemps, quand la glace des blanches cimes se fond en eau et que, sous le Zéphyr, la terre se dissout en boue », disent les vers des Géorgiques (I, 43-4) : la neige puis la terre se défont. Liquitur et resolvit sont les verbes de la dissémination, anticipant dans le texte la dissémination du trajet des promeneurs (« du chemin à faire jusqu’au château ») dans le paysage (« les lieux dont je m’éloignais »). L’énonciation même est dissémination : la récitation et la paraphrase (« deux fables » et une « explication de Virgile ») font éclater la ligne du discours poétique en fragments ressassés, comme le paysage éclate en vues et en saynètes. Par ces exercices de latin, la promenade met en scène le processus de sa représentation et, au-delà, le problème général de la peinture de paysage classique : il faut d’abord des vers de Virgile pour motiver l’image, car le modèle de la peinture d’histoire demeure la base de la représentation. Virgile fonde l’ekphrasis, qui accomplit la performance. Mais Virgile peine à être traduit, l’exercice ne finit pas, et si le paysage vu est, dans l’esprit de Diderot, presque déjà décrit, le paysage virgilien reste intraduisible : par la dissémination, le paysage déconstruit l’histoire comme base obligée de la peinture.
Toute la Promenade Vernet s’organise autour d’un face à face qui est d’abord celui de la peinture et de la nature, puis celui de la peinture et de la poésie. Le premier face à face pose le problème du statut du paysage en peinture ; le second engage globalement le statut de la peinture, voire, indépendamment du support de la représentation, de l’image en général dans le processus de la représentation. L’articulation de ces deux face à face s’opère sur le mode de la réversion du premier dans le second et constitue le dispositif de la Promenade : la confrontation entre nature et peinture déconstruit le support de la représentation, virtualise la toile, permettant, à un niveau supérieur, de rétablir l’ut pictura poesis à partir de matériaux hétérogènes, et de refonder par cet attelage le processus de la représentation.
Le chiasme est la modalité textuelle de cette réversion. Indigné que Diderot ose comparer les tableaux de Vernet au spectacle de la nature, et peut-être les préférer, l’abbé s’exclame :
Vous avez beau dire Vernet, Vernet, je ne quitterai point la nature pour courir après son image : quelque sublime que soit l’homme, ce n’est pas Dieu. (P. 596.)
L’abbé refuse de quitter ses montagnes pour aller visiter le Salon comme l’y avait invité Diderot, car le Salon ne contient que des images de la nature, donc des succédanés, de pâles imitations. L’homme n’est pas Dieu : Vernet, simple artiste, n’est pas le grand Démiurge et ne peut rivaliser avec lui. Mais la formule de l’abbé utilise le mot image au singulier et superpose, identifie la nature à Dieu : du lexique esthétique, on passe ainsi subrepticement au lexique théologique, pour lequel l’image de Dieu, c’est d’abord l’homme. Il s’agit, théologiquement, de ne pas quitter Dieu pour courir après l’homme, car, quelque sublime que soit l’homme, ce n’est pas Dieu. Le chiasme, avec son circuit en huit, son jeu de réversion verbale, est donc sous-jacent à la disjonction apparente qu’établit le discours de l’abbé : d’un côté, la nature et Dieu, tout ce qui est admirable ; de l’autre, la peinture et l’homme, tout ce qui est imparfait et dont il convient de se défier. Mais le circuit, au lieu d’opposer l’homme à Dieu, englobe celui-là dans Celui-ci et fait résonner le vieil interdit judaïque : « son image… ce n’est pas Dieu » ; l’abbé redit la vieille défiance biblique vis-à-vis des images.
Diderot oppose à l’abbé chiasme contre chiasme, mais en inversant le rapport d’inclusion, puisque Vernet devient le terme englobant, et que la nature est ainsi par lui circonscrite :
si Vernet vous eût appris à mieux voir la nature, la nature, de son côté, vous eût appris à bien voir Vernet (P. 596).
Il faut aller voir Vernet au Salon pour apprendre, ensuite, à regarder les sites qu’offre la nature : la peinture est une éducation de l’œil. Mais cette éducation inverse le rapport du modèle à l’imitation : c’est la peinture qui devient le modèle, cette belle nature qui permet de juger la nature et, dans le site réel, de repérer des défauts de composition. Les défauts du spectacle naturel nous apprennent alors à bien voir Vernet, à goûter les embellissements auxquels il a pourvu. Diderot décrit ici l’aller et retour qui est le sien et que mime la Promenade, du Salon à la nature, pour revenir de la nature au Salon.
Le chiasme organise, par dessus une disjonction logique (la nature/le peintre), une inclusion verbale (Vernet-nature/nature-Vernet : la nature est dans Vernet) : à l’extériorité rationnelle d’une opposition discursive, il superpose l’intériorité imaginaire d’une absorption que visualise la disposition des mots, que fait entendre la boucle verbale du retour au même. Pour le contenu, la réplique de Diderot contredit celle de l’abbé ; mais formellement, elle récupère la structure du chiasme qu’il n’avait qu’ébauchée et elle la parachève. On a vu de la même façon comment l’abbé répétait avec indignation la proposition avancée par son antagoniste, « l’ouvrage de l’homme quelquefois plus admirable que l’ouvrage de Dieu ! », incorporant d’abord son discours, non pas tant pour s’en démarquer que pour le retourner en lui-même. Le dialogue ne se constitue pas de l’alternance de deux discours antagonistes, mais de la réversion constante de la parole de l’autre, réversion qui fait tableau comme une inclusion.
Pour convaincre son interlocuteur, Diderot recourt à une double métaphore. C’est d’abord le coup de dés :
Si j’avais là un boisseau de dés, que je renversasse ce boisseau, et qu’ils se tournassent tous sur le même point, ce phénomène vous étonnerait-il beaucoup ?… “Beaucoup.”… Et si tous ces dés étaient pipés, le phénomène vous étonnerait-il encore ?… “Non”… (P. 597 ; DPV XVI 179.)
Le coup de dés, qui figure ici indifféremment la création du site ou du tableau, est encore une figure du renversement (« que je renversasse ce boisseau ») qui prépare celle du tourbillon de poussière (« qu’ils se tournassent ») : le désordre de l’aléa s’y renverse en nécessité des dés pipés, identifiant l’ordre naturel à une gigantesque tricherie.
— L’abbé, à l’application. Ce monde n’est qu’un amas de molécules pipées en une infinité de manières diverses. Il y a une loi de nécessité qui s’exécute sans dessein, sans effort, sans intelligence, sans progrès, sans résistance dans toutes les œuvres de nature.
La nature n’est pas sublime : on n’admire pas le résultat que produisent des dés pipés. L’image des dés et du boisseau est bien celle d’un dehors et d’un dedans, d’une inclusion et d’une exclusion, dans laquelle les rapports attendus sont renversés : à l’artiste, le coup de génie ; à la nature, un jet de dés pipés.
Si l’on inventait une machine qui produisît des tableaux tels que ceux de Raphael, ces tableaux continueraient-ils d’être beaux… “Non”… Et la machine ?… “Lorsqu’elle serait commune, elle ne serait pas plus belle que les tableaux”... Mais d’après vos principes, Raphael n’est-il pas lui-même cette machine à tableaux. … “Il est vrai”. Mais la machine Raphael n’a jamais été commune. Mais les ouvrages de cette machine ne sont pas aussi communs que les feuilles de chêne. Mais par une pente naturelle et presque invincible nous supposons à cette machine une volonté, une intelligence, un dessein, une liberté. Supposez Raphael éternel, immobile devant sa toile, peignant nécessairement et sans cesse. Multipliez de toutes parts ces machines imitatrices. Faites naître les tableaux dans la nature, comme les plantes, les arbres et les fruits qui leur serviraient de modèles, et dites-moi ce que deviendrait votre admiration. Ce bel ordre qui vous enchante dans l’univers ne peut être autre qu’il est. Vous n’en connaissez qu’un et c’est celui que vous habitez. Vous le trouvez alternativement beau ou laid, selon que vous coexistez avec lui d’une manière agréable ou pénible. (P. 597 ; DPV 179-180.)
La parabole de la machine Raphaël ne se contente pas de substituer, dans le duel de l’artiste et de la nature, le parangon des peintres d’histoire classiques au Vernet paysagiste contesté ; elle intervertit les positions du peintre et de la nature. Raphaël, ce peintre si parfait qu’il en cesse d’être admirable, c’est la nature, « peignant nécessairement et sans cesse » : sa perfection même le dessert. Raphaël est une machine, la machine même, globale, de la nature, tandis que les ouvrages de la nature, « aussi communs que les feuilles de chêne », se disséminent et dispersent l’attention 58.
À l’interversion de la nature et de l’artiste vient se superposer l’interversion du spectateur interlocuteur et du peintre, par le recours aux impératifs à la deuxième personne : « Supposez… Multipliez… Faites naître… ». Comme dans les comptes rendus des peintures, où ces formules sont monnaie courante, le lecteur est par ce biais invité à produire lui-même, virtuellement, les tableaux et, par là, à les inclure en lui au lieu de leur faire face. « Faites naître les tableaux dans la nature, comme les plantes, les arbres et les fruits qui leur serviraient de modèles » : l’impératif ordonne une double inclusion, du tableau dans la nature, d’abord, (c’est le site, le dispositif même de la Promenade), mais aussi, dans un second temps, de la nature dans l’imagination créatrice qui devient alors son modèle. Nous voici sommés d’imaginer que les tableaux serviront de modèles aux fruits qu’ils représentent et, par là, d’absorber, d’inclure en nous-mêmes cette modélisation inversée. Il y a là encore quelque chose du vertige chiasmatique, qui demeure bien la forme textuelle de la réversion scopique :
Faites naître (= modèle) les tableaux dans la nature,
comme
les plantes, les arbres et les fruits (= nature) qui leur serviraient de modèles
La parabole de la machine Raphaël fascine aujourd’hui car Diderot y met en scène, pour ainsi dire fortuitement, la concurrence de l’image manuelle, unique, du peintre, et de l’image mécanique, reproductible, du photographe. À l’artiste des œuvres admirables, dont la singularité altière exprime « une volonté, une intelligence, un dessein, une liberté », il oppose un Dieu froidement technicien, le Dieu de l’éternel retour des dés pipés, « immobile devant sa toile, peignant nécessairement et sans cesse », Dieu photographe clichant la nature de toutes parts en son sein. La sacralisation somme toute assez conservatrice du peintre créateur a un prix : le mépris épicurien du Dieu créateur, l’acceptation d’une indifférence universelle du monde.
Diderot fait ainsi échec aux manigances chrétiennes de l’abbé : le sublime des paysages ne le convertit pas à la providence du meilleur des mondes ; le tourbillon de poussière demeure pour lui le modèle physique d’un ordre naturel matérialiste, au grand dam de l’abbé aveuglé, aveuglé face à la nature comme il est raisonnable, pour l’athée, de figurer le croyant. Le tourbillon, reçu d’abord comme un désordre de la nature, se révèle finalement constituer le modèle même de l’ordre naturel ; de même, le trajet de la promenade, qui détruit la structure classique du tableau, avec sa perspective fixe et son point de vue immobile, modélise la nouvelle conception, naturalisée, du tableau, fondée sur l’aller et retour du spectateur au point de mire qu’il vise, dans une promenade réelle ou virtuelle dont le terme l’enveloppe et fait à son tour de lui, ou à défaut de son trajet, un tableau. Le second site en fait la démonstration par le trajet de la promenade de part et d’autre du pont, le pont figurant, au cœur du site, l’axe de la réversion constitutive du tableau. Le pont a été le lieu depuis lequel regarder le site, avant de devenir l’écran par quoi se referme la scène dans le site : l’inclusion du pont, son passage du dehors par quoi s’embraye la représentation au dedans qui l’habite et la structure, est l’événement majeur du second site.
Virgile, Lucrèce, Rousseau : l’histoire quand même
Mais la promenade commencée au premier site ne s’achève qu’au troisième. Nécessairement, elle décrit elle-même un circuit et suppose le retour au château : le château, point de départ externe depuis lequel aller voir des sites, devient alors le point de mire des promeneurs de retour et constitue le cœur du troisième site, selon la même réversion qui avait placé le pont au cœur du second 59 :
Et nous distinguions très bien le long de la terrasse, et autour de l’espace compris entre la tourelle et les mâchicoulis, différentes personnes, les unes appuyées sur le parapet de la terrasse, d’autres sur le haut des mâchicoulis ; ici il y en avait qui se promenaient ; là d’arrêtés debout qui semblaient converser… M’adressant à mon conducteur, Voilà, lui dis-je, encore un assez beau coup d’œil… “Est-ce que vous ne reconnaissez pas ces lieux”, me répondit-il… Non… “C’est notre château”… Vous avez raison… “Et tous ces gens-là qui prennent le frais, à la chute du jour ; ce sont nos joueurs, nos joueuses, nos politiques, et nos galants… (Pp. 602-3 ; DPV XVI 188.)
Ce n’est pas le paysage grandiose baigné de la lumière du couchant ; ce sont les personnages installés de part et d’autre du château, à gauche sur la terrasse, à droite sur l’esplanade où se dresse la tour, qui intéressent Diderot, décidé à déjouer par tous les moyens les prestiges du sublime. Par défi, il minimise l’effet auprès de son interlocuteur, l’abbé : le site se réduit négligemment à « un assez beau coup d’œil ». L’abbé invite alors Diderot à reconnaître le château de cette Marine de Vernet comme le château même du Grandval dont ils sont partis : « Est-ce que vous ne reconnaissez pas ces lieux, me répondit-il. » Diderot ne reconnaît rien et pour cause : ce bord de mer italien est bien difficile à accorder avec les Alpes des deux premiers sites, elles-mêmes bien éloignées des campagnes du Grandval francilien 60… Diderot pointe ici le déjointage 61 de la fiction au moment où se referme la boucle de la promenade, et où au « coup d’œil » du promeneur répondent les yeux braqués des habitants du château.
Pour aller plus vite et s’éviter de la fatigue, les promeneurs décident en effet de traverser l’anse de mer dans la barque d’un pêcheur, créant ainsi l’événement pour les badauds de l’autre rive :
Ce qui fut dit, fut fait. Nous voilà embarqués, et vingt lorgnettes d’opéra braquées sur nous, et notre arrivée saluée par des cris de joie qui partaient de la terrasse et du sommet du château. Nous y répondîmes selon l’usage. Le ciel était serein. Le vent soufflait du rivage vers le château ; et nous fîmes le trajet en un clin d’œil. Je vous raconte simplement la chose. Dans un moment plus poétique, j’aurais déchaîné les vents 62, soulevé les flots, montré la petite nacelle tantôt voisine des nues, tantôt précipitée au fond des abîmes ; vous auriez frémi pour l’instituteur, ses jeunes élèves, et le vieux philosophe votre ami. J’aurais porté de la terrasse à vos oreilles, les cris des femmes éplorées. Vous auriez vu sur l’esplanade du château des mains levées vers le ciel ; mais il n’y aurait pas eu un mot de vrai. Le fait est que nous n’éprouvâmes d’autre tempête que celle du premier livre de Virgile que l’un des élèves de l’abbé nous récita par cœur ; et telle fut la fin de notre première sortie ou promenade. (P. 604 ; DPV XVI 189-190.)
Il faut souligner ici la dimension parodique de ce retour en fanfare où le dispositif de la Promenade Vernet renverse le regard : ce n’est plus ni Diderot, ni l’abbé qui, de leur coup d’œil souverain, délimitent les sites spectaculaires et théâtralisent les scènes de la nature. C’est, depuis le fond du site, « vingt lorgnettes d’opéra », profanes et frivoles, qui les fixent ironiquement, eux qui, dérisoirement drapés dans leur culture virgilienne, « faisaient tableau d’une façon inénarrable », « faisaient tant soit peu tache dans le tableau » 63.
Brutalement, la verve diderotienne tourne court : « Je vous raconte simplement la chose ». Tout l’appareil poétique de l’humanisme est renvoyé au placard comme n’étant plus de mise. La prétérition épique, cette dénégation de tempête virgilienne n’est là que pour souligner le ridicule de la scène d’opéra à laquelle ils se sont livrés plus ou moins complaisamment.
Bien sûr, ce n’est pas ici avec le pêcheur, c’est avec l’abbé que se joue ce renversement : l’abbé est le chef d’orchestre de ce retour en fanfare dont il a eu l’initiative ; il reprend la main dans le dialogue qui l’opposait à Diderot et où le matérialiste avait marqué des points. L’abbé produit une vraie scène picturale classique, avec des spectateurs en face, sur la terrasse et l’esplanade, et un support poétique virgilien qu’il s’offre le luxe de faire déclamer par son élève le temps de la traversée : en même temps que Diderot rentre, la scène fait retour, comme structure archaïque et dépassée. Si la scène est ridicule, c’est parce qu’elle parodie le dispositif d’ensemble de la Promenade Vernet, qui prétend installer des tableaux dans la nature. Confronté brutalement au regard des hôtes du Grandval, Diderot fait tableau par l’artifice de son dispositif. Le renversement du point de vue n’est donc pas ici seulement renversement géométral entre le devant et le fond de la scène : il met en œuvre une réversion plus profonde qui, par la parodie, dans un travail de la négativité, retourne la dissémination de la peinture dans les sites en refondation sémiologique et philosophique. Pris entre deux feux, entre le « coup d’œil » liminaire du troisième site et les lorgnettes d’opéra braquées sur lui, Diderot théâtralise le va-et-vient oscillatoire de la pulsion scopique constitutive du nouveau regard de et sur la peinture : à la fois au seuil et au centre, il défait le tableau classique, mais fonde le faire tableau moderne.
Cette tempête imaginaire, que Diderot aurait pu susciter devant le château, invite à un rapprochement avec un épisode de la réalisation des Ports de France par Vernet. Vernet n’avait en principe pas le choix des points de vue depuis lesquels les ports devaient être peints : ceux-ci avaient été fixés à l’avance à Paris, dans un « Itinéraire » élaboré par un certain Pèlerin, premier commis de la Marine. Mais lorsqu’il arrive à Sète en 1757, il prend l’initiative d’une scène picturale qui n’était pas prévue :
le plus beau point de vue sera du côté de la mer. […] J’auroy là occasion de faire sur le devant du tableau une mer un peu en mouvements et peut-être en fairoy-je une tempête, ce qui produiroit un effet assez rare dans le nombre des tableaux que j’ay à faire pour le Roy, qui peignent ordinairement l’intérieur des ports. (Lettre de Vernet à Marigny.)
Marigny proteste et refuse : on ne verra plus le port, ce ne sera pas ressemblant, il faut respecter « le projet de ce tableau, tel qu’il est dans l’Itinéraire que je vous ai remis ». Vernet persiste et désobéit 64. Marigny, beau joueur, reconnaîtra finalement : « A l’égard de vos deux derniers tableaux que vous m’avez envoyés, je vous dirai sans exagération que je suis dans l’enchantement, et surtout celui de Cette 65. »
Contre l’exigence marchande d’une visibilité topographique des lieux, Vernet avait réagi en peintre, pour qui la scène impose, même de façon décalée, disséminée, un certain rapport à l’histoire, et exige l’événement. La mer, c’est la tempête, parce que le texte le plus célèbre sur la mer est le récit de la tempête qui projette la flotte d’Énée sur les rivages de Carthage au début de l’Énéide. Au moins une fois dans la série des Ports de France, Vernet impose que cette référence historique (au sens où les peintres entendent le mot histoire) soit rappelée : la Vue du Port de Cette en Languedoc n’est donc pas une exception parmi les Ports de mer, mais plutôt le rappel de l’ancienne règle, de la norme dépassée, à partir de laquelle les autres ports dissémineront la scène classique.
Pour le philosophe, le retour en bateau sous le regard des hôtes du château renvoie par ailleurs à un autre texte célèbre, celui du Suave mari magno de Lucrèce : quand la mer est grosse et que les vents font tourbillonner la mer, rappelle l’épicurien romain, il est bien doux de contempler depuis la terre ferme la grande souffrance d’autrui 66. Le retour au château installe dans la nature le dispositif sur lequel s’ouvre le livre II du De rerum natura, à cette différence près que l’e terra spectare, le regard depuis la terre ferme, n’y est pas celui du philosophe, qui se trouve ici dans la nacelle, immergé donc dans la nature.
Lucrèce fait du spectacle de la tempête depuis la terre ferme une allégorie de l’ascèse philosophique, l’esprit du sage se détachant du monde qui fait souffrir pour revenir à la nature et trouver le bonheur dans une vie simple. Le spectacle de la tempête n’est donc qu’un prélude au tableau opposé, celui de la quiétude champêtre, image vraie du bonheur opposée au luxe urbain et à la dépravation mondaine 67. Le texte de la Promenade Vernet suit le même cheminement.
Après une nuit de sommeil réparateur, Diderot s’éveille avec une méditation très proche de celle de Lucrèce :
Le lendemain en m’éveillant, je disais voilà la vraie vie, le vrai séjour de l’homme. Tous les prestiges de la société ne purent jamais en éteindre le goût. Enchaînés dans l’enceinte étroite des villes par des occupations ennuyeuses et de tristes devoirs, si nous ne pouvons retourner dans les forêts notre premier asile, nous sacrifions une portion de notre opulence à appeler les forêts autour de nos demeures. Mais là elles ont perdu sous la main symétrique de l’art leur silence, leur innocence, leur liberté, leur majesté, leur repos. Là, nous allons contrefaire un moment le rôle du sauvage ; esclaves des usages, des passions, jouer la pantomime de l’homme de nature. Dans l’impossibilité de nous livrer aux fonctions et aux amusements de la vie champêtre, d’errer dans une campagne, de suivre un troupeau, d’habiter une chaumière, nous invitons à prix d’or et d’argent le pinceau de Vauvermans, de Berghem ou de Vernet à nous retracer les mœurs et l’histoire de nos anciens aïeux (p. 604 ; DPV XVI 190).
Comme la veille, et comme chez Lucrèce, cette mélancolique rêverie sur « l’homme de nature » et son innocence perdue met à nouveau aux prises deux tableaux antithétiques, « le vrai séjour de l’homme » et « nos somptueuses et maussades demeures ». Mais l’antithèse logique se traduit pas une inclusion spatiale : l’état de nature est installé en peinture dans les boudoirs qui le corrompent et le renient. L’inclusion, l’involution vient court-circuiter les oppositions discursives et parasiter le simple face à face.
Nous ne sommes pas, comme dans la tradition de l’Hercule à la croisée des chemins, confrontés au choix entre deux modes de vie, deux postures morales antithétiques. Diderot constate, avec regret, l’impossibilité d’un tel choix : la ville, l’état de société sont notre prison. C’est de cette servitude que naît le désir, le besoin de peinture : il s’agit de faire entrer la nature sur les murs des maisons faute de pouvoir sortir des maisons pour retourner à la nature ; la peinture supplée la chimère de l’état de nature.
La déconstruction de l’antithèse classique 68 (la nature contre la société ; l’innocence contre le luxe) au profit d’une involution (les tableaux dans les palais, jouir de la nature dans le luxe) modifie radicalement le propos philosophique, puisqu’elle y introduit la question de la représentation, faisant de l’esthétique le nouveau terrain de la pensée politique.
Ces « pantomimes de l’homme de nature » qu’évoque Diderot à son lever, dans sa chambre du Grandval après la longue promenade de la veille, les hôtes du château lui en fournissent les figures : ne les a-t-il pas esquissées, dans le préambule de la Promenade Vernet, répétées durant le cheminement du troisième site ? Contrairement à lui, les mondains du château demeurent en deçà de la rupture que le dispositif de la Promenade introduit. Car paradoxalement, ce que Diderot moraliste fustige, le recours à la peinture pour suppléer la nature dans les palais, est ce que son dispositif textuel accomplit, qui prétend faire entrer la nature dans le compte rendu des tableaux, donner l’illusion d’une évasion hors du Salon, d’une abolition des artifices de la représentation, d’une promenade réelle et d’un retour symbolique à l’innocence de la nature, illusion qui relève de l’exercice le plus raffiné de la culture et de la représentation, qui passe par la pratique verbale la plus anti-naturelle qui soit, le feu d’artifice rhétorique de l’ekphrasis.
En identifiant la peinture de paysage à la rêverie sur l’état de nature, Diderot vise Rousseau. Dans le Discours sur les sciences et les arts (1750), Rousseau commence par opposer la décadence des grands empires aux mœurs des peuples vertueux :
« Opposons à ces tableaux celui des mœurs du petit nombre de Peuples qui, préservés de cette contagion des vaines connaissances ont par leurs vertus fait leur propre bonheur et l’exemple des autres Nations. » (Jean Jacques Rousseau, Œuvres complètes, t. III, éd. B. Gagnebin et M. Raymond, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, p. 11.)
L’opposition de deux séries de tableaux, celle des mœurs innocentes et celle des mœurs corrompues, fonctionne a priori comme une antithèse rhétorique, d’autant que ces tableaux ne sont pas des tableaux réels, mais des hypotyposes. Par elles, le discours commence par organiser l’exclusion radicale et réciproque de l’innocence et de la corruption.
Dans la seconde partie du discours, cependant, c’est bien la peinture réelle et concrète qui est convoquée, tandis que l’opposition première se complique :
Carle, Pierre 69, le moment est venu où ce pinceau destiné à augmenter la majesté de nos Temples par des images sublimes et saintes, tombera de vos mains, ou sera prostitué à orner de peintures lascives les panneaux d’un vis-à-vis 70. Et toi, rival des Praxiteles et des Phidias ; toi dont les anciens auroient employé le ciseau à leur faire des Dieux capables d’excuser à nos yeux leur idolatrie ; inimitable Pigal 71, ta main se resoudra à ravaler le ventre d’un magot 72, ou il faudra qu’elle demeure oisive.
On ne peut réfléchir sur les mœurs, qu’on ne se plaise à se rappeller l’image de la simplicité des premiers tems. C’est un beau rivage, paré des seules mains de la nature, vers lequel on tourne incessamment les yeux, et dont on se sent éloigner à regret. (Op. cit., pp. 21-22.)
Le message général est que la peinture est le symptôme avancé de la corruption des mœurs. À cette peinture réelle, dégénérée et prostituée, s’oppose « l’image de la simplicité des premiers temps », un tableau virtuel donc. Du coup, l’opposition boîte. Ce ne sont plus deux séries de tableaux qui s’opposent : par la réflexion sur les mœurs, la contemplation désolante d’un art corrompu suscite, en contre-feu, l’image mentale et vertueuse de la nature. L’image se renverse et l’œil se révolte : « On ne peut réfléchir sur les mœurs, qu’on ne se plaise à se rappeller l’image de la simplicité des premiers tems. » L’image de la pure nature surgit du cœur de la réflexion sur la nature corrompue, elle-même symptomatisée par la ruine de la peinture 73.
Or le tableau nostalgique de la nature perdue correspond étrangement à ce que Diderot, dans la Marine du troisième site, aurait pu voir de sa nacelle en se retournant derrière lui : devant, la société du Grandval, avec ses pantomimes mondaines ; derrière, « un beau rivage, paré des seules mains de la nature, vers lequel on tourne incessamment les yeux, et dont on se sent éloigner à regret ». La Marine de Vernet retourne en quelque sorte l’image rousseauiste de la nature.
Au sein de la corruption, nos yeux suscitent avec nostalgie l’image de l’état de nature : le dispositif est virtuellement présent dans le discours de Rousseau ; il devient chez Diderot installation réelle, où les deux temps du discours rousseauiste, luxe de la peinture puis nostalgie du rivage perdu, se trouvent confondus.
et les murs de nos somptueuses et maussades demeures se couvrent des images d’un bonheur que nous regrettons ; et les animaux du Berghem ou de Paul Potter paissent sous nos lambris, parqués dans une riche bordure ; et les toiles d’araignée d’Ostade sont suspendues entre des crépines d’or sur un damas cramoisi ; et nous sommes dévorés par l’ambition, la haine, la jalousie et l’amour ; et nous brûlons de la soif de l’honneur et de la richesse au milieu des scènes de l’innocence et de la pauvreté, s’il est permis d’appeler pauvre, celui à qui tout appartient. Nous sommes des malheureux autour desquels le bonheur est représenté sous mille formes diverses. O rus, quando te aspiciam 74, disait le poète, et c’est un souhait qui s’élève cent fois au fond de notre cœur. (P. 605 ; DPV XVI 190-1.)
C’est en vain que nous convoquons la nature dans les peintures de genre que nous installons dans nos riches demeures : les peintures de la méditation diderotienne sur la nature perdue sont des signes sublimes mais défaits, des images pathétiques mais vaines. D’une certaine manière, les deux philosophes partent du même constat et de la même déploration : la production artistique contemporaine a changé, la désaffection de la peinture d’histoire marque à leur grand regret l’avènement d’une esthétique du dessus-de-porte, commandée non plus par un luxe de magnificence, mais par un luxe de plaisir sans culture, sans valeur et sans gloire. Le pinceau de Nicolaes Berchem et de Philips Wouwermans retraçait au départ « les mœurs et l’histoire de nos anciens aïeux ». Les scènes d’histoire deviennent vite, plus vaguement, des « images d’un bonheur que nous regrettons », autrement dit des pastorales.
Chez Diderot, cette défection de la peinture atteint son cadre même et son statut d’objet. Il ne s’agit plus de décrire des tableaux de genre hollandais accrochés dans la demeure d’un fermier général qui esthétise par eux, et finalement à bon compte, la nostalgie de ses origines provinciales et roturières. Le texte évite le mot, l’idée même de tableau ; ce ne sont pas des tableaux, mais, par métalepse, des moutons, et les cadres dorés deviennent les bordures de leur enclos : « les animaux du Berghem ou de Paul Potter paissent sous nos lambris, parqués dans une riche bordure ». L’écriture diderotienne entremêle scènes réelles et scènes peintes, nature et luxe, disséminant les éléments de la pastorale peinte dans l’espace de la demeure et, réciproquement, les ressorts de la scène mondaine « au milieu des scènes de l’innocence et de la pauvreté ». Finalement, au terme de ce processus de dissémination, l’inclusion est inversée, renversant la pauvreté de nature en richesse du bonheur et la richesse du luxe en misère morale. Ce ne sont plus des tableaux de la nature au milieu des demeures du luxe, mais des êtres perdus par le luxe au milieu des tableaux de la nature : « Nous sommes des malheureux autour desquels le bonheur est représenté sous mille formes diverses », diverses signant la dissémination.
On voit ici quelle est la proximité intellectuelle de Diderot et de Rousseau, mais aussi en quoi leurs pensées divergent. Alors que chez Rousseau l’appel horatien au retour à la nature motive une séparation du monde et un affrontement, chez Diderot il produit la Promenade Vernet, c’est-à-dire quelque chose que l’on pourrait définir comme un dispositif d’accommodation révoltée : défaire la peinture et quitter le monde n’est ici qu’une posture momentanée, de laquelle faire retour et faire tableau. La critique morale d’un ordre social corrompu prend appui sur cette excursion virtuelle dans la nature, depuis laquelle elle fonde son point de vue. Assumant en quelque sorte une duplicité que Rousseau récuse, Diderot est ainsi à la fois dedans, participant voluptueusement de cette corruption, et dehors, la contemplant d’un œil révolté.
III. Paysage et dialogue : le circuit de la relation
« Le coup de battoir d’une blanchisseuse »
Entre la première grande promenade, jalonnée par les trois premiers sites, et les deux promenades suivantes, qui déboucheront sur le cinquième et le sixième site, le quatrième site marque en quelque sorte une pause, ou plus exactement organise une superposition : c’est depuis le château, soit de la fenêtre de sa chambre, soit de la terrasse depuis laquelle on peut admirer la montagne, que Diderot observe ce quatrième tableau naturel qui, contrairement aux autres, constitue le point de départ du texte, le seuil de la rêverie et du dialogue :
Un bruit entendu au loin, c’était le coup de battoir d’une blanchisseuse, frappa subitement mon oreille ; et adieu mon existence divine. Mais s’il est doux d’exister à la façon de Dieu, il est aussi quelquefois assez doux d’exister à la façon des hommes. Qu’elle vienne ici seulement, qu’elle m’apparaisse, que je revoie ses grands yeux, qu’elle pose doucement sa main sur mon front, qu’elle me sourie... que ce bouquet d’arbres vigoureux et touffus fait bien à droite ! cette langue de terre ménagée en pointe au-devant de ces arbres et descendant par une pente facile vers la surface de ces eaux est tout à fait pittoresque. Que ces eaux qui rafraîchissent cette péninsule, en baignant sa rive, sont belles ! Ami, Vernet, prends tes crayons, et dépêche-toi d’enrichir ton portefeuille de ce groupe de femmes. L’une penchée vers la surface de l’eau, y trempe son linge. L’autre accroupie le tord. Une troisième debout en a rempli le panier qu’elle a posé sur sa tête. N’oublie pas ce jeune homme que tu vois par le dos, proche d’elles, courbé vers le fond et s’occupant du même travail. (P. 605 ; DPV XVI 192.)
Le coup de battoir interrompt la rêverie matinale du philosophe en robe de chambre, « nonchalamment étendu dans un fauteuil », de la même façon que « ce bouquet d’arbres vigoureux et touffus », puis, plus près, « cette langue de terre ménagée en pointe au-devant de ces arbres », interrompent l’errance vague de l’œil vers les montagnes et la profondeur de l’horizon. Les blanchisseuses sont d’ailleurs installées, dans Les Occupations du rivage, à l’extrémité de ladite pointe de terre, qui deviendra plus loin dans le texte « la langue de terre aux blanchisseuses » : l’origine du bruit et la visée que se fixe l’œil se confondent 75. L’interception est à la fois sonore et visuelle : coupant en deux le temps et l’espace, elle fixe un module pour les mesurer et ouvre ainsi la possibilité d’un tableau.

De l’existence divine du rêveur, Diderot est brutalement ramené par ce coup à l’existence humaine. Il songe à Sophie, l’amante idéale : « Qu’elle vienne ici seulement, qu’elle m’apparaisse, que je revoie ses grands yeux, qu’elle pose doucement sa main sur mon front, qu’elle me sourie... » Au moment où le paysage se matérialise comme tableau devant ses yeux, la vision de Sophie absente précède immédiatement l’interposition du bouquet d’arbres : « Que ce bouquet d’arbres vigoureux et touffus fait bien à droite ! » Sophie fait écran. Comme les arbres au devant s’interposent devant les montagnes vaporeuses du lointain, Sophie s’interpose, à la fois comme vision du manque devant la plénitude de la vue et comme désir imaginaire de l’amante contre le rappel, dans le réel, par « le coup de battoir d’une blanchisseuse », de l’épouse de Diderot, Antoinette Champion, blanchisseuse de son état 76.
Contre la rêverie indéterminée qui dissémine le « moi » dans le vague du paysage, le tableau du quatrième site retourne l’atteinte intime du « coup de battoir », qui ramène Diderot au désastre de sa vie conjugale et à la souffrance que lui inflige l’absence de Sophie : « Pourquoi suis-je seul ici ? Pourquoi personne ne partage-t-il avec moi le charme, la beauté de ce site ? ». Avant le tableau, au contraire, « mes yeux étaient attachés sur un paysage admirable », une vue sans regard déployait au dehors le contentement d’un moi narcissique ivre des virtualités d’une indéfinie expansion :
le plaisir d’être à moi, le plaisir de me reconnaître aussi bon que je le suis, le plaisir de me voir et de me complaire, le plaisir plus doux encore de m’oublier. Où suis-je dans ce moment ? qu’est-ce qui m’environne ? je ne le sais, je l’ignore. Que me manque-t-il ? rien. Que désiré-je ? rien. S’il est un dieu, c’est ainsi qu’il est, il jouit de lui-même. (P. 605 ; DPV XVI 191-2.)
La tableau introduit, contre cette vue sans manque ni désir ni douleur, la blessure sonore, le sursaut du coup de battoir. Avec la blanchisseuse, et Sophie son envers, quelque chose depuis le paysage atteint le cœur douloureux de l’intimité diderotienne 77. L’expansion du dedans intime vers le dehors sublime se retourne ainsi en coup, en atteinte depuis le dehors vers le dedans, cette réversion constituant le tableau.
Contrairement aux trois premiers sites, le quatrième est contemplé par un Diderot solitaire, sans l’abbé. L’arrivée de celui-ci fait diversion et introduit, par rapport au dispositif visuel du quatrième site, à cette vue sublime que barre douloureusement une langue de terre intimement habitée, la distance parodique nécessaire au second renversement, qui n’est pas visuel cette fois, mais dialogique :
Je vous 78 appelais, j’appelais mon amie, lorsque le cher abbé entra avec son mouchoir sur son œil 79. Vos tourbillons de poussière, me dit-il avec un peu d’humeur, qui sont aussi bien ordonnés que le monde, m’ont fait passer une mauvaise nuit. Ses bambins étaient à leurs devoirs, et il venait causer avec moi. L’émotion vive de l’âme laisse, même après qu’elle est passée, des traces sur le visage qu’il n’est pas difficile de reconnaître. L’abbé ne s’y méprit pas. Il devina quelque chose de ce qui s’était passé au fond de la mienne… “J’arrive à contretemps”, me dit-il… Non, l’abbé… “Une autre compagnie vous rendrait peut-être en ce moment plus heureux que la mienne”… Cela se peut… “Je m’en vais donc”… Non, restez. Il resta. (P. 606 ; DPV XVI 193.)
Si l’abbé avec son tourbillon dans l’œil fait comiquement diversion, Diderot face à lui fait tableau par les marques que l’émotion du moment précédent a imprimées sur son visage.
Ces marques, Diderot les a évoquées à propos du buste de lui exécuté par Falconet pour Grimm : « on y voyait les traces d’une peine d’âme secrète dont j’étais dévoré, lorsque l’artiste le fit » 80. Dans un contexte en apparence complètement différent, on trouvait ailleurs, dans le grand genre, ces mêmes traces ravageant le visage de la sainte Anne du Carrache face au Christ mort 81 : « Le Carrache a placé sur le fond une Ste Anne qui s’élance vers sa fille, en poussant les cris les plus aigus, avec un visage où les traces de la longue douleur se confondent avec celles du désespoir » (p. 206 ; DPV XIII 224). Sur le visage de sainte Anne, le deuil et l’empreinte de la mort se mêlent à l’expression du lien affectif, comme la douleur et l’absence se mêlent en Diderot à l’appel aux liens de l’amour et de l’amitié. Anne, de spectatrice qu’elle était du corps du Christ étendu au premier plan, et de Marie renversée sous lui, devient l’objet original d’une nouvelle scène à front renversé, que les quatre corps disposés sous elle bordent et soulignent. De même Diderot atteint par l’émotion du paysage sublime que le coup de battoir a cristallisé devant lui devient pour l’abbé l’objet d’un nouveau tableau : l’atteinte implique la réversion 82.
Deux figures marquées se font donc face : à l’œil gonflé de l’abbé répondent les traces douloureuses imprimées sur le visage de Diderot. L’Autre du dialogue est un « moi » renversé. Atteinte matérielle contre atteinte sensible, image presque comique contre tableau pathétique, un système différentiel se met en place qui est le système même du dialogue diderotien, avec ses renversements, de la méditation philosophique en pantomime bouffonne, du tableau ridicule en scène sublime, de l’image théâtrale en discours philosophique.
Si la compagnie de l’abbé n’était pas tout à fait celle que j’aurais choisie, je m’aimais encore mieux avec lui que seul. Un plaisir qui n’est que pour moi me touche faiblement et dure peu. C’est pour moi et pour mes amis que je lis, que je réfléchis, que j’écris, que je médite, que j’entends, que je regarde, que je sens. Dans leur absence, ma dévotion rapporte tout à eux. Je songe sans cesse à leur bonheur. Une belle ligne me frappe-t-elle ; ils la sauront. Ai-je rencontré un beau trait, je me promets de leur en faire part. Ai-je sous les yeux quelque spectacle enchanteur, sans m’en apercevoir j’en médite le récit pour eux. Je leur ai consacré l’usage de tous mes sens et de toutes mes facultés ; et c’est peut-être la raison pour laquelle tout s’exagère, tout s’enrichit un peu dans mon imagination et dans mon discours. Ils m’en font quelquefois un reproche ; les ingrats ! (P. 607 ; DPV XVI 194.)
L’abbé supplée l’absence de « mes amis », qui eux-mêmes fournissent le support imaginaire d’une extension répétée du « moi ». À la fiction du dialogue avec l’abbé se superpose la réalité de l’entretien avec soi-même, de sorte que le cadre énonciatif du dialogue se constitue de deux situations d’énonciation incompatibles l’une avec l’autre : comme interlocuteur faute de mieux, l’abbé est nécessaire à Diderot, dont la pensée ne peut se déployer sans le support d’une altérité ; mais c’est dans l’absence des vrais interlocuteurs, dans la solitude d’une méditation solipsiste que s’élabore la pensée dialogique.
Le dispositif du dialogue met donc en œuvre d’une part le paysage comme espace répercutant l’absence des interlocuteurs réels, d’autre part la réversibilité du « moi » et de son autre comme structure oscillatoire fondamentale à partir de laquelle déployer la pensée dialogique. Entre cet espace et cette structure, que le quatrième site installe face à face, la fiction de l’abbé comme interlocuteur vivant du dialogue avec le philosophe établit la jonction, met en œuvre le circuit de la parole dialogique : l’abbé ne se contente pas en effet de suppléer les absents, de dresser en quelque sorte face à Diderot une figure minimale de l’altérité dialogique ; il assume et relaie lui-même la parole diderotienne, en allant lire et interroger les notes jetées au brouillon par le philosophe lorsqu’il méditait seul 83 :
Quelle question vous me faites là, cher abbé. Nous y serions encore demain, et tandis que nous passerions assez agréablement votre temps, vos disciples perdraient le leur… « Un mot seulement. »… Je ne saurais. Allez à votre thème et à votre version… « Un mot »… Non, non, pas une syllabe. Mais prenez mes tablettes, cherchez au verso du premier feuillet, et peut-être y trouverez-vous quelques lignes qui mettront votre esprit en train. L’abbé prit les tablettes, et tandis que je m’habillais, il lut.
La Rochefoucauld a dit que dans les plus grands malheurs des personnes qui nous sont le plus chères, il y a toujours quelque chose qui ne nous déplaît pas… « Est[-ce] cela ? » me dit l’abbé… Oui… « Mais cela ne vient guère à la chose »… Allez toujours… Et il continua. (P. 608 ; DPV XVI 196.)
Le dialogue diderotien n’est pas l’affrontement de deux antagonistes, de la même façon que le rapport à la peinture n’est pas le rapport d’un sujet stable à un objet fixe et distancié. L’autre du dialogue est le tableau déconstruit de la promenade Vernet : le même naturel, la même incongruité et la même vérité déconcertante surgissent face à Diderot, lorsqu’il entend le coup de battoir d’une blanchisseuse, puis lorsque l’abbé surgit à l’improviste. Face au philosophe se manifeste ce même faire tableau réversible, par quoi le « moi » se projette hors de lui-même, et en quoi il se trouve annexé, qu’il utilise comme support de son discours, et en quoi il se dissout pour s’universaliser comme monde. L’abbé lisant les notes de Diderot incorpore sa parole, mais dans le même temps en figure le caractère lacunaire, en pointe l’incompréhensibilité, due au défaut de liaison : projetée en cet interlocuteur par défaut, cette parole fait tableau par ce défaut qu’elle pointe, comme le paysage fait tableau pour Diderot par ce coup de battoir de la blanchisseuse qui pointe, pour lui et en ce seul moment, la blessure conjugale et l’absence de Sophie.
L’incorporation de la parole de l’autre est précédée par un épuisement de la langue. Diderot se refuse à la demande de l’abbé. Il n’accordera pas de réponse à sa question, mais un mot ; non pas un mot, mais une syllabe ; non pas une syllabe, mais « quelques lignes » que l’autre lira sur « mes tablettes ». L’écriture est le piètre supplétif d’une langue qui se dérobe 84, emportée ailleurs, aliénée au groupe des femmes dont l’abbé a interrompu la douloureuse évocation. La langue est dans le paysage : elle est « la langue de terre aux blanchisseuses ».
Dans le face à face de Diderot et du paysage, puis de Diderot et de l’abbé, il s’agit du même circuit entre un dedans intime et un dehors importun, en qui le « moi » se projette, et qui fait ensuite retour vers lui, le donne à voir comme tableau et en incorpore, en exprime, du dehors, la pensée. Par cette projection et cette incorporation, par cette réversion du regard constitutive de la relation esthétique, le dispositif dialogique diderotien est pensé depuis la déconstruction de la peinture.
Le modèle cartésien : l’admiration, forme première de la relation esthétique
Le dialogue de Diderot et de l’abbé devant le quatrième site ne doit pas être considéré comme une nouvelle digression, le thème du Beau succédant pour ainsi dire hiérarchiquement à Dieu puis à l’ordre de la nature. À travers ces thèmes, l’enjeu du dialogue est toujours, depuis le début de la promenade, la définition de la relation esthétique :
L’abbé placé à côté de moi s’extasiait, à son ordinaire, sur les charmes de la nature. Il avait répété cent fois l’épithète de beau, et je remarquais que cet éloge commun s’adressait à des objets tout divers. L’abbé, lui dis-je, cette roche escarpée, vous l’appelez belle ; la forêt sourcilleuse qui la couvre, vous l’appelez belle ; ce torrent qui blanchit de son écume le rivage et qui en fait frissonner le gravier, vous l’appelez beau. Le nom de beau, vous l’accordez, à ce que je vois, à l’homme, à l’animal, à la plante, à la pierre, aux poissons, aux oiseaux, aux métaux. Cependant vous m’avouerez qu’il n’y a aucune qualité physique commune entre ces êtres. D’où vient donc ce tribut 85 commun ?… « Je ne sais, et vous m’y faites penser pour la première fois »… C’est une chose toute simple. La généralité de votre panégyrique vient, cher abbé, de quelques idées ou sensations communes excitées dans votre âme par des qualités physiques absolument différentes… J’entends, l’admiration »… Ajoutez, et le plaisir. (P. 607 ; DPV XVI 194.)
La question de Diderot à l’abbé, « d’où vient donc ce tribut commun ? » est la question centrale de la pensée classique du langage : le langage est compris comme force de proposition, qui nomme les choses, qui appelle. Cette force de proposition rassemble la multiplicité des objets du monde, et les articule : dans la peinture de paysage d’abord, elle enserre dans les anneaux d’un seul discours « cette roche », « la forêt », « ce torrent », et compose ainsi le tableau ; puis, amplifiant le mouvement dans l’esquisse d’un embrassement classificatoire du monde, elle renvoie « à l’homme, à l’animal, à la plante, à la pierre, aux poissons, aux oiseaux, aux métaux ». La logique du langage repose sur cette tension : rassemblement performatif de la proposition d’une part, appuyé sur l’uniformité répétitive du « vous l’appelez belle » ; déclinaison infinie des objets convoqués d’autre part, disposant les figures d’un gigantesque tableau, qui n’est plus pictural cette fois, mais taxinomique. Cette logique du langage, qui propose et articule, désigne une forme et vise une fin : ces objets que le langage propose à l’attention, il s’agit de les désigner comme beaux. « L’épithète de beau », « le nom de beau » fixe la forme de ce qui, logiquement a été rassemblé dans la performance de la proposition ; mais cette désignation une, stable et fixe, repose elle-même sur une dérivation à partir d’éléments hétérogènes, « de quelques idées ou sensations communes excitées dans votre âme par des qualités physiques absolument différentes ».
La question du Beau interroge la structure même du langage classique, ce que M. Foucault nomme le quadrilatère du langage 86. Sa logique (proposition, qui appelle les objets ; articulation, qui les décline et les constitue en taxinomie du monde) se redouble dans sa forme (désignation, qui caractérise les objets et fixe ainsi « l’épithète de beau » ; dérivation 87, qui inscrit le Beau dans une histoire du sujet et de la culture, reposant sur « quelques idées ou sensations communes »). Logique et forme sont en effet structurées selon la même polarité : en l’une comme en l’autre, la puissance unificatrice du langage, qui propose et désigne, qui appelle et fixe, se renverse en menace de dissémination, qui désarticule et dérive. L’articulation logique des syntagmes se retourne alors en désarticulation sensible des objets juxtaposés 88 ; la dérivation comme forme métaphysique du raisonnement, ou comme principe rhétorique de classement typologique, devient dérive imaginaire, expansion informe et incontrôlée du langage.
Proposition, articulation ; désignation, dérivation : ce quadrilatère du langage, qui structure ici de bout en bout le discours de Diderot, met en évidence un dispositif qui est à la fois le dispositif du paysage dans la peinture et le dispositif du dialogue diderotien. Peu importe si, thématiquement, l’interrogation diderotienne sur le Beau hérite de L’Essai sur le mérite et la vertu de Shaftesbury ou de tel ou tel autre traité d’esthétique 89 ; elle est de toute façon bien pauvre. L’essentiel tient ici non au débat esthétique lui-même, mais au dispositif dialogique que Diderot repère en lui. Au cœur de ce dispositif se trouve ce qu’il s’agit de nommer globalement, c’est-à-dire à la fois de proposer, de désigner, d’articuler et de dériver : « les charmes de la nature ».
Les charmes de la nature sont l’objet du « panégyrique » de l’abbé, autrement dit de son ekphrasis, réduite ici à sa caricature. Face au paysage, faute d’en pouvoir restituer le discours, le commentateur est voué à « s’extasier à son ordinaire sur les charmes de la nature », c’est-à-dire à répéter la litanie des propositions les plus plates et des désignations les plus monotones.
Le discours de l’abbé réduit le discours de Diderot à sa pure forme et en renvoie l’image pauvre, dont Diderot déplie ici devant nous la logique. Toute proposition adressée à l’œil par le paysage, par la vue, est redoublée par la désignation qui la fixe dans le langage, comme forme arrêtée d’un compte rendu. Le tableau naturel face auquel l’abbé est campé est la forme que redouble le commentaire de Diderot qui, le caractérisant et le constituant en objet d’un jugement esthétique, le livre à la manipulation logique du compte rendu.
Le redoublement est marqué, dans la relation esthétique, par un effet de réversion : l’abbé s’extasie sur les charmes de la nature, sur le tableau naturel qui se déploie devant lui. Une forme est proposée à sa vue. Mais, « placé à côté de moi », l’abbé fait tableau pour Diderot, pour le public, pour la nature même qu’il regarde : désignant cette forme comme belle, l’abbé la renvoie à la cantonade, non comme proposition, mais comme désignation, non comme forme inerte offerte à la vue, mais comme logique de ce qu’il faut voir dans ce site. L’abbé ne fait pas tableau comme objet, mais comme regard, en tant qu’il s’extasie : nous ne le regardons pas ; nous le regardons regarder. Ce regard fait ainsi retour vers le site qui l’a suscité, accomplissant le circuit de la relation esthétique. Comment caractériser, dans les termes de l’esthétique classique, ce tableau d’un homme regardant quelque chose de beau, ce regard qui se retourne pour se donner à voir, ?
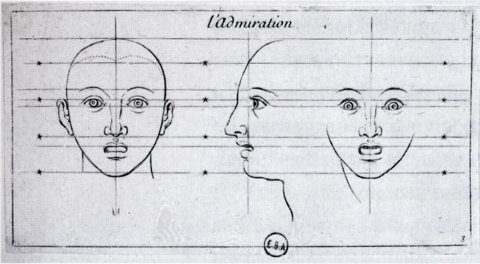
Le mot qui vient à l’abbé est celui d’admiration, un mot qui n’est pas neutre dans le champ de la métaphysique puisqu’il s’agit de la première passion de l’âme selon Descartes :
Lors que la premiere rencontre de quelque objet nous surprent 90, & que nous le jugeons estre nouveau, ou fort different de ce que nous connoissions auparavant, ou bien de ce que nous supposions qu’il devoit estre, cela fait que nous l’admirons & en sommes estonnez. Et pour ce que cela peut arriver avant que nous connoissions aucunement si cet objet est convenable, ou s’il ne l’est pas, il me semble que l’Admiration est la premiere de toutes les passions. Et qu’elle n’a point de contraire, à cause que, si l’objet qui se presente n’a rien en soi qui nous surprene, nous n’en sommes aucunement émeus, & nous le considerons sans passion. (Descartes, Les Passions de l’ame, 1649, article LIII 91.)
Les passions suivantes se présentent généralement par deux, et s’inscrivent en tout cas toujours dans un système différentiel, qui est le système même de la représentation discursive. Mais l’admiration « n’a point de contraire ». C’est un signifiant premier, et en quelque sorte muet. Ne renvoyant à aucune connaissance préexistante, ne manifestant ni convenance ni inconvenance, l’admiration ne caractérise pas l’objet qui la suscite, et exprime l’impossibilité de quelque forme que ce soit d’expression. L’admiration est le signifiant de l’absence de signifiant, l’origine même de la langue : elle est pure relation, que rien encore ne colore ni ne différencie.
Première passion de l’âme, l’admiration est la première figure qu’aborde la conférence de Le Brun sur L’Expression générale et particulière (1668) :
Comme nous avons dit que l’admiration est la première et la plus tempérée de toutes les passions où le cœur ressent le moins d’agitation, le visage reçoit aussi fort peu de changement en toutes ses parties, et s’il y en a, il n’est que dans l’élévation du sourcil, mais il aura les deux côtés égaux, l’œil sera un peu plus ouvert qu’à l’ordinaire, et la prunelle située également entre les deux paupières et sans mouvement, attirée sur l’objet qui cause l’admiration. La bouche sera aussi entrouverte, mais elle paraîtra sans aucune altération, non plus que le reste de toutes les autres parties du visage. Cette passion ne produit qu’une suspension de mouvement pour donner le temps à l’âme de délibérer sur ce qu’elle a à faire, et pour considérer avec attention l’objet qui se présente à elle 92.
L’admiration fournit une sorte de modèle de base de la figuration, dont toutes les autres figures seront des déformations : peu d’agitation, peu de changement dans le visage, une prunelle « sans mouvement », une bouche « sans aucune altération » et dans tout le corps « une suspension de mouvement ». Cette figure est purement négative, comme le confirment les premières gravures exécutées d’après la conférence de Le Brun 93, où les traits du visage de l’admiration s’inscrivent à l’intérieur des traits fixes de la grille qui sert de cadre commun à toutes les figures, alors que l’expression des autres passions déborde ce cadre.
Face à « l’objet qui se présente à elle » et « cause l’admiration », l’âme ne délivre donc aucun signe, ne manifeste ni marque, ni mouvement. Cette figure ne fonctionne à la limite pas comme signe, mais comme seuil, non seulement dans l’ordre visuel (comme figure sans trait), mais dans l’ordre discursif : suspendue, passive, attentive, elle ne dit rien, elle n’a rien à dire. Il n’y a pas de discours de l’admiration. L’admiration ouvre la possibilité d’un discours à venir, mais demeure en retrait par rapport à lui, entre infigurable et figuration, entre suspens inexpressif et expression. Elle est par là la passion qui convient le mieux au paysage, genre anhistorique par excellence, où la peinture n’est légitimée par aucune histoire susceptible d’en caractériser le sujet. L’admiration caractérise ce rapport paradoxal du paysage à l’histoire : ni éloquente, ni muette, mais prête à parler, elle place le spectateur à la limite acceptable du système classique de la représentation, avec ses figures et sa taxinomie.
Cependant, à l’admiration, Diderot ajoute le plaisir et, par ce second terme, fait basculer le paysage dans une autre économie du regard et de la représentation. Objet limite de la scène d’histoire classique, le paysage devient alors le lieu et le support de sa refondation. Le couple admiration/plaisir était présent dès le début du quatrième site. Diderot attachant ses yeux « sur un paysage admirable » avait aussitôt évoqué « le plaisir d’être à moi, le plaisir de me reconnaître aussi bon que je le suis, le plaisir de me voir et de me complaire, le plaisir plus doux encore de m’oublier » (p. 605). Lorsqu’il regrette l’absence de Sophie, il lui semble « que si elle était là, dans son vêtement négligé, que je tinsse sa main, que son admiration se joignît à la mienne, j’admirerais bien davantage » (p. 606) : le désir de Sophie, le plaisir d’être avec elle, s’expriment dans une admiration partagée du paysage. Admiration et plaisir sont essentiellement intriqués, comme le suggère ce chiasme :
Si vous y regardez de près, vous trouverez que les objets qui causent de l’étonnement ou de l’admiration sans faire plaisir ne sont pas beaux ; et que ceux qui font plaisir sans causer de la surprise ou de l’admiration, ne le sont pas davantage. (P. 607 ; DPV XVI 194-5.)
L’admiration, qui qualifie le beau dans l’objet présenté au regard, change ici de nature. Elle n’est plus la figure liminaire à partir de laquelle déployer l’éventail taxinomique des caractères et des passions. Elle devient la marque de l’atteinte intime qui, de l’objet regardé, se répercute sur le « moi » sensible, ouvert, fragile et défait. La forme même du chiasme dit cette réversion.
Ainsi, alors que Descartes oppose « agréement » et « horreur » comme deux passions antithétiques 94, Diderot fait naître la première de la seconde, dans un jeu de réversion où la représentation finale apparaît comme une défiguration de défiguration :
Le spectacle de Paris en feu, vous ferait horreur. Au bout de quelque temps, vous aimeriez à vous promener sur ses cendres. Vous éprouveriez un violent supplice à voir expirer votre amie ; au bout de quelque temps, votre mélancolie vous conduirait vers sa tombe, et vous vous y asseyeriez. (Suite du précédent.)
La merveille de Paris, capitale des Lumières, est d’abord défigurée en spectacle de Paris en feu, qui fait horreur. Mais ce spectacle lui-même est renversé, à la longue, en plaisir mélancolique d’une promenade sur ses cendres, où méditer sur la poétique des ruines. Sublime Paris, Paris en feu ; Paris détruit, sublimes cendres de Paris : le chiasme accomplit sa boucle. Puis, du paysage, on passe à la figure de l’amie, virtuellement exposée à la même boucle : Sublime Sophie, Sophie expirante ; Sophie dans la tombe, sublime tombe de Sophie.
Le modèle de l’acteur : « je suis double »
Le circuit chiasmatique est la forme de la réversion constitutive du regard diderotien. Mais, Diderot y insiste une nouvelle fois, cette forme est à la fois visuelle et sonore, iconique et verbale :
« Écartez du son toute idée accessoire, et morale, et vous lui ôterez sa beauté. Arrêtez à la surface de l’œil une image ; que l’impression n’en passe ni à l’esprit ni au cœur, et elle n’aura plus rien de beau 95. » (608 ; DPV XVI 195.)
Les idées accessoires sont le vecteur de cette réversion qui retournait l’horreur en agrément, l’expérience de la mort en jouissance esthétique. Le déploiement des idées accessoires, la division de la sensation visuelle sous la surface de l’œil, entre l’esprit et le cœur, entre distanciation critique et atteinte intime, préparent la schize du sujet et le circuit dialogique. La division du sujet se répercute alors dans l’objet, qui lui-même se divise. Une surface nouvelle s’interpose, qui n’est plus la surface de l’œil, mais celle de la toile peinte. Diderot reprend alors la situation de l’incendie, déjà évoquée avec Paris en feu :
« Il y a encore une autre distinction, c’est l’objet dans la nature, et le même objet dans l’art ou l’imitation. Ce terrible incendie au milieu duquel hommes, femmes, enfants, pères, mères, frères, sœurs, amis, étrangers, concitoyens tout périt, vous plonge dans la consternation ; vous fuyez, vous détournez vos regards, vous fermez vos oreilles aux cris. Spectateur peut-être désespéré d’un malheur commun à tant d’êtres chéris, peut-être hasarderez-vous votre vie 96, vous chercherez à les sauver ou à trouver dans les flammes le même sort qu’eux. Qu’on vous montre sur la toile les incidents de cette calamité, et vos yeux s’y arrêteront avec joie » (DPV XVI 195 ; p. 608).
L’oscillation scopique (« vous détournez vos regards » / « vos yeux s’y arrêteront avec joie ») est portée d’abord par la distinction entre deux images, la naturelle et l’artistique, le référent et le signifiant. Mais cette distinction abstraite, qui semble opposer deux situations matérielles différentes (le témoin « dans la nature » / le spectateur face à « la toile »), est en quelque sorte annulée par le dispositif général de la Promenade Vernet, bâti tout entier sur la superposition, l’identification de ces deux situations. Diderot cite alors les vers de Virgile :
« vous direz avec Énée : En Priamus. sunt hic etiam sua praemia laudi 97. »
Énée, qui vient d’échapper à la ruine de Troie, puis à la tempête déchaînée par la colère des dieux, aborde à Carthage et se trouve face au mur d’un temple en construction 98 où sont figurés les exploits des Troyens. Ce mur marque bien, chronologiquement, le passage de la catastrophe réelle, douloureusement subie par Énée, à sa représentation, qu’il a plaisir à rencontrer. Mais, dans la réalité matérielle du texte, cette catastrophe ne nous est rapportée qu’après le face à face avec ce mur, comme le récit rétrospectif d’Énée au banquet de Didon 99 : les situations, celle de l’histoire et celle du banquet, celle de la douleur et celle du plaisir, sont superposées. Le mur en constitue en quelque sorte l’interface.
Cette superposition organisée par la fiction de l’Énéide débouche sur une conception de la représentation dramatique fondée sur la scission du « moi » et l’aliénation du comédien.
On a dit, Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi 100. Mais tu pleureras tout seul, sans que je sois tenté de mêler une larme aux tiennes, si je ne puis me substituer à ta place. Il faut que je m’accroche à l’extrémité de la corde qui te tient suspendu dans les airs 101, ou je ne frémirai pas… “Ah ! j’entends à présent”… Quoi, l’abbé ?… “Je fais deux rôles, je suis double ; je suis Le Couvreur 102, et je reste moi. C’est le moi Couvreur qui frémit et qui souffre, et c’est le moi tout court qui a du plaisir”… (P. 610 ; DPV XVI 199.)
La douleur se communique de l’acteur au spectateur, puis du spectateur à l’acteur en qui il se projette, acteur et spectateur ne constituant bientôt plus que deux instances à peine différenciées dans un moi unique. Le renversement de la douleur en plaisir ne se fait plus alors ni avec le temps, ni du réel à sa représentation, mais, au sein du moi, du moi empathique, souffrant avec son personnage, au moi distancié, qui l’estime et l’apprécie.
Par ce circuit de la perception à la conscience, puis de la conscience à la perception, la douleur est retournée en plaisir 103. Diderot formule ici ce qui va constituer le sujet central du Paradoxe sur le comédien, où la même idée est énoncée de l’autre point de vue, non comme dédoublement du spectateur dans le jeu de réversion qui caractérise la relation esthétique, mais comme dédoublement de l’acteur dans la réversion symétrique qu’accomplit l’élaboration puis l’utilisation du modèle idéal :
Quel jeu plus parfait que celui de la Clairon ? […] Sans doute elle s’est fait un modèle auquel elle a d’abord cherché à se conformer ; […] elle est l’âme d’un grand mannequin qui l’enveloppe ; ses essais l’ont fixé sur elle. Nonchalamment étendue sur une chaise longue, les bras croisés, les yeux fermés, immobile, elle peut, en suivant son rêve de mémoire, s’entendre, se voir, se juger et juger les impressions qu’elle excitera. Dans ce moment elle est double : la petite Clairon et la grande Agrippine. (DPV XX 50-1 ; pp. 1381-2.)
La Clairon construit le modèle idéal d’Agrippine hors d’elle-même, comme objet séparé avec qui entretenir une relation distanciée. Mais cette relation, quoique distanciée, est mimétique : il s’agit de « se conformer » au modèle ; ce modèle est un « mannequin qui l’enveloppe », autrement dit une seconde peau. « Nonchalamment étendue sur une chaise longue », la Clairon est figurée dans la position même de Diderot face au paysage du quatrième site de la promenade Vernet : face à quelque chose à la fois de fondamentalement autre et de profondément soi.
Le paysage est ici le site d’une dépossession de soi, mais aussi d’une refondation : depuis le vague du réel, Vernet fait tableau ; depuis la pensée indéterminée du rêve, « la petite Clairon » forge « la grande Agrippine ».
Mais le dédoublement qu’évoque Diderot n’est pas seulement un dédoublement du moi (« je suis double », p. 610 ; « elle est double », p. 1382) : plus radicalement, le circuit dialogique qu’initie la révolte de l’œil diderotien organise un dédoublement symbolique 104 : contre la représentation instituée (un tableau de Vernet, bien délimité et encadré ; l’Agrippine du texte de Britannicus, récitée en appliquant sans imagination les règles et les codes de la déclamation), la rêverie revient au principe platonicien de la création artistique, que ce soit le site idéal d’un paysage virtuellement réel dont le tableau n’est qu’un aperçu, ou la réalité imaginée à nouveaux frais d’Agrippine, modèle idéal donc réel, dont les vers du poète à déclamer ne sont que le support second, non « une image première, une copie de la vérité, mais un portrait ou une copie de copie, fantavsmato", oujk ajlhqeiva" » (p. 522 ; DPV XVI 64).
Le modèle politique : émergence de la révolte
Ce dédoublement symbolique n’engage pas seulement la relation esthétique : il crée un battement entre l’institution imposée du dehors, le texte théâtral, les lois de la représentation et de là l’institution sociale en général, et les principes formulés à partir de soi : ce que l’acteur imagine de son personnage, les règles qu’il se fixe pour jouer et de là sa conception générale des mœurs. Alors, ce battement n’engage pas seulement le moi dans son rapport avec la représentation, mais l’objet même de tout dialogue philosophique :
On demanda qu’est-ce que la vertu, et chacun la définissant à sa mode la dispute changea d’objet, les uns prétendant que la vertu était l’habitude de conformer sa conduite à la loi ; les autres que c’était l’habitude de conformer sa conduite à l’utilité publique 105. (P. 611 ; DPV XVI 201.)
À la loi, instituée du dehors et imposée comme une contrainte sociale, s’oppose l’utilité publique, fondée ici sur la conviction intime du moi. L’utilité publique est le principe de la loi ; supérieur donc à la loi, ce principe ne sera pourtant socialement reconnu qu’après avoir été institué par elle. On touche ici à la question centrale qu’agite la philosophie politique classique, depuis notamment la préface du De cive de Hobbes 106.
Après que sa rêverie face aux blanchisseuses a été interrompue par l’abbé, Diderot n’est pas parti en promenade comme les jours précédents. Resté au château, il s’est mêlé à la société et « à l’entretien de nos philosophes ». Exaspéré par le bruyant enlisement de la discussion, Diderot part finalement « seul à travers champs, rêvant à la très belle et très importante question qu’ils agitaient. » Le débat philosophique est donc encadré par la promenade. La promenade fait l’objet d’un revirement comme le fera sur le plan du contenu dialogique la méditation sur la vertu et sur la loi. Diderot troque la société des philosophes contre une rêverie de promeneur solitaire : il quitte l’espace restreint du château pour l’espace vague de la promenade, et réciproquement le dehors social de la conversation pour le dedans intime de la méditation. Circuit de la promenade et circuit du débat philosophique procèdent d’une même réversion, d’un dedans en un dehors, d’une sociabilité en une intimité.
Le contenu du débat philosophique procède directement de cette réversion. Diderot semble commencer, dans la lignée de Hobbes, par réfuter la définition la plus libérale et la plus séduisante de la vertu :
D’ailleurs, si chacun s’institue juge compétent de la conformité de la loi avec l’utilité publique, l’effrénée liberté d’examiner, d’observer ou de fouler aux pieds les mauvaises lois conduira bientôt à l’examen, au mépris et à l’infraction des bonnes. (DPV XVI 202 ; p. 612)
Comme le montrera la poursuite de la méditation dans le « Cinquième site », cet assentiment apparent au conservatisme politique hobbésien 107 ne constitue qu’un premier moment, négatif, de la pensée diderotienne, au moment où Diderot quitte le château pour la promenade : « J’allais devant moi, ruminant ces objections qui me paraissaient fortes… » Diderot incorpore le discours des autres, il le « rumine » pour le retourner. La rumination dissémine l’objet dialogique dans l’espace de la promenade.
La dissémination atteint son comble au début du cinquième site, alors que Diderot assis devant la mer jouit de perdre son regard dans un spectacle sans objet ni cadre :
J’avais à ma droite un phare qui s’élevait du sommet des rochers. Il allait se perdre dans la nue, et la mer en mugissant venait se briser à ses pieds. Au loin des pêcheurs et des gens de mer étaient diversement occupés. Toute l’étendue des eaux agitées s’ouvrait devant moi. Elle était couverte de bâtiments dispersés. J’en voyais s’élever au-dessus des vagues tandis que d’autres se perdaient au-dessous ; chacun, à l’aide de ses voiles et de sa manœuvre, suivant des routes contraires, quoique poussé par un même vent ; image de l’homme et du bonheur, du philosophe et de la vérité. (P. 613 ; DPV XVI 203.)

Le paysage se présente d’abord comme dissémination d’objets et d’actions dans un espace qui déborde sa délimitation : le fanal ou le phare 108, la nue, la mer et le vent excèdent le cadre de la peinture.

Mais précisément parce qu’ils l’excèdent, ils enveloppent ce qui, pour le regard, est disséminé, ils articulent ce qui, dans la dispersion, est proposé à la vue : les « routes contraires » des bateaux « dispersés » procèdent d’« un même vent ». Le tableau regardé propose ainsi à l’œil du philosophe une dissémination articulée d’objets, que l’œil en retour désigne comme « image de l’homme et du bonheur, du philosophe et de la vérité », c’est-à-dire en quelque sorte comme image de lui-même articulant son rapport au monde par la mise en abyme de sa position par rapport au tableau. L’image désignée est elle-même une image topique, c’est-à-dire appuyée sur un espace rhétorique où le lecteur peut lui assigner une origine culturelle, le Suave mari magno de Lucrèce, et une dérivation historique : le topos du paysage image de l’homme se décline en une série de références littéraires 109 que l’image désignée rassemble, convoque, unifie.

Le topos est d’ailleurs formulé à l’envers : que font le bonheur et la vérité dans ce face à face avec la tempête, à laquelle la rhétorique assigne plutôt ordinairement pour fonction de figurer les vicissitudes de l’homme pris dans les malheurs et les mensonges du divertissement mondain et de l’agitation politique ?
La vue que propose le paysage du cinquième site ne correspond pas exactement en fait à l’image topique qui est ici convoquée 110. Il ne s’agit pas de naufrage, ni de vicissitudes, mais de pécheurs occupés et de voiles manœuvrées, activités intenses, mais nullement vaines, ni désespérées. L’humanité s’active dans les éléments déchaînés, et chacun suit son chemin : la réflexion philosophique sur l’activité du monde ne vise pas le détachement et l’ataraxie du sage ; au contraire, elle donne sens à cette activité, elle offre dans la tempête même l’image grouillante et vivante du bonheur et de la vérité.
La vue du cinquième site renverse donc d’emblée l’image topique qu’elle convoque, préparant la contre-offensive sur le fond du débat philosophique, la révolte contre la loi au nom de l’utilité publique. Ce qui est en jeu ici, c’est l’opposition à la doctrine hobbésienne de la soumission à la loi, initiée par Locke et radicalisée par Rousseau 111 : c’est du paysage, ou plus exactement de la lecture renversée qu’il fait de la tempête de Vernet, que Diderot déduit ici le discours porté par les Lumières de la révolte contre la loi, lorsque celle-ci ordonne des « actions contre lesquelles leur âme et leur conscience se révoltaient ».
Le dialogue s’engage alors avec une succession d’images qui sont autant de révoltes par l’œil :
Quoi donc, habitant de la côte du Malabar 112, égorgerai-je mon enfant, le pilerai-je, me frotterai-je de sa graisse pour me rendre invulnérable ? me plierai-je à toutes les extravagances des nations ? couperai-je ici les testicules à mon fils. Là foulerai-je aux pieds ma fille, pour la faire avorter ? ailleurs immolerai-je des hommes mutilés, une foule de femmes emprisonnées, à ma débauche et à ma jalousie ?… Pourquoi non. (P. 613 ; DPV XVI 203.)
Diderot relit ici le chapitre XIV du deuxième livre de De l’Esprit d’Helvétius 113. Il en complète le tableau et double l’abjection des lois absurdes énumérées par Helvétius d’après Cavazzi 114 avec des figures de castration : égorger l’enfant giague est suivi de couper la testicule hottentote 115, faire avorter la fille de Formose s’accompagne de la mutilation des eunuques. L’identification à l’Autre du dialogue passe par une scénographie de l’abjection et de la castration, de la même façon que le circuit de la relation esthétique passe, pour le spectateur devant le tableau, par la défiguration des objets et l’exclusion hors de la scène. Le dispositif du dialogue se calque sur le dispositif de la scène : c’est le même circuit, la même dépossession de soi, le même jeu de défection et de réfection du sens.
Diderot imagine alors et commente un dialogue entre Socrate et Aristippe. Faut-il rester silencieux face à la loi inique ? Faut-il lâchement s’éloigner ?
Je me tairai ou je m’éloignerai… Socrate dira lui, ou je parlerai et je périrai. L’apôtre de la vérité se montrera-t-il donc moins intrépide que l’apôtre du mensonge 116. Le mensonge aura-t-il seul le privilège de faire des martyrs ? pourquoi ne dirai-je pas ; la loi l’ordonne ; mais la loi est mauvaise. Je n’en ferai rien. Je n’en veux rien faire. J’aime mieux mourir… Mais Aristippe lui répondra ; je sais tout aussi bien que toi, ô Socrate, que la loi est mauvaise, et je ne fais pas plus de cas de la vie qu’un autre. Cependant je me soumettrai à la loi, de peur qu’en discutant de mon autorité privée les mauvaises lois, je n’encourage par mon exemple la multitude insensée à discuter les bonnes. Je ne fuirai point les cours comme toi. Je saurai me vêtir de pourpre. Je ferai ma cour aux maîtres du monde ; et peut-être en obtiendrai-je ou l’abolition de la loi mauvaise, ou la grâce de l’homme de bien qui l’aura enfreinte. (P. 613 ; DPV XVI 204.)
Non seulement un tel dialogue entre Socrate et Aristippe n’existe pas dans la tradition philosophique, mais il est pour ainsi dire impossible. Jamais Socrate n’a prêché la révolte. Le problème du conflit de la justice et de la loi se pose à lui au moment de son procès et, plus encore, à son issue 117. Socrate affronte héroïquement la mort sans réclamer contre des lois injustes, démontrant par cette terrible soumission que sa philosophie ne peut pas être interprétée comme un danger pour la cité. Sa mort prouve légalement son innocence et fait son apologie contre ses juges, avec et non contre les lois.
En affrontant ici Socrate à Aristippe, Diderot nous renvoie non au corpus des dialogues platoniciens, mais plutôt aux Mémorables de Xénophon, où il intervient deux fois, d’abord dans un dialogue sur la vertu 118, une seconde fois pour discuter de la nature du Bon et du Beau 119. Là encore, on ne trouve nul encouragement à la révolte. Le Socrate de Xénophon est très éloigné de celui de Diderot, qui d’ailleurs semble prendre finalement le parti d’Aristippe 120. Comme le Sénèque de l’Essai sur les règnes de Claude et de Néron, le Socrate de Diderot est en partie forgé 121. La question de l’obéissance à la loi n’est pas réellement tranchée, mais bien plutôt disposée comme circulation entre deux positions, comme enjeu mouvant du circuit dialogique. Du dispositif dialogique, Diderot repasse alors au dispositif visuel, selon le même principe d’entrelacement.
L’expérience du face à face avec le paysage initie à l’expérience d’une nouvelle forme de méditation philosophique, fondée sur l’exercice d’une pensée indéterminée. Promenade physique dans le paysage et promenade intellectuelle dans le monde des idées obéissent au même mouvement de flux et de reflux, le mouvement même de la marée :
« Je quittais cette question. Je la reprenais pour la quitter encore. Le spectacle des eaux m’entraînait malgré moi. Je regardais. Je sentais. J’admirais. Je ne raisonnais plus. Je m’écriais, ô profondeur des mers ! et je demeurais absorbé dans diverses spéculations entre lesquelles mon esprit était balancé, sans trouver d’ancre qui me fixât. Pourquoi me disais-je, les mots les plus généraux, les plus saints, les plus usités, loi, goût, beau, bon, vrai, usage, mœurs, vice, vertu, instinct, esprit, matière, grâce, beauté, laideur, si souvent prononcés, s’entendent-ils si peu, se définissent-ils si diversement ?... pourquoi ces mots si souvent prononcés, si peu entendus, si diversement définis, sont-ils employés avec la même précision par le philosophe, par le peuple et par les enfants. » (P. 613 ; DPV XVI 204-5.)
Quitter et reprendre, se saisir et se dessaisir : le mouvement de la méditation n’est pas seulement celui de la mer ; décrivant cet absorbement si caractéristique de la peinture classique (« je demeurais absorbé »), il nous ramène à ce que Freud désigne comme le fort-da 122. Par le jeu du yo-yo scénographiant le départ et le retour de la mère, le fort-da cherche à représenter le lieu invisible où elle s’est absentée. Le paysage en peinture est cet espace d’invisibilité : une surface qui désigne son invisible profondeur, derrière le cadre un hors cadre, et de même dans le dialogue philosophique une question qui n’est pas décidée, parce que son enjeu est placé hors champ. Ce n’est pas par exemple devant Catherine II qu’on décide explicitement entre la morale du citoyen Socrate et celle du monarque Aristippe, même si le discours peut aller jusqu’à disposer les éléments de la décision, jusqu’à dessiner l’espace rhétorique où s’articulent les enjeux.
Dans les Marines de Vernet, « le spectacle des eaux », où le regard se noie au moment où le peintre hisse pécheurs et bateaux hors de l’eau 123, est le lieu du fort-da scopique : entrer dans la toile et en sortir, de façon répétée, permet de conjurer quelque chose que désigne le débat philosophique, cette vacance autour de la loi que, dans le mythe d’Ixion choisi par Hobbes pour en dire l’allégorie, figure Junon, dédoublée et absentée pour leurrer son indiscret prétendant.
Obéir ou désobéir à la loi injuste ? Recevoir, par l’œil, la proposition de la vue, ou se révolter contre elle ? Diderot semble biaiser en se réfugiant dans le problème de l’acception des mots. Le dialogue n’est jamais bouclé, on ne peut pas tomber d’accord parce qu’on ne parle jamais la même langue 124.
Mais peut-être ne s’agit-il pas d’une esquive. Le problème de la définition des mots nous ramène au quadrilatère du langage classique : les mots proposés à la discussion (à l’articulation dans un raisonnement), doivent désigner des positions dans le débat d’idées (positions qui peuvent ensuite dériver les unes par rapport aux autres). C’est cette désignation, c’est-à-dire le retour du discours sur lui-même (de sa logique sur sa forme), qui pose problème. Le suspens absorbé de Diderot face au spectacle des eaux se situe entre la proposition et la désignation, comme dans la relation esthétique il nous place entre la vue que le paysage propose à Diderot et l’image que le regard puis la plume de Diderot en renverront. Ce moment de suspens est le moment de la révolte, c’est-à-dire à la fois de l’affirmation subjective (d’une position, d’un regard) et de la déstabilisation des objets (dissémination de la vue, dissémination du sens), vus, entendus, définis « si diversement ».
Dans ce mouvement second qui retourne la proposition en désignation, qui normalise la perturbation dialogique et réduit la dissémination visuelle à la forme close, assertive, du discours, Diderot place à égalité le philosophe et le peuple, la raison mûrement réfléchie et l’instinct des enfants :
« L’enfant se trompera sur la chose, mais non sur la valeur du mot. Il ne sait ce qui est vraiment beau ou laid, bon ou mauvais, vrai ou faux ; mais il sait ce qu’il veut dire tout aussi bien que moi. Il approuve, il désapprouve ; comme moi. Il a son admiration et son dédain... est-ce réflexion en moi ? est-ce habitude machinale en lui ?... mais de son habitude machinale, ou de ma réflexion, quel est le guide le plus sûr ?... Il dit, voilà ma sœur 125. Moi qui l’aime, j’ajoute ; petit, vous avez raison ; c’est sa taille élégante, sa démarche légère, son vêtement simple et noble, le port de sa tête, le son de sa voix, de cette voix qui fait toujours tressaillir mon cœur... » (Pp. 613-4 ; DPV XVI 205.)
La « réflexion » et l’« habitude machinale 126 » n’opposent pas simplement la raison de l’homme fait à la réaction impulsive de l’enfant, mais une représentation métaphysique de l’esprit, manipulant des catégories logiques abstraites (le beau, le bon, le vrai), et une représentation visuelle de la pensée, confrontant d’entrée de jeu le sujet à une image globale (« voilà ma sœur »). Ces deux représentations à vrai dire ne s’opposent pas, mais constituent le circuit logique du langage comme du regard, qui fait et défait son objet.
Au départ, il n’y a pas d’objet, mais une chose indéterminée : « l’enfant se trompera sur la chose ». Articulant des qualités (beau, bon, vrai) ou des éléments (les figures dans le paysage), rassemblant ce qui est disséminé dans la vue, le langage propose de faire de cette chose un objet, et désigne cet objet par un mot.
L’enfant ne se trompera pas sur « la valeur du mot », « il sait ce qu’il veut dire » et le désigne dans un véritable gestus performatif : « voilà ma sœur ». Voilà renvoie la vue du réel, rassemblée dans le mot, ma sœur, et fait de ce mot, dès qu’il est prononcé, une image à articuler au monde des représentations. Or aussitôt que démarre ce processus d’articulation, le mot entrant en résonance avec les représentations de l’Autre du dialogue, et de là avec la réserve culturelle que porte la langue, l’image dérive, travaillée par la dissémination : « c’est sa taille élégante, sa démarche légère, son vêtement simple et noble… » ; autant de propositions, autant de dérivations ; plus l’image se déploie dans l’espace rhétorique, plus elle s’y dissémine ; plus elle s’enrichit, plus le modèle idéal se défait.
L’instinct de l’enfant anticipe donc le jugement de l’homme fait, après que le jugement d’Aristippe a détrôné celui de Socrate. Bien sûr, dans un texte aussi digressif, qui épouse l’aléa sautillant de la promenade, on pourrait croire l’objet de la discussion changé : il s’agit ici de reconnaître Sophie ; il s’agissait tout à l’heure de décider entre l’obéissance absolue à la loi et la révolte au nom de l’utilité publique. Mais Sophie est toujours, dans la promenade Vernet, le furet du circuit discursif, pointant un manque dans le dispositif, une question en travail, une réversion à faire : Sophie, pour le coup de battoir d’une blanchisseuse ; Sophie, pour le principe de la loi ; Sophie comme signifiant de l’absence de signifiant, de ce qui, dans le tableau, ne peut pas être nommé et néantise le sujet, ou qui, dans le débat philosophique, ne peut être décidé et, à sa manière également, menace le philosophe.
1 Le maître de Fragonard, Charles Natoire, alors directeur de l’Académie de France à Rome, avait dessiné un Corésus et Callirhoé, actuellement conservé au musée Chéret à Nice. Un autre dessin, attribué à Luca Giordano, est au Louvre. Il faut enfin signaler un troisième dessin, de Boucher intitulé La Mort de Callirhoé (Pierre Rosenberg, Fragonard, RMN 1987, p. 216).
2 Voyage historique de la Grèce traduit par M. l’abbé Gédoyn, Paris, Didot, 1731, 2 volumes in-4°, Arsenal 4-H-888.
3 J. P. D’Orville, ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ Ἀφροδισιέως τῶν περὶ ΚΑΙΡΕΑΝ καὶ ΚΑΛΛΙΡΟΗΝ ΕΡΩΤΙΚΩΝ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΟΙ Η, Amsterdam, 1750.
4 Mémoires et journal de Jean-Georges Wille, éd. G. Duplessis, Paris, 1852(7?), I, pp. 284-285.
5 Correspondance de M. de Marigny avec Coypel, Lépicié et Cochin, éd. Furcy-Raynaud, Nouvelles Archives de l’Art français, 1903 et 1904, XII (XX?), p. 77. (En fait, lettre à Natoire.)
6 Pontus de Tyard en a proposé une ekphrasis dans ses Douze fables de Fleuves ou Fontaines, publiées en 1586 (Œuvres poétiques complètes, Droz, p. 264). Voir S. Lojkine, « L’Antre de Platon », Résistances de l’image, PENS, 1992, p. 182.
7 Callirhoé, tragedie représentée pour la premiere fois par l’Academie royale de musique, le mardy vingt-septiéme Decembre 1712. A Paris, chez Christophe Ballard, 1712. L’exemplaire de la Bnf (RES-YF-1883) comprend le fascicule original, relié avec les fascicules imprimés à l’occasion des reprises du spectacle : on y lit les mentions suivantes, « remise au theâtre le Jeudy 27. Decembre 1731 », « remise au theâtre le jeudy troisiéme janvier 1732 », « remise au theâtre le jeudi 3 janvier 1731 Et le mardi 22 octobre 1743. Nouvelle édition, conforme à la derniere remise ». Le dernier fascicule, imprimé à Paris chez Delormel, adopte une présentation différente : « Remise au théâtre, le jeudi 3 Janvier 1731, le mardi 22 Octobre 1743. Et le Mardi 9 Novembre 1773. ». Au verso de la page de titre : « Le poeme est de Roi. La Musique est de Destouches. »
8 Coresus et Callirhoé, tragédie, par Mr de La Fosse. A Paris, chez Pierre Ribou, 1704. Représentée pour la première fois le 7 décembre 1703, cette tragédie tomba à la quatrième représentation (Léris, Dictionnaire portatif historique et littéraire des théâtres, Paris, Jombert, 1763). Dans sa préface, de La Fosse se désigne des prédécesseurs : « L’Histoire qui fait le sujet de cette Tragedie, est si extraordinaire & si remarquable, qu’il est étonnant qu’elle soit si peu connuë. Le Guarini qui l’avoit tirée de Pausanias, d’où je l’ay prise, en a paré le commencement de son Pastor fido, & en a fait l’origine des malheurs qui affligeoient l’Arcadie, dans le temps de l’action que son Poëme represente. Il y a pourtant fait quelques changemens. Par exemple il a mis l’Arcadie au lieu de l’Etolie, & il a changé les noms de Coresus & de Callirhoé en ceux d’Amintas & de Lucrine. Vigenere dans ses Annotations sur Philostrate, & Spon dans son voyage en Grece rapportent l’histoire tout au long. »
9 Pierre Rosenberg a proposé plusieurs sources iconographiques pour la composition de Fragonard (cat. Fragonard, RMN, 1987, p. 216). Le dessin de Natoire sur le même sujet (Nice, Musée Chéret) est peu concluant, même si Natoire était le maître de Fragonard et a pu orienter le choix du sujet pour son élève. La Mort de Virginie par Doyen (Parme, Galleria Nazionale) avait fait sensation au Salon de 1759, malgré le commentaire peu flatteur de Diderot (p. 199 ; DPV XIII 81). Mais le face à face de Virginius, le père réclamant sa fille, et du décemvir Appius, qui la destine comme esclave d’un de ses clients, n’a rien à voir avec la scène en jeu dans Corésus et Callirhoé, d’autant que « le Peintre a préféré ce moment à l’horreur de celui qui le suivit, où Virginius sacrifia sa fille pour lui sauver l’honneur & la liberté » (description du livret). Point de couteau donc chez Doyen, où tout n’est que bras tendus dans l’altercation verbale. Le rapprochement avec le Sacrifice d’Iphigénie de Carle Vanloo (Château de Potsdam-Sans Souci, Nouveau Palais), le clou du Salon de 1757, est plus concluant : Calchas brandissant le couteau face à Iphigénie évanouie, comme assise sur l’autel du sacrifice, est dans la posture que devrait avoir Corésus face à Callirhoé. La posture de Callirhoé répète celle de l’Iphigénie de Vanloo, jusqu’au téton découvert. Le vaisseau pour le sang du sacrifice et l’urne funéraire sont également présents au premier plan chez Vanloo ; l’esclave agenouillé de dos qui en prend soin est encore présent dans la version d’Angers du Corésus de Fragonard. Quant au génie du Désespoir qui surplombe la composition de Fragonard, il occupe la place de l’Artémis qui, dans l’Iphigénie, vole au secours de la jeune fille.
10 Cette avancée est caractéristique de la scène théâtrale : comparer avec la gravure de Chauveau pour Médée, chap. 3.
11 Voir chap. 3.
12 Le récipient de bronze, en bas à droite, est destiné à recevoir le sang de Callirhoé égorgée. C’est du moins l’interprétation de Diderot qui le décrit comme « un de ces grands vaisseaux destinés à recevoir le sang des victimes » (p. 426 ; DPV XIV 257).
13 Le tableau est exposé à l’Académie, probablement dans la Galerie d’Apollon, depuis le 30 mars, date à laquelle Fragonard a été agréé. Le Salon ouvre ses portes le jour de la Saint-Louis, le 25 août, en principe pour un mois. Les lettres de Diderot à Sophie Volland, datées du 20 octobre et du 10 novembre 1765 nous apprennent que Diderot a commencé à composer le Salon de 1765 seulement un peu avant la mi-octobre, et qu’il a terminé début novembre. On peut donc penser qu’il a visité le Salon dans les derniers jours de l’exposition. Dans l’ordinaire du 15 septembre de la Correspondance littéraire, Grimm écrivait à ses abonnés, non sans inquiétude : « L’Académie royale de Peinture et de Sculpture a ouvert, le jour de la fête du roi, le Sallon où elle expose tous les deux ans ses ouvrages aux regards du Public. Le philosophe Denis Diderot, à qui j’ai accordé un brevet de mon Grand Sallonier, se met actuellement en état de vous rendre compte de cette exposition. Ainsi je ne dois pas empiéter sur ses droits. Je me contente de l’avertir tous les matins par un petit billet qu’il s’est passé vingt-quatre heures depuis la veille. »
Diderot a réellement a vu le Corésus et Callirhoé de Fragonard bien sûr, et il l’a vu, malgré ses dénégations, au Salon, accroché à gauche, selon l’esquisse de Saint-Aubin, sous le Guillaume le conquérant de Lépicié. Grimm le certifie en tout cas aux lecteurs de la Correspondance littéraire, en feignant de s’adresser à Diderot : « car enfin, tout ce beau rêve que vous venez de me conter, vous l’avez fait au Salon, en contemplant le tableau de Fragonard, et la plupart du temps, si je m’en souviens, j’avais le plaisir d’être à côté de vous et de vous entendre rêver tout haut. » (CFL VI 200.)
14 Platon, République, VII, 514a-521b.
15 Voir Michael Fried, La Place du spectateur, chap. 3, p. 141 et note 77, p. 247.
16 L’expression de Diderot traduit exactement le qaumatopoioiv grec, que Robin rend plus audacieusement par « montreurs de marionnettes ».
17 Voir Jean-Claude Bonnet, « Diderot a inventé le cinéma », Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, n°18-19, pp. 27-33, et le rapprochement avec les écrans de Mercier (Tableau de Paris, II, 144, éd. 1783, p. 78). L’article mélange malheureusement le dispositif d’écran, qui chez Diderot est théâtral et implique la découpe de plans fixes (voir R. Barthes, « Diderot, Brecht, Eisenstein »), avec ce flux d’images qui justement déconstruit le modèle théâtral et interdit toute découpe.
18 Cette dimension fantasmatique est propre à Diderot. Voir S. Lojkine, « L’Antre de Platon », op. cit., pp. 192-3. Dans la première scène de l’acte III, chez Roy et Destouches, Callirhoé ne décrit que des meurtres : « Tout m’accable & me désespere, / Le Fils infortuné s’arme contre le Pere, / Le Pere furieux perce le sein du Fils, / L’Enfant est immolé dans les bras de sa Mere. / Que de gémißements, de plaintes & de cris ! / J’en vois qui de leur sort ministres & victimes, / Achevent sur eux-mêmes, ou punissent leurs crimes. » Chez de La Fosse, le récit d’Arbas (II, 6) est plus éloigné encore de la version diderotienne : « En croirez-vous l’effet ? C’est un poison subit / Dont leur sang enflammé leur trouble à tous l’esprit : / La fureur s’en empare, & le regard farouche, / Le front pâle & livide, & l’écume à la bouche, / Ils sortent tous du Temple, & dans la Ville épars, / Avec des cris affreux courent de toutes parts. / A ceux qu’ils ont touché le mal se communique. / Rien ne peut arrêter cette fureur publique. / Tous ensemble mêlez, ne se connoissant pas, / Ils se livrent entre eux les plus cruels combats, / Ou d’un embrasement ils menacent la Ville. »
19 E. M. Bukdahl, op. cit., t. I, p. 319 ; J. Chouillet, Diderot poète de l’énergie, PUF, 1984, pp. 215-220 ; Nathalie Volle, Diderot et l’art de Boucher à David, p. 211 ; J. Starobinski, « Le sacrifice en rêve », Diderot dans l’espace des peintres, RMN, 1991, p. 76, 80-81, 87-88.
20 p. 426 ; DPV XIV 257.
21 Voir chap. 1.
22 De même, plus loin, « Je connais un peu nos artistes, et je vous jure qu’il n’y en a pas un en état d’ébaucher ce tableau » ; puis « savez-vous qu’un seul de vos rêves suffirait pour une galerie entière » ; enfin « le temple que vous venez de décrire est exactement le lieu de la scène du tableau de Fragonard ».
23 p. 424 puis 425 ; DPV XIV 254 puis 256.
24 Pausanias, ou voyage historique de la Grèce, traduit en françois, Avec des Remarques. Par M. l’Abbé Gedoyn, Chanoine de la Sainte Chapelle, & Abbé de Baugenci, de l’Académie Françoise, & de l’Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres. Tome second. A Paris, Chez F. G. Quillau, ruë Galande, près la Place Maubert, à l’Annonciation. MDCCXXXI. Avec approbation et privilege du Roy. Il y a une deuxième édition, la même année, chez Nyon, premier pavillon du Collège des Quatre Nations, Sainte-Monique.
25 La comparaison avec le dessin de Luca Giordano (Louvre, département des arts graphiques, inv. 9632) s’avère éclairante à ce sujet : chez Giordano, Corésus et Callirhoé est une scène de ville. Giordano adopte déjà la composition décentrée vers la droite qui structure le tableau de Fragonard.
Le groupe de femmes au premier plan à gauche est composé chez Giordano d’une mère indifférente au sacrifice qu’elles ne voit pas et d’une jeune fille qui se retourne et voit. La version d’Angers du Corésus de Fragonard conserve cette opposition des deux femmes, mais en les retournant. La version du Louvre conserve encore cette disposition, mais c’est cette fois la mère qui voit le spectacle, et sa compagne qui, de derrière la colonne ne le voit plus.
Corésus chez Giordano tombe entre deux prêtres. Fragonard fait passer Corésus de l’autre côté, mais maintient à gauche deux acolytes. Le Corésus de Fragonard semble faire la synthèse du Bacchus de Giordano, lui-même flanqué de deux enfants, et de son jeune homme à droite qui se précipite au secours de Corésus, contourne Callirhoé et, déséquilibré par elle, fait un étrange geste de la main droite pour rétablir son équilibre et ne pas tomber de la marche.
Rien ne prouve, bien sûr, que Fragonard ait connu le dessin de Giordano.
26 En supprimant ainsi la figure de Bacchus, Diderot ne tient pas seulement le discours convenu des Lumières contre la superstition, discours de bon ton dans la Correspondance littéraire. Chez Fragonard, l’absence de Bacchus résulte réellement d’une suppression : il n’est qu’à comparer avec l’esquisse préparatoire du tableau conservée au Musée des beaux-arts d’Angers (1758-1760). Fragonard y figurait alors Bacchus au fond dans un nuage de fumée, faisant émerger la statue du dieu à la manière d’une apparition. Primitivement, l’apparition divine était ce à quoi le sacrifice venait répondre.
27 La comparaison s’impose ici avec Le Sacrifice d’Iphigénie peint par Tiepolo pour la villa Valmarana, à Vicence. Tiepolo achève la réalisation du programme iconographique de la villa en 1757. Du 23 juin au 3 juillet 1761, Fragonard et Saint-Non visitent Padoue et Vicence. Mais on n’a pas la preuve que Fragonard ait vu cette fresque. (Voir le Journal de l’abbé de Saint-Non, in Saint-Non. Fragonard. Panopticon Italiano, un diario di viaggio ritrovato. 1759-1761, Rome, 1986, pp. 124-224.) La fresque du Sacrifice d’Iphigénie se trouve dans le vestibule d’entrée de la villa, sur le mur de droite. Le vestibule étant assez étroit, Tiepolo imagine une série de colonnades en trompe-l’œil. Le sacrifice est campé entre deux couples de colonnes, séparant de la scène, à gauche, l’arrivée sur un nuage de la biche de substitution, à droite, Agamemnon voilé dans son manteau, c’est-à-dire dans la posture imaginée par Timanthe. De la même façon chez Fragonard, la mère, à gauche, sous le vieillard qui tient lieu d’Agamemnon, se recule et masque son visage de ses mains. La scène centrale de Tiepolo n’a rien à voir avec celle de Fragonard ; mais le dispositif, ces colonnes massives qui prennent en charge l’articulation entre espace vague et espace restreint et isolent sur un côté le regard barré du père, est exactement le dispositif qu’exploite Fragonard dans la version du Louvre.
28 Le téton concentrant la lumière et attirant l’œil du spectateur n’est pas une invention de Fragonard. Voir par exemple L’Enlèvement des Sabines de Jean-François de Troy, 270x204, signé et daté 1729, Neuchâtel, musée d’art et d’histoire.
29 Voir chap. 2.
30 On voit ici ce qui sépare Diderot de Lessing, pour qui le cri ne saurait être représenté en peinture, preuve qu’il ne saurait y avoir d’ut pictura poesis tant les moyens de la poésie et de la peinture sont différents. Voir chap. 3.
31 Peut-être ne l’est-il pas, s’il constitue une variation sur le thème de l’Agamemnon dévoilé, inauguré par Vanloo en 1757. La posture avait alors fait scandale et suscité toute une littérature : une première brochure, outrageusement élogieuse, est attribuée au comte de Caylus ; un article d’un élève de Vien dans les Observations sur la physique et les arts, le journal de Toussaint, est violemment critique. Une troisième brochure prend à nouveau la défense de Vanloo, qu’elle place au-dessus de Rubens. Cochin enfin, secrétaire de l’Académie, écrit dans le Mercure une défense modérée de Vanloo… et du dessin : l’Iphigénie de Vanloo a ravivé le conflit entre poussinistes et rubénistes, partisans de la couleur et partisans du dessin. Voir le compte rendu de Grimm dans la Correspondance littéraire du 1er octobre 1757 : sous couvert de synthèse, il critique fortement Vanloo. « la douleur d’Agamemnon est commune, c’est un homme qui lève les yeux et les bras au ciel ; il n’y a point de génie dans tout cela ». Diderot s’est passionné pour la question, comme l’indique la fin de l’article de Grimm : « j’aurais volontiers supprimé Clytemnestre ; mais est-il permis d’avoir oublié Ulysse, qui a joué un si grand rôle dans cette affaire ? Quel personnage à peindre ! M. Diderot aurait voulu le voir embrasser Agamemnon dans ce moment terrible, pour lui dérober, par ce mouvement de pitié feinte, l’horreur du spectacle ; cela aurait été admirablement dans le caractère d’Ulysse. Je ne sais si l’effet d’une pensée aussi déliée aurait été assez frappant en peinture. »
32 Dans la lettre à Sophie Volland du 14 août 1759, Diderot nous apprend que son père « mourut, ou plutôt il s’endormit pour ne plus se réveiller, dans un fauteuil, entre son fils, sa fille et quelques-uns de ses amis. » La lettre à Grimm du 25 juin était plus circonstanciée : aux éblouissements du père renversé sur sa chaise ont succédé les cris déchirants de la sœur de Denis. Le tableau imaginé ici par Diderot tient donc lieu de tableau de la mort du père, et supplée imaginairement l’absence, alors, de Denis.
33 L’Entretien d’un père avec ses enfants fut donné en deux fois dans la Correspondance littéraire de Grimm, le 1er et le 15 mars 1771. Grimm précède le premier envoi d’un petit préambule où il écrit notamment : « Le père aimait son fils aîné d’inclination et de passion, sa fille de reconnaissance et de tendresse, et son fils cadet de réflexion, par respect pour l’état qu’il avait embrassé. » (DPV XII 461.) Diderot était l’aîné ; son petit frère était devenu abbé. La remarque de Grimm reprend en fait une remarque de Diderot, qui rapporterait une remarque de son propre père : « J’ai deux enfants. L’un est dévot comme un ange ; on dit que l’autre est sans religion. Je ne sais comment cela se fait, mais je ne saurais m’empêcher d’aimer mieux celui-ci. » (Lettre à Grimm du 20 juillet 1759.)
34 Il n’y avait qu’un portrait du père, que Diderot évoque lors du voyage à Langres de 1759 : « Il n’y a ici qu’un mauvais portrait de cet homme de bien ; mais ce n’est pas ma faute. Si les infirmités lui eussent permis de venir à Paris, mon dessein était de le faire représenter à son établi, dans ses habits d’ouvrier, la tête nue, les yeux levés vers le ciel, et la main étendue sur le front de sa petite-fille qu’il aurait bénie. » (Lettre à Sophie Volland du 3 août 1759.) Et : « Imaginez que j’ai toujours été assis à table vis-à-vis d’un portrait de mon père, qui est mal peint, mais qu’on a fait tirer il y a seulement quelques années, et qui ressemble assez » (14 août, dans la lettre à Sophie et dans celle à Grimm). Diderot a-t-il en tête, pour le tableau qu’il imagine, Le Maréchal dans sa forge de Le Nain, qui appartenait jusqu’en 1772 au duc de Choiseul ? Le tableau était par ailleurs gravé. Le forgeron est proche du coutelier et l’on retrouve le brasier associé à la figure du père entouré de ses enfants. Il est intéressant de voir comment la culpabilité d’avoir manqué la mort de son père se cristallise sur le portrait, et conduit Diderot à fabriquer un tableau imaginaire.
35 Cet échec éclate justement au moment de la mort du père. Voir la lettre écrite à sa femme Antoinette Champion depuis Langres, le 29 juillet 1759 : « Je ne suis pas parfait ; vous n’êtes pas parfaite non plus. Nous sommes ensemble, non pour nous reprocher nos défauts avec aigreur, mais pour les supporter réciproquement. Il ne faut pas mettre de l’importance à ce qui n’en a point, et réduire l’important à rien […]. Nanette, quand vous m’aurez mis au tombeau, vous n’en serez pas plus avancée. »
36 Le regard du père, dans « l’Antre de Platon » doit également également être mis en rapport avec Le Père de famille, dont Diderot définit le protagoniste comme « gémissant et passif » dans le Discours de la poésie dramatique. Comme le vieillard de Fragonard, D’Orbesson est un « regard paternel impuissant » (Roger Lewinter, Diderot ou les mots de l’absence, Champ Libre, 1976, pp. 33 et 36).
37 Sans doute le terme est-il impropre : Chardin comme Vernet, que Diderot se plaît à associer (p. 593), sont totalement intégrés dans l’institution, le premier comme officier de l’Académie et tapissier du Salon, le second, également académicien, comme peintre de la série royale des Ports de France. Il n’empêche : sur le plan esthétique, ils ne produisent pas ce que l’enseignement académique promeut, non seulement en tournant le dos à l’histoire, mais surtout, chacun à sa manière, en disséminant la scène, sur le dispositif de laquelle leur peinture pourtant s’appuie. Voir II et Conclusion.
38 Voir chap. 3.
39 Le jeu métaphorique du texte grec est articulé par la préposition préfixe parav, auprès de, le long de.
40 Le grec fait sentir l’identité du lien qui attache les prisonniers (desmwvtai) et du lien de la cité, dont les futurs maîtres assureront la cohésion (suvndesmo").
41 Ouvrages ne désigne jamais une peinture dans le dictionnaire de Trévoux : on y parle d’abord des ouvrages de la Création, et plus trivialement de ce que les ouvriers produisent. Les ouvrages sont donc dans la nature, alors que site est, lui, exclusivement du vocabulaire de la peinture, où il désigne l’assiette du lieu, autrement dit le choix du point de vue. Le passage des ouvrages aux sites est donc connotativement passage de la nature à la peinture, au moment où le texte annonce le contraire : cette contradiction est caractéristique de la pensée chiasmatique de Diderot, et de la réversion intime qui l’anime.
42 On suppose que Diderot a écrit ce texte au Grandval d’après la lettre à Sophie Volland du 28 septembre 1760 (Babelon III 102-3).
43 Tout renvoie, dans la Promenade Vernet, à ce château de la méditation philosophique, qui est le vrai lieu de la scène intérieure que vise Diderot, et réapparaîtra sous une forme allégorique dans Jacques le Fataliste : « un château immense au frontispice duquel on lisait : “Je n’appartiens à personne, et j’appartiens à tout le monde. Vous y étiez avant que d’y entrer, et vous y serez encore quand vous en sortirez.” — Entrèrent-ils dans ce château ? — Non, car l’inscription était fausse, ou ils y étaient avant que d’y entrer. — Mais du moins ils en sortirent ? — Non, car l’inscription était fausse ou ils y étaient encore quand ils en furent sortis. » (II, 728 ; DPV XXIII 42-3.)
44 « chaque scène champêtre », puis, dans le premier site, « la profondeur de la scène », « toute cette scène merveilleuse » (p. 595), « le copiste rigoureux de cette scène » (p. 596) ; dans le second site, « toute la scène imposante que je n’avais qu’entrevue », « la scène dont j’aurai fait le tour », « me voilà au côté gauche de la scène » (p. 599). Le mot disparaît ensuite pour ne réapparaître que dans le sixième site : « la terreur qu’elles donnaient à la scène », « la variété des objets et des scènes » (p. 625), « pour enrichir et animer la scène » (p. 626), et dans le rêve qui suit le septième tableau, « je voyais toutes ces scènes touchantes » (p. 631).
45 « je me sens arrêté brusquement » (p. 594) ; « le hasard y avait arrêté un voyageur » ; « mon attention était arrêtée » (p. 595) ; « mais lui se retournant, s’arrêtant subitement » (p. 597) ; face au second site, « ma voix coupée, mes idées confondues, je restai stupéfait et muet » (p. 598) contrairement au passant que « la beauté du lieu n’arrêtait pas » ; « Arrêtés là, je promenai mes regards » (p. 599). Voir J. Chouillet, « La Promenade Vernet », Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, n°2, 1987, p. 134).
46 Rousseau faisait explicitement la comparaison avec Pétrarque dans La Nouvelle Héloïse (I, 23 ; voir S. Lojkine, La Scène de roman, collection U, A. Colin, 2002, pp. 138-141). Diderot, dans l’article Vernet du Salon de 1763 puis dans l’article Loutherbourg du Salon de 1765, identifiait la nature offerte au peintre de paysages à un corps de femme qu’il s’agissait de posséder. Il cite Pétrarque à l’article Boucher du Salon de 1765 (p. 309 ; DPV XIV 55). Si éloignés l’un de l’autre que ces peintres puissent paraître, le même processus de dissémination de la scène est à l’œuvre chez Boucher et chez Vernet, l’un dans le « tapage insupportable » du bric-à-brac rococo, l’autre dans le grand écart que ses paysages imposent à l’œil.
47 Il a été identifié à un tableau ovale de Vernet intitulé La Source abondante, dont il existe plusieurs versions, notamment une dans une collection particulière à Paris, et une autre, inversée et simplifiée (sans la montagne du fond), dans la collection Youssoupov au musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg, peut-être exécutée d’après la gravure de Le Bas. On doit relever cependant, dans le tableau ovale de Paris, des différences notables par rapport à la description de Diderot : la montagne élevant son sommet vers la nue n’est, à l’arrière plan droit, qu’un très petit monticule qui ne dépasse pas en hauteur la ligne d’horizon ; l’homme tirant son filet hors de l’eau et la femme en rouge portant contre la hanche un panier d’osier, quoiqu’ils occupent le premier plan du tableau, sont absents de la description diderotienne ; enfin, le fond de la toile, au-delà de ce qui n’est pas un village mais une ville importante, est occupé par la mer. Quoique la description du livret soit on ne peut plus laconique (« Par M. VERNET, Conseiller. 39. Plusieurs Tableaux sous le même numéro. ») le commentaire de Diderot laisse penser que les tableaux exposés au Salon étaient rectangulaires, ce qui permettait de déployer sur la droite une haute montagne élevant son sommet vers la nue, comme Vernet le fera par exemple pour Mme du Barry en 1772 dans Le Matin, les baigneuses (Louvre, inv. 8329). Le succès des peintures exposées en 1767 aura amené Vernet à commercialiser plusieurs fois le même paysage, en plus simple et plus petit, qui permettait de vendre moins cher.
48 La Nouvelle Héloïse, livre I, lettre 23 (1761, rééd. 1764). Saint-Preux évoque « des scènes continuelles qui ne cessèrent d’attirer mon admiration ». Voir S. Lojkine, La Scène de roman, op. cit., chap. 5.
49 Émile, ou de l’éducation, livre III (1762).
50 Le paysage sublime donne des gages au discours leibnizien sur la perfection de la Création : « plus on sera éclairé et informé des ouvrages de Dieu, plus on sera disposé à les trouver excellens, et entierement conformes à tout ce qu’on auroit pû souhaiter. […] Ainsi je suis fort éloigné du sentiment de ceux qui soutiennent qu’il n’y a point de regles de bonté et de perfection dans la nature des choses, ou dans les idées que Dieu en a ; et que les ouvrages de Dieu ne sont bons que par cette raison formelle que Dieu les a faits. » (Leibniz, Discours de métaphysique, 1686, §§1-2.)
Dès les Pensées philosophiques (1746), la tolérance que Diderot plaide pour l’athée porte la révolte contre le discours leibnitzien d’un prétendu ordre sublime de la nature : « “si les merveilles qui brillent dans l’ordre physique décèlent quelque intelligence, les désordres qui règnent dans l’ordre moral, anéantissent toute Providence. Je vous dis que, si tout est l’ouvrage d’un Dieu, tout doit être le mieux qu’il est possible : car si tout n’est pas le mieux qu’il est possible, c’est en Dieu impuissance ou mauvaise volonté.” […] Voilà, dit l’athée, ce que je vous objecte, qu’avez-vous à répondre ? » (Pensée XV ; DPV II 22-23.)
Enfin, l’ordre leibnizien de la nature est récusé spectaculairement par la bouche de l’aveugle Saunderson sur son lit de mort dans la Lettre sur les aveugles (1749) : « Qu’est-ce que ce monde, M. Holmes ? un composé sujet à des révolutions qui toutes indiquent une tendance continuelle à la destruction ; une succession d’êtres qui s’entre-suivent, se poussent et disparaissent ; une symétrie passagère ; un ordre momentané. » (DPV IV 52.)
51 Descartes, Principia philosophiae (1644), II, 33. (« Comment, en chaque mouvement, il doit y avoir un cercle, ou anneau, de corps qui se meuvent ensemble. »)
52 Fontenelle, Entretiens sur la pluralité des mondes habités, Quatrième soir, Œuvres complètes, II, 84, Corpus des œuvres de philosophie en langue française, Fayard, 1991. Diderot avait lu Fontenelle, comme en témoigne par exemple la référence, dans Le Rêve de D’Alembert, à l’apologue de la rose et du jardinier (Fontenelle, op. cit., p. 111 ; DPV XVII 132).
53 « Les vents ne sont donc rien d’autre que des corps qu’on ne voit pas, qui balayent tantôt la mer, tantôt les terres, tantôt enfin les nuages du ciel, et, les secouant soudain violemment, ils les emportent en tourbillon » : Sunt igitur venti nimirum corpora caeca, / quae mare, quae terras, quae denique nubila caeli / uerrunt ac subito uexantia turbine raptant (Lucrèce, De rerum natura, I, 277-279). Le De rerum natura s’ouvre avec un hymne à Vénus que Diderot cite quelques pages avant la Promenade Vernet (pp. 577-578). L’identification diderotienne de la nature et du paysage à un corps de femme jouissant (p. 270, 399) est marquée par l’influence de Lucrèce, référence latine obligée pour le matérialisme des Lumières. Quant au discours selon lequel « la nature ne pourrait sans l’intervention des dieux s’accommoder si merveilleusement », il était déjà réfuté par Lucrèce (II, 168-170 et suivants).
54 Pour les conservateurs, le tourbillon symbolise l’immoralité des idées nouvelles : « Un jeune homme au sortir de son cours de philosophie, est jeté dans un monde d’athées, de déistes, de sociniens, de spinosistes et d’autres impies, fort instruit des propriétés de la matière subtile et de la formation des tourbillons, connaissances merveilleuses qui lui deviennent parfaitement inutiles ; mais à peine sait-il des avantages de la vertu, ce que lui en a dit un précepteur ; ou des fondements de sa religion, ce qu’il en a lu dans son catéchisme. » (Shaftesbury, Essai sur le mérite et la vertu, trad. Diderot, DPV I 294.) Diderot désigne également par tourbillon le divertissement mondain : « Il est inutile de vous prévenir que j’ai quitté la retraite et que me voilà rengagé dans le tourbillon, et circulant avec tous les êtres bizarres qui le composent, moi-même être aussi bizarre qu’aucun de mes voisins. » (Lettre à Sophie Volland du 12 novembre 1765, Babelon II 307.)
55 Dans le second site, Diderot évoque « l’habitude d’apprécier les distances entre des objets interposés » (599), puis « ces nuages interposés entre le ciel et la fabrique de bois » (600) ; dans le troisième site, il s’inquiète « comment nous regagnerions le château dont nous étions séparés par un espace d’eau assez considérable » (603) ; dans le sixième site, on retrouve comme au premier « un rocher qui se perd dans la nue » : « Il était dans le lointain, à en juger par les objets interposés » (617). Puis vient la description de la lune voilée de nuages : « C’est ainsi que nous avons vu cent fois l’astre de la nuit en percer l’épaisseur » (625). Le phénomène revient dans le septième tableau, où la lune « à demi cachée dans des nuées épaisses et noires […] teint de sa lumière pâle et faible et le rideau qui l’offusque et la surface de la mer qu’elle domine » (626) ; Diderot souligne plus explicitement ensuite le double effet contradictoire de cet écran, en parlant de « ces ténèbres qui couvrent tout et laissent discerner tout » (627). J. Chouillet parle à ce sujet de perspective verticale ( ?) (art. cit., p. 136).
56 Ce seuil fonctionne comme un quatrième mur : « Si l’on imagine un plan vertical élevé sur la cime de ces deux chaînes de montagne, et assis sur le milieu de cette fabrique de bois [= le pont], on aura au delà de ce plan, vers le fond, toute la partie éclairée de la composition ; en deçà, vers le devant, toute sa partie obscure et de demi-teinte » (p. 600 ; DPV XVI 184). Diderot ne fait d’ailleurs qu’appliquer ici la définition même de la perspective telle qu’elle est donné dans l’Encyclopédie : « c’est l’art de représenter sur une surface plane les objets visibles tels qu’ils paroissent à une distance ou à une hauteur donnée à-travers un plan transparent, placé perpendiculairement à l’horison entre l’œil & l’objet. » (Chevalier de Jaucourt, art. Perspective.)
57 Ce tableau n’a malheureusement pas été identifié. Pas trace notamment, dans la production de Vernet, de ce pont de bois sur lequel Diderot insiste lourdement : « une de ces fabriques de bois hardies » ; « la fabrique de bois qui unit les cimes des deux chaînes de montagnes » ; « je vois le pont de bois » (p. 599) ; « cette fabrique de bois » (p. 600). La mention des arches du pont suppose pourtant une construction en pierre : « Ces arches que j’avais en face il n’y a qu’un moment, je les avais sous mes pieds ; sous ces arches descendait à grand bruit un large torrent » (p. 599).Les arches, elles, se retrouvent dans l’aqueduc du fond des Cascatelles de Tivoli de 1747 (Saint-Pétersbourg, Ermitage, inv. 3746), puis dans Le Matin, les baigneuses en 1772 (Paris, Musée du Louvre, inv. 8329), très proche du second site. Diderot a-t-il aménagé sa description en désurbanisant le modèle de son second site, où un modeste et rustique pont de bois cadrait mieux qu’un élégant aqueduc italien ? La mention, unique, des arches, contradictoire avec la mention, répétée avec insistance, du bois, conserverait la trace de ce remaniement imaginaire. On peut citer, comme paysages contemporains avec des ponts de bois, la Vue d’un pont de la ville de Nerva de Leprince (1765, musée des beaux-arts de Rouen, inv. 818.1.22), ou surtout le Pont sous lequel on découvre les campagnes de Sabine, de Hubert Robert (Paris, collection Henri Decourt), exposé également au Salon de 1767 sous le n°111. Diderot a pu s’inspirer de ce dernier, ce qui expliquerait l’allusion fugitive à la « campagne immense » (p. 599) qu’il laissait derrière son dos : derrière son dos dans le Salon carré de l’exposition, peut-être ? À voir également, Le Soir de la série des dessus-de-portes commandés en 1764 par Marigny pour la bibliothèque du château royal de Choisy, et exposés au Salon de 1765. Diderot a donc vu Le Soir quand il écrit la Promenade Vernet. Les quatre tableaux sont au Louvre, inv. 8317 à 8320. Ils ont été gravés par Jean-Michel Moreau (eau-forte) et Louis-Jacques Cathelin (burin).
58 Cette réversion spécifiquement diderotienne se développe à partir d’une idée fondamentale pour les Lumières : si Raphaël n’était qu’une machine, il cesserait d’être admirable ; car l’homme est plus qu’une machine, comme l’exprime Kant à la fin de « Qu’est-ce que les lumières ? » : « Quand la nature a ainsi fait éclore, sous cette dure enveloppe, le germe dont elle prend soin le plus tendrement, à savoir l’inclination et la vocation pour la pensée libre, cette tendance influe en retour, progressivement, sur la mentalité du peuple (ce qui le rend peu à peu plus apte à agir librement) et finalement, sur les principes mêmes du gouvernement, lequel juge profitable pour lui-même de traiter l’homme, qui est dès lors plus qu’une machine, conformément à sa dignité. » (Kant, Œuvres philosophiques, éd. F. Alquié, trad. Heinz Wismann, Pléiade, 1985, tome II, p. 217.) Kant publie la « Réponse à la question : qu’est-ce que les Lumières » en 1784, année de la mort de Diderot.
59 La description du troisième site correspondrait, si l’on suit J. Seznec, à la Marine commandée en 1766 par M. Henry Hoare de Fleet Street, et payée en mars 1767, n° 860 du cat. Ingersoll-Smouse, pl. CII ; Coll. Hare, Stourehead ; collection P. Cailleux, Paris en 1926.
60 Le château du Grandval et son parc, aujourd’hui disparus, se trouvaient dans l’actuelle Sucy en Brie, canton de Boissy-Saint-Léger. La propriété appartenait à Mme d’Aine, la belle-mère du baron d’Holbach. C’est au Grandval que Diderot rédige son premier Salon en 1759, et la promenade Vernet, en 1767.
61 Sur la fiction comme conjointure et la manifestation du réel comme out of joint (Hamlet), voir J. Derrida, Spectres de Marx, « Injonctions de Marx », Galilée, 1993.
62 À comparer avec le début de Jacques le Fataliste : « Vous voyez, Lecteur, que je suis en beau chemin et qu’il ne tiendrait qu’à moi de vous faire attendre un an, deux ans, trois ans le récit des amours de Jacques, en le séparant de son maître et en leur faisant courir à chacun tous les hasards qu’il me plairait », et plus loin : « Que cette aventure ne deviendrait-elle pas entre mes mains, s’il me prenait en fantaisie de vous désespérer ! Je donnerais de l’importance à cette femme… » (DPV XXIII 24-26).
63 Dans leur barque, Diderot, l’abbé et les enfants font tableau pour les hôtes du Grandval, selon un dispositif qui évoque irrésistiblement l’apologue où Lacan se décrit faisant tableau dans la barque de Petit-Jean, en Bretagne : « Un jour, j’étais sur un petit bateau, avec quelques personnes, membres d’une famille de pêcheurs dans un petit port. […] Le nommé Petit-Jean […] me montre un quelque chose qui flottait à la surface des vagues. C’était […] une boîte à sardines. Elle flottait là dans le soleil, témoignage de l’industrie de la conserve, que nous étions, par ailleurs, chargés d’alimenter. Elle miroitait dans le soleil. Et Petit-Jean me dit — Tu vois, cette boîte ? Eh bien, elle, elle te voit pas ! Ce petit épisode, il trouvait ça très drôle, moi moins. […] Moi, à ce moment-là — tel que je me suis dépeint, avec ces types qui gagnaient péniblement leur existence, dans l’étreinte avec ce qui était pour eux la rude nature — moi je faisais tableau d’une façon inénarrable. Pour tout dire je faisais tant soit peu tache dans le tableau. » (Séminaire XI, VIII, pp. 88-89.)
64 Le 9 octobre 1756, Marigny écrit à Vernet de Fontainebleau : « je doute que le port de Cette représenté en vue du coté de la mer soit reconnu par le grand nombre de ceux qui ne l’ont vu que du coté de la terre. La tempête que vous avés dessein d’y ajoutter rendroit encore votre tableau moins ressemblant, atandu qu’il est rare de voir la mer dans un port agitée de la tempête. […] Je sens bien que votre imagination se trouve par là genée ; mais avec votre talent on peut réunir le mérite de l’imitation et celuy de l’invention : vous en avés donné des preuves. » Vernet lui répond aussitôt : « vous avez la bonté de me faire observer que […] le projet de ce tableau, tel qu’il est dans l’itinéraire que vous euttes la bonté de m’envoyer, rempliroit mieux l’objet que je dois me proposer […]. C’est comme si on me demandoit de peindre en un seul tableau l’intérieur du jardin des Tuilleries, où l’on vît la façade du bâtiment, le pont tournant, d’un côté Bellevue et Saint-Clou, et de l’autre le Pont neuf, les tours Notre-Dame, Pantin et Saint-Denis. Vous jugés bien, Monsieur, qu’on ne pourroit le faire à moins de faire une carte géographique. L’intention où je suis de représenter une tempête dans ce tableau ne m’oblige pas de me metre plus éloigné du port que si je le faisoit avec un temps calme, je me place vis-à-vis l’entrée, et c’est là où la mer se brise avec le plus de violence et où se perdent assés souvent des bâtiments ; la mer est même fort agitée dans le port selon le vent qu’il fait ; ainssy il n’y aura rien contre la vraisemblance, bien au contraire ; outre que ce tableau faira une variété parmis les autres, une tempête faira le caractère distinctif de ce port, et il sera plus reconnus pris du côté de la mer que si je le prennois de celuy de la terre, d’où je ne pourrois peindre les objets qui le caractérise. »
65 Il écrivait déjà à Vernet, le 21 novembre 1756 : « Je me rends à votre avis sur le projet de votre tableau du port de Cette, quoiqu’il soit opposé à celuy de l’itinéraire que je vous ay remis, et j’approuve toutes les reflexions qui vous ont engagé à faire votre nouveau plan. Ainsi vous pourrez suivre vos idées et vous livrer à votre génie dans le tableau de ce port. »
66 Suave mari magno turbantibus aequora ventis /e terra magnum alterius spectare laborem. Comme l’a montré Michel Serres, turbantibus renvoie à la physique du tourbillon dont nous avons montré la prégnance dans la Promenade Vernet, d’où notre traduction… (Michel Serres, La Naissance de la physique, Minuit, 1977).
67 Lucrece, De rerum natura, II, 23-33.
68 Voir par exemple la VIe élégie du livre II de Properce : « Nos Pères ne décoraient point leurs demeures de ces peintures licencieuses, et leurs lambris n’offraient point aux yeux l’image du vice. Pourquoi s’étonner maintenant si l’araignée voile de son réseau les autels de nos dieux, si l’herbe envahit à notre honte leurs temples abandonnés ? »
69 Carle Vanloo et Jean-Baptiste Marie Pierre.
70 Les images décorant l’intérieur d’une voiture de louage, assez étroite, où il n’y a de place que pour deux personnes en vis-à-vis.
71 Le sculpteur Jean-Baptiste Pigalle est reçu en 1744 avec un Mercure attachant ses talonnières.
72 Le magot est une statuette en chinoiserie. Le mot est, on s’en doute, péjoratif.
73 Voir à ce sujet les analyses décisives de Jean-Christophe Sampieri, Jean-Jacques Rousseau : Esthétique et révolte (l'auteur, le public, son public : entre solitude et communauté ; entre philosophie et œuvre de pensée), thèse de doctorat sous la dir. de Georges Benrekassa, Paris VII, 2002.
74 O campagne, quand te reverrai-je ? (Horace, Satires, II, 6, 60). Le début de cette satire, Hoc erat in votis : modus agri non ita magnus / hortus ubi… (C’est exactement ce que je voulais : une petite maison avec un jardin…) constitue l’exergue du livre VI des Confessions (l’idylle aux Charmettes avec Mme de Warens). Rousseau commence à écrire les Confessions en mars 1766, lors de son séjour anglais à Wootton.
75 En fait, nul battoir sur le tableau, où les blanchisseuses rincent puis essorent le linge, mais ne le battent pas. Peut-être est-ce la tâche dévolue au jeune homme agenouillé derrière elles ?
76 Dans ses mémoires, Mme de Vandeul, la fille de Diderot, évite soigneusement le mot, qui était injurieux. Après avoir rappelé les origines aristocratiques de sa grand-mère maternelle, « fille unique d’un gentilhomme du Mans, ruiné au service », puis son mariage désastreux, elle indique pudiquement que celle-ci s’installa avec sa fille à Paris « dans un petit logement, et toutes deux faisaient le commerce de dentelle et de linge » (DPV I 16). On reconnaît ici le tableau de Mme et Mlle d’Aisnon dans Jacques le Fataliste, tableau qui n’est que théâtre hypocrite monté par Mme de La Pommeraye pour prendre au piège son amant infidèle, le marquis des Arcis : « Vous filerez, vous coudrez, vous tricoterez, vous broderez, et vous donnerez aux Dames de Charité votre ouvrage à vendre. » (DPV XXIII 142.) Au tableau noble de la pauvreté aristocratique, peint par Mme de Vandeul et forgé par Mme de La Pommeraye, s’oppose, dans La Religieuse, l’évocation plus brutale d’une condition populaire sordide. Suzanne Simonin, après s’être enfuie du couvent, trouve refuge chez une blanchisseuse : « J’entre au service d’une blanchisseuse chez laquelle je suis actuellement. Je reçois le linge et je le repasse. Ma journée est pénible, je suis mal nourrie, mal logée, mal couchée, mais en revanche traitée avec humanité. » (DPV XI 284.)
77 Les blanchisseuses ne regardent pas à proprement parler Diderot : certes, la troisième, qui porte sur sa tête un panier de linge essoré, se dresse debout face au spectateur. Mais son regard glisse vers la gauche. Il faut prendre le ça me regarde lacanien (voir note 49) dans son double sens : un « ça » regarde le spectateur, qui se trouve par là interpellé, concerné, atteint. Diderot est concerné par les blanchisseuses, qui déclenchent la chaîne associative de ses idées : d’Antoinette Champion à Sophie, de Sophie à sa solitude, de sa solitude à la nécessité du dialogue philosophique.
78 Diderot s’adresse à Grimm, le destinataire de cette fiction de lettre qu’est le Salon.
79 Le vent a projeté un petit gravier dans l’œil de l’abbé à la fin du premier site.
80 Salon de 1767, p. 533, DPV XVI 84, à propos du portrait de Diderot par Louis-Michel Vanloo. Falconet détruisit ce buste lorsqu’il vit celui de Marie-Anne Collot, son élève, qu’il jugea supérieur au sien.
81 Cette Lamentation sur le Christ mort du Carrache, alors exposée au Palais-Royal, pourrait être celle donnée en 1913 à la National Gallery de Londres par la comtesse Rosalind de Carlisle (NG2923). Le tableau est intitulé également Les trois Maries. Diderot l’évoque à plusieurs reprises : d’abord face au tableau de Pierre exposé au Salon de 1761, qu’il accuse d’être un misérable pastiche (p. 206) ; puis face au Miracle des Ardents de Doyen, dans le Salon de 1767, alors qu’il invective à nouveau Pierre (p. 658) ; enfin, à propos du Saint Louis de Michel Vanloo, occasion d’une sortie contre Webb (p. 792).
82 Nous avons déjà recontré, au chap. 2, des visages marqués par les traces du moment précédent : Mme Greuze après l’amour, Marie de Médicis après l’accouchement. Mais ici il ne s’agit plus de défigurer la figure ; c’est la réversion constitutive de la relation esthétique qui est en jeu.
83 Peut-être cette conception très particulière du dialogue comme circuit d’une parole indivise tire-t-elle son origine de la première activité littéraire de Diderot comme traducteur de l’anglais. Dans le Discours préliminaire de l’Essai sur le mérite et la vertu, il écrit en effet de Shaftesbury : « Je l’ai lu et relu : je me suis empli de son esprit, et j’ai, pour ainsi dire, fermé son livre, lorsque j’ai pris la plume. » (DPV I 300.) Je me suis empli de son esprit : telle est la base de l’incorporation dialogique. Diderot procèdera à nouveau ainsi pour l’Essai sur les règnes de Claude et de Néron (I, 971-2 ; DPV XXV 36.) Comme le paysage de Vernet dans le Salon de 1767, la page de Tacite, Suétone ou Sénèque est ici l’espace d’invisibilité du dispositif dialogique : la page lue (le paysage vu) est le point de départ du dialogue, dont les idées jetées sur le papier suppléent en quelque sorte l’image originaire. C’est par rapport à cette image en effet que se constitue la structure oscillatoire du dialogue, qui renverse perpétuellement le discours de Diderot dans celui de Sénèque et vice-versa, tandis que la fiction de l’apologie assure la circulation de la parole, fragment contre fragment, décousu contre décousu, conjurant l’absence de l’Autre absolu qu’est Rousseau dans l’Essai sur les règnes de Claude et de Néron.
84 Ce qui n’est encore ici qu’une simple anecdote, la saynète d’un demi-importun s’emparant d’une feuille de brouillon sur la table du philosophe, sera érigé en véritable système du texte dans Le Rêve de D’Alembert : après sa controverse avec Diderot sur le matérialisme, objet d’un premier dialogue si l’on peut dire à l’ancienne, D’Alembert rentre dormir et dans un délire dont sa maîtresse, Julie de l’Espinasse, prend scrupuleusement note, il incorpore et prolonge le discours de son interlocuteur. (I, 625 ; DPV XVII 116-7.) Le second dialogue, entre Julie de l’Espinasse et le médecin Bordeu convoqué au chevet de D’Alembert, consiste dans la lecture de ces notes, que commente et complète Bordeu. D’Alembert alité n’assiste à ce second dialogue que de loin, de derrière les rideaux de l’alcôve. La lecture des fragments est alors explicitement posée comme la matrice d’un dispositif dialogique dont l’espace d’invisibilité est l’alcôve du délire, identifiée à l’obscurité d’une parole lacunaire notée tant bien que mal et lue avec distance. Cette distance est marquée par les parenthèses dont Julie ponctue sa lecture : « (Docteur, y entendez-vous quelque chose ?) » ; « (Vous riez, Docteur ; est-ce que vous trouvez du sens à cela ?) » ; « (Eh bien, Docteur ?) ; « (Ma foi, Docteur, j’entendais si peu ce que j’écrivais, il parlait si bas, cet endroit de mon papier est si barbouillé que je ne le saurais lire.) » ; « (Docteur, et vous n’appelez pas cela de la déraison ?) » (DPV XVII 117, 119, 121, 123, 129). Face à cet espace d’invisibilité, Bordeu assume la structure oscillatoire, le jeu de réversion dialogique : comme médecin, il oppose au « galimatias de cordes vibrantes et de fibres sensibles » du malade l’altérité d’une raison pondérée (DPV XVII 106 et 189) ; comme matérialiste, il comprend, incorpore et poursuit ce délire (DPV XVII 123), à la stupéfaction de son interlocutrice.
85 tribut pour attribut ?
86 M. Foucault, Les Mots et les choses, IV, 7, Gallimard, 1966, p. 131.
87 La dérivation chez M.Foucault désigne d’abord la dérivation formelle des mots à partir de leur racine, selon les inflexions et l’histoire de la langue. Purement grammaticale, donc, elle construit cependant un espace rhétorique qui, lui, ne relève plus simplement de la linguistique historique. C’est parce qu’il est aussi un espace imaginaire que l’espace rhétorique de la dérivation peut constituer le support efficace de la désignation.
88 C’est le problème de l’entassement des objets dans la description. Voir Conclusion.
89 Voir J. Chouillet, La Formation des idées esthétiques de Diderot, A. Colin, 1973, pp. 50-51 et DPV XVI 195, note 295. On retrouve ici des formules proches de l’article Beau de l’Encyclopédie (1752). Diderot y remarque d’entrée de jeu que « les choses dont on parle le plus parmi les hommes sont assez ordinairement celles qu’on connaît le moins ; & que telle est, entre beaucoup d’autres, la nature du beau : […] on accorde ou l’on refuse cette qualité à tout moment ; cependant si l’on demande aux hommes quelle est sa nature, sa notion précise, sa véritable idée, son exacte définition ; […] les uns avouent leur ignorance, les autres se jettent dans le scepticisme. » (P. 81 ; DPV VI 135.)
90 Définissant l’admiration, qui dans une culture de l’ekphrasis est la forme de base de la relation esthétique, comme surprise de la première rencontre, Descartes prépare, pour la relation esthétique, l’émergence du réel. L’abbé de Diderot répétait une extase convenue qui tendait à imposer, par l’expérience frelatée du sublime, une preuve de l’existence de Dieu. Mais toute extase repose sur une surprise, et par exemple sur la surprise d’une poussière dans l’œil… L’admiration cartésienne, comprise comme surprise de la première rencontre, renverse pour Diderot l’expérience mystique du sublime en expérience matérialiste de la relation esthétique.
91 Descartes, Les Passions de l’âme, éd. G. Rodis-Lewis, Vrin, 1970, pp. 108-109.
92 Conférences de l’Académie royale de peinture, éd. J. Lichtenstein et Ch. Michel, ensb-a, 2006, I, 1, p. 270.
93 Caractères des passions gravés sur les desseins de l’illustre M. Le Brun, Paris, Langlois, sans date, probablement en 1692 (19 planches illustrant 33 passions, gravées par Sébastien Le Clerc ; rééd. Paris, Marel, 20 pl.). La première édition illustrée date de 1698 (41 planches). Nouvelles éditions illustrées en 1701, 1711 (54 planches) et 1727 (20 planches gravées par Jean Audran). Le titre du recueil fait écho à un autre livre, Les Caractères des passions par le sieur de la Chambre, Paris, 1640, rééd. 1658, 1662. L’Encyclopédie reproduit trois planches de l’« Expression des passions » (Desseins, planches 24 à 26).
94 « Or encore que ce ne soit qu’un mesme Desir qui tend à la recherche d’un bien, & à la fuite du mal qui luy est contraire, ainsi qu’il a esté dit : le Desir qui naist de l’Agréement ne laisse pas d’estre fort different de celuy qui naist de l’Horreur. Car cet Agréement & cete Horreur, qui veritablement sont contraires, ne sont pas le bien & le mal, qui servent d’objets à ces Desirs, mais seulement deux emotions de l’ame, qui la disposent à rechercher deux choses fort differentes. » (Descartes, Les Passions de l’âme, article 89, éd. Rodis-Lewis, Vrin, 1970, p. 129.) Plus loin, Descartes identifie l’horreur à la représentation dans l’âme d’« une mort subite & inopinée », tandis que l’agrément est représentation de la jouissance.
95 Comparer avec « La peinture est l’art d’aller à l’âme par l’entremise des yeux ; si l’effet s’arrête aux yeux, le peintre n’a fait que la moindre partie du chemin. » (P. 408 ; DPV XIV 226) « tout y est du plus beau faire ; mais […] sans idée. Cela parle aux yeux, mais cela ne dit pas le mot à l’esprit ni au cœur. » (Pp. 554-5 ; DPV XVI 121.) « pour nous qui exigeons qu’une scène aussi intéressante s’adresse à notre cœur, qu’elle nous émeuve, qu’elle fasse couler nos larmes, nous cracherons sur la toile… » (P. 566 ; DPV XVI 139.) « En un mot, la peinture est-elle l’art de parler aux yeux seulement ? ou celui de s’adresser au cœur et à l’esprit, de charmer l’un, d’émouvoir l’autre, par l’entremise des yeux ? » (P. 583 ; DPV XVI 164.) « Il y a entre le mérite du faire et le mérite de l’idéal la différence de ce qui attache les yeux et de ce qui attache l’âme. » (P. 708 ; DPV XVI 349.)
96 Nous suivons ici la leçon de la copie de Saint-Pétersbourg, où Girbal corrige le manuscrit autographe, manifestement fautif : Spectateur peut-être désespéré de survivre à tant d’êtres chéris, hasarderez-vous votre vie.
97 « Voici Priam. Voici jusqu’en ces lieux le tribut qu’on rend à la gloire. » (Virgile, Énéide, I, 461.)
98 La description du mur orné de scènes de la guerre de Troie est précédée, dans le récit virgilien, par l’histoire des origines de la construction du temple. Arrivant sur le rivage, les premiers colons de la future Carthage déterrèrent en ce lieu un présage (effodere loco signum, v. 443), une tête de cheval. Les figures vues par Énée sont dressées à l’endroit du signum déterré par les Carthaginois, dont l’arrivée après une tempête racontait déjà, avant la lettre, l’arrivée du héros de l’Énéide. Donc, tandis que toute figure renvoie à un réel, c’est-à-dire à sa propre défiguration dans le réel, tout réel se manifeste comme signum, et, dès lors qu’il est saisi comme signe, déclenche le processus de figuration. Praemia est renversé en Priamus (noter l’homophonie, qui donne à entendre la réversion scopique), après que effodere signum a été conjuré par templum condebat.
99 Le récit d’Énée occupe les livres II et III de l’Énéide.
100 « Si tu veux me faire pleurer, souffre d’abord toi-même. » (Horace, Art poétique, vv. 102-103.)
101 Est-ce une allusion à un épisode de l’enfance de Caton d’Utique, rapporté par Plutarque dans les Vies parallèles (Caton le Jeune, II, Gallimard, p. 1388) et par Valère Maxime (III, 1, 2) ? Pompédius Silo (Quintus Poppédius chez V. M.), général des révoltés italiens qui demandaient le droit de cité romain, avait pris ses quartiers chez le jeune Caton. Il demanda aux enfants de la maison d’intercéder pour sa cause auprès de leur oncle Drusus. Caton gardant le silence, il le suspendit à la fenêtre et menaçait de le lâcher s’il ne promettait pas de parler. Mais Caton resta impassible, découvrant dès alors sa fermeté de caractère peu commune. Cet épisode est évoqué dans la Réfutation d’Helvétius, où Diderot fait dire à Caton ce seul mot, « Lâche » (I, 781 ; DPV XXIV 489).
102 Adrienne Lecouvreur était actrice à la Comédie française dans les années 1720. Le tome II du Dictionnaire des théâtres de Paris, de Parfaict (Paris, Rozet, 1767) comporte un article Couvreur, qui précise qu’elle « débuta à Paris le Vendredi 14 Mai 1717 par le role d’Electre dans la Tragédie de ce nom » (l’Electre de Longepierre, ou celle de Crébillon ?). Mais Maupoint, dans la Biblioteque des theatres (Paris, Prault, 1733) parlait de Monime dans Mithridate (de Racine).
103 Ce qui se joue dans le circuit et dans le dédoublement que Diderot décrit ici n’est autre que ce que Freud désigne comme le Pc-Cs (Perception <-> Conscience), qui est, pour le sujet, le système d’échange entre l’intérieur et l’extérieur, à l’interface duquel s’est constitué le moi. Le Pc-Cs organise le jeu entre principe de plaisir (qui règne à l’intérieur, depuis le ça) et principe de réalité (qui vient de l’extérieur et est relayé par le surmoi) : cherchant à substituer le second au premier, il transforme bien de la douleur en plaisir… (Voir Freud, Le Moi et le Ça, chap. 2-3, in Essais de psychanalyse, Payot, 1981, p. 236 et 247-8.)
104 S. Lojkine, Image et subversion, op. cit., 2e partie.
105 Diderot reprendra cette distinction presque dans les mêmes termes dans les Mélanges philosophiques, historiques… pour Catherine II : « La vertu se définit pour le législateur, la conformité habituelle des actions à la notion de l’utilité publique ; peut-être la même définition convient-elle au philosophe qui est censé avoir assez de lumières pour bien connaître ce que c’est que l’utilité publique.
Pour la masse générale des sujets, la vertu est l’habitude de conformer ses actions à la loi bonne ou mauvaise.
Socrate disait, “Je ne me conformerai point à cette loi parce qu’elle est mauvaise.” Aristippe répondait à Socrate ; “Je sais aussi bien que toi que cette loi est mauvaise, cependant je m’y conformerai. Parce que si le sage foule aux pieds une mauvaise loi, il autorise par son exemple tous les fous à fouler aux pieds les bonnes.” L’un parlait en souverain. L’autre, en citoyen.
Mais on voit par là qu’il n’y a point de code dont la sagesse puisse être éternelle ; et qu’il faut de temps en temps rappeler les lois à l’examen. » (chap. 47, « De la morale des rois », éd. en cours par G. Dulac pour DPV. Le titre du chapitre fait allusion à Xénophon, Mémorables, II, 1.)
106 « En un mot, de combien de rébellions et d’étranges félonies a été causée l’erreur de ceux qui ont enseigné qu’il appartenait à des personnes privées de juger de la justice ou de l’injustice des édits d’un monarque, et que non seulement on pouvait avoir raison, mais qu’on devait disputer de la qualité de ses commandements avant que de lui obéir ? » (Hobbes, Le Citoyen, 1642, trad. S. Sorbière, 1649, GF, 1982, p. 69.)
107 Dans le cinquième site, Diderot évoquera Socrate et Aristippe. J. Seznec rapproche ce passage du Traité des devoirs de Cicéron : « Quant aux actions conduites selon la tradition et les lois de la cité (more institutisque civilibus), il n’y a aucune directive à donner à leur sujet : ces actions sont elles-mêmes des directives (præcepta), il ne faudrait pas que quiconque soit abusé par l’erreur de croire que, si Socrate et Aristippe ont agi ou parlé contre la tradition et les usages de la cité, la même chose lui soit permise à lui. » (CICERON, De officiis, I, XLI, 148.) Mais chez Diderot, Socrate seul prône la révolte contre la loi au nom de la vertu, contre Aristippe qui la récuse et prêche la prudence. (L. Sorri, « La favola, la legge, l’attesa », Il Confronto letterario, université de Pavie, Mauro Baroni Editore, 1986.)
108 Selon Else Marie Bukdahl, le tableau que décrit le cinquième site serait Le Fanal exhaussé peint par Vernet à Rome en 1746. Voir Joseph Vernet, Paris, Musée de le Marine, 1976, cat. n° 12. Une gravure inversée en a été exécutée par William Byrne en 1772. Le fanal est la lanterne placée en haut du phare. Vernet pourrait avoir pris modèle sur une Marine avec le port de Gênes de Jan Theunisz Blanckerhoff (1628-1669), conservée à la Galerie Doria Pamphilj, à Rome. Le phare de Vernet est moins stylisé, moins haut, et le premier plan de la composition, des vagues noires chez Blanckerhoff, est un rivage peuplé de personnages chez Vernet ; la barque de pécheurs, ballottée par les vagues dans le modèle hollandais, est halée au sec dans Le Fanal exhaussé. Blanckerhoff peint la tempête, le gros temps ; Vernet en suggère les prémisses (dans une logique de l’instant prégnant) et exacerbe la dissémination figurale propre au paysage.
109 On pourrait citer aussi bien la lettre 34 de la correspondance de Cicéron, adressée à Atticus (Att., II, 7, 4) : « je veux regarder depuis la terre ferme le naufrage de ces gens, je veux, comme le dit ton ami Sophocle, sous un toit / Écouter la pluie battante, d’un cœur serein. » Sophocle, Lucrèce, Cicéron déclinent une image qui n’est pas exactement la même, mais dont les glissements et recoupements constituent un espace rhétorique de dérivation. Voir également le Colloque d’Érasme sur Le Naufrage (1523), et sa conclusion : « Quant à moi, j’aime mieux entendre de telles aventures que de les vivre. » (Imprimerie nationale, 1992, t. 1, p. 276.)
110 L’image topique du naufrage est portée, dans l’iconographie classique, par l’histoire de Céyx et d’Alcyone : malgré les objurgations de son épouse, Céyx s’embarque en mer pour consulter un oracle et périt dans un naufrage dont le tableau est envoyé en songe à Alcyone. Désespérée, celle-ci se précipite sur le rivage, d’où elle aperçoit le cadavre de son époux ballotté par les flots (Ovide, Métamorphoses, XI, 410-748). En juillet 1769, une gravure de William Woollett d’après Richard Wilson est publiée à Londres sous le titre Céyx and Alcyone et avec quelques vers de Dryden décrivant le désespoir de la reine devant Céyx repêché des flots. La gravure est absolument dans le style des Tempêtes de Vernet.
111 Voir Léo Strauss, Droit naturel et histoire, 1953, trad. française, Plon, 1954, et Robert Derathé, Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps, Vrin, 1979. La nécessité de désobéir à la loi quand elle est inique est un thème que Diderot avait développé déjà en traduisant Shaftesbury en 1745. (Shaftesbury, Essai sur le mérite et la vertu, II, 3, trad. Diderot, DPV I 329.)
112 La localisation de ces mœurs africaines sur les côtes de Malabar, au sud-ouest de la péninsule indienne, est purement fantaisiste, et peut-être simplement choisie pour l’assonance Malabar/Barbare (exploitée par Voltaire par exemple dans sa lettre à Frédéric, juin-juillet 1738 : voir Correspondance choisie, éd. J. Hellegouarc’h, LP, pp. 116-7).
113 Diderot avait écrit un compte rendu de De l’Esprit dans la Correspondance littéraire en 1758 (DPV IV 303-312). Au moment où Diderot écrit le Salon de 1767, Helvétius travaille à De l’Homme, achevé en 1770, publié en 1773 : Diderot, qui avait déjà lu le manuscrit, s’attellera à la Réfutation d’Helvétius lors du voyage en Hollande de 1773 (DPV XXIV 424). Sur le rapprochement du cinquième site et de De l’Esprit, voir DPV XVI 203, note 320.
114 Giovanni Antonio Cavazzi da Montecuccoli († 1680), Relation historique de l’Éthiopie occidentale, contenant la description des royaumes de Congo, Angolle et Matamba ; traduit de l’italien et augmenté de plusieurs relations portugaises des meilleurs auteurs... par le R. P. J. B. [Jean-Baptiste] Labat, Paris, C.-J.-B. Delespine, 1732, 5 vol. in-12° avec cartes et planches, cote Bnf 8-O3C-8. Helvétius cite d’abord Cavazzi, puis directement le père Labat.
115 Voltaire, Essai sur les mœurs, chap. 141, « Des découvertes des Portugais », Garnier, t. 2, p. 309. Ce passage apparaît pour la première fois dans l’édition de Genève, Cramer, 1761. Voir également l’article Hottentots de l’Encyclopédie par le Chevalier de Jaucourt (1765).
116 Le Christ, opposé à Socrate.
117 Dans le Criton, Socrate renonce à s’évader de prison malgré la mort qui l’attend. Désobéir aux lois revient à les détruire et à renverser la cité. Il préfère donc se soumettre à une sentence inique, quitte à y perdre la vie. (Platon, Criton, 50a-51a.) Diderot connaissait ce texte, lui qui avait traduit l’Apologie de Socrate à Vincennes. Voir DPV IV 237-9, où Raymond Trousson démontre que les extraits de l’Apologie de Socrate présents dans le Discours sur les sciences et les arts de Rousseau proviennent de la traduction de Diderot, preuve qu’il a bien traduit ce texte à Vincennes et qu’il en a discuté avec son ami d’alors.
118 Mémorables, II, 1. Ce dialogue contient l’histoire d’Hercule entre le Vice et la Vertu rapportée d’après Prodicos. C’est la source de Shaftesbury pour son Jugement d’Hercule et, de là, de Diderot pour l’article Composition de l’Encyclopédie. Voir chap. 2.
119 « Aristippe lui demanda une autre fois s’il connaissait quelque belle chose. — Oui, et j’en connais beaucoup, répondit Socrate. Eh bien, sont-elles toutes semblables ? — Il y en a qui diffèrent les unes des autres autant qu’il est possible. — Et comment ce qui diffère du Beau peut-il être beau ? » (Mémorables, III, 8 : c’était précisément le sujet de la discussion avec l’abbé dans le quatrième site.)
120 Diderot donne à Aristippe les paroles qui sont celles de Socrate dans le Criton. Il semble qu’il ait en quelque sorte fusionné les deux personnages : d’ailleurs, s’il s’identifie à Socrate quand il est emprisonné à Vincennes (1749), c’est à Aristippe qu’il dit ressembler dans sa nouvelle robe de chambre de luxe, offerte par Mme Geoffrin vingt ans plus tard : « O Diogene, si tu voyais ton disciple sous le fastueux manteau d’Aristippe, comme tu rirais ! O Aristippe, ce manteau fastueux fut payé par bien des bassesses ! quelle comparaison de la vie molle, rampante, efféminée, et de la vie libre et ferme du cynique déguenillé ? J’ai quitté le tonneau où tu régnais pour servir sous un tyran. » (Regrets sur ma vieille robe de chambre, 1769, p. 821 ; DPV XVIII 52.) Cette dernière représentation d’Aristippe est plus conforme à la tradition…
121 Diderot persiste et signe dans les Mélanges philosophiques, historiques etc écrits lors de son séjour auprès de Catherine II en 1773. Le titre du chapitre 47 des Mélanges, « De la morale des rois », signe la référence au premier dialogue du livre II des Mémorables, dont le point de départ est l’éducation du futur roi. On y retrouve quasiment la même formulation que dans le Salon de 1767 pour définir légalement la vertu, et la même opposition de Socrate et d’Aristippe. Diderot y précise son rapport aux deux philosophes : si Aristippe défend la morale des rois, le Socrate révolté diderotien figure la morale du citoyen : nous voici revenus aux termes de Hobbes, dont Le Citoyen opposait bien d’une part Jupiter, le monarque absolu, seul juge légitime de l’équité des lois, d’autre part Ixion, le sujet révolté, payant d’un châtiment éternel d’avoir voulu étudier de trop près cette équité, figurée dans le mythe par Junon dont il est épris (Hobbes, Le Citoyen, op. cit., p. 70). Mais Socrate n’est pas Ixion, et son nom seul légitime sa posture.
122 Freud, Au-delà du principe de plaisir, chap. 2, Essais de psychanalyse, op. cit., p. 52 et Lacan, Séminaire XI, V, 3, p. 60. Voir également Philippe Déan, Diderot devant l’image, p. 337, et la Lettre sur les aveugles : « Ne serait-il pas plus naturel de supposer qu’alors les enfants s’imaginent que ce qu’ils cessent de voir, a cessé d’exister ; d’autant plus que leur joie paraît mêlée d’admiration, lorsque les objets qu’ils ont perdu de vue, viennent à reparaître. Les nourrices les aident à acquérir la notion de la durée des êtres absents, en les exerçant à un petit jeu qui consiste à se couvrir et à se montrer subitement le visage. Ils ont de cette manière, cent fois en un quart d’heure, l’expérience que ce qui cesse de paraître, ne cesse pas d’exister. » (DPV IV 59-60.) Le « non pas montrer, mais laisser voir » constitutif du dispositif scénique analysé au chapitre 3 n’est en un sens que la répétition atténuée de ce fort-da.
123 Dans Le Fanal exhaussé, la mer est traitée comme surface, et même, à la manière des ports de France, comme interface. Ce n’est pas la haute mer, mais le terme d’un parcours où déjà l’on a pied. Le rivage et la jetée, en bas, stables, sûrs, abrités, s’opposent au ciel et au vent, où se joue la tempête, le tourbillon, l’instabilité. Entre les deux, la mer est une ligne de partage, une membrane d’échange, une barre sémiotique. L’exclamation de Diderot, « ô profondeur des mers », ne renvoie donc pas à la réalité visible du tableau, mais bien à l’espace d’invisibilité, à la profondeur inquiétante et inaccessible qu’il désigne métaphoriquement.
124 Diderot y reviendra dans le Paradoxe sur le comédien : « concevez combien il est fréquent, et facile à deux interlocuteurs, en employant les mêmes expressions, d’avoir pensé et de dire des choses tout à fait différentes. […] il y a dans la langue technique du théâtre une latitude, un vague assez considérable pour que des hommes sensés, d’opinions diamétralement opposées, croient y reconnaître la lumière de l’évidence. Et demeurez plus que jamais attaché à votre maxime : ne vous expliquez point, si vous voulez vous entendre. » (p. 1379 ; DPV XX 46-7.) La maxime était lancée dans Le Neveu de Rameau : « Moi. — Peu s’en faut que je ne sois de votre avis ; mais gardons nous de nous expliquer. Lui. — Pourquoi ? Moi. — C’est que je crains que nous ne soyons d’accord qu’en apparence ; et que, si nous entrons une fois dans la discussion des périls et des inconvénients à éviter, nous ne nous entendions plus. » (II, 685 ; DPV XII 179.) Ce problème de la désignation est développé plus loin, dans le 6e site (pp. 621-4 ; DPV XVI 217-221) et à nouveau dans la Réfutation d’Helvétius (I, 780 ; DPV XXIV 489).
125 On ne connaît pas de petit frère à Sophie Volland, qui avait environ quarante ans quand Diderot la rencontra, probablement en 1755 (Arthur Wilson, Diderot, Bouquins, p. 193). En revanche « la chère sœur » désigne dans les Lettres à Sophie Volland Mme Legendre, qui avait elle-même un fils, Fanfan (voir par exemple la lettre à Sophie du 3 mars 1766, Babelon III 61). L’enfant désignait-il Louis-Henriette (Sophie) comme « ma sœur » par imitation de sa mère ?
126 Sans doute faut-il voir ici une attraction du modèle mécaniste, identifiant l’enfant à une machine désignant mécaniquement les objets. Diderot se défie constamment d’un tel modèle. Dans Le Rêve de D’Alembert, c’est précisément le rire des enfants qui est convoqué contre le raisonnement mécaniste cartésien, dans le processus qui conduit de la germination dans l’œuf à la naissance du poussin : « Prétendrez-vous avec Descartes que c’est une pure machine imitative ? mais les petits enfants se moqueront de vous, et les philosophes vous répliqueront que si c’est là une machine, vous en êtes une autre. » (I, 618 ; DPV XVI 104.)
Référence de l'article
Stéphane Lojkine, L'Œil révolté. Les Salons de Diderot, « IV - La relation esthétique », Éditions Jacqueline Chambon, Actes Sud, 2007, p. 343-445.
Diderot
Archive mise à jour depuis 2006
Diderot
Les Salons
L'institution des Salons
Peindre la scène : Diderot au Salon (année 2022)
Les Salons de Diderot, de l’ekphrasis au journal
Décrire l’image : Genèse de la critique d’art dans les Salons de Diderot
Le problème de la description dans les Salons de Diderot
La Russie de Leprince vue par Diderot
La jambe d’Hersé
De la figure à l’image
Les Essais sur la peinture
Atteinte et révolte : l'Antre de Platon
Les Salons de Diderot, ou la rhétorique détournée
Le technique contre l’idéal
Le prédicateur et le cadavre
Le commerce de la peinture dans les Salons de Diderot
Le modèle contre l'allégorie
Diderot, le goût de l’art
Peindre en philosophe
« Dans le moment qui précède l'explosion… »
Le goût de Diderot : une expérience du seuil
L'Œil révolté - La relation esthétique
S'agit-il d'une scène ? La Chaste Suzanne de Vanloo
Quand Diderot fait l'histoire d'une scène de genre
Diderot philosophe
Diderot, les premières années
Diderot, une pensée par l’image
Beauté aveugle et monstruosité sensible
La Lettre sur les sourds aux origines de la pensée
L’Encyclopédie, édition et subversion
Le décentrement matérialiste du champ des connaissances dans l’Encyclopédie
Le matérialisme biologique du Rêve de D'Alembert
Matérialisme et modélisation scientifique dans Le Rêve de D’Alembert
Incompréhensible et brutalité dans Le Rêve de D’Alembert
Discours du maître, image du bouffon, dispositif du dialogue
Du détachement à la révolte
Imagination chimique et poétique de l’après-texte
« Et l'auteur anonyme n'est pas un lâche… »
Histoire, procédure, vicissitude
Le temps comme refus de la refiguration
Sauver l'événement : Diderot, Ricœur, Derrida
Théâtre, roman, contes
La scène au salon : Le Fils naturel
Dispositif du Paradoxe
Dépréciation de la décoration : De la Poésie dramatique (1758)
Le Fils naturel, de la tragédie de l’inceste à l’imaginaire du continu
Parole, jouissance, révolte
La scène absente
Suzanne refuse de prononcer ses vœux
Gessner avec Diderot : les trois similitudes

