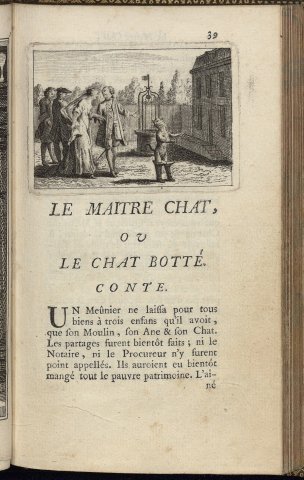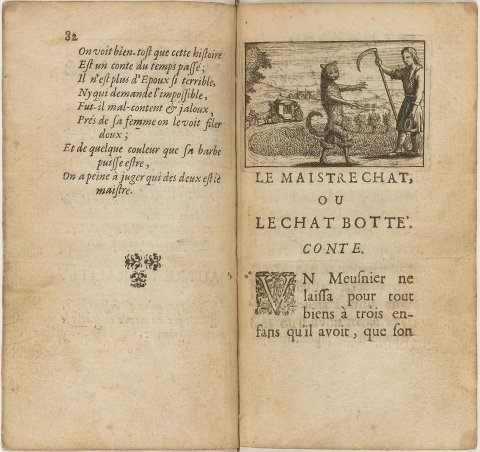Une édition fantôme
En 1742, sur le marché actif de l’édition illustrée, paraît [chez Coustelier] à La Haye un volume in-12 présenté comme une nouvelle édition des Histoires ou contes du temps passé avec des Moralités par Mr Perrault. Presque cinquante ans après la première publication des contes en prose par Claude Barbin qu’accompagnaient les gravures d’Antoine Clouzier (1697), cette version reprend les mêmes pièces en prose, soit huit contes ; elle les complète toutefois par « L’adroite Princesse » pourtant attribuée à Mlle L’Héritier mais que certains éditeurs ont pris l’habitude d’inclure dans les recueils des contes de Perrault.
Pour ce volume, le libraire rebat les cartes des textes et propose un agencement que l’on trouve déjà dans l’édition de Jacques Desbordes parue à Amsterdam en 1716 (y figure pour la première fois, et à la même place, le conte de Mlle l’Héritier, « L’adroite Princesse »). En remaniant ainsi le recueil comme l’avait fait Desbordes, en déplaçant les récits et en essayant d’autres combinaisons, il rappelle l’autonomie et simultanément la solidarité herméneutique des contes, leur aptitude à migrer et, en fonction de leur emplacement et donc de leurs voisinages, à renouveler une lecture qui saisit chaque récit pour lui-même et pour sa valeur au sein de l’ensemble. Au lieu de pénétrer dans le livre par le conte de « La Belle au bois dormant » dont l’hybridité thématique et stylistique, mêlant la merveille à sa parodie, donnait le ton du volume de 1697, le lecteur débute par « Le petit Chaperon rouge ». La notoriété de ce « conte-des-contes » justifie peut-être son emplacement inaugural ; sa lecture enténèbre en tout cas immédiatement l’atmosphère du recueil. Puis vient « Les Fées » : le récit, qui orne en une fiction métapoétique l’idée même de merveilleux, perd la position médiane et stratégique qu’il occupait auparavant. Cependant, à son nouvel endroit, il réintroduit la féerie sous son double aspect de laideur et de beauté en compensant le déplacement de « La Belle au bois dormant » disparu de l’ouverture. « La Barbe bleue » demeure le troisième conte. Mais ne lui succède plus directement « Le Maître chat » : l’édition intercale « La Belle au bois dormant ». Le remontage des deux textes pousse alors au rapprochement, dans le registre du monstrueux, entre l’ogresse gastronome dramatisant la fin de « La Belle au bois dormant » et l’étrange barbu féminicide qui prend son relai. Les trois contes suivants respectent la dispositio du volume Barbin.
Comme ce dernier, l’ouvrage de 1742 est assorti d’images. Pour partie, la série, gravée sur cuivre en taille douce, obéit à la configuration de l’édition princeps, elle-même conforme au magnifique manuscrit gouaché dédié, deux ans auparavant, à « Mademoiselle » (Mlle d’Orléans)1. L’éditeur n’a pas voulu reproduire les gravures d’Antoine Clouzier ; il emprunte néanmoins à l’édition Barbin, outre un frontispice en fonction de préface, calqué sur celui de Clouzier, la distribution systématique de vignettes en tête de chaque conte. Élaborées par Jacques de Sève, ces vignettes ne sont pas toutes signées. Pierre-Michel Lamy les réemploiera pour une édition parisienne en deux parties plus tardive, en 1781. Comme y figureront aussi les contes en vers, d’autres vignettes, de la main de François-Nicolas Martinet, seront adjointes au programme de Jacques de Sève.
Disposés avant le début de chaque récit, exactement au-dessus du titre, la vision figurale du texte précédant son écriture, les petits rectangles modelés par de Sève préparent le lecteur à sa lecture. Dans cet objet intermédial qu’est, depuis son origine, le livre de Perrault, le titre de chaque conte remplit donc la fonction d’interface entre l’image et le texte : il synthétise les récits pour la mémoire, engage le verbal et lance le récit par les quelques mots qui l’identifient en même temps que, tourné vers l’image, il équivaut à une légende. À cet emplacement, ouvrant dans la page la porte de l’imaginaire ou faisant office d’enseigne, l’illustration sert doublement d’incipit visuel et de sommaire narratif.
Or la Bibliothèque de l’Arsenal possède sous la cote RESERVE8-BL-18884 un curieux exemplaire pourvu de deux trames d’images2. L’ouvrage, qui a appartenu à l’inspecteur de la librairie française Joseph d’Hémery, se présente comme une édition de 1742 effectivement pourvue des vignettes et du frontispice créés par de Sève. Cependant, les complète dans le corps de chaque récit une planche gravée en pleine page, signée Simon Fokke. À ma connaissance, aucun autre exemplaire de 1742 ne rassemble ces deux séries. Les gravures de Fokke n’apparaissent, semble-t-il, pas avant l’édition bilingue de 1745 conçue par Jean Néaulme à La Haye et sous le titre complet Contes de ma mère l’Oye en françois et en anglois. Nous y découvrons un frontispice effectivement signé Fokke et daté (1745) ; il est similaire à celui de l’édition de 1742 bien qu’en contrepartie. L’intitulé « Contes de ma Mère l’Oye », qui avait initialement été inséré dans le frontispice de 1742, a été remplacé par un tableau de paysage accroché au mur du fond. En 1742, le frontispice ne porte aucune signature.
Dans son Guide de l’amateur de livres à figures, Henry Cohen recense cette édition en indiquant qu’on peut y apprécier « 1 frontispice et 8 jolies figures de de Sève gravées par Fokke3 ». Or si l’attribution des vignettes est incontestable puisque deux d’entre elles sont signées (« Le Petit Chaperon rouge » et « Les Fées »), rien ne permet en revanche de penser que Fokke est bien l’auteur des gravures. Dans sa livraison de juin 1899 (n°47, p. 796-797), le Bulletin de la librairie Damascène Morgand donne, de son côté, une référenciation différente :
36436 PERRAULT Histoire ou Contes du temps passé avec des moralités par M Perrault La Haye Paris, Coustelier 1742 in 12 front et fig mar rouge double rangée de fil tr dor (Capé.) Cette édition contient neuf contes y compris l’Adroite princesse ; elle est ornée d’un frontispice et de 9 jolies vignettes en têtes gravées par Fessard d’après De Sève. Manque le frontispice.
Pour le Bulletin, comme pour Vérène de Diesbach-Soultrait4, Étienne Fessard, et non Simon Fokke, serait le graveur de de Sève. À bien examiner la vignette du « Petit Chaperon rouge », le nom de Fessard se devine, à droite, symétrique de celui de de Sève. Il est dès lors peu probable que Fokke ait exécuté les autres illustrations et le frontispice. La confusion vient vraisemblablement de ce que Fokke reprend en son nom le frontispice de 1742 dans la version bilingue parue chez Néaulme et, d’autre part, de ce que l’exemplaire de l’Arsenal, associant les séries, introduit le nom de Fokke et laisse entendre, dans sa notice, qu’il serait le graveur de la totalité des images. Depuis le XIXe siècle, en réalité, les catalogues, à l’instar de ceux de Cohen, complété par Portalis, ou de Tchemerzine, entretiennent le flou sur les attributions en continuant de voir en Fokke le graveur de 1742. Récemment encore, le site de la Bnf légende la vignette de tête du « Petit Chaperon rouge » en ces termes : « Publiée quarante-cinq ans après l'édition originale, cette nouvelle édition, augmentée et réorganisée, fait date par son illustration. Gravées en taille douce par le Hollandais Simon Fokke d’après les dessins de Jacques de Sève, les huit vignettes en tête de chaque conte se démarquent de l'illustration princeps par le sujet et par le style5. »
Par son croisement d’images empruntées aux éditions de 1742 et de 1745, l’exemplaire de l’Arsenal est très certainement un hapax. Son programme illustratif est l’œuvre fictivement collaborative de Jacques de Sève pour le dessin des vignettes de tête, d’Etienne Fessard pour les gravures de ces images, et de Simon Fokke pour les planches. On reconnaît dans cet agencement singulier l’habitude qu’avaient les bibliophiles de cette époque de truffer les éditions, en faisant circuler les figures et en recomposant pour leur plaisir personnel des ouvrages uniques et distinctifs. Il n’en demeure pas moins que le livre conservé à l’Arsenal existe, qu’on peut le lire et le regarder pour ce qu’il est, une fiction de montage, vraisemblablement à usage privé : trois livres en un.
Marie-Claire Planche estime que les vignettes des contes de Perrault, ajoutées à la commande pour le Temple de Gnide de Montesquieu, ont lancé de Sève dans le métier d’illustrateur6. Certainement sa contribution fait-elle date, en 1742, à un moment où, contrairement à ce que l’on pourrait penser, les textes de Perrault ne sont qu’assez peu illustrés. Avant la magistrale édition du Cabinet des fées de Charles-Joseph de Mayer à partir de 1785, dont la partie insérant les contes de Perrault au Tome I sera confiée à Marillier, la série Sève ou Sève-Fokke, contenant soit 8 vignettes et un frontispice soit 17 illustrations en tout avec les planches, ramène les histoires du temps passé à leur cotexte premier d’images ; elle réactive le pouvoir de figuralité inhérent à des fictions que l’écrivain a segmentées comme des pans de rêve, en les enracinant dans l’imaginaire culturel de son temps.
La reprise du montage iconotextuel voulu par Barbin est une façon pour Coustelier de s’inscrire dans une tradition visuelle – et déjà de la constituer comme telle –, sur un modèle en commun avec les Fables de La Fontaine. En 1668, en effet, paraissent chez le même libraire plusieurs éditions du premier recueil du fabuliste (in-4 et in-12), rehaussées d’un appareil identique de vignettes, de la main de François Chauveau. Les genres brefs, ramassés, denses de la fable ou du conte, dont Perrault revendique pour sa part le jumelage, réclament des images de tailles réduites, comparables à des miniatures ou aux gravures emblématiques auxquelles l’œil du lettré est depuis longtemps accoutumé. À l’évidence, le format des éditions a influencé le choix de telles gravures restreintes, agencées comme de petites vues. Mais c’est prioritairement à une poétique de textes conçus pour concentrer l’imagination et développer les facultés pensives du lecteur que contribuent ces formats d’illustrations, rendant inséparables le récit et son avant-scène figurée.
Toutefois, l’apport des planches gravées par Fokke entraîne une incontestable modification du régime visuel. La présence de ces images sollicite un peu plus encore la double compétence du lecteur Janus des éditions à figures, le regard partagé entre lire et regarder. L’étrange ouvrage de l’Arsenal, qui compile les deux séries de Sève-Fokke, nous invite à passer des textes à leurs commentaires visuels et à circuler d’illustrations en illustrations, au prix d’accommodations, ajustées aux dimensions des images, de modifications de la distance de perception et de changements de modalités de lecture. Avec les planches, la vignette bénéficie en particulier d’une amplification plastique et d’un redoublement visuel, qui s’appuie éventuellement sur des répétitions thématiques (telle scène reprise ou variée selon les deux formats). Que le conte bénéfice, à partir de 1745 probablement, de l’image pleine page à laquelle les éditeurs ont de plus en plus souvent recours, le rapproche de l’illustration des romans, en le faisant entrer dans une nouvelle dimension graphique.
Pourvu des deux séries, l’exemplaire de l’Arsenal (1742-1745) est, à sa façon, un témoignage de l’expansion des figures au sein des livres. Mais avant tout, son montage propose un double processus de lecture figurale qui permet de jouer à la fois sur les relations des contes et de leurs images et sur les liens des illustrations entre elles. En résulte une forme singulière d’hyperfiguration du recueil des contes en prose dont on interrogera les effets sémantiques et les conséquences sur la réception du lecteur. Par là, on considérera l’intermédialité, doublée ici d’intericonicité et de « diplopie » illustrative (deux images pour un texte), comme un processus éminemment plastique, générateur d’interactions potentielles et de connexions aléatoires, nous permettant d’observer les images au travail et donc d’envisager leur figurabilité, entendue comme agencement de figures et hybridation de ces agencements.
Scènes remontrées
Les illustrations de 1742 n’existent pas sans celles de 1697. De Sève prend visiblement les images de Clouzier comme référents pour démarquer sa propre interprétation tout en assumant leur héritage. Sa démarche est parallèle à celle de Perrault lui-même qui, sur la base des états préexistants des récits qu’il a sélectionnés, module le déjà-connu et trouve sa légitimité dans l’exercice de la réappropriation. Frontispice, vignettes : entre 1697 et 1742, nombre de scènes se ressemblent, le dessinateur ne faisant guère porter son effort sur l’originalité des moments prélevés aux textes. Aussi le frontispice de de Sève conserve-t-il les protagonistes de la veillée idéale qui occupaient déjà l’entrée dans le manuscrit. Entre les éditions, le décor d’un intérieur chauffé par l’âtre ardent d’une cheminée est presque identique (Fig. 1-2).
D’une parution à l’autre, le petit chaperon rouge couché dans le lit de sa mère-grand continue de subir l’assaut violent du loup qui le tue ; reproduisant le même parallèle contrastif entre les récits, la belle au bois dormant accueille, près de son lit, le prince charmant qui la réveille. Au milieu de la forêt, la cadette offre toujours à boire à la fée à sa gauche une eau servie dans une cruche. Riquet et la princesse se parlent de la même façon ; derrière eux, les convives du banquet sont également reproduits. Quant aux deux Cendrillons, elles perdent leurs chaussures qu’un prince, toujours aussi attentionné, ramasse en se baissant. Le même petit Poucet tire la botte de l’ogre qui, à 50 ans d’écart, n’est toujours pas sorti de son sommeil ; les six frères de l’enfant débrouillard, alors qu’à en croire le conte ils ne devraient plus se trouver là, continuent de se tenir serrés les uns contre les autres à l’intérieur du « Rocher creux » (Fig. 3-4).
Par maints détails cependant, les vignettes de de Sève signalent leurs différences. Certains éléments ont été écartés : le chat du frontispice, par exemple, ne se tient plus en boule, face à nous, devant la cheminée désormais dépourvue de grille ; l’ogre n’arbore plus son chapeau qui l’embourgeoise ; le lit de la Belle au bois dormant a été privée de ses quenouilles à tête de chimère... Même si elles se remarquent d’autant plus qu’elles sont en nombre limité, ces quelques disparitions sont compensées par une grande quantité d’ajouts qui étoffent l’ambiance visuelle des illustrations sans en bouleverser l’interprétation.
Deux vignettes, en revanche, optent pour une scénographie qui se distingue franchement de la série Clouzier : « La Barbe bleue » et « Le Maître chat ». Pour le premier conte, par exemple, tout différemment de l’illustration de 1697, de Sève ne montre pas le mari furieux prêt à décapiter son épouse à la mode orientale pas plus qu’il ne garde la seconde moitié de l’image où les frères font irruption par le pont levis de la demeure (Fig. 5-6). La vignette de 1742 enchaîne le récit là où l’image de 1697 s’était arrêtée. Pour autant, bien que fragmentant l’histoire figurée en trois morceaux, aucune des deux éditions n’expose la mise à mort de la Barbe bleue : le personnage est soit encore vivant (1697) soit déjà mort (1742).
Souvent, comme pour bien signifier qu’il ne se contente pas de décalquer les images antérieures, de Sève en redispose les constituants. À la façon d’un décor tournant, sa vignette de « Cendrillon » (Fig. 7-8) fait pivoter l’estrade de l’orchestre et la replace dans l’axe du regard, quoique toujours à gauche. Le prince s’est, quant à lui, rapproché de la jeune femme que les dessinateurs retiennent, dans les deux images, au moment de son départ précipité. C’est avec la même intention de recentrer la scène que de Sève modifie la place des lits de la Belle et du petit Chaperon (Fig. 9-12). Dans les gravures de Clouzier, les meubles tiraient une oblique, symétriquement inverse, de façon à ménager de la profondeur et suggérer, sur le plan symbolique, la curieuse analogie des situations (d’où se déduisait que le prince, sublimant son désir, était le contraire civilisé du loup ou qu’en tout prince, se cache un loup). De Sève aligne les lits au fond ; de la sorte, ils épousent mieux la géométrie de la vignette dans laquelle les meubles se rangent et dont ils accentuent le cadre. Quant à l’ample tissu suspendu au-dessus du lit de la grand-mère, il redessine exactement le lit de la Belle. Grâce à l’espace que le nouvel aménagement des lits a permis de dégager, les deux intérieurs accueillent plus de meubles qu’en 1697 : fauteuil, tabouret, lambris, porte, cheminée… complètent le décor et créent une plus forte illusion référentielle, ou théâtrale.
Entre les deux vignettes, les objets sont distribués en écho : à gauche du lit, le fauteuil rappelle chez la Belle le petit banc (ou la mai ?) de la grand-mère, placé au même endroit ; dans la modeste demeure de village, la silhouette graphique de la cheminée qui, à l’intérieur du château, habille la chambre réapparaît dans l’association de la commode et de la porte derrière elle. Comme en 1697, les vignettes forment un pendant, bien que leur contenu ait été accru. Un phénomène comparable s’observe pour « Riquet à la houppe » (Fig. 13-14) attelé aux « Fées » (Fig. 15-16) : dans les deux cas, les images d’extérieur, superposables à leurs modèles, disposent en leur centre, principalement bordé d’arbres, le couple des personnage (Riquet et la princesse ; la fée et la cadette).
Une des constantes graphiques de de Sève est d’accentuer le compartimentage de ses vignettes. Les bosquets d’arbres dans « Riquet à la houppe », les arbres encore et la fontaine à droite dans « Les Fées » sont les versions naturelles d’un plus vaste système de surcadrage. Il se répercute dans les intérieurs ou dans les cours des demeures : entrées, portes, fenêtres abondent, qu’imitent formellement les caissons des lambris ou les manteaux des cheminées. Les pans d’espace ainsi dessinés redécoupent la vignette, délimitent le territoire de l’image et lui donnent des allures de décors de théâtre. La cour de « La Barbe bleue », les chambres du « Petit Chaperon rouge » ou de « La Belle au bois dormant », la salle de bal de « Cendrillon » offrent des plateaux visuels fermés bien qu’ouverts par les sorties et les entrées.
Grâce à cette organisation qui simultanément dynamise l’espace et le structure, de Sève obtient une gamme suggestive d’actions. Les protagonistes peuvent dès lors se serrer au centre plus ou moins exact de la vignette afin d’y concentrer l’événement de la rencontre, comme dans « Les Fées » ou « Riquet à la houppe ». Les circonstances de leur survenue sont alors minorées au profit de la figuration des échanges qui, dans les deux gravures, amènent de Sève à présenter les personnages de profil. Depuis la première édition, l’intérêt de cette mise en scène est de développer un parallèle entre le don de l’eau dans « Les Fées » et le charme de la conversation agréable dans « ‘Riquet à la Houppe » : le talent galant de Riquet concrétise la métaphore de la belle parole dispensée par la cadette que récompense la fée en remerciement de sa générosité.
Au centre de l’image toujours, convergent régulièrement des vecteurs actantiels. Dans « La Barbe bleue » (Fig. 6), les deux frères (ils n’ont plus rien du Dragon et du Mousquetaire nommés par le récit) viennent de tuer le mari dont le cadavre gît face à notre regard. On supposera qu’ils sont entrés par la porte crénelée de droite qui prolonge celle de Clouzier (Fig. 5), mais côté cour. Les deux hommes sont descendus de leurs chevaux. L’un d’eux a l’épée encore pointée vers le corps de la Barbe bleue tandis qu’une autre arme, aperçue en oblique, semble transpercer l’épaule du mort. Jouissant de la lumière, alors que l’autre frère est maintenu dans l’ombre, le visage du sauveur se tourne vers sa sœur qui, dans un geste d’amour, accomplit ce qu’épuisée, elle ne parvient pas à faire dans le texte : se précipiter pour embrasser son frère. Le corps de ce dernier est emporté dans la tension du coup violent qu’il vient de porter mais il accueille l’effusion de tendresse de sa sœur. Sa jambe et son bras droits traduisent par leurs mouvements opposées ces deux élans contradictoirement simultanés.
Agenouillé avec courtoisie, le prince de « La Belle au bois dormant » paraît encore dans le mouvement de son arrivée auprès de l’endormie (Fig. 10) ; ses paumes ouvertes, prêtes à embrasser l’inconnue, montrent sa surprise et son émerveillement. Quant au loup du « Petit Chaperon rouge » (Fig. 12), installé depuis quelque temps déjà dans la scène miniature qu’enchâsse le lit, il bondit comme un diable pour tirer à lui la tête de l’enfant ; il la ramène dans cette zone opaque où fusionnent son corps et le drap et qui, gonflée à la manière d’un ventre, occupe le milieu de la gravure. Cendrillon, elle, sort de scène en courant, pressée par le temps trop vite écoulé (Fig. 8) ; elle se jette vers la droite mais, d’une brusque torsion de la tête, elle se retourne vers le prince et voit qu’il ramasse sa pantoufle. Dans la vignette du « Petit Poucet » (Fig. 4), incliné en raison de sa posture d’endormi, moulé dans les anfractuosités de la pierre, le corps de l’ogre pèse de toute son inertie sur l’image ; le petit Poucet tire les bottes de la créature imposante, minéralisées par le rocher. Il est repoussé dans le coin droit mais, malgré sa petitesse et sa force relative, il parvient à décentrer l’image. Bientôt chaussé de sa rapine, il prépare sa sortie de scène.
S’agissant du « Maître chat » (Fig. 17), le moment diffère totalement de celui choisi par Clouzier (Fig. 18). L’édition de 1697 mettait en relief l’épisode où le chat s’adresse aux moissonneurs pour les menacer : son corps redressé, chaussé de bottes, toutes griffes sorties, fait du chat une figure hybride, combinant le don humain de la parole, libérée par la position verticale, et la sauvagerie bestiale. De Sève ôte sa férocité à l’animal, non sa ruse ; il préfère lui accorder un air de politesse conforme à cette atmosphère de mœurs civilisées qui caractérise plusieurs de ses illustrations et que diffusent effectivement les contes, promoteurs plus ou moins explicites des nouvelles règles de comportement dictées par la morale mondaine.
La vignette situe la scène dans l’espace seuil d’une cour : le chat désigne la demeure censée appartenir au faux Marquis et volée à l’ogre ; son Maître vient à sa suite, en costume d’aristocrate, devançant la princesse qu’il espère séduire. Imitant le chat et sous sa conduite, le fils du meunier convie sa future épouse à pénétrer dans sa toute récente propriété. Les gestes des complices orientent le regard vers la droite, là où paraît, grisée, la façade de la maison ; préparant le passage à l’intérieur, ils engagent la conclusion du récit qui se déroulera lors de la collation. L’image prend place juste avant que, dans le texte, le Marquis « donnant la main à la jeune princesse », comme on le voit déjà ici, la guide pour rejoindre la grande Salle. Cette entrée dans le château qui débute par la présentation de la cour et des « Bâtiments qui l’environnent » correspond également à la sortie de la scène visuelle. Semblables à celui de l’un des frères de la « La Barbe bleue », les deux visages, du chat et du Marquis, se retournent parallèlement en direction de la jeune femme qui est, pour sa part, légèrement penchée vers son galant, dans une attitude d’attention amoureuse. Cette reprise du mouvement de torsion dynamise latéralement la vignette ; l’image glisse de sa gauche d’où arrive la troupe des personnages vers sa droite où les attend la fête. La position commune des corps du chat et du meunier fait d’eux des doubles ; elle assimile la bête et l’homme d’une façon différente du diptyque constitué par « La Belle au bois dormant » et le « Petit Chaperon rouge » mais elle conduit pareillement à une lecture soupçonneuse qui, dans un monde abandonné à la séduction, au trafic des signes et à l’économie des désirs, superpose constamment humanité et animalité.
L’émotion des drapés
De Sève traite la scène visuelle de manière cinétique là où la série de Clouzier privilégiait plutôt l’instant suspendu. Non que les gravures de 1697 soient dépourvues d’animation narrative mais les gestes qui résultent de l’action sont presque toujours arrêtés. Certes, le loup se jette bien sur sa victime, son élan est néanmoins stoppé au moment où la gueule s’ouvre et où la main de la victime tente de freiner l’attaque. De même, la Barbe bleue lève son cimeterre pour frapper son épouse trop curieuse cependant que les deux frères à droite franchissent le pont levis ; le chat menace le laboureur et la fée s’apprête à boire à la cruche mais, en 1742, elle porte les lèvres au récipient et se désaltère effectivement. Tout en faisant réapparaître dans ses images celles de Clouzier, de Sève y intègre des modulations du mouvement qui ont pour premier effet de les revivifier. Cette animation, constamment à l’œuvre dans les illustrations de 1742, redonne vie aux gravures premières ; elle est d’abord ce par quoi de Sève se ressaisit des images antérieures et les réactive comme images, le mouvement devenant alors l’un des motifs essentiels de son interprétation des contes, et sa signature esthétique.
La comparaison entre les deux vignettes prévues pour « Cendrillon » accuse nettement le changement de rythme introduit dans l’édition Coustelier (Fig. 7-8). Le contenu des scènes est, on l’a constaté, presque identique. Pourtant, la lecture de de Sève insiste bien plus sur l’espèce de fièvre collective qui emporte les personnages du bal. Le prince n’a pas encore récupéré la chaussure (mais ne veut-il pas plutôt toucher le pied dénudé ?) alors que, chez Clouzier, il s’en saisit, un genou au sol comme s’il faisait une révérence. La version de de Sève ne traite pas le prince différemment des danseurs : son corps se projette, pousse sur ses pieds au risque de tomber ; on dirait qu’il contre l’air ou s’appuie sur lui. Son vêtement colle à son corps ou se gonfle, se soulève par pans et se plisse ; ses cheveux sont décoiffés sous l’effet de cette vivacité qui déforme la silhouette et complique le dessin. Il est tout près de Cendrillon, si près qu’il la touche presque : la main la plus en recul effleure la pointe du tissu qui flotte. La gravure de Clouzier esquisse la séparation qui va succéder à la scène en répartissant les deux personnages à chaque bord de l’image. Comme l’habit du prince, la robe de Cendrillon concentre la vitesse et la restitue dans les tourbillons de ses drapés ; la jeune femme danse elle aussi tout en quittant le bal. Au son de la musique, le mouvement gagne intégralement l’image ; partout autour du couple, des figures aériennes peuplent la représentation, tel ce danseur qui, au second plan à gauche, dans un équilibre impossible, lance sur un unique pied son corps de flamme.
Même lorsqu’il peint le sommeil, de Sève continue d’insuffler du mouvement : l’ogre assoupi (ill. 4) se coule dans la roche qui, à son contact, s’est pour ainsi dire amollie ; le paysage environnant est caractérisé par cette fluence qui liquéfie la pierre et la change en cascade. Opère l’action conjuguée du sommeil, qui assouplit le corps, et du petit Poucet ; ce dernier, tirant la botte du géant, étire plastiquement l’image, exerce sur elle une force qui estompe les contours, creuse les formes. L’arbre penche comme la tête de l’ogre pour accompagner la bascule de l’image vers l’enfant arcbouté.
On observera un phénomène similaire dans la vignette des « Fées » dont le décor est strié d’obliques, à l’instar de la cruche inclinée d’où va bientôt jaillir la bonne eau (Fig. 16). Mais, déjà, les plis du vêtement de la cadette comme ceux de la fée métaphorisent la coulée. De même, le couple de « Riquet à la houppe » s’entretient dans une forêt dont les arbres se sont écartés et s’inclinent (Fig. 14). Leur forme a été décidée par une nature qui refuse la rectitude et le figement ; elle rend hommage à la parole aimable que s’échangent les personnages et qui va transformer leur vie en la délivrant de tout déterminisme afin de lui redonner sa mobilité salvatrice.
Avant ces diverses images, il suffit de mettre en regard les gestes de la nourrice dans les deux frontispices (ill. 1-2) : apparemment identiques, ils dessinent pourtant deux axes opposés. Chez Clouzier, le fil de la quenouille tombe droit, comme un fil à plomb : la porte, la cheminée, la chandelle épousent la même verticale. Tout reprend vie chez de Sève : le fil plus lâche, que la vieille femme pince entre ses doigts, trace une diagonale qui fait bouger les lignes. C’est à partir de ce trait matriciel, détendu, que de Sève imagine ensuite ses compositions et les anime. Partout dans le frontispice, la ligne est déliée : la fumée de la cheminée monte par petits traits en demi-cercles ; les jambages de la cheminée se sont arrondis ; la lampe biscornue, empruntée à l’univers de la féerie orientale, a remplacé la flamme droite de la bougie ; moins bien attachés que ceux gravés par Clouzier, les fibres de la quenouille agencent une torche relayée par les flammes du feu mobile. Enfin, le panneau sur la porte a retrouvé une calligraphie plus souple, en abandonnant les majuscules droites du frontispice Barbin.
De Sève confie aux drapés le soin de compliquer les figures, de faire circuler l’expressivité et d’entretenir le mouvement, y compris dans une apparente immobilité. Corps renversés, chancelants, fléchis témoignent du passage de ce mouvement ; ils le rechargent à la façon d’une énergie que le dessinateur met au service de l’émotion plus que de la narration. Les gestes complémentaires du prince et de Cendrillon communiquent d’abord les sentiments qui les submergent en la circonstance merveilleuse : chez l’homme, l’ardeur d’aimer la jeune femme ; chez la jeune femme, la surprise de l’audace de l’homme. L’intention narrative s’éclipse au profit des formules passionnelles.
On pourrait croire que le trait de de Sève, vif, acéré, sert davantage l’expressivité des visages. On sait le défi que représente la petite taille des vignettes pour l’exactitude des émotions. De Sève prouve que son dessin se fait suffisamment précis pour restituer les déformations imprimées par les émotions sur les visages : l’effroi du petit chaperon et la hargne du loup qui ferme son regard, l’assurance enjouée du Marquis de Carabas, les difformités apparentes du profil de Riquet et même l’extrême concentration du petit Poucet marquant son visage sont rendus pleinement lisibles grâce au pouvoir du trait. Le visage de la nourrice comme ses mains, dont les rides sont beaucoup plus creusées dans le frontispice de 1742 (Fig. 2), mettent l’accent sur la netteté du dessin ; ils concrétisent et annoncent le changement stylistique par lequel de Sève entend singulariser ses figures.
Ces traits affermis, l’artiste les relaie par un minutieux travail sur les vêtements ; ceux, pour commencer, de la nourrice et des enfants fascinés. Les plis abondants que favorisent les couches de tissus ajoutées les unes aux autres sont épais, méandreux, fluides ; ils contrastent avec l’habit très « repassé », strict, de la conteuse de Clouzier, figée dans sa raideur (Fig. 1). Le modelage des drapés est une des constantes des illustrations de l’édition de 1742. Clouzier n’ignorait pas l’intérêt graphique des plis, pour représenter par exemple les grandes tentures ornant les lits de la Belle et du petit Chaperon rouge. Mais, chez lui, le drapé ne s’affirme pas comme un véritable motif, une matière assouplie, pathique et cinétique ; il aide à amplifier les ombres alors que, pour de Sève, il dynamise le processus imageant.
Clouzier rattache le pli à l’exercice de la gravure dont la hachure, employée dans toutes ses potentialités, est l’unité principale. Il confère du volume à des formes relativement sculptées ; de son côté, de Sève tire des lignes expressives. Dans « Les Fées » (Fig. 16), la silhouette de la cadette se découpe pourtant à la façon d’une belle statue installée dans un décor de nature : son pied droit repose sur une pierre comme sur un piédestal ; la courbe de son corps l’assimile à une cariatide. Mais la position des pieds traduit en réalité l’effort pour soulever la cruche et l’offrir à la fée. C’est donc l’expression d’une tension que restitue de Sève. Elle porte les valeurs cardinales du récit : la générosité, la grâce du partage, le don désintéressé à l’autre.
Plusieurs vêtements, historicisant le conte, teintent les images d’une couleur d’époque. Ceux du marquis de Carabas ou des frères de l’épouse de la Barbe bleue appartiennent à peu près au temps de l’édition. Pour autant, les personnages de de Sève ne portent essentiellement que des tuniques antiques, vraisemblablement en raison de la vertu vibratoire de leur drapé. Le prince de « La Belle au bois dormant » appartient au monde antérieur des épopées ou des tragédies (Fig. 10) : ses sandales, le bandeau noué qui ceint son front, sa tunique enfin l’habillent en héros grec. Les figures féminines sont, elles, directement empruntées à l’iconographie des nymphes et des déesses ; la cadette des « Fées » est une dryade ou une naïade (Fig. 16). Aussi le conte se nourrit-t-il de l’imaginaire des mythologies anciennes pour livrer, par une formule syncrétique, des mondes fictionnels qui, dépourvus de la vraisemblance historique, permettent de visualiser l’éternité des histoires. Autant d’occasions d’introduire le drapé et d’en sonder les ressources.
Dans « Les Fées », la vrille de plis qui engaine le corps de la fée évoque le filet d’eau qu’elle va bientôt boire et que préfigure la cascade de la fontaine aménagée à droite, dans un décor d’anfractuosités rocheuses. L’image du chaperon est saturée de lignes anguleuses (Fig. 12) : à l’intérieur du cadre du lit éventré, elles fractionnent et pour ainsi dire mettent en pièces les formes. L’étrange position du corps de la fillette, disloqué sous l’effet de la violence et presque par avance mutilé, se répercute autour d’elle. Le lit s’est transformé en antre où elle est piégée et défigurée ; il est une énorme gueule hérissée de dents. C’est ce que fait apparaître, dans un grand désordre, le dessin des tissus (draps, vêtements…) découpés en pans, lambeaux, plis de toutes sortes. Par son pouvoir maléfique de transformation organique du monde, le loup les a taillés. Lui-même est couvert à mi-corps du drap qui le masquait sans doute avant qu’il ne révèle et ne libère sa bestialité. Il est le maître des plis, dans le prolongement de sa gueule et, en définitive, de tout son corps ; il leur impose la violence que subit l’enfant et qui la déchire.
L’illustration de « Cendrillon » (Fig. 8), où les plis dansants dissolvent la ressemblance mimétique et emplissent l’image, celle de « La Belle au bois dormant » (Fig. 10), où les plis, plus alanguis, concentrent la volupté de la rencontre, fournissent d’autres variations scénographiques du drapé que de Sève charge de la puissance féerique et à partir duquel il file ses rêveries. L’image de « La Belle au bois dormant » radicalise cette emprise du tissu animé. Aucun visage n’y est parfaitement visible : le prince se tourne de biais vers la princesse ; la tête de la jeune femme est rejetée en arrière. Les plis prennent les deux personnages dans une unique trame visuelle qui les unit ; ils élongent le corps de la Belle afin qu’elle adopte la langoureuse attitude des endormies. Le moment est une rencontre « véritable » qui cependant, d’essence pleinement littéraire, imite celles des romans et s’apparente à une fiction mentale, à un fantasme dont la princesse ensommeillée serait la source. Songe-t-elle à un prince, venu d’un autre temps la visiter, en le faisait apparaître comme par magie ; est-elle sur le point de s’éveiller en connaissant déjà l’extase au contact d’un homme qui, par sa seule présence, la ravit ?
De Sève hésite entre deux options graphiques : souligner les traits du visage, les inclure dans le registre des plis et des drapés, ou bien au contraire les gommer et laisser le visage presque vide comme une excroissance du corps tout entier, une goutte déposée. Le frontispice essaie les deux formes, réparties entre la vieille nourrice aux traits marqués et les jeunes enfants qui l’écoutent avec leurs visages adoucis. Ce style figuratif qu’introduisent les trois enfants, imité peut-être des expressions attendries du Corrège, est le plus caractéristique de l’artiste. Suaves, légèrement tournés pour amorcer l’expression d’un emportement, ce sont presque toujours des visages de femmes que représente ainsi de Sève. Leur justification graphique est, dès le frontispice, liée à l’écoute curieuse et passionnée des récits. Cette extase se reproduit ensuite, mais cette fois sur le plan de l’émotion narrative tout en conservant probablement sa dimension onirique, comme si toutes ces jeunes femmes étaient les auditrices de l’histoire qu’elles vivent dans le même temps.
Leur émotion prend son origine dans le contexte de l’histoire mais son symptôme est aussi l’effet du conte. La cadette des « Fées » (Fig. 16) semble éprouver sous sa forme aiguë le plaisir que ressent la fée à boire ; la princesse écoute Riquet qui, malgré sa laideur restituée par le dessin, la transporte d’aise (Fig. 14) ; son corps, dont le visage incliné paraît sans bouche, est simplement attendri par les mots galants qu’elle entend et dont le repas partagé en arrière-plan est l’écho sensoriel. La princesse du « Maître chat » témoigne de la même émotion vive ressentie à l’écoute des paroles d’amour (Fig. 17). Quant à l’épouse effrayée de « La Barbe bleue » (Fig. 6), elle se précipite vers son frère comme s’il était son amant et qu’elle voulait l’embrasser. Son soulagement ne suffit pas pour expliquer une telle exaltation ; la vigueur du geste rappelle l’irrésistible attraction de la jeune femme pour la violence qu’elle pressentait chez son mari et qu’elle retrouve chez son sauveur.
Cette image décompose en trois figures la masculinité sans les dissocier, en les proposant même comme trois avatars dans un continuum d’identité. Étendue perpendiculairement à terre tout en ayant les jambes orientées vers le groupe des autres personnages, la Barbe bleue ressuscite visuellement à travers le premier frère frappé d’ombre ; ce dernier assure la transition, entre mort et vie, avec le second frère, puissamment éclairé et à qui sont destinées les démonstrations d’affection de celle qui est désormais veuve. Le dessin accole les corps des trois hommes en modulant leurs similitudes, les lames des différentes épées venant effleurer chacun de leurs pointes. Les personnages dépendent les uns des autres, les armes assurent leur contact et leur unité thématique sous l’aspect de la virilité offensive.
La forme la plus soutenue de ces gammes d’émotion sur un visage pourtant sans traits expressifs se trouve bien dans la « Belle au bois dormant » (Fig. 10). De Sève montre chez l’héroïne l’effet de la petite mort plus que la soumission au sommeil maléfique. Chargée de faire ressentir les émotions par le seul mouvement de la tête et de parcourir ainsi, avec une grande économie de moyens, l’échelle des emportements, cette constante plastique rapproche la plupart des femmes représentées . Elle les donnerait presque pour les figurations d’une seule existence débutée dans le frontispice par la très jeune auditrice et achevée, au sein de la même image, par la nourrice âgée. De l’une à l’autre, d’un âge à l’autre, dans l’intervalle, les contes auront varier la féminité à travers une série d’expériences, de celles qui tissent une vie, mêlée de drames et de bonheurs. L’illustration les aura rassemblées dans l’éprouver. C’est, en effet, grâce à l’émotion véhiculée par le mouvement, imprimée dans les lignes et les tensions bouleversant les corps que se transcrit pour de Sève le sentiment du conte. Ce que vivent les figures est encore ce que pourront ressentir des lecteurs au contact d’histoires dévolues, aux yeux de l’illustrateur, au pouvoir de sentir.
La dernière vignette, pour « L’adroite Princesse » (Fig. 18), synthétise les expériences figuratives. Son thème, éminemment dramatique, correspond au moment où le prince Riche-Cautèle, introduit dans la tour des princesses, se dépouille des oripeaux de la pauvresse en laquelle il s’était déguisé. Animé des plus mauvaises intentions, il prend à la gorge Nonchalante tandis que Finette et Babillarde fuient dans leur chambre. La scène est tumultueuse : les chaises sont renversées, les corps se heurtent brutalement. On croirait une danse ; elle ressemble au bal de « Cendrillon » mais l’émotion du désir se dégrade en violence sexuelle : on revoit le couple du prince et de Cendrillon comme celui de la sœur et du frère à la fin de « La Barbe bleue » dans une version agressive de leur rencontre ou de leurs retrouvailles. Éclairé par la grande chandelle qui mêle au symbolisme de la vérité (le prince se dévoile) celui d’une virilité ardente, le moment fait davantage penser à l’assaut du loup contre le petit Chaperon. L’expression éperdue du visage de Nonchalante est également une variation de celle de la Belle vers laquelle avance aussi, quoiqu’avec un respect timide, la main d’un homme. Abandonné en tas, le déguisement du prince cauteleux occupe le coin droit de l’espace. Les jeux de drapé esquissent alors la forme d’un corps nu disloqué ou la silhouette indéterminée d’un fantôme ; ils imposent une zone d’inquiétude dans une image où la violence est entièrement chorégraphiée au service du pathos.
La vision augmentée
Pour le lecteur qui a la chance d’avoir entre les mains l’exemplaire de 1742 pourvue de sa double trame d’illustrations, l’impression est de nature particulière. Enluminés par les vignettes de Jacques de Sève, avant le début de leur lecture, les contes de Perrault s’éclairent d’images supplémentaires essaimées au fur et à mesure des récits, sous la forme des planches de Simon Fokke. Aussi le lecteur peut-il lire environné d’images, et sentir confirmée en lui la certitude que le conte se prête à l’expression visuelle. Chaque illustration complète les représentations qui se forment dans son esprit sous l’impulsion imageante des textes et – c’est la force d’imprégnation de la gravure –, elle agit en retour sur ces mêmes images pour emplir notre mémoire. Par leur position et en raison de ce que l’on attend d’une illustration narrative, prévue pour résumer le récit, les planches hésitent entre une fonction de redoublement de la valeur sommative des vignettes et d’instance sur une scène. Cette scène, sans doute, aura été retenue en raison de sa suggestivité et sa capacité à retranscrire au mieux l’âme du conte, en lui servant de délégué de présence et de signification. Mais on voit aussi la volonté qu’a eue Fokke de faire scène et donc de préserver en telle ou telle de ses images l’autonomie interne du sens.
Concernant « Les Fées » par exemple (Fig. 19), Fokke opte pour une image en deux parties, avec un semblant de profondeur de champ qui lui permet de contenir deux scènes du conte en une troisième. Dans un espace de figuration unifié, possible topographiquement mais invraisemblable du point de vue diégétique, Fokke montre la fontaine et la maison de la mère. Il combine deux épisodes du récit : la rencontre avec la fée et la séquence au cours de laquelle la cadette, se mettant à parler, laisse magiquement échapper de sa bouche roses et perles, à la grande surprise de la marâtre contrariée. L’illustrateur confirme le parallélisme de construction sur lequel repose le conte, structuré par les deux lieux et les duos qui y évoluent. La scène à la fontaine peut, en conséquence, se lire doublement, soit qu’elle réunisse la cadette et la fée soit qu’elle confronte l’aînée et la même fée sous une autre apparence. Au vu du geste d’incompréhension de l’une des protagonistes, on aurait tendance à penser qu’il s’agit du dialogue avec l’aînée. La scène du fond aurait donc lieu après celle du premier plan, dans l’ordre du récit.
Fokke emploie dans « Le Maître chat » le même système de condensation spatiale pour reproduire le temps écoulé, mais de manière plus complexe encore (Fig. 20). Au loin, le moulin correspond à l’origine du meunier (et donc à l’entame du conte) tandis que le perron, au premier plan à droite, introduit le même personnage dans son nouvel environnement aristocratique. Pourtant, le meunier n’étant apparemment pas vêtu en marquis, nous pouvons aussi penser que nous nous situons au début de la métamorphose que le chat arrache au déterminisme social. Son apparence encore incomplète, le meunier est en cours de transformation.
Comme chez Clouzier, Fokke fait courir un chemin ; il relie les niveaux de l’image et définit le parcours de l’aventure : le carrosse royal y est engagé pendant que le chat s’affaire en expliquant à son maître, placé dans la coulisse de l’image, le rôle qu’il a à jouer. Un moissonneur, aperçu sous la patte dressée du chat, fait allusion à l’épisode à venir qui consistera à s’accaparer le domaine de l’ogre. La gravure de Clouzier fait de cette péripétie le centre de sa vignette (Fig. 21). Elle a, en quelque sorte, été incorporée dans la planche de Fokke, à la manière d’une citation, reconfigurée au service d’une refonte élaborée des temporalités. Car il serait également possible d’envisager, s’il n’y avait le doute sur l’habit du meunier, que le roi va découvrir à qui appartiennent les terres (il serait alors renseigné par le laboureur) avant que le prétendu marquis ne l’accueille dans sa nouvelle demeure, c’est-à-dire juste avant la vignette de de Sève qui précède cette illustration, dans l’exemplaire de l’Arsenal tout au moins. L’ordre du récit proposé par l’image est relativement incertain, mais en réalité suffisamment modulable pour embrasser plusieurs épisodes et les lier dans une image cohérente multiréférentielle.
Fokke aime déposer dans le fond de ses images quelques figures en ombres chinoises (les bûcherons croisés en chemin par le Chaperon par exemple). Dans « Le petit Poucet » (Fig. 22), il dispose un couple dans le lointain de l’illustration. Difficile de dire si ce sont le bûcheron et la bûcheronne ou bien quelques galants, du genre de ceux dont Poucet sera bientôt l’entremetteur. Cette vignette dans l’image, rendue d’autant plus minuscule que l’ogre occupe, par force, tout l’espace, est donc un rappel du passé et une prolepse visuelle ; quelle que soit son interprétation, elle contribue à la stratification ou à la mise en perspective du temps par l’espace.
Pour « La Barbe bleue » (Fig. 23), citant de nouveau l’édition de 1697 (Fig. 5), Fokke revient au schéma spatial de la vignette originelle. De Sève s’en était détaché pour inventer une scène illustrée inédite (Fig. 6) mais, à la façon de Clouzier, Fokke scinde son illustration en deux lieux qui permettent la simultanéité des actions et rappellent le champ-contre champ auquel Perrault lui-même recourt dans son texte, quand il alterne la venue des frères guettée par la sœur (Fokke l’ajoute) avec les délais que tente d’obtenir de son côté l’épouse promise à la mort. Fokke situe à gauche le dialogue cruel du mari avec sa femme et à droite, en retrait, l’arrivée des frères. Les autres illustrations s’émancipent davantage des images antérieures. Le petit Chaperon rouge n’est, par exemple, plus directement attaqué par le loup (Fig. 24). Fokke préfère dessiner l’enfant aimant, les mains chargées de galettes, en train de se diriger, après avoir pénétré dans la maison, vers sa grand-mère qui laisse, malgré l’ombre, deviner son nouveau visage de bête.
À plusieurs reprises, Fokke se fonde sur le schéma scénique d’un personnage entrant ou entré dans un lieu. Le prince de « La Belle au bois dormant » découvre, le pied sur le seuil, la chambre de la Belle où dorment l’héroïne et ses dames de compagnie (Fig. 25). Il aura été nécessaire de déplacer une nouvelle fois le lit de la Belle : le prince entre côté jardin, surprend les femmes qui se trouvent à l’intérieur, à droite, mais que le lecteur a déjà sous les yeux puisqu’il se situe supposément à l’intérieur du palais, au vu de l’orientation du lit placé face à lui. Le spectacle qui assurément enchante le visiteur est fortement éclairé alors qu’il reste lui-même dans l’ombre.
Comparée aux premières illustrations, la facture des scènes de ces deux contes est tout à fait originale. En première analyse cependant, elles dépendent d’une symétrie qui caractérisait les images dès le manuscrit orné. Mais, au lieu que les personnages soient distribués près du lit (de la grand-mère ou de la Belle), le Chaperon et le prince se meuvent dans l’espace et engagent la péripétie décisive : la dévoration de l’enfant, le réveil de la Belle. La petite fille connaît bien la maison où elle est comme chez elle (cette familiarité lui ôte justement sa prudence) ; la chambre est, elle, inconnue au prince et ce qu’il y voit l’étonne. La superposition des deux vignettes illustre un discours sur la sexualité pour lequel homme et bête se confondent. Elle se rejoue autrement dans la planche de Fokke, qui rapproche l’offrande gourmande de la fillette anticipant sa dévoration et l’atmosphère franchement érotique du palais de la Belle. Parodiant les scènes lestes de la littérature libertine, la gravure de « La Belle au bois dormant » décore le lit d’une guirlande de corps féminins à demi dénudés sous le regard d’une étrange créature assimilable à un génie des songes ; son corps spiralé flotte dans l’air au-dessus du lit dont il paraît, on ne sait trop comment, retenir les tentures bouffantes. Fokke n’oublie pas que, comme le note Perrault avec impertinence, la Belle a largement eu le temps de s’adonner aux rêves érotiques. L’orbe que composent les corps alanguis auprès de la princesse relaie le nuage cotonneux de l’oreiller, tel un nimbe de rêves, qui entoure de sa forme généreuse le visage de la Belle ; ensemble, ils matérialisent la projection de l’agréable activité mentale.
Le charme singulier de l’exemplaire composite de l’Arsenal est qu’il noue entre les vignettes et les planches un dialogue constant, en élaborant d’authentiques opérations de création non décidées par les artistes eux-mêmes. On supposera toutefois que Fokke connaît parfaitement les illustrations de de Sève – preuve en est le frontispice qu’il pastiche – et qu’il conçoit son propre programme par rapport à elles. En somme, l’ouvrage de l’Arsenal matérialise le travail effectué par Fokke à partir des images de Sève pour son édition de 1745 ou il donne forme aux rapprochements imaginaires que pourrait tenter un lecteur qui possèderait, dans sa bibliothèque, les deux éditions.
Régulièrement, Fokke décale le temps de l’image ; sa planche et la vignette réagencent alors une chronologie cohérente. Le petit Chaperon franchit la porte, s’approche du lit puis le loup se jette sur lui (Fig. 24) ; la fillette entre à gauche, contourne le battant inférieur de la porte, revient vers le lit installé au fond à droite. Elle avance de trois quart. Le point de vue glisse latéralement ensuite (chez de Sève, Fig. 12), recadre le lit où la fillette est couchée et le loup, débarrassé du bonnet de la grand-mère, assaille l’enfant en bête réensauvagée.
Dans « Les Fées » (Fig. 19), Fokke relègue au second plan la vignette de de Sève et il donne le privilège à la discussion de la cadette avec sa mère. Le raccord avec la vignette s’effectue sur le plan visuel par l’anaphore de la scène à la fontaine au sein de la planche (l’espace lointain accueille la mention) et sous l’angle d’une extension du récit : la vignette sera alors antérieure ou postérieure au premier plan de la planche selon la lecture que l’on en fait.
Incontestablement, Fokke fournit au lecteur bien plus de détails que ses prédécesseurs, à commencer par un enrichissement systématique du décor. Pour le plaisir de la vue de près, il dessine les hachures des galettes du chaperon, chantourne les motifs végétaux de la robe de Cendrillon ou ajuste le plumet du prince qui ramasse le joli soulier (ce plumet circule jusqu’à l’ogre comme le turban oriental coiffe également la Barbe bleue) ; il orfèvre le manche du poignard de l’ogre en le décorant d’une étrange et inquiétante tête miniature… Ce souci du détail participe du double régime d’attention du lecteur de conte à qui les textes proposent nombre de signes sursignifiants mais dont la valence est d’autant plus expressive qu’elle se détache d’une réalité dissoute ou indéterminée. Avec « Les Fées », Fokke tient un ensemble de petits motifs (roses, perles…) propres à valoriser la virtuosité du dessin, minutie dont on croirait l’illustration incapable et à laquelle de Sève dans ses vignettes n’avaient guère eu recours, sauf dans la mise en scène des drapés. Mais le drapé sert le mouvement. Fokke veut que ces images agrandies comblent l’œil de mille choses à voir.
En outre, de Sève a plutôt tendance à cadrer ses scènes, qu’elles soient intérieures ou extérieures, sans chercher de véritable perspective ; l’image s’ajuste au rectangle graphique et l’occupe pleinement. Fokke bénéficie de plus de champ grâce à la pleine page et peut amorcer des effets de profondeur. Mis en facteur commun des deux séries, et du reste présent en 1742 et en 1745, le frontispice présente leurs manières différentes de gérer l’espace réservé à l’illustration. Le geste de la nourrice, tendant entre ses mains le fil de laine, évoque métaphoriquement son activité de conteuse (Fig. 2). Comme elle file, elle dévide le texte des récits ou étire le filet de sa parole ; elle prend aussi des mesures, s’appliquant peut-être à indiquer la dimension des images. Assigne-t-elle des limites aux traits ou bien agrandit-t-elle autant qu’elle le peut leur intervalle ? Entre vignette et planche, le fil bornera le visible ou définira l’ampleur de l’espacement. De même, les deux options graphiques trouvent dans ce frontispice les ressources plastiques à exploiter. On peut y percevoir le travail que de Sève va mener sur les traits, le drapé, les visages, les mouvements. Mais la même image laisse aussi place à l’interprétation de Fokke et anticipe ses orientations esthétiques.
En particulier, la partition de l’image en deux pans d’inégale proportion. À droite de ses vignettes, Fokke s’attache à un élément qui ferme l’espace, double le cadre sans être lui-même intégralement représenté. Cet élément se substitue à la cheminée sur laquelle vient s’adosser la scène du frontispice et qui permet de surligner le point de fuite ; le foyer est, avec la lampe posée sur la tablette, la source vive de la lumière. Fokke remplace la cheminée soit par le morceau d’une façade de maison devant laquelle échangent la mère et la cadette (« Les Fées »), soit par le bout d’un toit et d’un mur (« Le petit Poucet »), une colonne derrière laquelle se tient le meunier en discussion avec le chat (« Le Maître chat »), le lit de « La Belle », l’arbre imposant mais tronqué à côté duquel conversent Riquet et la princesse (Fig. 26), le lit où se tient tapi le loup (« Le petit Chaperon rouge »), l’estrade sur laquelle sont réunis le roi et la reine (« Cendrillon »). Les métamorphoses plastiques apparaissent alors nettement si l’on met en comparaison les images : le linteau de la cheminée contient la possibilité graphique d’un toit ou d’un baldaquin, les volutes du feu sont déjà un tronc ou des branches, le foyer une porte ou un lit. Parmi ces illustrations, une majorité retient la scène de parole qu’emblématise le frontispice.
Cette première image est, plus généralement, le patron à partir duquel sont confectionnées les autres illustrations comme si elle se démultipliait en diverses situations figurées. Le petit public de la conteuse, et la conteuse elle-même, se retrouvent en partie représentés dans les scènes contées et, en même temps, fictivement vécues. L’image illustre des moments de récit tout comme l’activité imageante qu’ils engendrent dans l’espace mental. Elle est faite de la matière des contes et de leur énergie psychique, projective. Les personnages des images ne seraient donc jamais que les personnages du frontispice, et eux-mêmes des substituts du lecteur, sortes de comédiens endossant tour à tour les habits des fictions, selon les conditions d’une écoute des contes par identification. Il suffit que la nourrice joue la cadette ou l’ogre, que l’un des enfants mette le costume du prince ou se rapetisse à la taille de Poucet. Les images sont un plateau à décor compartimenté qui, de toiles peintes en toiles peintes, permet aux enfants et aux adultes de s’adonner aux tableaux vivants de leur lecture ; ils jouent des rôles qui ne sont pas ou plus de leur âge et que pourtant ils éprouvent sensiblement, c’est-à-dire figurément. Chaque illustration devient un miroir psychique, la simulation de l’effet du conte en images. Les enfants du frontispice sont si près de la conteuse qu’ils semblent être alors au plus près mentalement des scènes qui naissent en eux : ils sont entrés dans les images ou les images sont entrées en eux, en leur faisant la plus forte des impressions. La série des illustrations enregistrerait alors ou modéliserait la chaîne syncopée des altérations vécues par les lecteurs absorbés et changés en identités virtuelles, au moyen de la lanterne magique des contes (comme celle posée sur la cheminée du frontispice en forme de lampe d’Aladin).
Quant à la seconde partie de la structure qui, dans le frontispice de 1742, complète le mode de spatialisation élu par Fokke, elle correspond au plan derrière la conteuse. Pour sa conception, de Sève a abandonné la porte qui donnait pourtant au frontispice de Clouzier son aura de mystère Unheimliche : le titre initial du recueil directement cloué comme un écriteau ne manquait pas de susciter la curiosité, invitant à forcer la porte, avec d’autant plus d’envie qu’elle était fermée ; l’ouvrir pour les personnages et, pour le lecteur, entrer dans sa lecture paraissaient immanquablement comme des transgressions.
Or, aucune porte ici : un simple mur sur lequel cependant a été maintenue, hors de toute vraisemblance réaliste, l’appellation « contes de ma mere l’Oye ». Cependant, les illustrations contribuent à abattent cette cloison. Chez Fokke, elle se transforme en une vaste ouverture donnant sur l’extérieur ou en une porte, justement, pour permettre par exemple au prince d’entrer dans la chambre de la Belle ou au Chaperon de passer le seuil de la maison de sa grand-mère. Au loin, dans cette dernière image (Fig. 24), des bûcherons débitent du bois. C’est, on le dirait, le pan de mur qu’ils ont abattu ; de la porte de la maison n’apparaît que son battant inférieur, laissant le regard se porter vers la scène de ces hommes au travail. Leur action laborieuse n’a plus rien de rassurant. Si, dans le conte, la présence des bûcherons gêne le loup et empêche l’enfant d’être dévorée dans la forêt, ici, ils taillent l’image, concentrent l’ombre, préparent à la violence, à la déchirure des dents que tout dans cette illustration évoque : les lattes déchiquetées du plancher, les tissus anguleux, les ombres qui font frissonner.
À la place des ouvertures, comme l’indique la percée de la perspective vers les bûcherons, ce sont des morceaux de décor que Fokke greffe sur la scène selon un agencement des plans, tantôt rapprochés, tantôt éloignés : un moulin au bout d’un chemin avec un carrosse et un arbre (« Le Maître chat »), des danseurs sous la loge des musiciens et l’éclairage des lustres (« Cendrillon », Fig. 27), l’ogre faisant basculer l’image de tout le poids de son corps endormi (« Le petit Poucet »), la fontaine où se déroule la rencontre magique (« Les Fées »), la table du banquet arrondi comme une assiette autour de laquelle s’activent nombre de personnages (« Riquet à la houppe ») ; cette animation rappelle la grappe des têtes d’enfants entassés dans le creux du rocher du « petit Poucet ». Le pan du décor, en arrière-plan, est le plus inventif ; il dialogue avec la scène de premier plan pour ménager une échappée qui enrichit l’image, parfois la complète d’une véritable scène, seconde, associée, complémentaire.
Parmi toutes les illustrations, celle pour « La Barbe bleue » (Fig. 23) est certainement l’une des plus élaborées. On y revoit l’agencement par compartiments de Clouzier, développé autrement. Car la scène est échelonnée, elle n’est plus frontale. Un premier plan réunit l’épouse et son bourreau. Fokke l’a théâtralisé pour qu’il s’apparente à une scène de tragédie (contrairement à 1697, la Barbe bleue n’a pas encore levé son arme pour frapper, il s’appuie sur l’épée comme sur un sceptre). Derrière, le décor est d’une remarquable complexité et défie un peu la cohérence de l’espace. Car où se trouvent les protagonistes face à nous ? À l’extérieur du château, dans un jardin attenant ? La demeure comporte une porte crénelée, des fenêtres à croisillons sur laquelle tombe en ogive l’ombre du grand arbre de droite. Une tour pointe encore derrière un toit qu’agrémente une fenêtre lucarne. Sur le côté, ombrés comme le sont les bûcherons du « Petit Chaperon rouge », les frères accourent à cheval répondant à l’appel de leur sœur Anne nichée au sommet d’une autre tour attenant au corps de la maison. On ne voit pas très bien comment ils pourront rejoindre et sauver leur sœur menacée tant ils semblent loin d’elle et se diriger dans une autre direction que la porte de bois qu’il serait plus facile d’emprunter. Peu importe : la logique réaliste compte moins que la faculté de l’image à produire des images, à multiplier en un vaste labyrinthe lieux et scènes.
Dans nombre de ses travaux pour l’illustration, Fokke montre son peu d’intérêt pour la perspective ; elle semble n’être pour lui d’aucun bénéfice visuel. Il s’en sert plutôt comme d’un matériau plastique, qui contrarie sa vision mais qu’il parvient aussi à intégrer, fût-ce ironiquement, pour façonner la matérialité spatiale. Un bon exemple de ce refus d’organiser l’espace en fonction d’un point de fuite est l’illustration du « Petit Chaperon rouge » (Fig. 24) : le battant de la porte entraîne l’œil du lecteur vers l’extérieur d’où vient l’enfant mais qu’elle ne regarde plus. Il n’est pas complètement refermé. Il dessine une oblique qui pourrait fuir dans une perspective ; or, il n’en est rien. D’autant qu’il croise l’ombre portée de l’enfant en sorte que, loin de lancer une échappée, le pan se rabat sur la fillette qui va bientôt être mangée par la bouche d’ombre du lit.
L’axe perspectif régissant très faiblement les images de Fokke, le sol qui aide souvent à ordonner la vision, à l’instar du frontispice au pavement parfaitement quadrillé, est dépourvu de cohérence géométrique au profit de la sensorialité. Aussi le plancher de la maison de la grand-mère s’apparente-t-il à des dents ou à une langue. Que ce soit dans « Le petit Chaperon rouge », « La Belle au bois dormant », « Cendrillon » ou « L’adroite Princesse », l’espace est au contraire organisé par de Sève selon la géométrie des dallages. Dans ces quatre contes, les pièces où se tiennent les personnages sont fermées ou disons que le piège ou le risque de l’enfermement est le sujet visuel. La clôture intensifie les mouvements et la perspective, affirmée, se heurte au fond ; elles contribuent alors toutes deux à assurer le regard, à lui donner nettement prise même si l’image vibre de corps parfois en déséquilibre, au bord de la chute. Mais ces personnages cherchent justement à ramasser, tenir : le prince veut attraper la pantoufle de Cendrillon, le loup se tend pour agripper sa proie, la cadette en pamoison soutient sa cruche, l’épouse de la Barbe bleue plaque sa main sur l’épaule de son frère, le prince serre le cou de Nonchalante et le petit Poucet tire la botte de l’ogre.
Pourtant, Fokke s’intéresse aux gestes ; chez lui aussi, le petit Poucet s’acharne à se saisir de la botte du géant assoupi (Fig. 22). Mais de Sève modèle l’enfant à la pointe des torsades qu’enroule le corps de l’ogre (Fig. 12) ; il fait exactement débuter son corps à partir des mains serrant le talon de la botte. Dans son travail illustratif sur Perrault, la prise est un point d’intensité, là où l’image, par ailleurs mobile, prend et concentre l’émotion. Pour son illustration du « Petit Poucet » (Fig. 22), Fokke colle plus franchement le petit héros à la masse de la botte de l’ogre avec laquelle il fusionne et d’où il naît aussi, dans un mouvement ajouté aux flux graphiques d’une image sans limite apparente, aux seuils brouillés, surface lisse entièrement dévolue à la prolifération et aux contacts de ses éléments. Afin d’obtenir l’impression que ses images ne se fixent jamais mais qu’on y sonde le désordre, Fokke dissout la perspective ; il l’amollit comme l’indique, localement, le glissement d’un tissu qui s’épand sur le sol à partir d’un lit (« La Belle au bois dormant ») ; il la tord, la fait serpenter à la façon d’un chemin tortueux (« Les Fées », « Le Maître chat », « Cendrillon ») ; il la disperse, en créant des zones de fuite latérales comme des vagues (« Riquet à la houppe ») ; il la met en lambeaux (« Le Petit Chaperon rouge ») ou rapièce vaguement ses morceaux d’espace (« Le Petit Poucet »). Les sols géométrisés ne soutiennent plus l’image cependant que le dessin récupère les lignes ainsi libérées pour recréer des formes et les disséminer. Elles sont employées à saturer de résilles la surface des bottes de l’ogre (« Le Petit Poucet ») ou les encorbellements d’une colonne qui supporte peut-être un balcon (« Le Maître chat ») ; à quadriller les lourdes tentures qui théâtralisent les scènes (« Cendrillon », « La Belle au bois dormant ») ; à tirer des salves de traits horizontaux pour les ciels ou à ourler de courbes les volumes…
Fokke se sait limité par le format des gravures (même si les siennes ont gagné en taille par rapport à de Sève) et par l’emplacement que le livre leur accorde. Il ne renonce pourtant pas à l’espace : il l’emplit, le fractionne en micro-lieux qu’il coordonne non en fonction d’une perspective qui recréerait artificiellement de la profondeur mais selon des processus combinés de juxtaposition, d’accumulation ou bien de ramification (des arbres très fournis bouchent nombre de scènes). La planéité n’est pas traitée par Fokke selon les règles de la perspective classique, qui lui ferait a priori augmenter l’espace ; il songe plutôt aux modèles de l’encastrement ou de la marqueterie (fenêtres à croisillons), presque de manière rhizomique. Disposer une image pour Fokke, c’est assumer un certain chaos (le tas de tissus dans l’ombre à droite de l’illustration du « Petit Chaperon rouge ») et c’est gérer une poussée visuelle : la table sortie de terre dans « Riquet à la houppe » (Fig. 26) permet, d’une part, de contrarier la perspective en ouvrant le « sol » de l’image et de rendre possible une image invraisemblable. Bizarrement penchée, elle s’aplatit comme si le dessin était maladroit, sans qu’aucune assiette toutefois ne tombe. Un personnage pourvu d’une chaufferette nous regarde en admoniteur et fournit avec l’instrument qu’il brandit le modèle miniature de cette table. De fait, Fokke disperse beaucoup d’éléments de forme ronde ou ovale (pot de chambre, assiettes, marches d’escalier…), justement parce qu’ils contribuent à déjouer la perspective et à contrarier le rectangle de l’illustration.
Comme à son habitude, Fokke s’essaie à d’autres façons de représenter l’espace, c’est-à-dire de l’occuper et de le faire vivre et, en conséquence, de le régénérer. Le conte autorise parfaitement cette liberté que s’octroie l’artiste. Fokke explore donc les potentialités de l’espace agrégatif, sans chercher à l’homogénéiser ; il transmet des situations graphiques avec des invraisemblances d’échelle dont le conte n’a que faire, et que même il cultive. La perspective dominante est volontairement reléguée ou employée très localement voire ironiquement afin que l’image s’affirme comme une surface d’attraction plutôt que comme une véritable épaisseur rationalisée. Fokke ne pratique pas exactement un système de plans successifs, il gère plutôt des plans divisés, et qui, de la sorte, ont tendance à se changer en lieux.
Avec la disparition de la porte ou du mur, que remplacent toutes sortes d’ouvertures vers des ailleurs, Fokke ôte à l’espace sa protection. Le lieu du conte n’est pas le refuge chaleureux de la maison ; avec lui, le monde de l’enfance communique avec un extérieur et ses zones diffuses, souvent troublantes, potentiellement dangereuses. Cette dynamique spatiale est cependant appréhendée d’abord sur le mode du déploiement imaginaire, de l’accès, grâce à la fiction, aux surgissements magiques, aux secteurs de la merveille dont l’enchantement est réversible, euphorique ou mortifère. La paroi du frontispice tombée, un univers mobile advient : l’espace s’avère certes moins rassurant mais plus ludique, et il donne accès aux expériences. Fausser la perspective amène Fokke à esquisser des échappées, à en faire des épreuves pour la vision (et à travers elle pour l’existence). Le lointain (y compris quand il est à l’intérieur du plus familier) est bien là, il est concrétisé par l’image et en elle. Mais ces éloignements, Fokke n’a de cesse les rapporter à la surface du papier et de rappeler que, malgré notre trouble éventuel, les histoires que nous lisons, dont nous ressentons les visions, demeurent des histoires, filées au coin du feu, là où l’on peut toujours revenir se blottir, la main sur le giron de sa nourrice.
C’est à une économie de l’illustration, son « iconomie », auquel nous sensibilise le double montage du livre fabriqué à partir des éditions de 1742 et de 1745, rendu plus abondamment figuratif par son double régime de gravures (vignettes et planches) et sa dépense visuelle ; cette copia affecte la cohérence des images, bouleverse leur logique interne et démultiplie des formules instables qui, à l’appui des récits, s’émancipent des règles de la représentation. Car se complétant ou, le plus souvent, se mettant en concurrence, les deux ensembles illustratif font apparaître une préoccupation de l’image, dans une certaine mesure même une inquiétude, inspirée par le conte et dans laquelle ils puisent leur énergie, rendant tout à fait incertaine la réalité au profit de troubles perceptifs induits par l’atmosphère onirique des récits. En même temps qu’elles proposent des hypothèses visuelles destinées à transposer les lectures que les artistes tentent sur les textes, les illustrations s’attachent à en redistribuer les éléments entre vignettes (de Sève) et planches (Fokke) ; cette mobilité graphique, ajoutée à des audaces compositionnelles, crée pour le regard les conditions d’une constante perturbation favorable à l’imprégnation sensible des contes.
Notes
Le manuscrit est conservé par la Pierpont Morgan Library de New York.
Voir sur Gallica l'exemplaire de l'Arsenal.
Je remercie très chaleureusement Volker Schröder pour tous les renseignements qu’il a eu la gentillesse de me communiquer et qui ont permis sur beaucoup de points de rendre mon travail plus précis.
Henry Cohen, Guide de l’amateur de livres à figures du dix-huitième siècle, sixième édition revue, corrigée et considérablement augmentée par Seymour de Ricci, Librairie A. Rouquette, 1912, 6e édition, p. 789.
Vérène de Diesbach-Soultrait, Six Siècles de littérature française - XVIIe siècle, Genève, Droz, tome II, 2010, p. 92 (notice 235).
Marie-Claire Planche, « Jacques de Sève (1715-1795), dessinateur et peintre parisien : une carrière dévoilée », Dix-huitième siècle, vol. 55, n°1, 2023, p. 469-492.
Illustrer les contes de Perrault
3|2024 - sous la direction de Olivier Leplatre
Illustrer les contes de Perrault
Illustration
Temporalité et spatialité dans les illustrations des « Fées »
Les métamorphoses plastiques de la féerie
Illustrations gothiques des contes de Perrault par Marillier pour Le Cabinet des fées
De face ou de dos, les enjeux de l’illustration de la mise à mort de la Barbe bleue
Les objets dans les Contes de Perrault et dans les illustrations de Gustave Doré
Décoration
« The Tangle of World’s Wrong and Right » : la saturation comme stratégie d’effacement
Illustrer, décorer : un grand décor pour un grand récit
Récits graphiques, albums
La « pensée visuelle et spatiale » au service de quatre contes de Perrault
« Le Petit Chaperon rouge » en noir-blanc-rouge dans l’album contemporain pour la jeunesse
Images des Contes de Perrault dans les albums jeunesse