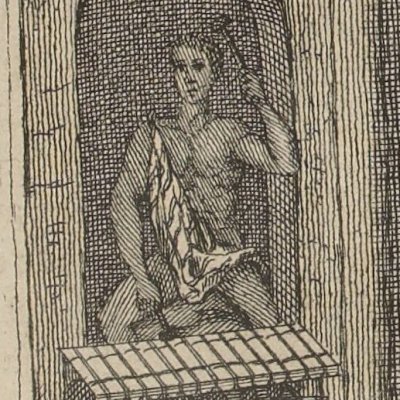I. La différence des usages
Une anthropologie de la différence
Brûlement des femmes aux Indes (Madelslo, Voyages de Perse aux Indes)
Dans la première édition de l’Essai sur les mœurs, l’édition Cramer de 1756, on peut lire au chapitre 120, « Du Japon, &c. », la réflexion suivante sur la différence fondamentale qui partage l’humanité :
« C’est un objet digne de l’attention d’un Philosophe, que cette différence entre les usages de l’Orient & les nôtres, aussi grande qu’entre nos langages. Les peuples les plus policés de ces vastes contrées n’ont rien de nôtre police1. Leurs Arts ne sont point les nôtres. Nourriture, vêtemens, maisons, jardins, loix, culte, bienséances, tout différe. Y a-t-il rien de plus opposé à nos coutumes que la manière dont les banians trafiquent dans l’Indoustan ? Les marchés les plus considérables se concluent sans parler, sans écrire, tout se fait par signes. Comment tant d’usages Orientaux ne différeraient-ils pas des nôtres ? La nature n’est point la même dans leurs climats que dans nôtre Europe2. On est nubile à sept ou huit ans dans l’Inde Méridionale. Les mariages contractés à cet âge y sont communs. Ces enfants, qui deviennent péres, jouissent de la mesure de raison que la nature leur accorde dans un âge où la nôtre est à peine dévelopée. » (Essay sur l’histoire generale, & sur les Mœurs & l’Esprit des Nations, depuis Charlemagne jusqu’à nos jours, vol. 3, chap. 120, « Du Japon, &c3 », p. 201-202)
Le philosophe fixe de son attention un objet, et cet objet n’est pas l’Homme des moralistes du Grand Siècle, mais la différence. Ce qui devient essentiel, ce qui faisant tableau tient lieu d’essence, c’est la différence, une différence des usages que Voltaire rapporte à la différence des langues qui, en quelque sorte, la symptomatise. Mais d’où, de quel poste d’observation, le philosophe peut-il fixer une telle attention mondialisée ? Le lieu d’une telle vigie est techniquement impossible, seule une expérience de pensée peut le réaliser, c’est-à-dire une fiction théorique, une opération de l’esprit suppléant à une expérience physique irréalisable.
D’un côté, donc, il faut supposer un observateur impossible dont le regard embrasserait la totalité du globe, et en percevrait simultanément toutes les activités ou, plus précisément, toutes les transactions humaines, tous les échanges. De l’autre, dans l’objet, c’est-à-dire dans ces rapports, il s’agit de mettre en évidence à chaque fois la différence, en tant que cette différence revient à la différence des langues. Autrement dit, il ne s’agit pas d’une hétérogénéité absolue, il y a bien quelque part une linguistique générale qui régit ces différences, une rationalité supérieure à partir de laquelle se décline la variété des langues, c’est-à-dire la variété des usages, polices et manières de commercer.
Cette linguistique générale est présupposée par le dispositif même de l’expérience de pensée, par la possibilité qu’un philosophe porte son attention sur cette différence des usages. Le philosophe figure l’intelligence de cette linguistique, son regard désigne cette raison des différences. Lorsque la différence éclate et choque, dans sa singularité même elle nous ramène, par le rapport qu’elle établit, à notre similitude : « la manière dont les banians trafiquent dans l’Indoustan » nous étonne, il n’y a rien de plus « opposé » à nos usages ; mais cet usage par quoi les Banians, la caste des marchands de l’Inde, nous paraissent radicalement différents de nous, incomparablement éloignés, concerne précisément le commerce, c’est-à-dire non seulement ce qui organise les rapports des objets et des personnes en Inde, mais ce par quoi notre continent entre en rapport avec eux. On conclut les marchés d’une manière incroyablement exotique et déconcertante, d’une manière sans rapport avec les nôtres ; mais ce sont des marchés qu’on conclut, y compris des marchés que nous sommes amenés nous-mêmes à conclure avec eux. Nous sommes révoltés d’apprendre que les filles sont considérées comme nubiles, et donc mariées à sept ou huit ans, que les garçons deviennent pères de famille à cet âge : rapport sexuel, mariage, rapport de filiation constituent autant de liens constitutifs du tissu social, au même titre que le commerce, et de façon plus intime encore. La différence porte sur le lien ; le spectacle de la différence organise une gestion mondialisée des liens.
Le problème ontologique de la nature humaine
Nègre montant à un palmier (Nouvelle relation de l'Afrique occidentale, 1728)
Le jeu des usages, le système des polices, la grammaire des rapports ne reposent sur aucune ontologie : pour Voltaire, il n’y a pas d’essence universelle de l’homme, il n’y a pas de nature humaine unique : ce que la nature montre et produit dans le monde n’est pas verrouillé par une hypostase métaphysique. L’objet que fixe l’attention du philosophe n’est pas une nature. Il n’y a plus de nature. Il faut faire attention à ce terme de nature, qui dans la langue classique est à la fois de physique et de métaphysique : la nature, c’est, phénoménologiquement, ce qu’on voit dans la Nature, et c’est aussi ce qui, ontologiquement, définit la nature des choses. Voltaire avait d’abord écrit, en 1756, « La nature n’est point la même dans leurs climats que dans nôtre Europe », où la nature définissait les productions de la nature et leur variation en fonction du climat. Mais les productions engagent les espèces, et leur nature. La formulation de 1756 a visiblement posé problème, puisqu’elle est corrigée dans l’édition de Kehl :
« La nature, dont le fond est partout le même, a de prodigieuses différences dans leur climat et dans le nôtre. »
La nature est à la fois ontologiquement une et phénoménologiquement diverse. Si l’unité ontologique de la nature est réaffirmée dans la relative incidente qui est ajoutée, la différence de ses manifestations en fonction du climat est exacerbée et devient hyperbolique. Il y a bien une similitude de nature, mais cette similitude n’engage que l’individu :
« Tous ces peuples ne nous ressemblent que par les passions, & par la raison universelle qui contrebalance les passions, & qui imprime cette Loi dans tous les cœurs, ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu’on te fît. Ce sont-là les deux caractères que la nature empreint dans tant de races d’hommes différentes, & les deux liens éternels dont elle les unit4. Tout le reste est le fruit du sol de la terre, & de la coûtume. Là c’était la ville du Pégu, gardée par des crocodiles qui nagent dans des fossés pleins d’eau. Ici c’était Java, où des femmes montaient la garde au Palais du Roi. » (Ibid., p. 202)
Nègre jouant du Balafo (Nouvelle relation de l'Afrique occidentale, 1728)
La grammaire cartésienne des passions, et les principes rationnels de la morale qui en délimitent le périmètre permis, sont universels : ce périmètre, rigoureusement privé, des déterminations individuelles, des motivations invisibles, s’oppose à la police et aux échanges qui dessinent les tableaux bariolés des différentes sociétés. Il y a similitude au fond, le fond de l’homme est partout le même, mais c’est un fond limité, dont les ressorts secrets ne concernent pas l’historien ; ce que le monde donne à voir, ce qui fait tableau comme monde, c’est le jeu public des différences qui est en même temps le système social des rapports. Autrement dit la façade des différences, leur jeu horizontal et de surface, devient l’enjeu philosophique essentiel. Dans cette polarité du fond et de la façade, la hiérarchie métaphysique traditionnelle qui promeut la substance contre les attributs, l’essence contre les apparences, l’être contre les phénomènes, est renversée : Voltaire inaugure l’âge des sciences humaines, avec ses réseaux, ses rapports horizontaux, ses différences. C’est dans cette nouvelle horizontalité mondialisée que peut se penser, à partir du commerce, le jeu social des rapports, l’espace public de ce jeu, et la politique qui administre cet espace.
Le système des différences, la linguistique générale qui les régit, définit, à l’échelle du globe, une politique. Cette politique administre l’espace public ; elle le gère et le protège, elle en garde les lieux stratégiques. Significativement les deux exemples que donne Voltaire sont des exemples de garde. Il s’agit de voir comment on garde le port de Pégou5 ou le palais royal de Java6 : les manières sont pittoresques, manifestent la différence des usages, mais l’enjeu, toujours le même, est la préservation de la communauté, de la même manière que la loi morale universelle, en limitant les actions, préserve les territoires des singularités.
Le racisme de Voltaire
À l’interface des territoires individuels, où s’exerce la loi morale, et des territoires publics, dont le gouvernement politique garantit la garde, Voltaire évoque « tant de races d’hommes différentes » : la race n’est pas encore « le fruit du sol de la terre, & de la coûtume », mais elle n’est déjà plus le caractère de la nature, qui est le caractère de l’homme universel. La race est pour Voltaire ce qui fonde le jeu des différences, elle est la différence principielle, on frémit à le lire. En 1765, lorsqu’il publie une Philosophie de l’histoire qui va devenir l’introduction de l’Essai sur les mœurs, Voltaire écrit juste après les « Changements dans le globe » un chapitre II intitulé « Des différentes races d’hommes ». Il s’agit d’installer au plus fondamental, au plus essentiel, l’articulation du jeu horizontal des différences avec une pensée de la globalisation. Le monde physique est en « révolution » perpétuelle, le mot apparaît quatre fois dans le chapitre I ; à ces révolutions, ou bouleversements de la nature, correspond au chapitre II « la différence sensible des espèces d’homme qui peuplent les quatre parties connues de notre monde ». Cette différence est de nature et, dans sa description, l’idée d’une caractéristique morale et rationnelle commune a disparu :
« Il n’est permis qu’à un aveugle de douter que les Blancs, les Nègres, les Albinos, les Hottentots, les Lapons, les Chinois, les Américains, soient des races entièrement différentes.
Il n’y a point de voyageur instruit qui, en passant par Leyde, n’ait vu la partie du reticulum mucosum7 d’un Nègre disséqué par le célèbre Ruysch. Tout le reste de cette membrane fut transporté par Pierre le Grand dans le cabinet des raretés, à Pétersbourg. Cette membrane est noire ; et c’est elle qui communique aux Nègres cette noirceur inhérente qu’ils ne perdent que dans les maladies qui peuvent déchirer ce tissu, et permettre à la graisse, échappée de ses cellules, de faire des taches blanches sous la peau.
Leurs yeux ronds, leur nez épaté, leurs lèvres toujours grosses, leurs oreilles différemment figurées, la laine de leur tête, la mesure même de leur intelligence, mettent entre eux et les autres espèces d’hommes des différences prodigieuses. Et ce qui démontre qu’ils ne doivent point cette différence à leur climat, c’est que des Nègres et des Négresses, transportés dans les pays les plus froids, y produisent toujours des animaux de leur espèce, et que les mulâtres ne sont qu’une race bâtarde d’un noir et d’une blanche, ou d’un blanc et d’une noire8. »
La découverte en 1665 du reticulum mucosum par Marcello Malpighi, défraya la chronique scientifique des Lumières. Grâce à l’usage alors tout nouveau du microscope, Malpighi avait mis en évidence la structure de la peau, son organisation en couches superposées et, dans ces couches, en réseaux cellulaires. Ses découvertes sont révolutionnaires, on parle encore aujourd’hui, en médecine, des couches de l’épithélium malpighien, qui constituent l’épiderme. L’erreur de Malpighi fut d’imaginer un reticulum mucosum spécifique aux Noirs9, contenant le pigment noir de leur peau sous forme d’un liquide qu’ils étaient seuls capables de sécréter, ce qui fondait en nature la différence raciale entre noirs et blancs. Ce liquide ne put évidemment jamais être isolé : après avoir répété, sans succès, l’expérience de Malpighi à Paris en 1702, Alexis Littré conclut à une position moyenne (la peau noire résultant pour partie du climat, pour partie du reticulum mucosum), qui est reprise par Pierre Barrère dans une Dissertation sur la cause physique de la couleur des nègres, de la qualité de leurs cheveux, et de la dégénération de l’un et de l’autre, défendue devant l’Académie de Bordeaux et publiée en 1741. Le reticulum mucosum alimentera le discours raciste de légitimation de l’esclavage au XIXe siècle10.
La négresse portée dans un hamac (Tenture des Nouvelles Indes, 6e) - Desportes
Le discours de Voltaire proclamant la différence essentielle des races nous horrifie aujourd’hui : du tableau d’une infinie variété, le propos dérape vers l’établissement implicite d’une hiérarchie, par « la mesure même de leur intelligence ». Rien ne peut excuser de telles insinuations. Or ce discours n’est pas isolé dans le corpus voltairien. Il réapparaîtra notamment dans les Questions sur l’Encyclopédie11. C’est que la phénoménologie des différences, qui organise la pensée voltairienne de la globalisation, bute sur le principe ontologique de l’universalité de la nature humaine, qui est avant tout, à l’époque de Voltaire, un principe chrétien, défendu par l’Église. Voltaire ne croit pas que tous les hommes descendent d’Adam et Ève, et le spectacle de la variété des hommes vient à l’appui de sa critique : « Après cela, tirez-vous d’affaire comme vous pourrez avec Adam et Eve », conclut-il malicieusement.
Il reste néanmoins tributaire du cadre établi depuis la Renaissance par l’Église, qui établit une différence entre les Amérindiens, à qui elle reconnaît l’égalité, et les Noirs, dont elle ne condamne pas l’esclavage. La liste des races que Voltaire annonce au début de son développement lui permet effectivement, dans un véritable esprit de tolérance et un souci révolutionnaire de décentrement culturel, de promouvoir non seulement la police, les usages, les mœurs de toutes sortes de peuples, mais d’exalter leur raison contre notre ignorance, notre bêtise, nos préjugés. Dans ses romans, qui suivent en cela l’exemple de son théâtre, le parfait Zadig est un Babylonien adepte de Zoroastre, Cacambo, le personnage le plus intelligent de Candide, est un quart d’Espagnol, c’est-à-dire un métis aux trois-quarts amérindien, et l’Ingénu, véritable super-héros, est mi-Breton, mi-Huron : aucun des héros de roman de Voltaire n’est un Européen blanc, aucun non plus n’est un nègre. Comme l’Église, Voltaire excepte les Noirs de cet exercice humaniste salutaire de renversement des points de vue et son article Esclaves des Questions sur l’Encyclopédie est pour le moins embarrassé12.
II. Raison suffisante et disparate des événements
La description horizontale des différences se heurte frontalement au récit théologique, vertical, des similitudes : Dieu a créé l’homme à son image, et de l’homme originel procède l’humanité tout entière, saisie comme monde. L’enchaînement des causes définit l’autre logique, verticale, contre laquelle milite le tableau multicolore des mœurs planétaires : toutes les causes (terrestres) remontent à une origine (divine), à ce que Leibniz appelle une « raison suffisante ». À l’intersection de ces deux logiques, entre description et narration, entre logique des mœurs et logique des êtres, entre anthropologie et métaphysique, on trouve l’événement : l’événement fait tableau sur une scène, dans un site ou un territoire, et l’événement prend place dans une chaîne des événements, dans un enchaînement qui a sa raison. Il y a un site horizontal et une raison verticale de l’événement. La nouvelle économie des différences que promeut Voltaire s’affronte immédiatement à la verticalité des raisons.
Critique de la raison suffisante : Candide
Thérèse épie Mme C… et l’abbé T… au jardin (Thérèse philosophe, Londres, 1782)
La déconstruction de la verticalité de l’événement et la promotion de son horizontalité de scène, de site et de territoire constituent l’enjeu poétique décisif de Candide, dont la parodie de l’optimisme leibnizien fournit l’habillage et l’alibi philosophique. La thèse selon laquelle nous vivons dans le meilleur des mondes possibles constitue le mot de Candide, auquel viennent s’articuler l’ensemble de ses événements. Ce mot si puissamment organisateur définit, affiche la fadaise du galimatias prétendument philosophique de Pangloss. Mais il ne constitue pas le fond de ce qui est en jeu philosophiquement dans Candide. Ce qui est en jeu, c’est la verticalité qui permet au métaphysicien de ramener tout événement à une raison suffisante, c’est-à-dire tous les effets à une cause unique, qui est Dieu. Le principe de raison suffisante constitue la base de la métaphysique leibnizienne, le substrat de sa théorie des mondes possibles et de la théodicée qu’elle met en œuvre : il y a une rationalité de l’événement, qui permet d’expliquer chacun d’eux, et de ramener l’infinie variété des phénomènes à une origine unique et essentielle. C’est cette verticalité de l’enchaînement causal que Voltaire entreprend d’attaquer : le maître mot de Candide, la cible visée, ce n’est pas l’optimisme de Pangloss, mais plus essentiellement le principe de raison suffisante.
Le terme apparaît dès le premier chapitre de Candide, et d’emblée sous une forme carnavalesque. Cunégonde se promène dans le parc du château de Thunder-ten-tronkh et surprend Pangloss dans les bras de Paquette, la femme de chambre de sa mère. Pangloss lui donne « une leçon de physique expérimentale », et nous apprendrons plus tard qu’il est par la même occasion en train d’attraper la vérole :
« Comme mademoiselle Cunégonde avait beaucoup de dispositions pour les sciences, elle observa, sans souffler, les expériences réitérées dont elle fut témoin ; elle vit clairement la raison suffisante du docteur, les effets et les causes, et s’en retourna tout agitée, toute pensive, toute remplie du désir d’être savante, songeant quelle pourrait être la raison suffisante du jeune Candide, qui pouvait aussi être la sienne. » (p. 39)
Voltaire parodie une scène de roman libertin, où la jeune novice surprend par effraction le libertin en pleine action et fait son apprentissage par ce qu’elle voit. L’apprentissage est double, puisque le libertin pratique lui-même le sexe comme un enseignement, « une leçon de physique expérimentale » : l’enseignement qu’en tire Cunégonde est un enseignement d’enseignement, dont le contenu est désigné comme « la raison suffisante », et glosé par « les effets et les causes ». La raison suffisante est le mot de la scène, le mot du philosophe, et de la philosophie leibnizienne. Ce mot fait ici métalepse : dans le discours, il se manifeste comme enseignement indirect (ce que j’ai appelé un enseignement d’enseignement, Cunégonde tire un enseignement de ce qu’elle voit Pangloss enseigner à Paquette), mais sur la scène il est l’objet nouveau que Cunégonde découvre, le sexe en action de son maître de philosophie. Elle se demande alors ce que pourrait être le sexe du jeune Candide, et si ce sexe ne pourrait pas lui revenir, être sien, si à son tour elle ne pourrait pas en jouir. Le jeu carnavalesque consiste ici, par la métalepse, à prendre la raison suffisante à la fois dans le sens le plus abstrait d’un principe organisateur de l’ensemble des événements et de faire advenir par lui, immédiatement sous les yeux de Cunégonde, l’événement même.
Dorinde montre à Mérindor son visage vérolé (L’Astrée, 1733, IV, 4) - Guélard
Le terme de « raison suffisante » revient au chapitre IV, lorsque Candide retrouve Pangloss défiguré et mutilé par la vérole. Nous accédons cette fois au discours direct du philosophe, qui évoque les effets de la maladie dont il est atteint. Mais est-ce bien Pangloss qui parle ?
« Les Turcs, les Chinois, les Siamois, les Japonais, ne la connaissent pas encore ; mais il y a une raison suffisante pour qu’ils la connaissent à leur tour dans quelques siècles. » (p. 48)
Le discours leibnizien est parasité par l’ironie voltairienne, qui introduit contre l’effet de raccourci de la raison suffisante le déploiement des peuples divers dans l’espace et de la contagion dans le temps. Voltaire parle à travers Pangloss et contre lui : le « merveilleux progrès » de la syphilis, que Candide commente d’un « voilà qui est admirable » extasié, est un des plus horribles fléaux de l’époque moderne. Ce qui est dit merveilleux et admirable n’est ni merveilleux, ni admirable : on reconnaît là les marqueurs de l’ironie. Mais ce qui se joue plus fondamentalement dans ce parasitage du discours, c’est le conflit entre la verticalité métaphysique de la raison suffisante et l’horizontalité, dans l’espace et dans le temps, des effets.
Mais qu’est-ce exactement que cette raison suffisante qui serait le concept clef de la métaphysique leibnizienne ? Curieusement, le terme ne se trouve pas dans La Théodicée, tout entière gouvernée pourtant par son principe. Voltaire n’avait d’ailleurs probablement pas lu directement Leibniz, dont la philosophie s’était largement répandue en France notamment par l’intermédiaire de l’Encyclopédie. De 1751 à 1756, avant l’interdiction de l’Encyclopédie et l’interruption de sa publication en 1757, « raison suffisante » apparaît notamment dans les articles de l’abbé Yvon (Ame, Ame des bêtes, Appétit, Athéisme, Attribut), mais aussi de D’Alembert (Attraction, Continuité, loi de, et surtout Espace), Formey (Contradiction), Morellet (Fatalité).
Leibniz évoque la raison suffisante dès la Confessio Philosophi :

« Je pense qu’on peut démontrer qu’aucune chose n’existe jamais qu’il ne soit possible (du moins à un esprit omniscient) d’assigner la raison suffisante pourquoi elle est plutôt que de n’être pas, et pourquoi elle est telle plutôt qu’autrement. Celui qui nie cela détruit la distinction entre l’être lui-même et le non-être. La chose, quelle qu’elle soit, aura assurément tous les réquisits pour exister ; or, tous les réquisits pour exister pris ensemble sont la raison suffisante d’exister ; donc tout ce qui existe a une raison suffisante. » (Leibniz, Confessio Philosophi / La Profession de foi du philosophe [1673], texte, traduction et notes, nouvelle édition revue et augmentée, Vrin, Paris, 2004, p. 35.)
Rien n’existe sans raison : de tout ce qui existe, il est possible de rendre raison. La raison suffisante définit une philosophie de la responsabilité rationnelle : la raison a des comptes à rendre, de chaque événement elle peut et elle doit rendre compte. Mais, comme le fait remarquer Jacques Bouveresse13, Leibniz ne dit jamais que nous, que l’homme en général, est capable « d’assigner la raison suffisante » des choses. Cette raison peut être assignée : mais bien souvent seul « un esprit omniscient », c’est-à-dire Dieu même, est capable de le faire.
Au chapitre V, Voltaire décrit assez précisément la catastrophe de Lisbonne, avec son premier acte, le tremblement de terre en mer qui provoque la tempête et le naufrage des voyageurs, et son second acte, le raz-de-marée qui détruit la ville (« la mer s’élève en bouillonnant dans le port », p. 50). La scène de l’effondrement de la ville, traitée à la manière théâtrale du tremblement de terre des Indes galantes14, constitue l’événement dont il s’agit ensuite d’extraire le mot, le fin mot, c’est-à-dire le fond derrière la façade du spectacle15 :
« Le matelot disait en sifflant et en jurant : “Il y aura quelque chose à gagner ici. — Quelle peut être la raison suffisante de ce phénomène ? disait Pangloss. — Voici le dernier jour du monde !” s’écriait Candide. » (p. 50)
Le matelot cynique et brutal qui vient de noyer l’anabaptiste voit dans le tremblement de terre une occasion de jouissance et de profit ; il démystifie le tableau dramatique et sensible de l’événement, le fait basculer dans la triviale brutalité d’un envers du décor, où seul compte l’intérêt qu’on peut en tirer ; c’est là une manière de rendre compte. Pangloss invoque la raison métaphysique de l’événement, et Voltaire respecte le système de Leibniz : le philosophe ne donne pas la raison suffisante, dont seul un esprit omniscient pourrait rendre compte ; il se contente de l’interroger. Candide enfin se prépare à l’Apocalypse, qui est la troisième forme du « rendre compte », le dévoilement chrétien, dans la catastrophe, des fins dernières. Cette triple réaction à l’événement obéit à la logique des 3F : le matelot révèle le plan du fond, Pangloss déroule la fadaise et Candide continue de jouer sur la façade du théâtre du monde.
Naufrage sur le chemin du retour en Espagne (Vita I. Loiolæ, 1622)
La raison suffisante rend compte et engage une responsabilité métaphysique de la raison face à l’événement, elle garantit la rationalité du réel ; la raison suffisante d’autre part n’est bien souvent accessible, connaissable que par un esprit omniscient : c’est pourquoi elle est destinée à être postulée plutôt qu’énoncée, et se trouve donc devant nous comme horizon d’explication, bien plus que dernière nous comme cause, présente certes mais inconnaissable a priori ; la raison suffisante enfin détermine l’événement, c’est par elle que les choses sont plutôt qu’elles ne sont pas : par la raison suffisante, c’est l’être de l’événement qui est engagé et garanti, et à partir de cet être circonstanciel l’Être divin tout entier.
Dans leur jeu parodique même, les réactions que Voltaire décrit du matelot, de Pangloss et de Candide figurent ces trois caractéristiques essentielles de la raison suffisante :
-
la rationalité de l’événement, c’est l’argent que le matelot pourra en tirer ;
-
l’inconnaissabilité de la raison suffisante est rappelée par la question de Pangloss, ridicule sous cette forme jargonnante, mais pouvant aussi se lire, de façon sous-jacente, comme une douloureuse mise en question de la foi ;
-
la question de l’être et de l’existence se manifeste dans le cri de Candide, pour qui c’est la fin.
La parodie de la raison suffisante, ou du recours à la raison suffisante comme principe n’engage donc pas simplement une critique de ce qu’on appelle, un peu vite, l’optimisme leibnizien. La raison suffisante motive l’être des choses, elle en rend raison ; sa parodie attaque la légitimité même de l’être et se manifeste du coup systématiquement dans des formulations, des situations où l’être est menacé, où la mort menace, où le monde semble prend fin. Dans le chapitre dit de la boucherie héroïque, c’est l’œuvre de mort des baïonnettes sur le champ de bataille : « La baïonnette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d’hommes. » (p. 43) Ici, c’est l’apocalypse du tremblement de terre de Lisbonne16.
Le fait et l’énoncé : les deux raisons suffisantes
Leibniz est revenu à la question de la raison suffisante dans la Monadologie, en articulant nettement ce qu’elle engage sur le plan métaphysique (la raison d’être des choses et des événements) avec ce qu’elle désigne sur le plan logique (dans le raisonnement) :
« 31. Nos raisonnements sont fondés sur deux grands Principes, celuy de la Contradiction, en vertu duquel nous jugeons faux ce qui en enveloppe17, et vray ce qui est opposé ou contradictoire au faux.
32. Et celuy de la Raison suffisante, en vertu duquel nous considerons qu’aucun fait ne sauroit se trouver vray ou existant, aucune Enontiation veritable, sans qu’il y ait une raison suffisante, pourquoy il en soit ainsi et non pas autrement, quoyque ces raisons le plus souvent ne puissent point nous être connues. (Leibniz, Monadologie [1714], éd. Laurence Bouquiaux, Gallimard, Tel, 1995, p. 99)
Cette première définition ne recoupe pas exactement la précédente : la raison suffisante n’est pas considérée pour ce qu’elle détermine directement dans le réel, mais pour ce qu’elle ordonne dans le discours. Plus exactement, Leibniz établit un parallèle entre le fait et l’énonciation, c’est-à-dire entre la manière dont s’enchaînent les événements et la cohérence selon laquelle s’articule une démonstration. La raison suffisante est placée sur le même plan que le principe de non-contradiction : elle détermine une vérité mathématique (et delà une vraisemblance fictionnelle) bien plus qu’elle n’authentifie les données du réel. De fait, le terme « existant » qui s’applique au fait ne s’applique plus à l’énonciation.
D’autre part, les raisons « le plus souvent ne p[euv]ent point nous être connues » : dans l’enchaînement des causes et des effets, Leibniz introduit une clause d’inconnaissabilité ; certaines causes excèdent les capacités d’investigation et de calcul de l’esprit humain et ne sont accessibles qu’à l’esprit omniscient de Dieu. Il y a donc dans l’enchaînement causal un jeu, un mystère, un saut incompréhensible, qui vient en quelque sorte brouiller l’évidence, la verticalité directe de la raison suffisante : il faut calculer les causes, et dans ce calcul procéder parfois à l’itération infinie d’une opération, penser un passage à la limite dont on ne peut pas suivre linéairement et pas à pas la succession. La pensée de ce saut logique est fondamentale chez Leibniz : c’est elle notamment qui lui permet de formaliser et de développer le calcul différentiel.
Leibniz distingue dès lors deux sortes de « vérités », correspondant aux deux plans du raisonnement et du fait entre lesquels il a établi un parallèle. Les vérités de raisonnement ne posent pas de problème, soit qu’elles constituent des vérités simples, soit qu’elles en forment la combinaison : la recherche des raisons va consister à décomposer l’énoncé en une combinaison de principes, c’est-à-dire de vérités simples. Mais les choses se compliquent avec les vérités de fait à cause de l’infinie variété du réel :
« 36. Mais la raison suffisante se doit aussi trouver dans les verités contingentes ou de fait, c’est-à-dire dans la suite des choses repandues par l’univers des Creatures, où la Resolution en raisons particulieres pourroit aller à un detail sans bornes, à cause de la variete immense des choses de la Nature et de la division des corps à l’infini. Il y a une infinité de figures et de mouvemens presens et passés, qui entrent dans la cause efficiente de mon ecriture presente, et il y a une infinité des petites inclinations et dispositions de mon âme, présentes et passées, qui entrent dans la cause finale.
37. Et comme tout ce detail n’enveloppe que d’autres contingens anterieurs ou plus detaillés, dont chacun a encor besoin d’une Analyse semblable pour en rendre raison, on n’en est pas plus avancé : et il faut que la raison suffisante ou derniere soit hors de la suite ou serie de ce detail des contingences, quelqu’infini qu’il pourroit être.
38. Et c’est ainsi que la derniere raison des choses doit être dans une substance necessaire, dans laquelle le detail des changemens ne soit qu’eminemment, comme dans la source, et c’est ce que nous appellons Dieu. » (Monadologie, op. cit., p. 100)
Les vérités de fait ne sont pas d’une nature différente des vérités de raisonnement, mais elles engagent un nombre d’éléments incomparablement, et même infiniment plus important. Dans la causalité des faits, la raison doit prendre en compte un infini hétérogène de déterminations, c’est-à-dire que Leibniz est confronté exactement à cette même différence infinie sur laquelle Voltaire historien appuie sa pensée de la globalisation : le global est le passage à la limite d’un calcul infini de différences locales ; la pensée effectue un saut, elle bascule du décompte successif des différences de lieu en lieu vers la saisie globale d’un monde, ou même d’un système des mondes. C’est-à-dire que le global ne peut se penser qu’à partir d’un calcul prenant en compte une infinité d’éléments soumis à une infinité de paramètres : cette double infinité, nous dit Leibniz, ne peut être appréhendée qu’« éminemment », c’est-à-dire depuis une intelligence supérieure, placée en surplomb et capable de saisir globalement ce qui dans la minutie du calcul point par point, se perd et se dissout sans pouvoir arriver à la fin.
Seul Dieu donc, en fin de compte, dispose pleinement de la raison suffisante, laquelle du coup, rétroactivement, démontre l’existence de Dieu. Leibniz garantit ainsi, par l’incalculabilité de la raison suffisante, le principe métaphysique de l’unité de l’être. La raison suffisante n’est donc pas seulement « la derniere raison des choses », qui arrive en dernier en amont d’une succession infinie de causes ; elle est aussi un argument en dernier recours pour sauver la métaphysique, et avec elle la verticalité de l’Un, un ultime verrou avant l’invasion généralisée des différences, avant l’explosion et le triomphe des bigarrures du divers. Tout le paradoxe tient dans ce que Leibniz, tout en maintenant jusqu’au bout, comme métaphysicien, l’inconnaissabilité ultime de la raison suffisante autrement que par l’esprit omniscient de Dieu, crée, comme mathématicien, les conditions de possibilité de cette connaissance globale et infinie par l’invention du calcul différentiel.
On touche ici au paradoxe fondamental de la différence dans son articulation avec la globalisation : l’énoncé des différences pose, ou au moins prédispose, l’évaluation, la prise en compte, le calcul de celles-ci. Le tableau des différences du monde globalise celles-ci comme un monde. Chez Leibniz, face à « la suite [infinie] des choses répandues par l’univers des Creatures », la métaphysique affirme ultimement le principe originaire unique de la raison suffisante et les mathématiques mettent en œuvre les modalités humaines, finies, raisonnables, de son calcul infini. Chez Voltaire, l’Essai sur les mœurs proclame, comme « essai », la fin d’une histoire universelle qui serait portée par un discours téléologique, et insiste sur la diversité des polices et des usages, proclamant rageusement la différence radicale des races qui les portent ; parallèlement, le roman voltairien accumule à plaisir le disparate des événements ; mais dans le même temps, la différence des mœurs ordonne une économie mondialisée des rapports et le bric-à-brac des accidents narratifs, compulsivement rappelé, est concaténé dans une chaîne toujours plus simple, plus réduite, plus vite et facilement énoncée. Le paradigme de l’hétérogène, du disparate, de l’hybride qui se met en place nourrit la pensée voltairienne de la globalisation, qui est à la fois une idéologie, une économie et une poétique, complètement innervée par le calcul leibnizien qu’elle rejette en surface.
III. Le trou et le saut : processus de la globalisation voltairienne
Lisbonne avant et après le tremblement de terre de 1755 - D. Herrliberger
Dans Candide, le narrateur relayé par ses personnages insiste lourdement sur le disparate des événements. À la différence des mœurs, qui occupe Voltaire historien, correspond la clocherie dans l’enchaînement des événements chez Voltaire romancier. De façon circonstancielle et superficielle, le discours de Pangloss parodie l’optimisme leibnizien confronté à la catastrophe d’envergure européenne du tremblement de terre de Lisbonne, un des premiers événements que relaye médiatiquement la presse internationale naissante. Plus profondément, ce discours répète et relance, à chaque étape de la narration (du moins dans les premiers chapitres de Candide) le principe de la raison suffisante comme principe rationnel d’explication des causalités (apparemment) inexplicables. Or l’enchaînement causal n’est pas une simple affaire de controverse post-scolastique, qui devrait ou pourrait satisfaire, ou au contraire indisposer telle ou telle école philosophique : du point de vue poétique, c’est-à-dire ici du point de vue de la fabrique du roman, l’enchaînement causal est la condition de possibilité du récit, dont il conditionne a minima la cohérence. Lorsque cet enchaînement est attaqué, c’est le récit même qui se défait, se délite, perd l’adhésion de son lecteur.
On assiste donc à un double décollement, de l’événement par rapport à la chaîne des causes, et du récit par rapport à la vraisemblance. Ce dédoublement correspond aux deux catégories leibniziennes de la vérité de fait et de la vérité d’énonciation. Dans l’une comme dans l’autre le principe de la raison suffisante est mis en jeu : il n’est dénoncé qu’en surface. Fondamentalement, la raison suffisante est capable de rendre compte du disparate : le disparate signale dans la causalité un incalculable, et impose de poser, face au phénomène, un esprit omniscient qui le pense, ou autrement dit d’opérer le saut logique du calcul différentiel, ou encore d’établir par expérience de pensée un dispositif depuis lequel prendre en compte la globalité du monde, rendre compte du gobal.
Dans l’enchaînement (des faits, des énoncés) s’opère un décollement, non une rupture : la chaîne se déploie depuis la façade de l’événement, depuis la scène du monde, et se replie, se raccourcit, s’embrouille, fait nœud comme non-sens, comme tableau absurde, d’où point le réel. C’est là la dynamique de la fadaise : la fadaise, même si elle procède d’une façade des choses, ne se réduit pas à un discours de façade. Pangloss ne tient pas le discours de l’explication apparente des choses. C’est même tout le contraire : les apparences plaident toujours contre lui. En invoquant la raison suffisante, Pangloss recourt au fond, qui est l’interrogation sur les causes de l’événement. Mais le recours, précisément parce qu’il convoque le raccourci de la raison suffisante, non seulement ne convainc pas mais fait scandale.
Différence, disproportion et renversement : l’exemple du château de Thunder-ten-tronckh
Pourtant, et c’est là tout le paradoxe, le récit est du côté de Pangloss : la narration gère les événements selon le principe même de concaténation des disparates qui est le principe de la raison suffisante. Dans la première page de Candide, on peut lire par exemple :
« Monsieur le Baron était un des plus puissans Seigneurs de la Westphalie, car son Château avait une porte & des fenêtres. » (p. 3718)
La cause cloche : il n’y a aucun rapport évident entre la première proposition, qui affirme la puissance du Baron, et la seconde qui décrit son château de la façon la plus sommaire. Entre cette affirmation et cette description, un élément de réel ne nous est pas donné qui permettrait de faire la liaison. Au lieu de cela, ce qui se manifeste non sans brutalité, c’est la disproportion entre l’affirmation de puissance et la simple mention d’une porte et des fenêtres. Mais comment comprendre cette disproportion qui nous fait rire ? Il appartient au lecteur de réduire la disproportion en complétant l’explication, c’est-à-dire de suppléer un trou, un manque dans la chaîne causale qui lui est présentée.
Le château se réduisait apparemment à une simple maison avec une porte et des fenêtres, mais cette maison aussi simple manifestait un luxe inouï dans une province plongée dans la misère. En présentant cette causalité trouée comme une évidence, le narrateur manifeste la discordance entre un point de vue westphalien, pour qui naturellement une simple porte avec des fenêtres est une marque de richesse et donc de puissance, et le point de vue interloqué du lecteur français, qui imagine du coup, à rebours, en lieu et place du château, une demeure misérable. Voltaire fait peut-être allusion ici, au passage, à la Window Tax mise en place par les Anglais en 1696 et récemment alourdie en 1758 : elle faisait des portes et fenêtres le signe extérieur principal de richesse, et condamnait de fait les propriétaires les moins aisés à obstruer leurs fenêtres, plongeant des quartiers entiers de Londres dans l’insalubrité. La mention des fenêtres suggère du coup le petit nombre des fenêtres : le simple fait qu’elles soient mentionnées au pluriel est un tour de force de puissance !
Voltaire ne situe pas au hasard l’action en Westphalie : c’est le traité de Westphalie qui en 1648 avait mis fin à la plus sanglante et la plus longue des guerres civiles que l’Allemagne ait connue, la Guerre de Trente ans. Et c’est en Westphalie que fait rage la Guerre de Sept ans, au moment où Voltaire écrit : elle se conclura en 1762 par la destruction complète d’Arnsberg, capitale du duché de Westphalie.
Intérieur d’un palais avec figures conversant près des fontaines - J. de Lajoüe
Le château du baron de Thunder-ten-tronkh apparaît donc dans le récit par le biais d’une causalité tronquée. Voltaire fera, directement ou indirectement, d’autres références au château dans la suite du récit. Lorsque la Vieille raconte son histoire, elle déclare fièrement :
« On m’éleva jusqu’à quatorze ans dans un Palais auquel tous les Châteaux de vos Barons Allemands n’auraient pas servi d’écurie ; & une de mes robes valait mieux que toutes les magnificences de la Westphalie. » (chap. XI, p. 64)
La même disproportion est reconduite mais cette fois la chaîne causale est remplacée par le système des différences qui ordonne une observation globale du monde. Le récit de la Vieille fait entrer le château du chapitre I dans la série de « tous les Châteaux de vos Barons Allemands », puis cette série dans l’écurie du Palais italien de la fille du pape Urbain X. La comparaison oppose d’un côté la magnificence et le raffinement de l’architecture et de la culture italiennes ; de l’autre, la rusticité grossière des masures allemandes pompeusement nommées châteaux. Mais cette comparaison est en même temps une inclusion : de la même façon que les différences de l’Essai sur les mœurs portaient sur le commerce, le mariage et l’ensemble des rapports et des liaisons, de même la différence des châteaux implique une mise en série et la construction virtuelle, monstrueuse, d’un château gigogne qui renverse les rapports d’interlocution : « vos Barons Allemands » désigne les barons que respecte et révère Cunégonde, la maîtresse de la Vieille. Ces barons étrangers, inaccessibles, légitiment la supériorité de Cunégonde, sa position de maîtrise. Mais le récit de la Vieille fait entrer, par métonymie, vos Barons dans mon palais, dans l’écurie du palais où, petite et princesse, la Vieille a été élevée. Du point de vue de la Vieille, ce qui est à vous et est considéré comme grand et respectable par vous entre dans mes apanages, sous la forme la plus humiliante et la plus réduite.
La Vieille se venge. Par son récit, elle renverse les perspectives et les hiérarchies. Mais précisément parce que ce récit se présente comme un récit vengeur, le lecteur le lit comme tel, sans donc nécessairement adopter le point de vue de la Vieille. Ici encore un jeu, un flottement du sens, est laissé à l’appréciation du lecteur : non véritablement une liberté d’interprétation, mais bien plutôt une marge de flottement, un indécidable qui doit le rester. Le jeu des différences n’établit donc pas simplement une disproportion entre les réalités comparées ; il insinue, à partir de cette disproportion, un double point de vue : plus exactement, il discrédite l’un par l’autres les points de vue locaux, forçant à un saut herméneutique, au passage à la limite et au saut vers l’expérience de pensée de la globalisation.
La comparaison des châteaux ressurgit, sous une forme atténuée, au début de l’épisode de l’Eldorado, lorsque Candide et son valet Cacambo arrivent en vue d’un premier village. Ils surprennent des garnements, qu’ils prennent pour des princes, jouant au palet19 avec des disques d’or et de pierres précieuses. Leur maître les appelle, ils jettent les palets, Candide se précipite pour rapporter les cailloux, que le maître jette à nouveau à terre.
« Cacambo était aussi surpris que Candide. Ils aprochèrent enfin de la premiére maison du village ; elle était bâtie comme un palais d’Europe. » (chap. XVII, p. 87)
La simple auberge de l’entrée du village leur semble « un palais d’Europe » : le seul palais d’Europe dont il ait été question auparavant est le palais où la Vieille a raconté avoir été élevée. La comparaison renverse donc la précédente disproportion : le palais de la princesse de Palestrina, dans l’écurie duquel entrait le château de Thunder-ten-tronckh, devient l’équivalent d’une très modeste auberge d’un petit village des confins d’Eldorado. Mais là encore, la narration établit un double point de vue : à la surprise et à l’admiration de Candide et de Cacambo se superposent les excuses amusées de l’aubergiste : « Vous avez fait mauvaise chère ici parce que c’est un pauvre village ; mais partout ailleurs vous serez reçus comme vous méritez de l’être. » (p. 88) Dans la comparaison, le supérieur est toujours susceptible d’être renversé en inférieur à la faveur d’un nouveau comparant. Au reste, le lecteur doit-il entendre ces excuses comme des excuses sincères ? comme une marque extraordinaire de modestie ? ou comme l’expression presque moqueuse, à la limite de la condescendance, d’une supériorité de peuple riche face à deux migrants pauvres auxquels on peut s’offrir le luxe d’accorder l’hospitalité ? Le jugement sur la valeur du château demeure ainsi indécidable.
Au chapitre suivant, alors qu’ils sont toujours en Eldorado, Candide, après leur conversation avec le sage vieillard, évoque une nouvelle fois le château de Thunder-ten-tronkh :
« Ceci est bien différent de la Westphalie & du Château de Mr. le Baron : si nôtre ami Pangloss avait vû Eldorado, il n’aurait plus dit que le Château de Thunder-ten-trunkh était ce qu’il y avait de mieux sur la Terre ; il est certain qu’il faut voyager. » (chap. XVIII, p. 90)
À entendre Candide, la supériorité de l’Eldorado vient contredire le discours leibnizien de Pangloss sur le meilleur des mondes possibles. Chez Leibniz, le meilleur des mondes est, globalement, l’ensemble de notre monde ; dans la parodie leibnizienne que figure Pangloss, ce meilleur des mondes est devenu local, un simple et ridicule cocorico de clocher20. Du coup, il devient, dans l’espace, horizontalement, comparable à d’autres mondes, au lieu de demeurer, par raison suffisante, verticalement et ontologiquement incomparable.
Mais dans cette comparaison que rend possible la révolution phénoménologique des différences, le jugement peut toujours se retourner :
« Candide ne cessait de dire à Cacambo, Il est vrai mon ami, encor une fois, que le Château où je suis né ne vaut pas le pays où nous sommes ; mais enfin Mademoiselle Cunégonde n’y est pas, & vous avez sans doute quelque maîtresse en Europe. » (p. 92)
On comprend bien sûr ici la stratégie narrative de Voltaire, qui doit bien trouver une raison de faire sortir ses protagonistes de l’Eldorado pour que le récit avance. Et on peut même voir dans l’évocation de Cunégonde une référence parodique à la nostalgie d’Ulysse pour Pénélope alors qu’il coule des jours heureux chez Calypso. Mais cet ultime renversement, en restituant au château de Thunder-ten-tronckh sa valeur première qui n’avait pourtant cessé de se déprécier au fil du voyage, rend surtout sensible, dans le rapport de différence comme dans l’enchaînement causal, l’ouverture désorganisatrice d’un manque, d’une clocherie, d’une mise en défaut. Cunégonde manque comme, dans la raison de la supériorité d’une porte et des fenêtres, manquaient dès la première page de Candide les circonstances de cette supériorité.
Dans la différence, et donc dans la comparaison, quelque chose manque ; dans l’enchaînement, quelque chose de la causalité échappe ; et ce quelque chose a à voir avec le désir.
La chaîne et la somme : généalogie de la vérole
Lorsque Candide retrouve Pangloss défiguré par la vérole21 au chapitre IV, celui-ci lui explique tout le circuit qu’a emprunté la maladie pour se propager jusqu’à Paquette, la jolie suivante de la baronne, auprès de qui il l’a attrapée :
« Paquette tenait ce présent d’un Cordelier très savant, qui avait remonté à la source ; car il l’avait eue22 d’une vieille Comtesse, qui l’avait reçuë d’un capitaine de cavalerie, qui la devait à une Marquise, qui la tenait d’un Page, qui l’avait reçuë d’un Jésuite, qui étant novice l’avait eue en droite ligne d’un des compagnons de Christophe Colomb. Pour moi je ne la donnerai à personne, car je me meurs. » (chap. IV, p. 47)
Le comique de l’enchaînement des relatives tient à la disproportion : la succession des contagions est à la fois trop brève pour émouvoir et trop longue pour ne pas titiller l’exaspération du lecteur. Rien ne nous est épargné, et en même temps nous percevons à tout instant d’invraisemblables raccourcis. Du Cordelier, Pangloss nous dit qu’il « avait remonté à la source », nous faisant espérer une cause première imminente ; mais notre attente est aussitôt déçue, car nous ne sommes qu’au début de l’enchaînement. Du Jésuite novice, Pangloss remonte « en droite ligne » à ce qu’on espère enfin être le premier porteur, mais qu’on découvre être encore un satellite, « un des compagnons de Christophe Colomb », dont il ne nous est pas dit d’où il la tenait. Et comment une succession de deux siècles et demie a-t-elle pu se faire par seulement sept personnes, dont la différence d’âge pouvait difficilement être, à chaque fois, de plus de trente-cinq ans… ?!
Ce qui est sûr en revanche, c’est qu’on se perdait alors en conjectures sur l’origine de la maladie. Charles Musitan, dans son Traité de la maladie vénérienne, récapitule les différentes hypothèses avancées. Historiens et médecins, écrit-il, conviennent que la maladie apparaît en 1494, à l’occasion du siège de Naples par les armées de Charles VIII, roi de France23. La maladie apparaît dans le camp français, mais d’où vient-elle ? Girolamo Fracastoro s’interroge dans son poème latin Syphilis, sive Morbus Gallicus, publié en 1526, plusieurs fois réédité, traduit en italien puis en français en 175324 ; Musitan traduit les premiers vers :
« D’où sont venuës les semences de ce mal inconnu durant tant de siécles, & par quelles avantures s’est-il répandu dans nos jours avec tant de fureur par toute l’Europe, dans une partie de l’Asie, & même jusques dans les Villes de l’Afrique ? A l’égard de l’Italie, ce mal y a pénetré par le moyen des guerres que les François y ont portées : aussi a-t’il pris son nom de cette Nation25. »
La syphilis fascine comme maladie de la mondialisation. Mais le réseau qu’elle dessine en se propageant peut se lire à chaque fois dans les deux sens, brouillant et rendant indécidable la question de l’origine :
« Mais il est impossible de débroüiller si ç’ont été les François qui assiégèrent Naples, ou les Napolitains qui étoient assiégez, ou les Espagnols qui vinrent à leur secours, qui infectérent les premiers le Genre humain de cette contagion, ou s’ils la reçûrent d’ailleurs ; & cette incertitude les a tous portez à se reprocher ce malefice les uns aux autres, & à donner à la maladie le nom de chacune de ces Nations26. »
Musitan ajoute, à la fin de son chapitre, une série de remarques à la faveur desquelles apparaît l’hypothèse américaine. Il commence par la rejeter absolument :
« L’opinion de la transmission de la verole des Indes occidentales en Europe, par les Espagnols qui avoient suivi Christophle [sic] Colomb à la découverte du Nouveau Monde, a été reçûë de la plûpart des Auteurs, sur une tradition fort incertaine : les faits qu’ils rapportent pour l’appuyer, étant faux dans leurs circonstances les plus essentielles, & démentis par les Historiens les plus autorisez, comme on le verra dans la suite27. »
Musitan convoque d’abord Antoine d’Herrera28, selon qui Colomb à son retour n’a pas abordé à Naples mais au Portugal, n’était pas accompagné d’une nombreuse troupe, et est arrivé deux ans avant le siège de Naples par les Français. Musitan réfute d’ailleurs, en s’appuyant sur Mézeray29, qu’il y ait eu un siège de Naples : la ville se rendit presque aussitôt à Charles VIII. À partir de Mézeray, il synthétise ainsi les apories auxquelles cette question des origines de la syphilis est confrontée :
« On peut inférer trois choses de la rélation de cet Historien.
1°. Que cette opinion communément reçuë parmi les Medecins touchant l’origine de la verole n’est pas tout à fait certaine.
2°. Que la maladie épidémique qui regnoit aux Isles de l’Amerique dans le tems que l’on en fit la découverte, pouvoit être differente de la verole, telle que nous la voyons presentement, & qu’elle a été connuë depuis l’Expedition de Naples.
3°. Que l’on n’a peut-être pas plus de sujet d’avancer que les Espagnols ont apporté cette maladie du nouveau Monde en Europe, que de dire qu’ils l’ont portée d’Europe aux Indiens, s’il est vrai sur tout, qu’elle n’y ait été connuë qu’au tems qu’Herrera nous a marqué l’origine de cette maladie […], qui arriva selon lui en l’année 150330. »
Voltaire ne pouvait pas ne pas connaître, sinon le détail de ces débats, du moins leur existence : il lisait assidument Mézeray pour l’Essai sur les mœurs et les conjectures d’Herrera, de Frascator, de Musitan sur l’une des épidémies les plus terrifiantes de l’Europe moderne étaient largement répandues31. Il semble bien qu’il y avait consensus pour considérer qu’il était impossible de déterminer si les Espagnols avaient attrapé la syphilis des Indiens, ou s’ils la leur avaient apportée en Amérique, et en ce cas de savoir d’où elle venait en Europe. L’exemple de la syphilis était donc un exemple en or pour mettre à l’épreuve la doctrine de la raison suffisante : il fournissait un cas d’école de l’indécidabilité des causes.
Du coup, lorsque Pangloss, « le grand homme », décrit avec assurance l’origine de la maladie, il faut prendre garde que ce n’est nullement Voltaire qui parle en son nom, mais qu’il continue, comme dans l’ensemble du récit, à caricaturer le principe de raison suffisante :
« O Pangloss ! s’écria Candide, voilà une étrange généalogie ! n’est-ce pas le Diable qui en fut la souche ? Point du tout, repliqua ce grand homme ; c’était une chose indispensable dans le meilleur des mondes, un ingrédient nécessaire ; car si Colomb n’avait pas attrapé, dans une Isle de l’Amérique, cette maladie qui empoisonne la source de la génération, qui souvent même empêche la génération, & qui est évidemment l’opposé du grand but de la nature, nous n’aurions ni le chocolat ni la cochenille ; il faut encor observer que jusqu’aujourd’hui, dans nôtre Continent, cette maladie nous est particuliére, comme la controverse32. Les Turcs, les Indiens, les Persans, les Chinois, les Siamois, les Japonois, ne la connaissent pas encore ; mais il y a une raison suffisante pour qu’ils la connaissent à leur tour dans quelques siécles. » (p. 47-48)
Face à maître Pangloss, l’élève Candide, caricaturant les préjugés religieux du temps, s’étonne d’une « étrange généalogie » dont l’origine ne peut être que le Diable. Le point de vue du christianisme populaire, qui ne s’embarrasse guère d’une origine diabolique toute trouvée, nous rappelle que le point de vue opposé, rationnel, philosophique, scientifique, devrait être celui… de Voltaire ! Mais Voltaire s’attaque au principe d’enchaînement généalogique d’où qu’il vienne, et il en montre l’absurdité dans les deux points de vue qu’il oppose. Ce qu’il vise, c’est la verticalité transcendante de la causalité : désigner le Diable ou désigner Christophe Colomb comme l’origine, c’est produire deux explications des causes dont les raccourcis sont renvoyés dos à dos comme également ridicules.
Ce qui est ridicule, c’est le raccourci, dont Pangloss livre l’expression la plus truculente lorsqu’il explique que grâce à la syphilis, nous avons le chocolat et la cochenille33. Comme dans la présentation du château de Thunder-ten-tronckh au premier chapitre de Candide, la causalité est ici trouée : pour le château, on ne voyait pas le rapport direct entre la mention d’une porte et de fenêtres et la puissance du baron ; ici de la même manière, le lien de la vérole au chocolat doit être suppléé par le lecteur. Et il est du même ordre : ce qui manque, ce qui demeure informulé, ce sont les circonstances, l’histoire, l’économie, le réel.
L’idée avancée à demi mot par Pangloss, et sous une forme tellement raccourcie qu’elle devient ridicule, est que la vérole est un effet collatéral de la colonisation du nouveau monde, dont l’Europe a tiré les plus grands bénéfices commerciaux. Le chocolat et la cochenille sont deux exemples, deux objets emblématiques de la nouvelle économie du luxe qui a pu se développer à la faveur du commerce avec les Indes occidentales : nouveau goût et nouvelles saveurs d’une part, nouvelles techniques de teinture d’autre part, ont contribué à faire naître la nouvelle Europe industrielle. Significativement, Voltaire n’évoque pas l’importation de l’or américain qui, apportant à l’Espagne une richesse immédiate, a ruiné à long terme son économie, mais le chocolat et la cochenille des négociants hollandais, qui firent la fortune des Provinces-Unies.
Du coup, le raccourci dans la chaîne causale, censé rendre sensible l’efficacité verticale de la raison suffisante et de son principe métaphysique, produit parallèlement un tout autre effet : contrastant avec le premier paragraphe consacré aux enchaînements (« l’avait eue de », « l’avait reçue de », « la devait à », « la tenait de », l’avait reçue de »…), le paragraphe suivant prend pour objet global « le meilleur des mondes », c’est-à-dire, à partir d’une simple « île de l’Amérique », « notre continent » et, de là, « les Turcs, les Indiens, les Persans, les Chinois, les Siamois, les Japonais ». L’épidémie comme le commerce se disséminent selon un processus de globalisation similaire34. La dissémination est le principe horizontal d’articulation entre la différence et la globalisation. La vérole « empoisonne la source de la génération », et souvent même elle « empêche la génération », c’est-à-dire la ligne verticale de succession des générations : on voit bien ici comment les deux principes, vertical et horizontal, s’opposent et même se combattent.
IV. Vers un dispositif visuel
De la somme au dispositif
Candide tue le Juif amoureux de Cunégonde (Voltaire, Kehl t44, 1785)
Au chapitre VIII, lorsque Cunégonde raconte son histoire, son récit apparaît traversé par la même tension entre une extension verticale et horizontale, paradigmatique et syntagmatique :
« Agitée, éperduë, tantôt hors de moi-même, & tantôt prête de mourir de faiblesse, j’avais la tête remplie du massacre de mon père, de ma mère, de mon frère, de l’insolence de mon vilain soldat Bulgare, du coup de couteau qu’il me donna, de ma servitude, de mon métier de cuisiniére, de mon Capitaine Bulgare, de mon vilain Don Issachar, de mon abominable Inquisiteur, de la pendaison du Docteur Pangloss, de ce grand misereré en faux-bourdon pendant lequel on vous fessait, & surtout du baiser que je vous avais donné derrière un paravent, le jour que je vous avais vû pour la dernière fois. » (p. 59)
Après avoir repris « le fil de son histoire » (p. 57), Cunégonde est arrivée ici quasiment à sa fin, de sorte que cette longue phrase se présente essentiellement comme une récapitulation des événements : il y a un fil et il y a une somme, soit deux logiques contradictoires.
L’énumération des événements se fait par une succession de compléments d’agent, qui dépendent tous du participe passé « remplie ». Pour le sens, ces compléments retracent de façon synthétique l’enchaînement des événements, et se suivent donc dans le temps : Cunégonde a d’abord vu massacrer sa famille, puis a été violée, puis a reçu un coup de couteau, puis a été réduite en esclavage comme cuisinière, puis comme courtisane auprès d’Issachar, puis partagée entre le Juif et l’Inquisiteur ; enfin elle a vu l’autodafé. Mais cette succession pour le sens contredit l’articulation syntaxique de tous les compléments au seul participe « remplie » : syntaxiquement, tous les compléments constituent des paradigmes équivalents, et occupent la même fonction grammaticale, c’est-à-dire qu’ils ont le même statut logique du point de vue de la construction de la phrase.

Voltaire a recours ici à un procédé stylistique d’extension du paradigme en syntagme : il bloque l’avancement syntaxique de la phrase, mais il développe quand même la progression d’événement en événement par le jeu de variation et de déclinaison des paradigmes. La différence des paradigmes tient lieu d’enchaînement syntagmatique, le jeu des différences supplée le défaut d’enchaînement.
Or le participe choisi pour déclencher l’extension du paradigme en syntagme est plein de sens : « j’avais la tête remplie » implique que tous les événements qui suivent viendront s’accumuler dans la tête de Cunégonde, c’est-à-dire qu’une vision globale de la totalité des événements se constitue dans sa tête, que le jeu des différences se globalise en vision dont cette récapitulation met en place le dispositif.

Cunégonde conclut sa liste par un dernier événement qui ne suit pas tous les autres, mais au contraire les précède et en quelque sorte en constitue l’origine : c’est le baiser donné à Candide derrière le paravent et surpris par le baron, au chapitre I, c’est-à-dire l’élément déclencheur de l’ensemble du récit. « Et surtout du baiser » : le baiser fait la somme des événements qu’il a précédés. Il n’a pourtant pas causé ces événements : il n’est certainement pas, sub specie æternitatis, la raison suffisante de la guerre des Avares et des Bulgares, des massacres et des viols, de la servitude de Cunégonde. Mais pour Cunégonde, dans sa tête remplie, c’est ce baiser qui donne sens à tout le reste et constitue son histoire, sa vie. Le baiser opère la globalistaion visuelle de l’enchaînement discursif. On passe alors d’une causalité trouée à une vision globale, dont la raison tient à l’expérience de pensée du récit, à l’attention de Cunégonde, au regard qu’elle porte sur les événements, et qu’elle s’approprie ainsi.
La scène du baiser derrière le paravent devient le produit visuel de l’hyper-concaténation des événements disparates livrés par le récit. C’est un baiser derrière : Cunégonde se projette par le récit de l’autre côté du paravent, dans le regard du baron son père, qui l’a surprise derrière le paravent. Elle établit un dispositif d’écran : entre le regard du barron et la vue du baiser s’interpose l’écran du paravent : écran, dans la langue du dix-huitième, signifie d’ailleurs également paravent.
Au chapitre X, alors que Candide, Cunégonde et la Vieille, fuyant l’inquisition portugaise, se sont embarqués à Cadix pour Buenos-Aires, la conversation tombe sur la comparaison des malheurs de chacun. La Vieille suggère que ses infortunes ont été supérieures à celles de sa maîtresse, au grand scandale de celle-ci :
« Hélas ! lui dit-elle, ma bonne, à moins que vous n’ayez été violée par deux Bulgares, que vous n’ayez reçu deux coups de couteau dans le ventre, qu’on n’ait démoli deux de vos Châteaux, qu’on n’ait égorgé à vos yeux deux mères & deux pères, et que vous n’ayez vû deux de vos Amants fouettés dans un Auto-da-fè, je ne vois pas que vous puissiez l’emporter sur moi ; ajoutez que je suis née Baronne avec soixante & douze quartiers, & que j’ai été cuisiniére. Mademoiselle, répondit la vieille, vous ne savez pas quelle est ma naissance ; & si je vous montrais mon derrière, vous ne parleriez pas comme vous faites, & vous suspendriez votre jugement. » (p. 63)
En apparence, Cunégonde reprend le même procédé de récapitulation. Cette fois, ce sont des propositions subordonnées circonstancielles de concession, toutes rapportées à l’« à moins que » liminaire, qui jouent le rôle des compléments d’agent du chapitre VIII. L’effet de disparate des événements est accentué, car les événements ne sont plus énoncés dans l’ordre de leur succession chronologique : les parents égorgés, qui initiaient la chaîne au chapitre VIII, arrivent ici en 4e position. Mais surtout Cunégonde a tout multiplié par deux : ce n’est pas son histoire, mais la prolifération délirante d’une histoire doublée qu’il s’agit maintenant de comparer son histoire à celle de la Vieille. Autrement dit, le principe horizontal de différence et de dissémination s’est un peu plus généralisé.
Enfin, les propositions dépendent d’un « à moins que », qui les ordonne donc selon une soustraction, alors qu’au chapitre VIII les compléments dépendaient d’un « remplie de », qui mettait en place une addition. La généralisation de la différence est soustractive. Dans le dialogue qui s’engage entre Cunégonde et la Vieille, Cunégonde insiste sur la disproportion entre ses soixante-douze quartiers de noblesse et l’humiliation d’avoir servi comme cuisinière, à quoi la vieille répond par ce mot d’abord comiquement incompréhensible : « vous ne savez pas quelle est ma naissance ; & si je vous montrais mon derrière, vous ne parleriez pas comme vous faites, & vous suspendriez votre jugement ». « Vous ne savez pas quelle est ma naissance » fait pièce aux soixante-douze quartiers, et de fait nous apprendrons que la Vieille est fille d’un pape et d’une princesse italienne du plus haut lignage35. Quant au derrière de la Vieille, il fait allusion au siège par les Russes de la forteresse turque d’Azov36, au cours duquel les femmes prisonnières, parmi lesquelles la narratrice, se seraient vues couper chacune une fesse grâce à l’intervention d’un imam pieux, qui persuada aux janissaires ce compromis pour ne pas mourir de faim tout en épargnant les vies de leurs prisonnières. La Vieille rétorque donc à une disproportion (Cunégonde baronne et cuisinière) par une disproportion supérieure (née Princesse elle est mutilée d’une fesse). Le dialogue établit ainsi une différence, une disproportion entre deux disproportions.
Ces disproportions appellent elles-mêmes une comparaison terme à terme : Cunégonde est baronne, mais la Vieille est princesse ; Cunégonde est cuisinière, mais la Vieille s’est faite cuisiner une fesse. Voltaire le fait exprès : Cunégonde violée, maîtresse forcée d’un Juif et d’un Inquisiteur, a connu pire que d’être cuisinière ; Voltaire choisit de mentionner la cuisine pour son lien métonymique avec la fesse : sur le plan imaginaire, la comparaison est une inclusion, la disproportion une dévoration. Son derrière montré, dit la Vieille, couperait court au discours de supériorité de Cunégonde, il stopperait net sa jactance et suspendrait son jugement. Le derrière montré ferait silence et ferait tableau : mais le derrière ne peut être montré, non seulement pour des raisons de pudeur, mais parce que ce qui doit être montré manque, est spectaculaire précisément de ce qu’il fait défaut.
Le mot derrière, envoyé par la Vieille contre le récit de vie de Cunégonde qu’il déprécie rétrospectivement, fait également écho à ce qui concluait la récapitulation de ce récit au chapitre VII, le « baiser que je vous avais donné derrière un paravent » : dans les deux cas, le derrière fait écran, il donne à voir un tableau et le dérobe, il suggère une scène et l’interdit au regard. Au terme du processus de globalisation initié par le jeu des différences, le disparate des événements et leur concaténation dans le récit, leur dissémination et leur comparaison, un dispositif visuel s’affirme et se précise, qui s’appuie ici au chapitre X sur le face à face des deux femmes, chacune jaugeant l’autre.
« Si je vous montrais mon derrière, vous ne parleriez pas comme vous faites » : si je vous montrais lance un défi, prend au piège le regard de Cunégonde et, par lui, celui du lecteur. Si je vous montrais incite à vouloir regarder, déclenche un désir de voir, ouvre le piège du regard ; aussitôt après vient la deuxième détente du piège, vous ne parleriez pas comme vous faites, qui à la faveur de la sidération créée coupe la parole, impose silence, lève l’écran et installe la faillite du signifiant avec l’image de la fesse coupée.
Voltaire n’a pas complètement inventé cette histoire. Elle n’a rien à voir avec le siège de la forteresse d’Azov par les armées de Pierre le Grand : il l’a trouvée dans une lettre de saint Jérôme à Jovinien que cite Simon Pelloutier dans son Histoire des Celtes, une lecture que Voltaire fait sans doute pour nourrir son Essai sur les mœurs :
« St. Jérôme nous apprend à la verité, qu’ayant eu occasion dans sa jeunesse, de faire un voyage dans les Gaules, il y avoit vû des Ecossois qui mangeoient de la chair humaine. Ils trouvent, dit-il, dans les forêts des Troupeaux entiers de pourceaux & d’autre bêtail ; & cependant ils préferent de couper les fesses des bergers, & les mammelles des femmes. Ce sont là pour eux les plus délicieux de tous les mets37. »
Pelloutier exprime ses plus grands doutes sur l’authenticité des faits. Mais Voltaire se fait un plaisir de colporter l’anecdote, qu’on retrouve dans la continuation de l’article Anthropophage pour les Questions sur l’Encyclopédie (177038) et dans Un chrétien contre six Juifs (177639). L’histoire de la Vieille opère, par rapport au récit de saint Jérôme, condensation (la fesse de la Vieille pour « les fesses des bergers, & les mammelles des femmes ») et déplacement (des « fesses des bergers », reformulées par Voltaire en « fesses des jeunes garçons », vers une fesse de femme devenue sexuellement repoussante).
L’écran du dispositif visuel qui se met en place à la faveur du basculement opéré par le processus de différence et de globalisation pourrait bien recouvrir une scène primitive que dissimule le travestissement de l’anecdote de saint Jérôme : y a-t-il là le souvenir rendu méconnaissable d’un attentat homosexuel ? et son articulation à un fantasme de dévoration annale40 ? Faut-il articuler cette scène à l’épisode de la bâtonnade du chevalier de Rohan, où Voltaire s’est trouvé en quelque sorte fessé ? Quoi qu’il en soit, un dispositif se met en place, qui articule à une disposition dans l’espace (un face à face et l’interposition d’un écran), l’abjection scopique d’une rencontre (une vision horrifiante, un attentat) et le déploiement symbolique d’une nouvelle économie (une pensée de la globalisation, la gestion mondialisée d’un système d’échanges).
Le nègre de Surinam
La concaténation des événements dans un récit de vie tournant à une liste de contaminations (la vérole de Pangloss), ou de transactions (la Vieille vendue, puis Cacambo et Cunégonde vendus41), ou simplement de lieux (les auberges où la Vieille a travaillé, puis les villes où Candide a cherché Cunégonde42) prépare une double dévaluation du discours, à la fois comme discours métaphysique et comme narration fictionnelle : l’enchaînement tourne à la fadaise. Parallèlement le principe même de Leibniz, qui est à l’œuvre dans la raison suffisante fustigée en apparence en la personne de Pangloss, opère : l’itération infinie de l’enchaînement, le passage à la limite des additions de différences, opèrent le basculement vers la vision globalisée, c’est-à-dire à la fois vers une pensée de la globalisation et vers la mise en œuvre d’un dispositif visuel susceptible de l’accueillir. Ce dispositif prend la forme de la (mauvaise) rencontre.
La narration, dans Candide, est jalonnée de rencontres ou de retrouvailles : retrouvailles de Candide avec Pangloss défiguré par la vérole à la fin du chapitre III (p. 45-46), avec Cunégonde devenue courtisane au chapitre VII (p. 55-56), avec le frère de Cunégonde chez les Jésuites du Paraguay au chapitre XIV (p. 77), avec Paquette et frère Giroflée au chapitre XXIV (p. 116) ; avec Cacambo au chapitre XXVI (p. 125), avec Pangloss et le frère du Baron devenus galériens au chapitre XXVII (p. 130-131), avec Cunégonde défigurée et la Vieille au chapitre XXIX (p. 135). La scène de retrouvailles, chez Candide, produit l’effet visuel de la différence : elle affronte à chaque fois Candide à l’autre visage, rendu méconnaissable par les vicissitudes de l’événement ; elle cristallise dans le face à face le travail de la dissémination (l’autre s’est perdu dans le monde), de l’altération (l’aléa de l’événement l’a défiguré), le jeu et le poids d’un système de transactions mondialisé (cet aléa a été commandé ou rattrapé par une transaction, d’abord sexuelle, puis commerciale).
En dehors de ces scènes de reconnaissance, les scènes de rencontre sont assez rares dans Candide : l’anabaptiste Jacques (III, 45), la Vieille (VI, 54), Cacambo (XIV, 74), Martin (XIX, 98), sont introduits dans le récit sans scène de rencontre. Quant aux scènes épisodiques, comme celle des femmes poursuivies par les singes (XVI, 80), celle du bateau de Vanderdendur coulé par un pirate (XX, 100) ou celle de l’amiral fusillé à Portsmouth (XXIII, 114), ce sont des scènes vues, des tableaux sans rencontre, sans interaction directe avec les protagonistes du récit. Enfin des personnages épisodiques comme le vieillard d’Eldorado (XVIII, 89), l’abbé Périgourdin (XXII, 105) ou le seigneur Pococuranté (XXV, 119-120) sont introduits pour tenir tel ou tel discours, ou donner à voir tel ou tel endroit, sans que leur rencontre en soi soit théâtralisée.

La rencontre avec le nègre de Surinam occupe donc une place toute particulière dans l’économie générale du récit. Elle n’est pas traitée comme une rencontre épisodique, mais adopte le modèle des scènes de reconnaissance. Elle fait d’abord tableau comme horreur de la défiguration avant d’être ramenée, par l’échange dialogique, à la familiarité de la communauté. Cacambo et Candide sortent tout juste d’Eldorado et font route vers la côte, pour se rembarquer en Europe. Ils approchent d’une ville que Cacambo « soupçonne être Surinam, appartenant aux Hollandais ». Surinam est en fait le nom de la colonie hollandaise, alors administrée par la Compagnie des Indes occidentales basée à Amsterdam : c’est au Surinam que cette compagnie réalise alors l’essentiel de son chiffre d’affaire. Le pays est nommé par erreur Surina dans le Dictionnaire de Trévoux. Il y a un article Surinam ou Suriname dans l’Encyclopédie (XV, 689b, 1765), qui nous explique que c’est une rivière qui a donné son nom au pays. La ville principale du Surinam est Paramaribo, un comptoir fondé en 1650, dont le nom est inconnu aussi bien de Trévoux que de l’Encyclopédie. Il n’y a donc jamais eu à proprement parler de ville de Surinam et le Surinam de Voltaire constitue une approximation historique. Pour le lecteur du XVIIIe siècle, le nom n’évoque qu’un vague rapport avec le commerce dans les Amériques.

Or Voltaire n’administre jamais les lieux au hasard. Lors de la fuite de Candide de Lisbonne vers Cadix, il a établi avec précision, sur la carte qu’il avait en sa possession, les villes par lesquelles passent les fugitifs43. Il n’y a pas de raison pour qu’il ait procédé autrement ici. Plusieurs cartes avaient été établies au début du XVIIe siècle situant Eldorado sur le plateau des Guyanes au nord du Brésil, au bord d’un légendaire lac Parimé44. A partir de ces cartes, il était logique de faire rentrer Candide en Europe via l’une des colonies guyanaises du littoral. Or, si Cacambo déclare à la fin du chapitre XVIII « Marchons vers la Cayenne », c’est-à-dire vers l’est, c’est à Surinam au nord que Voltaire fait arriver finalement ses voyageurs. Voltaire nous annonce donc la Guyane française avant de conduire ses personnages en Guyane hollandaise, qui fait sans doute écran à la satire virulente des effets de l’esclavage à laquelle il se livre ici, effets qui concernent aussi bien les territoires, les personnes et les intérêts économiques français :
« En aprochant de la Ville, ils rencontrèrent un Négre étendu par terre, n’ayant plus que la moitié de son habit, c’est-à-dire d’un caleçon de toile bleüe ; il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite. Eh mon Dieu ! lui dit Candide en Hollandais, que fais-tu là, mon ami, dans l’état horrible où je te vois ? J’attends mon maître Monsieur Vanderdendur45 le fameux négociant, répondit le Négre. Est-ce M. Vanderdendur, dit Candide, qui t’a traité ainsi ? Oui, Monsieur, dit le Négre, c’est l’usage. On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement deux fois l’année. Quand nous travaillons aux sucreries, & que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main : quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe : je me suis trouvé dans les deux cas. C’est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. » (chap. XIX, p. 94-95)

Candide s’adresse au nègre « en Hollandais » (quand et où a-t-il appris cette langue ?), le propriétaire du nègre est un Hollandais, M. Vanderdendur : Voltaire insiste lourdement sur le fait que nous sommes en territoire hollandais. Il peut critiquer, cela n’a rien à voir avec la France ! Mais Cayenne, a-t-il pris soin de nous rappeler, est à quelques encâblures, et Cayenne c’est la France. Quant à la Hollande, Voltaire a évoqué ce pays au chapitre III : c’est en Hollande que Candide a trouvé refuge après la boucherie héroïque ; il avait en effet entendu dire « que tout le monde était riche dans ce pays-là, et qu’on y était chrétien » (p. 44). Surinam présentera donc l’envers du décor hollandais, sur quoi s’appuie cette richesse et cette bonne conscience chrétienne.
Le nègre que rencontrent Candide et Cacambo est défiguré, comme était défiguré Pangloss au chapitre III, et comme le sera Cunégonde au chapitre XXIX. Le corps du nègre a été mutilé, comme la Vieille révèle qu’elle a été mutilée au chapitre XII, comme le frère de Cunégonde est éventré au chapitre XV. Ces comparaisons ne minimisent nullement les souffrances que le nègre a endurées : au contraire elles intègrent ces souffrances dans la communauté humaine de Candide, qui est une communauté de différences et de mutilations. Par ses mutilations, dans l’univers paradoxal de Candide, le nègre fait partie de la famille.
Ce n’est d’ailleurs pas le corps mutilé, mais le vêtement coupé en deux qui frappe d’abord Candide et Cacambo. La rencontre se fait à la façade, et l’effet visuel premier est celui de l’habit. Une moitié d’habit manque, la surface de toile bleue est incomplète. Voltaire avait une très mauvaise vue46, il nous décrit ici le surgissement de l’image pour le myope. Il place aussi le manque à l’origine : du défaut d’étoffe on passe à la jambe et à la main qui manquent, de ce manque à la loi qui l’organise, de cette loi, à l’établissement de la disproportion qui opère le saut de la globalisation par la formule « c’est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe ».
L’amorce visuelle qui définit cette séquence comme scène n’empêche pas le texte de suivre le même processus d’enchaînement troué et de passage à la limite qui caractérise l’écriture et la pensée voltairienne de la différence et de la globalisation. Mais le trou n’est plus logique : il est récupéré par le dispositif scénique, il devient ce qui se manifeste immédiatement, visuellement, dans la rencontre.
La puissance de cette scène tient à la tranquillité avec laquelle, sur le ton de l’évidence et sans aucune manifestation de révolte, le nègre de Surinam explique à Candide la raison de ses deux mutilations. Cette raison est une nouvelle fois une raison suffisante, et en tant que telle parfaitement rationnelle : une rationalité peut être radicalement immorale ; si l’on coupait effectivement la main des noirs dont un doigt avait été attrapé par la meule qui broyait la canne à sucre, c’était pour éviter la gangrène ; et si l’on coupait la jambe des fuyards récidivistes (très nombreux à la lisière d’une forêt équatoriale impossible à surveiller47), c’était effectivement un moyen rationnel efficace d’empêcher une nouvelle fuite.
Il ne s’agit donc pas de la manière dont M. Vanderdendur « a traité » son esclave, comme le suggère Candide. Cette affaire n’est pas personnelle, n’est pas laissée à la libre appréciation morale d’un traitement. Ce dont il s’agit, c’est de la logique de la traite, dont le Code noir48 est la conséquence nécessaire, et l’application inévitable. Candide s’adressait au nègre en tant que personne : « t’a traité » ; mais celui-ci lui répond en tant que peuple, ou que population soumise à un certain régime de traitement : « on nous donne », « nous tavaillons », « nous attrape », « on nous coupe »…
Le mot de Candide, « Est-ce M. Vanderdendur qui t’a traité ainsi ? » fait syllepse, il porte en lui, derrière le traitement, la traite, derrière le problème moral de la mise en œuvre, la logique économique du système colonial qui a initié la globalisation politique. Le nègre répond « oui » à Candide, mais sur un malentendu : il ne reproche pas à M. Vanderdendur de l’avoir maltraité ; il explique à Candide que son maître l’a traité selon les règles instituées dans le cadre de la traite des nègres. « C’est l’usage49 » reprend « traité », mais en change le sens. Vient enfin, au terme de l’explication, la formule « c’est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe », où cette fois c’est le mot prix qui fait syllepse. Dans le discours du nègre, « c’est à ce prix » signifie que c’est grâce à cet usage, grâce à ces règles qui encadrent le traitement des esclaves, que la production du sucre de canne peut se faire en Amérique et nous parvenir en Europe. Mais le mot prix pointe dans le même temps le principe économique de la raison développée par le nègre : ce n’est pas une affaire de traitement, c’est une affaire de prix. ; l’esclavage permet de baisser les prix.
La scène nous a ainsi fait passer de la façade, le vêtement bleu du nègre, au fond, le prix du sucre, en suivant le développement de la fadaise, qui explique rationnellement (selon une rationalité ignoble, faut-il le rappeler) pourquoi le nègre a été mutilé. La première mutilation constitue un dégât collatéral de l’activité économique ; la seconde prévient une éventuelle nouvelle fuite et relève donc d’une mesure de police. Il n’est question ni dans l’une ni dans l’autre de faute ni de punition ; elles sont renvoyées l’une et l’autre dos à dos : du point de vue du corps, ce sont, au même titre, deux mutilations.
La condamnation du traitement des esclaves tient donc tout entière dans le regard que Candide et Cacambo portent sur le nègre et sur ce qu’il dit. Il n’y a pas de mots pour elle ; elle est prise en charge par le seul dispositif scénique, par le face à face de la (mauvaise) rencontre. Le mot du nègre de Surinam, son trait, « c’est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe », ne pointe pas seulement le ressort fondamentalement économique de l’abomination ; il la ramène à quelque chose qu’on mange. Symboliquement et par concaténation, quand nous mangeons le sucre, nous mangeons le corps du nègre : au sucre croqué correspond le corps mutilé. Dans la circulation du discours, le manque reporté d’étape en étape fait ainsi de nous des anthropophages et relie cette scène à celle de la fesse coupée de la Vieille, où une même scène primitive d’abomination est à l’œuvre.
Cette correspondance est très importante, car elle identifie Voltaire lui-même au nègre mutilé. Nous avons vu à quels propos racistes, au nom même d’une idéologie de la différence généralisée, Voltaire pouvait être conduit. La tolérance voltairienne, l’engagement pour la justice, ne peuvent chez lui se faire qu’à partir de l’expérience d’une différence radicale. La double syllepse, qui porte sur traité puis sur prix, symptomatise la faille dans l’interlocution : l’Européen blanc de Westphalie, disciple de Leibniz via Pangloss, ne peut pas comprendre ce que le nègre de Surinam a à lui dire, qui plus est en hollandais ; ils ne se comprennent, ne s’accordent qu’à la faveur de cette double syllepse, c’est-à-dire d’un double malentendu. La syllepse précipite le trait ironique et, dans l’ironie, fait jouer une latitude du sens qui permet à Voltaire de ne pas se prononcer complètement. Le discours du nègre de Surinam se poursuit en effet ainsi :
« Cependant, lorsque ma mère me vendit dix écus patagons sur la côte de Guinée, elle me disait, Mon cher enfant, bénis nos Fétiches, adore-les toujours, ils te feront vivre heureux ; tu as l’honneur d’être esclave de nos Seigneurs les Blancs, & tu fais par là la fortune de ton père & de ta mère. Hélas, je ne sçai pas si j’ai fait leur fortune, mais ils n’ont pas fait la mienne. Les chiens, les singes, & les perroquets sont mille fois moins malheureux que nous : les Fétiches Hollandais qui m’ont converti me disent tous les Dimanches que nous sommes tous enfans d’Adam, blancs & noirs. Je ne suis pas Généalogiste, mais si ces Prêcheurs disent vrai, nous sommes tous cousins issus de germain. Or vous m’avoüerez qu’on ne peut pas en user avec ses parents d’une maniére plus horrible. » (p. 95)
Alors que dans sa première phase le discours du nègre de Surinam rendait raison selon la logique du Code noir et de l’économie coloniale, autrement dit en empruntant les mots et les manières des planteurs blancs, dans cette seconde phase, la parole se subjective et s’africanise : un « je » remplace le « nous », on voit apparaître des fétiches et le bestiaire exotique des singes et des perroquets. La mutilation avait fait du nègre de Surinam un semblable de Candide ; ce deuxième temps de son discours le ramène à une différence irréductible.
Sur le fond, l’accusation se déplace. Les usages étaient d’abord mis en cause, ne serait-ce qu’indirectement par le silence indigné de Candide ; c’est maintenant la naïveté ou l’inconséquence de la mère qui est pointée : comment a-t-elle pu pour dix patagons50 vendre son fils ? Au fond, la mère est la coupable. Si les dix écus patagons qu’il mentionne sont bien les thalers à croix bourguignons en argent frappés en 1616 par les archiducs Albert et Isabelle, surnommés patagons et d’une valeur équivalente à un écu français, la mère a obtenu une jolie somme : commercialement, elle a fait, elle a cru faire une bonne affaire ; il n’y a rien à dire sur cette honnête transaction (on se place ici, bien sûr, du point de vue ignoble du négrier, dans la logique de la traite). Si en revanche on comprend ce terme de patagons dans l’acception dérivée qu’il a fini par avoir, comme de la monnaie « [bis]cornue et mal fabriquée », sans valeur donc, l’acheteur a en plus grugé la mère, il ne lui a versé qu’une somme dérisoire.
Les commentateurs interprètent généralement le texte dans ce second sens, qui en quelque sorte dédouane la mère et conduit à interpréter l’épisode comme une condamnation générale de l’esclavage par Voltaire. Le premier sens est pourtant le plus plausible : les monnaies dites patacòn ou pataca, monnaies de peu de valeur distinctes de l’écu patagon de 1616, apparaissent en Amérique et en Extrême-Orient au XIXe voire au XXe siècle, bien après Voltaire. À l’époque de Voltaire, un écu patagon est une pièce d’argent utilisée pour les transactions commerciales internationales : sa valeur a plutôt tendance à s’apprécier car ce métal devient rare. Un écu vaut au XVIIIe siècle environ six livres ; d’après un passage de l’Essai sur les mœurs que Voltaire écrit sans doute juste après Candide, un « beau nègre » se négociait à cinquante livres51 : le nègre de Surinam a été vendu au-dessus du prix du marché.
Autrement dit, le nègre de Surinam est parfaitement conscient que sa mère en le vendant s’assurait un bon pécule. C’est ce qui explique son exclamation pleine d’amertume : « Hélas, je ne sçai pas si j’ai fait leur fortune, mais ils n’ont pas fait la mienne. » Voltaire ici suggère que les Africains sont responsables de leur esclavage, car rien ne les oblige à vendre leurs enfants. Il vient juste de publier, dans l’Essai sur les mœurs, la remarque suivante qui va dans le même sens :
« On ne trouve, au contraire, dans toute l’Asie, d’autres esclaves que ceux qu’on achette, ou qu’on a pris à la guerre : on n’en achette point dans l’Europe Chrétienne ; les prisonniers de guerre n’y sont point réduits en servitude52. Il n’y a chez les Asiatiques qu’une servitude domestique, & chez les Chrêtiens qu’une servitude civile. Le paysan Polonois est serf dans la terre, & non esclave dans la maison de son Seigneur. Nous n’achetons des esclaves domestiques que chez les Négres. On nous reproche ce commerce : un peuple qui trafique de ses enfans est encor plus condamnable que l’acheteur ; ce négoce démontre nôtre supériorité ; celui qui se donne un maître était né pour en avoir. » (Essay sur l’histoire générale…, Genève, Cramer, 1757, tome 7, chap. CCXI, « Résumé de cette histoire », p. 26 ; Essai sur les mœurs, éd. Pomeau, op. cit., t. 2, chap. CXCVII, p. 805)
Essayons de suspendre notre indignation pour comprendre le mouvement de la pensée de Voltaire. C’est d’abord un mouvement de globalisation : à partir de la différence des pratiques de l’esclavage sur le globe, il s’agit de penser globalement l’esclavage, qui se décompose en différents modes, différentes pratiques, que Voltaire commence par ne pas hiérarchiser. La juxtaposition des usages fait apparaître les incohérences, les absurdités, ce que j’ai appelé le trouage des enchaînements : pourquoi n’achetons-nous des esclaves domestiques que chez les nègres ?
À ce point du discours surgit le reproche : « On nous reproche ce commerce », non pas cette pratique mais ce commerce, non pas le principe de l’esclavage mais la transaction économique. Et là Voltaire, pris dans le « nous » qu’il a installé, se défend et rejette la faute sur les victimes. Immédiatement, sortant de l’indifférenciation du « on » et du « il y a », qui décrit un tableau des varia, ce « nous » rétablit une hiérarchie, et la plus ignoble qui soit : la longue note embarrassée des éditeurs de Kehl en 1785 tente en vain de travestir ici le sens, qui est bel et bien de dédouaner les marchands d’esclaves. La formule outrancière de la fin, le mot, le trait qui synthétise ici la pensée, « celui qui se donne un maître était né pour en avoir », par son outrance même, marque le malaise de Voltaire.
Il y a là bien plus qu’un mouvement d’humeur. La transaction commerciale constitue le point d’aboutissement de la pensée horizontale des différences, qui à partir de la déclinaison des variétés, des disparités, des disproportions, établit la mesure des différences et instaure les liaisons entre les peuples, les passages entre les mondes, les égalités entre les marchandises et l’universalité des transactions. Au cœur de cette circulation généralisée surgit brutalement le commerce des esclaves, non comme une particularité marginale, comme un territoire spécial qui mériterait un régime d’exception, mais comme le cœur même de l’économie coloniale, qui est, à l’époque de Voltaire, la nouvelle économie de la mondialisation. La transaction établit non une égalité, fixée par le prix, mais une supériorité radicale, qu’instaure le rapport du maître à l’esclave, et que tente de masquer une prétendue supériorité morale du peuple qui ne trafique pas de ses enfants sur celui qui en trafique. Il y a cette ignominie dans le texte, que Voltaire écrit dès 1757, et qu’il reconduit d’édition en édition jusqu’à l’édition posthume de Kehl.
Mais la condamner comme ignominie ne change rien à la contradiction fondamentale qui se révèle ici dans la pensée de la globalisation dont Voltaire est un des pionniers : l’horizontalité des rapports de différence qu’elle dissémine se heurte à la verticalité de son principe originaire, même lorsque ce principe se déplace de la raison suffisante leibnizienne vers la traite comme ressort général de l’économie coloniale mondialisée. Il faut lire l’épisode du nègre de Surinam comme une tentative pour résoudre cette contradiction. Repartant de la transaction commerciale, le discours du nègre de Surinam, dans son dernier développement, rétablit une équivalence des mœurs malgré le rapport de domination qu’introduit l’esclavage : aux fétiches de Guinée correspondent les fétiches Hollandais, qui ramènent le christianisme à une idolâtrie comme une autre, tandis que le discours des fétiches, la fadaise chrétienne, rappelle que « nous sommes tous enfans d’Adam ».
Ce propos rapporté par le nègre de Surinam n’exprime nullement la pensée profonde de Voltaire, et ne réintroduit en aucun cas, à la fin de la séquence, un credo humaniste voltairien. Il faut le mettre en relation avec le développement sur le reticulum mucosum dans l’article Ignorance des Questions sur l’Encyclopédie : « Après cela, tirez-vous d’affaire comme vous pourrez avec Adam et Eve. » Voltaire, dans la bouche du nègre de Surinam, stylise parodiquement le discours hypocrite de l’Église53, qui proclame le message évangélique d’égalité tout en cautionnant l’esclavage ; il ne le fait pas pour mettre en accusation l’esclavage, mais pour mettre en accusation le message évangélique d’égalité.
C’est dans la dernière phrase, au moment où le nègre de Surinam prend ses interlocuteurs à témoin, que Voltaire parle en son nom : « Or vous m’avoüerez qu’on ne peut pas en user avec ses parents d’une maniére plus horrible. » Il faut bien comprendre ce qui est dit ici : « avec ses parents » signifie avec nous les nègres, qui avons été convertis au christianisme au motif que dans cette religion nous sommes tous parents. « Ses » renvoie à « on », qui est l’agent invisible, impersonnel, de la traite et en même temps le sujet du discours chrétien. Ce qui est condamné ici n’est pas directement la « manière horrible » (l’esclavage), mais la contradiction entre la comédie évangélique et la réalité des plantations, entre la façade et le fond.
Le nègre de Surinam n’accuse jamais non plus directement ses interlocuteurs (qui sont d’ailleurs un Allemand et un trois-quarts d’Amérindien, totalement étrangers à la traite) : « on » n’est ni le « vous » de l’interlocution, ni le « nous » de l’Essai sur les mœurs (« On nous reproche ce commerce »), ni même spécifiquement le maître du nègre de Surinam, M. Vanderdendur. Il désigne une collusion vague, des prédicateurs et des planteurs, avec qui il est plus facile, pour Voltaire, de se désolidariser.
Conclusion
Pour conclure, nous ne trouvons pas, dans l’épisode du nègre de Surinam, une condamnation radicale de l’esclavage, que Voltaire n’était pas prêt à prononcer, comme le montre la confrontation de cette scène de roman avec les textes de l’Essai sur les mœurs, des Questions sur l’Encyclopédie et d’Un chrétien contre six Juifs, qui portent sur la même question. Il faut mettre cet embarras en relation avec celui de l’Encyclopédie, dont le long article Esclavage par le chevalier de Jaucourt (1755) porte une condamnation ferme, réitérée et sans appel, tandis que l’article Nègres de Le Romain (1765) justifie et même idéalise l’esclavage aux Antilles.
Cela pour autant minimise-t-il la puissance d’indignation et la portée politique de ce qui est dénoncé ici par Voltaire ? Nullement à notre sens : si la traite n’est pas dénoncée, le traitement infligé aux esclaves, exposé ici dans toute son horreur et son indignité, scandalise le patriarche de Ferney. Ce scandale n’est pas seulement moral, il est politique : il met en contradiction, radicalement, le discours d’égalité du prosélytisme chrétien, qui cautionne et accompagne l’expansion coloniale, avec l’inégalité radicale des conditions qu’institue une société esclavagiste.
Voltaire va jusqu’à cette mise en contradiction, mais ne va pas jusqu’à la remise en question de l’inégalité, car sa pensée est une pensée des différences. C’est sa force et c’est sa faiblesse. Par la mise en œuvre généralisée (poétique et politique) d’une logique des différences, il passe à la globalisation, il pense la globalisation : l’esthétique de l’énumération, de la somme, l’extension du paradigme en syntagme, le basculement de la fadaise au dispositif visuel de la rencontre sont les moyens poétiques de ce passage ; l’articulation des mondes, le jeu des transactions, le principe économique de ce jeu, ce que nous appellerions aujourd’hui son libéralisme, s’ordonnent en pensée et en système politique.
Pour autant, Voltaire n’est pas l’apôtre de ce système, de cette nouvelle économie dont toute son œuvre dessine la logique et les contours. Il en perçoit et en dénonce sans cesse la butée : butée contre le principe de raison suffisante, qui en justifiant les différences rétablit la verticalité ontologique du Dieu providentiel chrétien ; butée contre l’esclavage qui, en s’appuyant sur une différence essentielle des races et sur un libéralisme radical des transactions, légitime la plus scandaleuse et la plus inhumaine des institutions.
Il y a bien d’autres points de butée dans la dissémination des différences qu’ordonne la nouvelle économie globale. Nous avons évoqué la vérole du chapitre IV (« nous n’aurions ni le chocolat ni la cochenille ») ; il faudrait évoquer également le discours de Voltaire sur les Juifs54. A chaque fois, la mise en contradiction de la logique globale des différences donne l’impression d’un disparate de la pensée voltairienne, d’une faiblesse.
Mais s’agit-il bien d’une faiblesse ? Et n’est-ce pas précisément la force des Lumières, dont Voltaire est en la matière le digne représentant, que de ne jamais se déployer en système sans, de ce système, proposer immédiatement la critique, que de ne jamais produire un discours sans, de ce discours, saisir et dénoncer la fadaise ?
Notes
Voltaire choisit Java et Pegou cimme « des pays dont on a peu de connaissance » et qui peuvent à peine « entrer dans le plan de cette histoire générale » (Essai sur les mœurs, éd. R. Pomeau, op. cit., t. 2, chap. CXCVI, « Du Japon au XVIIe siècle », p. 798).
Le reticulum mucosum est également mentionné dans The Anatomy of the Human Body de William Cheselden, l. III, chap. 1, « Of the external parts, and common integuments », Londres, 1763, p. 134
Ce n’est point sans raison que j’emploie le cheval et l’âne pour termes de comparaison entre les blancs et les nègres. La ressemblance d’affinité, et la négation d’identité paraissent si frappantes des deux côtés, qu’on est invinciblement entraîné à en tirer ce résultat : l’homme blanc est au nègre, ce que le cheval est à l’âne. Mais la négresse avec le blanc produit des individus féconds, caractère d’identité : le cheval et l’ânesse ne produisent, au moins communément, que des individus inféconds, caractère de disparité. J’ai déjà proposé quelques réflexions contre cet argument ; j’ajoute ici que quand même on accorderait à cette faculté d’engendrer des sujets féconds, toute la force possible d’induction en faveur de l’identité, que je ne lui trouve pas, cette induction serait suffisamment balancée par un autre caractère aussi puissamment exclusif d’identité, savoir, ce reticulum mucosum qui fait la peau noire du nègre, essentiellement noire. Ce signe de disparité me semble aussi décisif contre l’identité de nature entre le blanc et le nègre, que le signe d’infécondité, au second degré, paraît décisif aux naturalistes pour en inférer la non-identité entre le cheval et l’âne. Je vois même que le signe d’exclusion d’identité entre le blanc et le nègre, je veux dire ce réseau noir qui rend noire la peau du nègre, est constant, invariable ; au lieu que le signe de disparité entre le cheval et l’âne n’est point constant. Le reticulum mucosum est toujours noir dans les nègres, il sera toujours noir ; il n’est point un accident, il est une essence physique. Dans le cheval et l’âne au contraire, le signe de disparité a varié, il s’est démenti ; des mules ont engendré. Le fait et le raisonnement me paraissent être de quelque poids.
De ces considérations intellectuelles, je passe à des considérations plus simples, et qui tombent en partie sous les sens ; elles ne sont pas à négliger. Qu’y a-t-il de plus opposé que le blanc et le noir, le jour et la nuit ? Cet argument est à la portée de tout ce qui a des yeux ; à la portée des bêtes même, qui cèdent à son évidence en se jetant sur les noirs comme sur une proie qui leur est destinée, tandis qu’elles ménagent les blancs. L’argument tiré de l’infécondité n’est qu’entre les mains des savans, qui se trompent quelquefois. Lequel vaut le mieux ? Le premier est l’argument de la nature ; le second est de l’invention des hommes. » (F. Valentin de Cullion, Examen de l’esclavage en général, et particulièrement de l’esclavage des nègres dans les colonies françaises de l’Amérique, Paris, Desenne, 1802, t. 2, p. 201-202)
Monsieur l’abbé, c’est le contraire qui est constant. Vous ignorez que les nègres ont le reticulum mucosum noir, quoique je l’aie dit vingt fois. Sachez que vous auriez beau faire des enfants en Guinée, vous ne feriez jamais que des Welches [= des Français] qui n’auraient ni cette belle peau noire huileuse, ni ces lèvres noires et lippues, ni ces yeux ronds, ni cette laine frisée sur la tête, qui font la différence spécifique des nègres. Sachez que votre famille welche, établie en Amérique, aura toujours de la barbe, tandis qu’aucun Américain n’en aura. Après cela, tirez-vous d’affaire comme vous pourrez avec Adam et Eve. » (Voltaire, Questions sur l’Encyclopédie, article Ignorance)
Le plus troublant dans cette enquête sur l’implication éventuelle de Voltaire dans la traite des nègres, c’est la carte qu’elle dessine : Buenos Aires, Surinam, la Guinée se retrouvent dans Candide. Voltaire est parfaitement conscient des lieux névralgiques de la nouvelle économie coloniale mondialisée.
On sait soigner la syphilis depuis les années 1940 seulement, grâce aux antibiotiques.
Dans la langue classique, le terme vérole est ambigu : la grosse vérole est la syphilis, mais la petite vérole est la varicelle.
Voltaire avait commencé à écrire sur Pierre le Grand quelques années après son Histoire de Charles XII (1731). En 1748, il publie les Anecdotes sur le czar Pierre le Grand ; en 1757 il reçoit commande du comte Schouvaloff ; en 1759, la même année que Candide, paraît à Genève chez Cramer la première partie de l’Histoire de Russie sous Pierre le Grand (le 2e vol. est publiée en 1763).
Le Code noir français a eu une importance décisive dans l’institutionnalisation d’un esclavage colonial mondialisé, avec notamment la publication de codes noirs hispaniques à Saint Domingue et en Louisiane dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Il y a un bref article Code noir, anonyme, dans l’Encyclopédie (III, 581-582, 1753), qui insiste surtout sur la dimension religieuse : expulsion des Juifs des colonies françaises (article 1), interdiction du protestantisme, obligation faite aux esclaves d’être catholiques. Le Code noir est mentionné dans plusieurs autres articles : Esclave, Manioc, Manumission, Maron, Nègres, Patron, Sucrerie. L’article Nègres (XI, 83, 1765) contient une présentation détaillée de l’édit par Jean-Baptiste-Pierre Le Romain, ingénieur en Martinique. Il ne porte aucune condamnation, insistant au contraire sur la chance pour eux de venir travailler en Amérique sous un climat qui leur est plus favorable, et sur l’humanité avec laquelle ils sont traités… !
Il n’y avait pas de Code noir dans le Surinam hollandais. En l’absence de Code, le propriétaire de l’esclave avait tout pouvoir, et la condition des esclaves était plus dure encore. Voir l’article très documenté de François J.-L. Souty, « Agriculture et système agricole au Suriname de la fin du XVIIe à la fin du XVIIIe siècle », Revue française d’histoire d’outre-mer, 1982, n°256, p. 193-224.
Il semble que le patagon soit originellement le surnom donné au thaler à croix bourguignon, une monnaie en argent mise en service dans les Flandres méridionales en 1616, sous le règne des archiducs Albert et Isabelle, et frappée à leur effigie. Cette monnaie avait une valeur internationalement reconnue et appréciée ; elle était encore en circulation au XVIIIe siècle, et en usage en Europe de l’est, jusqu’en Russie qui en fit même un temps une monnaie officielle, le jefi mok.
Ce sont les soldats des armées espagnoles qui donnèrent à cette monnaie le surnom dépréciatif de patagon, ou patacón. Le Trévoux donne une série d’étymologies possibles ; on a également suggéré que le mot aurait été forgé de l’arabe batakká, fenêtre : les pièces de monnaie frappées au Moyen Âge par les Arabes avaient sur une de leurs faces un dessin représentant un mihrab (la niche vide qui dans la mosquée indique la direction de la prière). Le mihrab faisait penser à une fenêtre, qui par métonymie évoquait pour les soldats espagnols une pièce de monnaie arabe.
Le surnom du thaler de 1616 semble avoir ensuite essaimé pour désigner toutes sortes d’autres monnaies, de bien moindre valeur. En italien, patácca désigne la pacotille, voire la fausse monnaie. Dans les colonies portugaises, comme à Macao, on trouve le pataca. Le patacón se rencontre dans plusieurs pays d’Amérique latine.
Voltaire fait à nouveau référence aux écus patagons dans la VIIe lettre des Questions sur les miracles, (1765) : « Un bon cochon gras vaut environ dix écus patagons ». On appréciera l’équivalence de prix avec le nègre de Surinam…
Dans la lettre sur le Valais de La Nouvelle Héloïse, Saint Preux fait l'expérience d'un tel assaut d'hospitalité des valaisans qu'il n'a « pas pu trouver à placer un patagon » (I, 23, GF p. 110), comme on dirait un centime, un kopeck ou un liard. Rousseau pourtant ajoute en note « écu du pays », soit l'équivalent de trois livres françaises.
« Police, s. f. Loix, ordre & conduite à observer pour la subsistance & l’entretient des Etats & des Societez. Politia. En général il est opposé à la barbarie. Les Sauvages de l’Amérique n’avoient ni loix ni police quand on en fit la découvèrte. Les Etats différens ont diverses sortes de police pour leurs mœurs & pour leur gouvèrnement. La police de Sparte étoit différente de celle d’Athènes. Le mot de police signifie la Justice de la ville. Loyseau. » (Dictionnaire de Trévoux, éd. 1738-42, p. 952)
Cette phrase reste identique dans l’éd. Cramer de 1761 (t. IV, p. 73) mais devient, dans l’édition de Kehl : « La nature, dont le fond est partout le même, a de prodigieuses différences dans leur climat et dans le nôtre. » (éd. R. Pomeau, Bordas-Garnier, 1990, t. 2, p. 321)
Dans l’édition de Kehl, ce chapitre est dissocié en un chapitre 142 « Du Japon » et un chapitre 143 « De l’Inde en deçà et delà le Gange ». Le passage ici cité se situera alors au chap. 143.
L’édition de Kehl ajoute ici : « … malgré tout ce qui les divise. »
Pégou est l’une des anciennes capitales des Môns, révoltés contre les Birmans en 1740 : ils connaissent alors une brève période d’indépendance, jusqu’à la reprise et à la destruction de la ville par le roi birman Alaungpaya en 1757.
La troisième guerre de succession javanaise (1746-1755) s’est conclue par le traité de Giyanti, sous les auspices de la Compagnie néerlandaise des Indes Orientales.
« Les deux dernières parties de la peau que nous venons de faire connaître d’une manière générale sont celles que depuis Malpighi l’on comprend sous le nom de corps réticulaire, réseau de Malpighi, reticulare corpus, reticulum mucosum, à cause de l’espèce de réseau qu’elles forment pour le passage non-seulement des papilles nerveuses, mais aussi des parties accessoires ou de perfectionnement. L’une ou la première est suivant nous la source de la matière colorante, et la seconde est formée de cette matière, ou en est le dépôt. » (M. H. M. Ducrotay de Blainville, Traité des animaux. De leur organisation ou principes d’anatomie comparée, Paris Levrault, 1822, « Structure générale de la peau », t. I, p. 34)
Voltaire, Essai sur les mœurs, éd. R. Pomeau, op. cit., t. 1, p. 6.
La découverte de Malpighi fut contestée par Jean Riolan, qui contestait également la circulation du sang… Voir Andrew S. Curran, The Anatomy of Blackness: Science and Slavery in an Age of Enlightenment, « The Problem of Difference », Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2011, p. 121sq.
Voir par exemple les développements nauséabonds de F. Valentin de Cullion, qui dérapent très vite de considérations pseudo-scientifiques vers un appel écœurant au bon sens : « Nouveaux arguments contre l’identité d’origine des blancs et des nègres.
« N’est-il pas constant qu’un grand nombre de familles européanes, transplantées dans les côtes d’Afrique, y sont devenues, sans aucun mélange, aussi noires que les naturelles du pays ?
Disons un mot sur l’accusation portée contre Voltaire d’avoir fait fortune grâce au commerce triangulaire : toute l’histoire de sa collaboration avec un armateur nantais et de son investissement dans un navire, le Congo, qui aurait pratiqué la traite, est fausse, et repose sur un faux forgé au XIXe siècle. Il est vrai en revanche que Voltaire a investi financièrement dans la Compagnie des Indes, comme il le confie à Pilavoine, dans une lettre qu’il lui écrit de Ferney à Pondichéri le 23 avril 1760 : mais ces Indes-là sont les Indes orientales. C’est la compagnie néerlandaise des Indes occidentales qui a au XVIIIe siècle le quasi-monopole du commerce avec l’Amérique, via les Antilles et le Surinam. Si les capitaux de Voltaire ont été impliqués dans le commerce triangulaire, c’est donc très indirectement : une partie des marchandises ramenées de l’océan Indien servaient en effet ensuite au troc d’esclaves en Afrique. Voltaire a investi par ailleurs en 1751 dix mille livres dans la cargaison du Saint Georges pour Buenos Aires, dont les armateurs étaient les frères Gilly (lettre à son banquier Tronchin du 20 août 1755). Les frères Gilly ne pratiquèrent qu’exceptionnellement la traite, il est impossible de savoir si Voltaire sut que ce bateau-là faisait escale en Guinée et, s’il le sut, quand il le sut. Cela ne le dédouane certes pas, et ne l’incrimine ni plus ni moins que n’importe quel autre bourgeois de son niveau social à son époque…
Jacques Bouveresse, « Quelques remarques sur les relations entre le “principe de contradiction”, le “principe de raison” et le “principe du meilleur” chez Leibniz », in Leibniz et le principe de raison, dir. Jean Matthias Fleury, Paris, Collège de France, 2014. Le développement qui suit s’inspire largement de cet article.
Jean-Philippe Rameau, Les Indes galantes, IIe entrée, « Les Incas du Pérou », scène 5. L’opéra est joué pour la première fois en 1735, repris en 1743, 1751 et 1761. Tandis que les cordes de l’orchestre miment la précipitation du tremblement de terre, le chœur chante : « Dans les abîmes de la terre, | Les vents se déclarent la guerre. | Les rochers embrasés s’élancent dans les airs, | Et portent jusqu’aux cieux les flammes des enfers. » (livret de Fuzelier). On peut citer un autre tremblement de terre d’opéra, postérieur à Candide, à la dernière scène de l’acte V des Danaïdes de Salieri (1784).
Le spectacle du tremblement de terre n’est donc pas le réel de la scène, il n’en constitue que la façade préliminaire, la version noble et esthétisée. Le fond vient ensuite, quand le matelot se paye une fille sur les ruines fumantes (p. 51).
Il n’y a plus de référence explicite à la raison suffisante dans Candide après le chapitre V.
C’est-à-dire tout raisonnement qui enveloppe de la contradiction, qui comporte une contradiction.
Je restitue la typographie originale, d’après l’édition Cramer de 1759, exemplaire Bnf Res P Y2 2291.
Le palet est un jeu qui ressemble à la pétanque, mais avec des palets au lieu de boules. « Palet, s. m. Jeu qui se fait avec un carreau ou morceau de pièrres, de bois, de fèr, qu’on jette à la portée du bras ; celui qui approche le plus près du but gagne le coup. Discus orbiculus. Apollon en jouant avec Hyacinthe son mignon, le tua d’un coup de palet. » (Dictionnaire de Trévoux, 1738-1742, p. 463 ; reprenant Furetière-Basnage, 1727, t. 3)
Dès le premier chapitre, Voltaire ironise en qualifiant « maître Pangloss » de « plus grand philosophe de la province, et par conséquent de toute la terre » (p. 39). Cette conséquence suppose un saut qui est toujours le même saut, ridicule ici mais sérieusement nécessaire, de la pensée locale à la pensée globale, de la causalité simple à la causalité complexe dont la raison suffisante permet de rendre compte.
On appelle vérole, maladie vénérienne ou syphilis une même maladie, sexuellement transmissible, qui apparaît en Europe à la fin du XVe siècle et se manifeste par l’apparition d’un chancre ou ulcère à l’endroit de la contamination. On a longtemps cru pouvoir traiter cette maladie au mercure, mais on prenait en fait pour une guérison ce qui n’était que la rémission naturelle et temporaire du mal, dont l’évolution, en trois stades, est très lente. Au second stade, les chancres se multiplient sur le corps. Au troisième stade, de 3 à 15 ans après la contamination, la maladie touche tous les organes et les articulations. Dans certains cas, la maladie déclenche également des troubles neurologiques.
Noter l’accord au féminin, qui renvoie à un antécédent, vérole ou maladie, qu’il faut suppléer. Les éditions modernes tournent tout le passage au masculin. Mais l’ensemble de la phrase réfère des effets à une cause sans origine, indécidable, à un antécédent absent. Le féminin de Voltaire est donc plein de sens…
Charles Musitan, Traité de la maladie vénérienne et des remedes qui conviennent à sa Guérison, Trévoux, L. Ganeau, 1711, vol. 1, chap. 3, « Du tems auquel le mal venerien a commencé de paroitre », p. 31.
Jérôme Fracastor, Syphilis, ou le mal vénérien, trad. Philippe Macquer et Jacques Lacombe, Paris, Quillau, 1753.
Charles Musitan citant Fracastor, op. cit., p. 32.
Musitan, op. cit., p. 32-33.
Charles Musitan, op. cit., 1ère remarque à la fin du chap. III, p. 33.
Histoire generale des voyages et conquestes des Castillans dans les Isles & Terre-ferme des Indes Occidentales, traduite de l’Espagnol d’Antoine d’Herrera […] par N. de la Coste, Paris, 1671, livre V, chap. 11.
François Eudes de Mézeray, Histoire de France depuis Faramond jusqu’à maintenant, Paris, M. Guillemot, 1643-1651. Mézeray est une des sources essentielles de Voltaire pour l’Essai sur les mœurs.
Charles Musitan, op. cit., 4e remarque à la fin du chap. III, p. 41-42.
On les retrouve, avec tous les épisodes et circonstances, à l’article Vérole du dictionnaire de Trévoux, dont le dernier alinéa est consacré à la grosse vérole, puis à l’article Vénérienne de l’Encyclopédie (1765).
Cette mention de la controverse paraît a priori incongrue et semble ajouter à l’effet de disparate général. Elle a pourtant sa logique leibnizienne : aux vérités et enchaînements de faits correspondent les vérités et enchaînements d’énonciation, à la dissémination de la maladie dans l’ordre des événements, celle de la controverse dans l’ordre du discours. La fadaise est le système de cette correspondance.
« Cochenille, s. f. Vèrd gris qui vint des Indes, & qui étant mis dans l’eau, fait une teinture fort rouge. Coccinilla, vermiculus Indicus. Cette cochenille est d’un si grand trafic, qu’il en entre dans Tascala, ville de Méxique, pour plus de deux cens mille écus pas an, à ce que dit Hèrrèra. C’est dont on fait l’écarlate de Hollande. On nomme cramoisi les couleurs où il entre de la cochenille. » (Dictionnaire de Trévoux, éd. 1738-1742)
De la même manière, au chapitre XII, la Vieille raconte d’abord comment, réduite en esclavage, elle est passée de mains en mains : « Un Marchand m’acheta & me mena à Tunis. Il me vendit à un autre Marchand, qui me revendit à Tripoli ; de Tripoli je fus revenduë à Alexandrie, d’Alexandrie revenduë à Smirne, de Smirne à Constantinople. J’apartins enfin à un Aga des Janissaires, qui fut bientôt commandé pour aller défendre Asof contre les Russes qui l’assiégeaient. » (p. 69) La chaîne du récit est une chaîne des ventes : le récit se propage par transactions commerciales successives. Après sa fuite de Moscou, la Vieille poursuit ainsi : « je m’enfuis ; je traversai toute la Russie ; je fus longtems servante de cabaret à Riga, puis à Rostock, à Vismar, à Leipsick, à Cassel, à Utrecht, à Leyde, à La Haye, à Rotterdam : j’ai vieilli dans la misère & dans l’opprobre… » (p. 70) : ici, le fil du temps, son écoulement (« j’ai vieilli ») établit un itinéraire presque abstrait, destiné à être suivi sur une carte de l’Europe. La chaîne se mue alors en carte : la fiction se globalise.
« Je suis la fille du pape Urbain X, et de la princesse de Palestrine » (chap. X, p. 64).Voltaire invente, comme père de la Vieille, le pape Urbain X qui n’a jamais existé, le dernier Urbain étant Urbain VIII, mort en 1644. Mais la mère de la Vieille, la princesse de Palestrina, a bien existé : née en 1716, Cornelia Barberini, quatrième princesse de Palestrina, épouse en 1728 Giulio Cesare Colonna di Sciarra, scellant l’union de deux des plus puissantes familles aristocratiques romaines, les Colonna et les Barberini. Cornelia Barberini était la dernière héritière en ligne directe du pape Urbain VIII, le représentant historique le plus illustre de la famille Barberini. Le couple eut sept filles et deux fils : le fils aîné, né en 1733, fut appelé Urbain en l’honneur de l’illustre ancêtre, dont ses deux parents descendaient.
Historiquement, il y eut deux sièges, lors de la première Campagne d’Azov du 2 juillet au 2 octobre 1695 (mais les Russes levèrent le siège sans avoir pris la forteresse), et lors de la deuxième Campagne en juillet 1696 : la garnison turque d’Azov se rend aux Russes le 19 juillet. Pierre le Grand ne signera la paix avec les Turcs qu’en 1700 (traité de Constantinople). Voltaire s’est intéressé à cette guerre dans son Histoire de Russie sous Pierre le Grand. Voir dans la 1ère partie le chapitre VIII, « Expédition vers les Palus-Méotides. Conquête d’Azof ». Mais il n’y est nullement question de femmes retranchées aux mains de janissaires… !
Simon Pelloutier, Histoire des Celtes, et particulièrement des Gaulois et des Germains, depuis les temps fabuleux, jusqu’à la prise de Rome par les Gaulois, La Haye, I. Beauregard, 1740, vol. I, livre II, chap. 3, p. 243. Le livre figure dans le catalogue de Ferney et dans la Bibliothèque de Voltaire à Saint Pétersbourg. A la Bnf, cote 8-LA2-40 (E). Voir également l’article Celtes des Questions sur l’Encyclopédie, qui sans le nommer rend compte au vitriol du livre.
« j’ai vu des Écossais dans la Gaule, qui, pouvant se nourrir de porcs et d’autres animaux dans les forêts, aimaient mieux couper les fesses aux jeunes garçons et les tétons aux jeunes filles ! » (section III).
« des Écossais qui, pouvant se nourrir de porcs, aimaient mieux couper les fesses des jeunes garçons et les tétons des jeunes filles » (chap. 30, « Des enfans à la broche »).
Le motif des fesses dévorées réapparaît en effet dans l’épisode des femmes poursuivies par les singes du pays des Oreillons : « Ces clameurs partaient de deux filles toutes nuës qui couraient légérement au bord de la prairie, tandis que deux singes les suivaient en leur mordant les fesses. » (chap. XVI, p. 80)
« Mais comment peut-elle être réduite à un état si abject avec les cinq ou six millions que tu avais emportés ? Bon, dit Cacambo, ne m’en a-t-il pas fallu donner deux au senor don Fernando d’Ibaraa, y Figueora, y Mascarenès, y Lampourdos, y Souza, gouverneur de Buénos-Ayres, pour avoir la permission de reprendre mademoiselle Cunégonde ? et un pirate ne nous a-t-il pas bravement dépouillés de tout le reste ? Ce pirate ne nous a-t-il pas menés au cap de Matapan, à Milo, à Nicarie, à Samos, à Petra, aux Dardanelles, à Marmara, à Scutari ? Cunégonde et la vieille servent chez ce prince dont je vous ai parlé, et moi je suis esclave du sultan détrôné. Que d’épouvantables calamités enchaînées les unes aux autres ! dit Candide. » (chap. XXVII, p. 130)
« Quoi ! disait-il à Martin, j’ai eu le temps de passer de Surinam à Bordeaux, d’aller de Bordeaux à Paris, de Paris à Dieppe, de Dieppe à Portsmouth, de côtoyer le Portugal et l’Espagne, de traverser toute la Méditerranée, de passer quelques mois à Venise ; et la belle Cunégonde n’est point venue ! » (chap. XXIV, p. 115)
Chap. IX et X, p. 61 et 62. Voir Utpictura 18, notice B7210, et l’article très détaillé et documenté de Pedro Pardo Jimenez, « Cartes sur table: note sur le voyage de Candide en Espagne et sur le réalisme de Voltaire », in Bestiaires de Voltaire, Genèse de Candide et autres études sur Voltaire, dir. Ch. Mervaud et F. Deloffre, Oxford, Voltaire Foundation, SVEC, 2006:06.
Voir Utpictura18, notices B7201 et B7202.
45Le nom de Vanderdendur ne peut pas être un jeu sur l’expression « avoir la dent dure » qui n’est pas encore attestée à cette époque. Plus plausiblement, il a été mis en relation avec le nom d’un éditeur hollandais, Johannes Van Duren (sans doute le fils, installé à Francfort, 1719-1793), avec qui Voltaire prépare en 1740 la publication de l’Anti-Machiavel de Frédéric II. Ils sont alors en bons termes, mais Collini, le secrétaire de Voltaire, rapporte des années plus tard une violente altercation entre eux. En juin 1753 à Francfort, Van Duren fait passer un matin à Voltaire une facture pour des livres qui s’avèrent être des exemplaires de ses propres œuvres. Il revient l’après-midi ; Voltaire va à lui sans un mot et le gifle : « C’est la seule fois que j’ai vu Voltaire frapper quelqu’un », écrit Collini qui console Van Duren en lui disant « qu’au bout du compte ce soufflet venoit d’un grand homme ». (Côme Alexandre Collini, Mon séjour auprès de Voltaire, Paris, Léopold Collin, 1807, p. 181-182. Le récit est rapporté de façon décalée au milieu des événements de 1756.)
Par exemple : « Je ne me plains que de la peine que m’ont faite mes pauvres yeux en lisant [la pièce de Goldoni] ; mais le plaisir de l’esprit m’a bien consolé des tourments de mes yeux » (lettre à Goldoni, 10 mai 1763) ; « dans l’état où sont mes yeux, il leur est impossible de lire cet ouvrage. […] Ce qui me fait le plus regretter la perte de mes yeux, c’est de ne plus pouvoir lire l’Arioste » (lettre au marquis Alberti Capacelli, 21 déc. 1764).
Au Surinam, les nègres marrons (c’est-à-dire qui avaient réussi à fuir), ou Bushinengués, constituèrent dans la forêt guyanaise des communautés, parmi lesquelles le peuple Boni (du nom d’un de leurs chefs), qui réussit à vivre libre dès le XVIIIe siècle. Les fuites d’esclaves hors des plantations furent particulièrement importantes à l’occasion de la tentative de colonisation du Surinam par les Français en 1712, sous le commandement de l’amiral Jacques Cassard. Pour stopper l’hémorragie, les autorités coloniales du Surinam furent contraintes de signer des traités de paix avec les marrons, reconnaissant et pérennisant ces communautés autonomes qui vivaient en forêt.
Le Code noir est une ordonnance royale signée par Louis XIV en mars 1685 « sur les esclaves des îles de l’Amérique », réglementant leur statut juridique (dont le statut des métis), leur accordant certains droits (baptême, mariage, enterrement, repos dominical), fixant les châtiments et mutilations que la justice royale devait leur infliger en cas de fuite ou de violence, réglementant (très théoriquement) les châtiments que leurs maîtres pouvaient leur infliger à titre privé. L’ordonnance est enregistrée d’abord en Martinique le 6 août 1685, mais à Cayenne seulement le 5 mai 1704. Elle prend le nom de Code noir à partir du milieu du XVIIIe siècle. On peut consulter ici le texte intégral du Code noir, tel qu’imprimé à Paris en 1765 : http://1libertaire.free.fr/CodeNoir02.html.
C’est l’usage, non la loi, en l’absence de Code noir. Mais l’usage se calque apparemment sur lui : selon le Code noir, l’esclave fugitif avait les oreilles coupées ; s’il était pris une seconde fois, on lui coupait le jarret ; une troisième fois, c’était la mort.
« Patagon, s. m. Monnoie de Flandres faite d’argent, qui a valu d’abord 48 sols, & depuis 58 sols. On le confond avec les richedalles d’Allemagne & les monnoies Espagnoles qu’on appelle reaux, & autres piéces cornuës & mal fabriquées, dont il est venu un grand nombre du Pérou. Ménage croit que ce mot vient de patac, petite monnaie d’Avignon valant un double [denier]. Borelle dérive de l’Allemand patar, qui est aussi une espèce de monnoie. M. Huet dit que cette monnoie a peut-être pris son nom des peuples appelés Patagons ; car Regio della Plata, d’où elle venoit, n’est pas éloignée de leur pays. » (Trévoux, 1738-42, p. 622) Difficile d’y voir clair dans une définition aussi composite !
« Nous allons acheter ces nègres à la côte de Guinée, à la côte d’Or, à celle d’Ivoire. Il y a trente ans qu’on avait un beau nègre pour cinquante livres : c’est à peu près cinq fois moins qu’un bœuf gras. Nous leur disons qu’ils sont hommes comme nous, qu’ils sont rachetés du sang d’un Dieu mort pour eux, et ensuite on les fait travailler comme des bêtes de somme : on les nourrit plus mal ; s’ils veulent s’enfuir, on leur coupe une jambe, et on leur fait tourner à bras l’arbre des moulins à sucre, lorsqu’on leur a donné une jambe de bois. Après cela nous osons parler du droit des gens ! » (Essai sur les mœurs, chap. CLII, « Des îles françaises et des flibustiers », éd. R. Pomeau, Garnier, t. 2, p. 379-380. Ce chapitre fait partie de l’ensemble formé par les chap. CL à CLIV ajouté en 1761, qui contient toute l’information américaine de Voltaire pour Candide.) Il n’y a aucune raison de douter ici de la sincérité de l’indignation voltairienne.
Cette phrase est supprimée après 1757.
Le nègre de Surinam est censé avoir été prêché par des pasteurs protestants (« si ces Prêcheurs disent vrai »). Mais Surinam est là pour Cayenne : l’Église et son prosélytisme jésuite sont les cibles favorites de Voltaire. Il n’y a d’ailleurs pas de différence fondamentale dans le comportement des deux religions vis-à-vis de l’esclavage. Les populations hollandaises calvinistes en Amérique latine étaient essentiellement citadines, tandis que les plantations de canne à sucre étaient plutôt aux mains de colons portugais ou français, catholiques. Le commerce des esclaves était donc plutôt protestant, via la Compagnie des Indes, tandis que leur exploitation dans les plantations était plutôt catholique. Voir Jean-Pierre Bastian, Le Protestantisme en Amérique latine: une approche socio-historique, Labor et Fides, 1994, p. 31.
Voir Stéphane Lojkine, « Voltaire et les Juifs : le côté obscur de la force voltairienne ». https://utpictura18.univ-amu.fr/Voltaire/VoltaireJuifs.php
Référence de l'article
Stéphane Lojkine, « Différence et globalisation », Voltaire, l'esprit des contes, cours d'agrégation donné à l'université d'Aix-Marseille, 2019-2020.
Voltaire
Archive mise à jour depuis 2008
Voltaire
L'esprit des contes
Voltaire, l'esprit des contes
Le conte et le roman
L'héroïsme de l'esprit
Le mot et l'événement
Différence et globalisation
Le Dictionnaire philosophique
Introduction au Dictionnaire philosophique
Voltaire et les Juifs
L'anecdote voltairienne
L'ironie voltairienne
Dialogue et dialogisme dans le Dictionnaire philosophique
Les choses contre les mots
Le cannibalisme idéologique de Voltaire dans le Dictionnaire philosophique
La violence et la loi