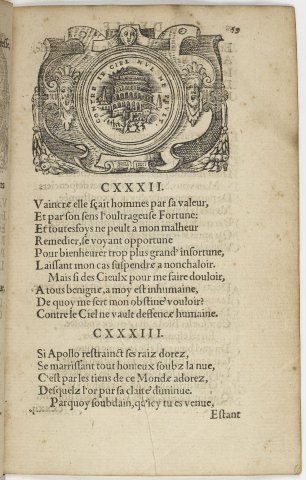Mythe : une catégorie délicate
Définir ce qu’on entend par « mythe » n’est pas chose aisée. Le Robert suggère qu’il s’agit d’un « récit fabuleux, souvent d'origine populaire, qui met en scène des êtres (dieux, demi-dieux, héros, animaux, forces naturelles) symbolisant des énergies, des puissances, des aspects de la condition humaine ». L’étymologie par le grec mythos n’est pas d’un grand secours puisque ce terme a eu le sens de « récit », sans aucune connotation négative, sans impliquer une opposition entre ce qui relève de l’imaginaire, du fictionnel, voire du mensonge, au logos, seul récit ou discours véridique, rationnel, argumenté. En évitant de figer les choses, on dira simplement que les mythes sont des récits partagés, oraux ou écrits, généralement objets de performances puisqu’on les chante, on les récite, on les danse, on les met en scène au théâtre ou au sanctuaire. Les mythes ne relèvent pas d’un genre littéraire précis ; c’est plutôt un mode de pensée qui permet, à travers des créations fictionnelles, d’explorer le monde, ses origines, ses ressorts, ses contradictions. On ne croit pas aux mythes, comme on croit aux dogmes dans les religions monothéistes (la résurrection, la trinité…), mais on adhère à la représentation du monde qui en ressort. Car le mythe a un fort pouvoir de légitimation : il rend compte, explique, donc justifie l’organisation des sociétés, les règles qu’elles se sont données, les rapports de force qui les traversent. La richesse de ce qui se joue dans les mythes explique pourquoi ils ont tant retenu l’attention et pourquoi, du naturalisme au structuralisme, en passant par l’évhémérisme ou l’allégorisme, diverses clés de lecture ont été proposées pour tenter de percer le sens de cet univers foisonnant de personnages, épisodes, variantes... Car les mythes sont des objets vivants, profondément historiques, qui se transmettent et se reconfigurent au gré de leur réception dans des contextes nouveaux, comme l’Orfeu Negro, transplanté au Carnaval de Rio de Janeiro par Marcel Camus en 1959.
Babylone, la grande prostituée
Dans un ouvrage paru en 2003 et intitulé La Tour de Babel, l’assyriologue Jean-Jacques Glassner se demandait, en sous-titre, « Que reste-t-il de la Mésopotamie ? ». Assurément, dans l’imaginaire collectif, Babylone occupe une place de choix. Elle est le symbole ambivalent d’une civilisation opulente et d’un monde décadent. Tout récemment, en 2022, Damien Chazelle choisit d’appeler Babylon un film qui propose le récit des excès les plus fous du système hollywoodien et donne à voir l’ascension et la chute de divers personnages pris dans cette ère de décadence et de dépravation. Paradigme de l’Orient vu à travers le regard colonialiste des Occidentaux, Babylone était pourtant considérée comme « la porte des dieux » (babi li ou bab ilani) selon une étymologie savante que les scribes locaux avaient valorisée pour mettre l’accent sur la centralité de la capitale. Il est vrai que, dans le grand récit babylonien de la création, l’Enuma Elish, remontant sans doute au XIIe siècle av. n.è., lorsque Marduk s’est imposé sur Tiamat, il découpe son corps et finalise la création du cosmos qui se parachève par la fondation de Babylone. Bien plus tard, quand Hérodote (I, 178-187) visite Babylone aux alentours de 450 av. n.è., il en souligne la vastitude et la splendeur, avec les célèbres jardins suspendus, mais aussi les murailles, les ponts, les portes, la voie processionnelle, les sanctuaires… Une voix dissonante se fait entendre, celle des Juifs qui ont été victimes des Babyloniens puisque le roi Nabuchodonosor II (le Nabucco de Verdi, en 1842), à deux reprises, au début du VIe siècle av. n.è., met le siège devant Jérusalem, la détruit, en particulier son Temple, et déporte une large partie de sa population en Babylonie. Babylone devient donc le symbole du pouvoir oppresseur, des polythéistes d’autant plus malfaisants qu’ils sont riches et puissants. Qu’il s’agisse du Livre de la Genèse, avec la Tour de Babel, des prophètes, ou encore de l’Apocalypse de Jean (« Sur son front était écrit un nom, un mystère : Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. » ; Apoc. 17, 5), dans laquelle, chevauchant la bête aux sept têtes, Babylone se lit au miroir de Rome, Babylone est le contrepoint de Jérusalem. Les catholiques en feront le symbole du paganisme, les protestants, l’image du catholicisme ! Plus près de nous, dans les gospels, dans le reggae, le metal ou le rap, Babylone est le symbole de la corruption, donc de l’État, voire des forces de l’ordre. On touche du doigt le caractère paradoxal des parcours de réception des mythes puisque, dans le livre de la Genèse, la tour de Babel représente à l’inverse un monde chaotique et fragmenté.
De la zigggurat à la Tour de Babel
Une ziggurat est une « tour à étages » abritant une ou plusieurs divinités, matérialisation de la jonction entre le ciel et la terre, comme le suggèrent les textes littéraires sumériens et akkadiens qui la décrivent comme une montagne unissant l’espace des dieux et celui des hommes. Leurs dimensions peuvent varier de 30 à 60 m de côté et de 40 à 100 m de hauteur, tout comme le nombre d’étages (de 3 à 7). Il en existait à Uruk, Ur, Nippur, Eridu, mais la plus célèbre est celle de Babylone, détruite et reconstruite à plusieurs reprises, appelée l’Etemenanki ou la « maison qui est le fondement du ciel et de la terre ». Aujourd’hui, il ne reste que des ruines de ce monument, découvertes en 1913 par les archéologues allemands, un monument largement pillé, donc difficile à reconstituer. On peut penser que sa hauteur se situait entre 45 et 60 m, avec peut-être six étages et un temple au sommet, d’une hauteur de 12 m. Il s’agissait donc d’un monument imposant et magnifique, devenu le symbole de la puissance et de la richesse de Babylone. Ainsi, après la destruction de la ville par le roi assyrien Sennachérib, Assarhaddon, son successeur, entreprend de reconstruire la ville, des travaux considérables qui se prolongèrent longuement. Nabopolassar (626-605 av. n.è.), dans un texte gravé sur un cylindre, fait allusion à cette entreprise1 :
Le Seigneur Marduk me commanda de fonder l’Etemenanki, la ziggurat de Babylone, depuis longtemps délabrée et écroulée, sur la poitrine du monde infernal, (et) de faire rivaliser son sommet avec les cieux. J’ai alors fabriqué houes, marres (et) moules à briques en ivoire et en bois ušu et mesmakanna. J’ai organisé des artisans innombrables (et) la mobilisation de mon pays. (…) J’ai pris les mesures. Les grands dieux ont confirmé l’oracle contemplé. Par l’art des exorcistes et l’intelligence d’Ea et Marduk, j’ai purifié cet endroit. Dans la première base, j’ai placé le document de fondation (…). J’ai construit un temple à l’image de l’Ešarra, dans la joie et la jubilation, comme une montagne. J’ai élevé sa tête pour Marduk, mon Seigneur, comme aux jours anciens, je l’ai décoré.
Le temple posé au sommet de la ziggurat accueillait en effet Marduk et son épouse Zarpanitu (Beltiya), mais aussi une pluralité d’autres dieux : Ea, Anu, Enlil, Nabu, Tashmetu. Cet espace constituait en quelque sorte le cœur du paysage religieux babylonien. Spectaculaire et visible à des dizaines de kilomètres, la ziggurat symbolisait le centre de l’univers, une sorte d’omphalos comme celui de Delphes pour les Grecs. Les Juifs déportés à Jérusalem vécurent donc à l’ombre de la ziggurat et l’intégrèrent dans leur imaginaire collectif, comme le symbole honni d’un monde hostile et étranger, y compris sur le plan religieux.
La « tour de Babel » apparaît, dans le livre de la Genèse, à la suite de l’épisode du Déluge, sous le règne de Nemrod, comme le symbole d’une humanité arrogante, qui nourrit la folle, vaine et pernicieuse ambition d’atteindre les cieux, apanage des dieux, ou mieux de Dieu. Le texte raconte (Genèse 11, 1-5)2 :
Tout le monde se servait d’une même langue et des mêmes mots. Comme les hommes se déplaçaient à l’Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils s’y établirent. Ils se dirent l’un à l’autre : ‘Allons ! Faisons des briques et cuisons-les au feu !’ La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent : ‘Allons ! Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux ! Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la terre !
Pour empêcher les hommes de s’élever au-dessus de leur statut humain, Yahvé jette la confusion parmi eux en brouillant leur langage ; incapables de se comprendre et de communiquer, les hommes abandonnent la construction et se répandent dans le monde. Le stratagème de Yahvé fait écho au statut de Babylone, capitale cosmopolite d’un puissant empire, mais la diversité des langues qui caractérise la Tour de Babel provoque surtout une grande confusion et l’échec de l’entreprise. De fait, lorsqu’Alexandre le Grand pénètre dans Babylone en octobre 331 av. n.è., le prestigieux quartier des temples est en piteux état et le Macédonien décide de le restaurer. Jusqu’à sa mort en 323, les travaux avancèrent lentement et ne furent jamais achevés. Le monument devint une carrière de briques et s’effaça littéralement du paysage jusqu’à ce que les fouilles, au début du XXe siècle, en restituent les fondations.
Brueghel et ses Tours de Babel
Dans l’Antiquité, les images de la ziggurat de Babylone sont très rares. On possède bien une stèle découverte à Babylone et conservée dans une collection privée, à Oslo, sur laquelle on voit un roi portant une tiare conique, sans doute Nabuchodonosor II, à la droite d’une tour à six étages, coiffée d’un temple au sommet ; une inscription cunéiforme précise : « Etemenanki, la ziggurat de Babylone ». En revanche, les représentations de la Tour de Babel sont bien plus tardives, puisqu’elles débutent avec le Moyen Âge. Avant d’y venir, on signalera que la Grande Mosquée de Samarra, en Irak, l’une des plus importantes œuvres architecturales de l’Islam, construite au IXe siècle par les califes abbassides, présente un minaret en spirale hélicoïdale qui relève d’une même aspiration humaine à s’élever vers le divin (fig. 1)3.

Dès le XIIe siècle (1176-1189), dans la magnifique cathédrale de Monreale, près de Palerme, ornée de mosaïques, est représenté le motif biblique (fig. 2), accompagné d’une légende en latin : Filli Noe edificantes turrim confusae sunt linguae eorum et vocatum est locum illud Babel (« Tandis que les fils de Noé construisaient une tour, leurs langues furent bouleversées et ce lieu fut appelé Babel »).
Les enluminures médiévales montrent la construction d’une tour, en faisant intervenir des engins et en dépeignant la foule des ouvriers du grand chantier. Certaines images signalent en haut, dans le ciel, une présence divine : Dieu en personne ou un ange, pour rappeler le contexte biblique et le distinguer d’une scène de la vie quotidienne, qui ferait référence à la construction d’un château quelconque ou d’un campanile. Dans un manuscrit de La Cité de Dieu d’Augustin (fig. 3a et 3b), manuscrit datant entre 1469 et 1473, le roi Nemrod apparaît sur le chantier, richement vêtu, dans une attitude qui en dit long sur son arrogance ; il tourne d’ailleurs le dos à Dieu qui, du ciel, exprime sa désapprobation.

Avec la Renaissance, le sujet gagne en popularité et la tour ressemble davantage au Colisée qu’à une forteresse médiévale. En 1547, le graveur hollandais Cornelis Anthonisz représente l’effondrement de la tour sous l’effet d’une tempête divine, mêlant en une même image le destin de Babylone, celui de Rome et plus globalement de tous les pécheurs (fig. 4). « Contre le Ciel nul ne peult », précise une gravure sur bois de quelques années antérieure (1544), illustrant le Dizain 132 de la Délie de Maurice Scève (fig. 5a et 5b).

C’est sur cet arrière-plan que s’inscrivent les deux toiles de Pierre Brueghel (env. 1525-1569) : en 1563 d’abord, puis en 1568, il peint la Tour de Babel. La première toile, conservée à Vienne, est de grandes dimensions (114 x 155 cm), la seconde, conservée à Rotterdam, est de plus petites dimensions (59,9 x 74,6 cm). Dans les deux cas, il s’inspire du Colisée pour donner vie à une scène grandiose4. Dans la première toile (fig. 6a et 6b), au premier plan à gauche, Nemrod, le sceptre en main, accompagné de ses conseillers, visite le chantier ; devant lui, un homme se prosterne, signe d’une attitude inadéquate puisque c’est face à Dieu que l’on doit se prosterner. Tel un roi-constructeur assyrien ou babylonien, il veille sur les sanctuaires, mais la dimension de celle qui est en cours d’édification dit la démesure d’un pouvoir pernicieux. Dans L’Enfer de Dante, Nemrod manifeste son hybris en maltraitant Virgile et Dante dans un sabir incompréhensible (« Raphel may amech zabi ami » ; Enfer, 31, 67). Sa pensée est mauvaise, commente Virgile ; c’est pourquoi, comme Jean Bodin et Machiavel, Brueghel le peint en tyran, craint par son peuple.

Le gigantisme de la tour écrase en effet les êtres humains – plusieurs milliers d’entre eux figurent sur la toile ! – et le paysage aux alentours, champs, prairies, forêts et cours d’eau qui expriment toute la beauté de la création divine, par opposition à l’œuvre humaine si imparfaite. La démesure est le maître mot de cette entreprise. La tour est constituée d'un ensemble de cylindres concentriques et superposés, légèrement inclinés, comme pour former une spirale ascendante, mais pour donner aussi la sensation de confusion, de déséquilibre, d’une œuvre inachevée et vouée à l’échec, déjà en train de s’écrouler alors qu’elle est encore en cours de construction. C’est donc aussi la vanité des efforts humains pour imiter Dieu qui sont mis en image, même si la capacité technique des hommes est également exaltée avec la présence d’un grand nombre d’engins et de machines ayant rendu possible cette prouesse technique. L’époque de Brueghel est bien celle de nombreuses avancées dans ce domaine ; le chantier de la Basilique Saint-Pierre de Rome s’étend de 1506 à 1590.
Dans la version conservée à Rotterdam, datant de 1568 (fig. 6a et 6b), le roi Nemrod a disparu, mais la présence de nuages se mêlant au sommet de la tour inachevée évoque la sanction des dieux. Régulière et complète en bas, la tour se désagrège au fur et à mesure de son élévation, tandis que la palette chromatique traduit un désordre émotionnel et moral qui condamne la tour à ne jamais remplir sa mission ; son sommet est déjà une ruine rougeoyante, en dépit des efforts consentis par la population qui s’agite sur le chantier, ainsi que dans le port voisin, signe d’une humanité laborieuse, comme celle que Brueghel voyait à l’œuvre dans sa Hollande natale. À une époque où le latin était une langue largement partagée les élites et la langue de la liturgie, mais au moment aussi où les Réformés misaient sur les langues vernaculaires, la « babélisation » devait faire débat et questionner le devenir des cultures.
Nul ne sait si Pierre Brueghel avait connaissance de ce qu’était une ziggurat ou s’il avait lu Hérodote (I, 181) décrivant celle de Babylone5 :
Le centre de chacun de ces deux quartiers de la ville est remarquable : l’un, par le palais du roi, dont l’enceinte est grande et bien fortifiée, l’autre, par le lieu consacré à Zeus Bélos, dont les portes sont d’airain et qui subsiste encore actuellement. C’est un carré régulier en tous sens. On voit au milieu une tour massive qui a un stade tant en longueur qu’en largeur ; sur cette tour s’en élève une autre, et sur cette seconde encore une autre et ainsi de suite, de sorte que l’on en compte jusqu’à huit. On a pratiqué en dehors des degrés qui vont en tournant, et par lesquels on monte à chaque tour. Au milieu de cet escalier, on trouve une loge et des sièges, où se reposent ceux qui montent. Dans la dernière tour est une grande chapelle, dans laquelle un grand lit bien garni et, près de ce lit, une table d’or. On n’y voit aucune statue.
Après Brueghel
Le succès du motif de la Tour de Babel ne s’est pas démenti, jusqu’au XXIe siècle, qu’il s’agisse de la Bible de Gustave Doré (1866)6 où l’on voit la tour frappée par une tempête et, à son pied, au premier plan, le désespoir intense des hommes livrés à la punition divine. Au début du XXe siècle, dans le film muet Metropolis de Fritz Lang, réalisé en 1926, une « nouvelle tour de Babel » est édifiée par des ouvriers opprimés pour abriter le siège d’un pouvoir totalitaire. Dans cette société dystopique, la verticalité oppose une ville haute réservée aux élites, vivant dans l'oisiveté et le luxe et le divertissement, et une ville basse, où s’entassent les travailleurs soumis à une domination brutale. Entre catacombes et tour de Babel, le destin de l’humanité dépend de plus en plus des machines. La tour de Babel devient ainsi le symbole de la fragilité des sociétés humaines face aux aléas du pouvoir, divin ou humain, ou en proie à l’incommunicabilité, ou encore celui de la conquête insatiable du pouvoir, comme dans les jeux vidéo (Call of Duty, Forge of Empire…) et dans la bande-dessinée.
Pour aller plus loin
BOURETZ, Pierre, DE LAUNAY, Marc, SCHEFER, Jean-Louis, La Tour de Babel, Paris, Desclée de Brouwer, 2003.
GLASSNER, Jean-Jacques, La tour de Babylone : que reste-t-il de la Mésopotamie ?, Paris, Seuil, 2003.
KAMINSKA, Barbara A., « “Come, let us make a city and a tower”: Pieter Bruegel the Elder’s Tower of Babel and the Creation of a Harmonious Community in Antwerp », Journal of Historians of Netherlandish Art 6:2 (Summer 2014) DOI: 10.5092/jhna.2014.6.2.3.
Pour prolonger l’enquête du côté de la création artistique contemporaine, on pourra consulter le catalogue de l’exposition organisée par le musée des Beaux-Arts de Lille en 2012 : Babel, préface de Jean-Claude Carrière, textes d’Alain Tapié et Régis Cotentin, Invenit Editions, 2012.
Notes
Traduction S. Anthonioz, « La ziggurat. Origine et symbole », Lumière et Vie, 58/1, n° 281, Janvier-Mars 2009, p. 73-77, en part. p. 77.
Traduction Bible de Jérusalem.
Cette mise en scène spectaculaire d’une ruine réelle, le Colisée, chez Brueghel, est à comprendre à la lumière de l’engouement des humanistes et des peintres pour les ruines à la Renaissance, évoqué dans le présent dossier par Charles Davoine dans son article « Peindre les ruines à la Renaissance »*.
Traduction Laura Battini, « La ville de Babylone par Hérodote », in Sociétés humaines du Proche-Orient ancien, 12/02/2018, https://ane.hypotheses.org/241.
Images et réception de l'Antiquité
Dossier dirigé par Anne-Hélène Klinger-Dollé et Questions d'images depuis 2024
Images et réception de l'Antiquité
En guise d'introduction
Réception de l’Antiquité aux XVe-XVIIIe siècle
Imaginaire collectif et transmission des mythes : de la ziggurat de Babylone à la Tour de Babel de Brueghel
Peindre les ruines antiques à la Renaissance : enjeux d’un genre nouveau
Le symbole, objet privilégié de la « restitution de l’Antiquité » par les humanistes de la Renaissance : l’exemple de l’ancre et du dauphin
Les Emblèmes d’Alciat : une réception humaniste de l’Antiquité par le texte et par l’image
Des images de Mithra en livre : la tentative de L'Antiquité expliquée (1719-1724) de Bernard de Montfaucon
Dessine-moi la déesse Isis. L’exemple des illustrations de la métamorphose d’Iphis au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles
Réception de l’Antiquité aux XIXe-XXIe siècle
Polychromie et réception de l’Antiquité
Étude de la polychromie dans un tableau d’Alma-Tadema
L’évolution de l’iconographie dans les manuels scolaires d’histoire de collège (1880-2009) : le cas de la Guerre des Gaules
Réception de l’Antiquité et vie politique. L’exemple du monument du « génie latin » de Jean Magrou (1921)
L’image de restitution dans le domaine du patrimoine architectural
La restitution virtuelle de la Rome antique à l’Université de Caen Normandie
Vade-mecum pour étudier en classe les relations entre Antiquité et art contemporain
Transformer des dieux et des héros gréco-romains en super-héros de comics aux États-Unis : quelques exemples
Du mythe à l’écran, du demi-dieu à l’homme. L’image d’Hercule au cinéma (XXe et XXIe s.)