
La polémique agace, fatigue, excède, gêne la marche de nos sociétés contemporaines démocratiques. Mais elle nous rassure aussi : la libre impertinence de ses excès est pour nous la garantie du respect des valeurs fondamentales que les Lumières nous ont léguées : le débat contradictoire en matière juridique, l’expression libre d’opinions politiques et religieuses divergentes, la possibilité de manifester publiquement l’injustice, de dénoncer scandales et abus de pouvoir, ne sont pas simplement des droits conquis ; ils constituent le socle même de notre culture, au sens le plus noble, le plus classique, le plus traditionnel aussi de ce terme. L’esprit de notre culture, jusque dans les articulations les plus délicates de son expression, dans les ressorts les plus subtils de son déploiement, est nourri de cette polémique qui braille intempestivement à nos oreilles et se manifeste apparemment comme torrent abject, carnaval gras, salissure et perte de temps.
Pour comprendre ce paradoxe, nous proposons de remonter d’abord aux usages originaires du mot et de dégager à partir de la constellation lexicale dans laquelle il s’inscrit ce qui a conduit les Lumières à distinguer, et en même temps à articuler un usage modéré et un usage immodéré de la dispute.
Nous montrerons ensuite comment la dispute a constitué, du moyen âge jusqu’aux Lumières, un dispositif d’auto-représentation culturelle qui n’était pas destiné primitivement à accueillir la différence dialogique : il conviendra de s’interroger sur cette transformation décisive qu’a constitué l’introduction d’une dispute à deux voix égales, sur ses raisons et ses modalités. Car l’articulation de la dispute à la polémique est essentiellement liée à l’émergence de cette conception dialogique.
Enfin, revenant aux Lumières, nous nous interrogerons sur la manière dont Le Neveu de Rameau, saisi par Hegel comme une représentation décisive du basculement de l’ancienne société de cour vers la conscience divisée moderne, met en œuvre le dispositif de la dispute, à la fois dans sa forme la plus traditionnelle et comme ouverture vers la polémique comme monde : le monde même dans lequel nous vivons.
I. Ambivalences de l’Encyclopédie face à la polémique
Polémique : la hantise du débordement
L’Encyclopédie ne consacre qu’un tout petit article à Polémique, qu’elle définit exclusivement comme un adjectif et restreint au champ théologique :
POLÉMIQUE, (Théolog.) titre ou épithete qu’on donne aux livres de controverse, principalement en matiere de théologie.
Ce mot vient du grec πόλεμος, guerre, combat, parce que dans ces sortes d’ouvrages on dispute sur quelque point de dogme ou d’histoire. Ainsi l’on dit théologie polémique, pour signifier une théologie de controverse. La question des ordinations angloises dans ces derniers tems a produit plusieurs écrits polémiques de part & d’autre.
On donne aussi ce nom dans la littérature à tout écrit, où l’on entreprend la défense ou la censure de quelque opinion. Les exercitations de Scaliger contre Cardan sont un livre purement polémique.
Polémique qualifie donc un certain type de discours, qui substitue à la guerre réelle une guerre verbale, et encore par écrit, c’est-à-dire à distance. Un espace polémique s’esquisse ici, qui métaphorise le champ clos du combat.
La matière originelle de l’écrit polémique est théologique, mais cette matière est d’emblée débordée : ce dont on dispute regarde le dogme ou l’histoire, et bientôt la qualification de polémique se donne « dans la littérature à tout écrit, où l’on entreprend la défense ou la censure de quelque opinion ».
Le premier exemple donné est significatif : une lettre anonyme datée du 5 février 1722 et publiée dans le numéro d’avril des Mémoires de Trévoux, contestait la validité des ordinations d’évêques effectuées en Angleterre selon le rite anglican, à cause des changements que ce rite apportait au « pontifical romain ». Pierre François Le Courrayer1, professeur de philosophie et de théologie, y répond en 1723 par une Dissertation défendant la validité des ordinations anglicanes, puis par des Éclaircissements publiés en avril dans le Journal des savants, d’obédience janséniste. Les Mémoires de Trévoux rétorquent en août avec un Prélude de la réfutation du livre entier du P. Le Courrayer, signé par le père Hardouin, de la Société de Jésus. Viennent ensuite, à l’automne, les Lettres d’un théologien à un ecclésiastique…, du père Gervaise, qui dénoncent également ces ordinations : l’église anglicane n’a pas le droit de changer la forme de l’ordination. La querelle se poursuit en 1725, par les deux journaux antagonistes interposés, tandis que le père Lequien, professeur de théologie de l’ordre des frères prêcheurs, publie une Nullité des ordinations anglicanes ou Réfutation d’un livre intitulé : Dissertation..., qui atteint maintenant deux volumes. En 1726, un bénédictin y va de sa Lettre contre Le Courrayer. Le doyen Fennell, Irlandais, publie à Paris la même année un Mémoire ou Dissertation sur la validité des ordinations, qui appuie en deux volumes la thèse de l’invalidité des ordinations anglicanes sur le récit complet de l’histoire de la Réforme en Angleterre. Le Courrayer se défend, publie volume sur volume, et dénonce les calomnies dont ces ordinations ont fait l’objet : on a prétendu que l’évêque Parker, auteur de ces ordinations, avait lui-même été ordonné prêtre dans un cabaret de Londres. Mais déjà les évêques de France se sont rassemblés : ses thèses sont condamnées, Le Courrayer se rétracte et le cardinal de Noailles annonce officiellement en 1727 sa soumission. Cela n’arrêta pas les publications et le déchaînement contre Le Courrayer, qui s’enfuit finalement en Angleterre, où il publie, en 1736, une Histoire du Concile de Trente, précédée d’une introduction où il dénonce les persécutions qu’il a subies et l’esprit d’intolérance qui les a suscitées. De 1767 à 1769 il fera paraître à Amsterdam une traduction française de l’Histoire de la réformation, de Jean Sleidan.
On remarque l’extrême prudence et la neutralité de la formulation dans l’article Polémique de l’Encyclopédie : l’histoire des ordinations anglicanes renvoie pourtant au conflit larvé qui oppose en France depuis près d’un siècle Jansénistes et Jésuites, et, au-delà de ce conflit, à l’héritage social de la Réforme, aux problèmes que pose ce que l’on pourrait appeler la digestion institutionnelle des situations héritées du grand conflit théologique et politique qui a divisé l’Europe du XVIe siècle. Le Père Le Courrayer, qui reçoit un canonicat à Oxford, traduit une Histoire de la Réformation et meurt à Londres en se disant « membre de l’Église catholique, mais sans approuver plusieurs opinions et superstitions qui ont été introduites dans l’Église romaine et qu’on enseigne dans les écoles et dans les séminaires et qu’on présente comme des articles de foi. » Le sujet, apparemment futile au départ, déclenche un débordement que l’institution ne maîtrise plus : la disproportion de ce débordement verbal fait apparaître sous la surface polémique, avec son jeu rhétorique de lettres, de dissertations et de réfutations, une profondeur, une résonance dont le cœur irréductible, impossible à concilier, à effacer, est le conflit de la Réforme.
Le second exemple, donné comme non théologique, ou comme débordant du strict champ théologique, est celui du livre écrit par Scaliger contre Cardan. Nous sommes cette fois en plein milieu du XVIe siècle. Jules Scaliger, humaniste français d’origine italienne, défenseur du cicéronianisme, célèbre pour ses travaux sur la poétique et la rhétorique d’Aristote, avait rédigé en 1557 des Exercitationes exotericae de subtilitate contre le traité métaphysique De subtilitate rerum de Jérôme Cardan. Celui-ci y répondit en 1559 par une Actio contra calumniatorem. L’enjeu de la polémique était la définition de l’âme. Cardan distinguait dans l’âme d’une part une intelligence passive, propre à chaque individu mais mortelle, d’autre part un agent intelligent, immortel mais mobile, passant d’un être humain à un autre. Scaliger, s’appuyant sur Aristote, réfute cette thèse presque matérialiste : l’âme se caractérise par un principe de réflexion qui lui permet de concevoir des objets plus grands qu’elle-même, et ce principe est en même temps un principe d’individuation.
A l’article Cardan de son Dictionnaire historique et critique, Bayle attaque violemment Scaliger, qu’il accuse de malhonnêteté polémique :
« Naudé2 […] le blâme de n’avoir point voulu lire la 2. édition de l’Ouvrage de Cardan. Ce blâme est fort bien fondé, car est-il juste que parce qu’un Critique ne veut point perdre la peine qu’il a prise à noter des fautes, on fasse le procés publiquement à un Ecrivain pour des erreurs qu’il a déjà corrigées ? […] On remarque […] que Scaliger fit plus de fautes qu’il n’en critiqua à Cardan, pendant les neuf années qu’il donna à cette critique. […] Le motif de Scaliger n’étoit pas tant l’amour de la vérité, que la passion de se batre contre tout ce qu’il y avoit alors de plus éminent dans la République des Lettres. »
La polémique de Scaliger contre Cardan devint une sorte de cas d’école : Scaliger « s’imagina sans raison que sa critique l’avoit fait mourir », mais il n’a pu s’imaginer cela que parce que Cardan était fou3. Si Cardan fait polémique pour Bayle au-delà de Scaliger qu’il réprouve pourtant, c’est que le quasi matérialisme panthéiste de Cardan, pourtant pensionné par le pape, a de fait participé au mouvement intellectuel qui initiait la Réforme en Italie4 : or Cardan ne peut qu’être rejeté par les théologiens protestants.
Controverse : enjeux idéologiques d’un dispositif rhétorique
« Livre de controverse », « théologie de controverse » : l’adjectif polémique est clairement ramené, dans l’Encyclopédie, à une catégorie plus générale et plus commune, qui est celle de la controverse. Polémique indique un débordement ; controverse définit un genre. Polémique qualifie exclusivement un écrit, ou plus exactement une prolifération incontrôlée d’écrits à partir d’une querelle : la controverse désigne au contraire une performance orale, un exercice singulier, circonscrit de rhétorique. Articuler la polémique à la controverse revient à définir une structure et sa déconstruction, un objet et sa fragmentation, sa dissémination.
Mais les choses se compliquent lorsque nous nous reportons à l’article Controverse, qui porte l’astérisque : il a été écrit par Diderot lui-même, qui l’a jugé stratégique et ne l’a pas du tout traité avec la compétence de grammairien que le sujet semblait requérir. Tout l’effort de l’article consiste à revendiquer une positivité de la Controverse, ce qui signifie à la fois que cette positivité ne va plus de soi et qu’il y a là un espace idéologique à conquérir :
*CONTROVERSE, s. f. dispute par écrit ou de vive voix sur des matieres de religion. On lit dans le dictionnaire de Trévoux, qu’on ne doit point craindre de troubler la paix du Christianisme par ces disputes, & que rien n’est plus capable de ramener dans la bonne voie ceux qui s’en sont malheureusement égarés : deux vérités dont nous croyons devoir faire honneur à cet ouvrage. Ajoûtons que pour que la controverse puisse produire les bons effets qu’on s’en promet, il faut qu’elle soit libre de part & d’autre. On donne le nom de controversiste à celui qui écrit ou qui prêche la controverse.
Diderot se réfère ironiquement à l’article Controverse du Trévoux : son article est donc en quelque sorte un méta-article, qui surplombe et réoriente un objet, une pratique a priori de l’apanage des Jésuites, à la fois techniquement (car les Jésuites contrôlent l’enseignement universitaire, d’où cette pratique tire sa forme) et idéologiquement (car les Jésuites ont fait de la controverse une arme essentielle de propagation des doctrines de la Contre-Réforme).
Dans le Dictionnaire de Trévoux, la controverse est en effet clairement présentée comme une arme de l’Église pour combattre les hérétiques :
CONTROVERSE , s. f. terme dogmatique, dispute sur une chose qui n’est pas certain, où il s’agit d’opinions qui peuvent être soûtenues de part & d’autres. Controversia. Les Astronomes ne sont plus en controverse sur le mouvement de la terre ; il est hors de controverse. Sénèque a fait deux livres de controverses5.
Controverse se dit maintenant en un sens plus étroit, des disputes sur les matières de Religion ☞ qui ne sont pas absolument décidées par l’Eglise, ou sur les points de foi, entre les Catholiques & les Hérétiques. Etudier la controverse, c’est-à-dire les matières controversées ; prêcher la controverse, se dit d’un Prédicateur qui discute, éclaircit en chaire les points contestés entre les Catholiques et les Protestans. De re ad christianam fidem pertinente controversia. On ne doit point craindre de troubler la paix du Christianisme par des controverses, quand il s’agit d’établir les vérités de la Religion. Rien n’est plus capable de ramener dans la bonne voie ceux qui s’en sont malheureusement égarés, que de savantes controverses. Les hérétiques n’ont rien tant en horreur que les controverses, parce que rien ne fait mieux voir la fausseté de leurs opinions, & ne détrompe plus efficacement ceux qui sont dans l’erreur.
Les Jésuites de Trévoux définissent bien la controverse comme un « terme dogmatique », c’est-à-dire comme une dispute théologique, sur le dogme. Pourtant, les premiers exemples qu’ils donnent ne sont pas théologiques, mais scientifiques (les Astronomes) et judiciaires (Sénèque), c’est-à-dire précisément non dogmatiques. Ainsi, la « dispute sur des matières de religion » n’apparaît plus que comme un cas particulier d’une pratique beaucoup plus générale (faite par là pour nous rassurer), tandis que l’article progresse savamment des spéculations incertaines (le mouvement des astres, Galilée réfuté, les accusations et les défenses plus ou moins hasardeuses du prétoire) vers les vérités assurées de la Religion et les certitudes de l’Église.
Il faut remarquer cependant que, si la première partie de l’article spécifie bien pour la controverse l’opposition de deux opinions, des « opinions qui peuvent être soutenues de part et d’autre », cette opposition est progressivement réduite. Il ne s’agit pas de donner la parole aux hérétiques : c’est un seul prédicateur qui, en chaire, réduit l’hérésie, un seul discours qui, englobant le discours de l’Autre, le ramène au Même.
Enfin, la confusion est entretenue entre la controverse des chrétiens contre les hérétiques et celle des Catholiques contre les Protestants. Le dictionnaire superpose ainsi une tradition très ancienne, remontant aux Pères de l’Église et aux premiers conciles, qui ont établi les articles du dogme par l’exercice de la controverse, et une histoire beaucoup plus récente, celle de la Réforme et de la Contre-Réforme, où émerge malgré tout, en creux, l’idée de deux partis égaux, équivalents, affrontés.
C’est de cette superposition imparfaite que Diderot va tenter de tirer parti, en citant la formule par laquelle la définition générique de la Controverse bascule en modélisation d’un dispositif de contrôle idéologique : « On ne doit point craindre de troubler la paix du Christianisme par des controverses, quand il s’agit d’établir les vérités de la Religion. Rien n’est plus capable de ramener dans la bonne voie ceux qui s’en sont malheureusement égarés. » Car il y a un danger de la controverse : donner une audience, même contrôlée, même indirecte, aux thèses, aux discours de l’hétérodoxe ne risque-t-il pas de lui faire gagner du terrain dans l’opinion publique ? Les Jésuites parient le contraire et sortent en cela d’une simple gouvernance rhétorique de la parole : il ne s’agit pas seulement de peaufiner ses arguments, son raisonnement, son enchaînement ; il faut prévoir un dispositif dans lequel l’aléa de l’hérésie, l’impondérable de la parole de l’Autre et de ses effets, seront accueillis, circonvenus. L’hérétique, et nommément le Protestant, n’est plus un trouble mais une voie. Le trouble s’oppose à la paix comme une perturbation brouillant le discours monologique de l’institution : il n’a pas de statut audible, ne définit pas un type d’opinion face à un autre type. La mauvaise voie au contraire s’oppose à la bonne voie à égalité sur une même carte, dans un même espace. L’égalité est posée dans le discours du prédicateur entre les Catholiques et les Protestants ; mais depuis la Chaire, le prédicateur qui montre la carte, qui indique la bonne voie, est jésuite ; à l’égalité horizontale, rhétorique des deux discours, s’oppose l’inégalité verticale de la chaire et du public, du prédicateur et de ceux qui l’écoutent.
Diderot perçoit parfaitement le dispositif qui est en jeu et il le dénonce : « deux vérités dont nous croyons devoir faire honneur à cet ouvrage. Ajoûtons que pour que la controverse puisse produire les bons effets qu’on s’en promet, il faut qu’elle soit libre de part & d’autre. » Autrement dit, comme la pratique jésuite de la controverse, l’entreprise encyclopédique ne doit pas être perçue comme semant le trouble quand il s’agit d’établir des vérités ; comme les Jésuites, les Encyclopédistes ramèneront ceux de leurs lecteurs qui se sont égarés dans la bonne voie. Sans doute ne s’agit-il ni des mêmes vérités de religion, ni de la même bonne voie. Mais surtout cela ne peut se faire qu’à la condition que la controverse « soit libre de part & d’autre », c’est-à-dire que l’égalité horizontale des discours ne soit pas contrebalancée par l’inégalité verticale du dispositif.
Dans le Dictionnaire de Trévoux, l’article Controverse et ses apanages, Controversé, Controversiste, est fâcheusement suivi de Controuver, inventer une fausseté, une imposture. Sans doute l’enchaînement, qui fait ici figure de véritable inconscient jésuite du dictionnaire, a-t-il été remarqué par Diderot, qui s’arrange pour en proposer un tout autre. Dans l’Encyclopédie, l’article qui suit immédiatement Controverse est Contumace, « du latin contumacia, qui signifie desobéissance ». Diderot paraphrase la fin de l’article Contumace du Trévoux : « Ce mot vient du latin contumax, désobéissant. » En le plaçant en tête d’article, Diderot accentue l’effet de rapprochement avec Controverse, qu’il s’agit d’instituer en un dispositif social de désobéissance.
La dispute comme modèle social
C’est à l’article Dispute que ce dispositif est véritablement exploré et développé. La controverse était définie dans l’Encyclopédie comme une « dispute sur des matières de religion ». La dispute apparaît donc comme la forme générale du dispositif, dont la controverse n’est que l’application ou le dévoiement théologique.
L’article Dispute est, lui, du pasteur Formey (1711-1797), huguenot d’origine française résidant à Berlin. Formey a contribué en tout à 27 articles tout au long de l’Encyclopédie, dont quatre avec D’Alembert, un avec Daubenton, deux avec Jaucourt. La plupart sont des articles scientifiques (Continu, Liquide, Parhélie, Précession des équinoxes…), beaucoup sont des reprises de textes qu’il a déjà publiés. Dispute est développé et soigné, c’est un article d’apparat, comme en témoigne le rythme ternaire solennel de son entrée en matière :
DISPUTE, s. f. (Métaph. & Morale.) L’inégale mesure de lumieres que Dieu a départies aux hommes ; l’étonnante variété de leurs caracteres, de leurs tempéramens, de leurs préjugés, de leurs passions ; les différentes faces par lesquelles ils envisagent les choses qui les environnent, ont donné naissance à ce qu’on appelle dans les écoles dispute.
La naissance de la dispute est décrite pour ainsi dire théologiquement, d’abord comme décision divine d’une répartition inégale des lumières, puis comme tableau de la variété ainsi créée, enfin comme mise en œuvre de ces différences. Cette naissance d’une pratique présentée comme consubstantielle à la nature de l’homme, ou plus exactement comme suppléant nécessairement à son essentielle diversité, s’incarne dans un exercice scolastique, la dispute « dans les écoles » : Formey pose ainsi, discrètement mais sûrement, l’origine médiévale de la dispute, comprise comme exercice universitaire.
Les Lumières auraient dû balayer cette pratique d’un autre temps : c’est tout le contraire qui s’est produit.
A peine [la dispute] a-t-elle respecté un petit nombre de vérités armées de tout l’éclat de l’évidence. La révélation n’a pû lui inspirer le même respect pour celles qu’elle auroit dû lui rendre encore plus respectables. Les sciences en dissipant les ténebres, n’ont fait que lui ouvrir un plus vaste champ. Tout ce que la nature renferme de mystérieux, les mœurs d’intéressant, l’histoire de ténébreux, a partagé les esprits en opinions opposées, & a formé des sectes, dont la dispute sera l’immortel exercice.
Le développement de la dispute est décrit, avec une distance où perce la réprobation, comme un débordement, le débordement même de la polémique. Formey feint d’adopter le point de vue du théologien gardien de la foi pour décrire un phénomène qui se nourrit de lui-même et en vient à ignorer les « vérités », qu’il place à l’extérieur de lui. Il ne s’agit à aucun moment de plaider pour la tolérance, pour la coexistence pacifique de points de vue, de convictions divergentes. Le partage des « esprits en opinions opposées » porte atteinte à la recherche de la vérité. La dispute n’a aucun respect pour les dogmes du christianisme, dont la révélation est ici l’emblème. Depuis cet irrespect théologique que Formey réprouve, la gangrène de la dispute s’est étendue aux sciences : la science fournit de nouveaux sujets de dispute au lieu de les éteindre par l’accroissement des certitudes ; la nature, les mœurs, l’histoire définissent le vaste champ de la dispute comme le champ même de la culture humaniste. Dans l’humanisme subsiste le substrat scolastique de la dispute, qu’il s’agit de réduire. La recherche objective et factuelle de la vérité scientifique prend la suite de l’affirmation monologique du dogme religieux. La science positive constitue le nouveau modèle contre la dispute, contre le débat contradictoire : les Lumières se présentent comme la seule lumière de la vérité, comme l’éclat immédiat de l’évidence qui dissipe les ténèbres, contre le partage inégal des lumières, contre les opinions opposées qui forment les sectes, c’est-à-dire tout ce que l’histoire a de ténébreux.
Formey ne réclame pas cependant la disparition, ni l’interdiction des disputes, mais leur modération, c’est-à-dire en fait leur neutralisation :
La dispute, quoique née des défauts des hommes, deviendroit néanmoins pour eux une source d’avantages, s’ils savoient en bannir l’emportement ; excès dangereux qui en est le poison. C’est à cet excès que nous devons imputer tout ce qu’elle a d’odieux & de nuisible.
La logique de la dispute qui se développe ici est complètement paradoxale : alors que la dispute a pour origine une déficience naturelle (« quoique née des défauts des hommes » reprenant sous une forme atténuée l’entrée solennelle de l’article, « L’inégale mesure de lumieres que Dieu a départies aux hommes »), elle se retourne en « source d’avantages » qui supplée à cette déficience, ou au contraire précipite la société vers sa corruption et sa perte. La dispute est originaire : elle est le substrat de l’ancienne économie, antique et médiévale, du savoir ; mais la dispute a également connu un développement sans précédent avec la révolution épistémologique des Lumières. Comme origine, elle constitue le ressort, le principe du développement du savoir ; comme excès, elle rend ce savoir dangereux, odieux et nuisible. C’est là la logique du pharmakon platonicien qu’analyse Derrida : la dispute est « poison » et « avantage », que départagent la modération et l’excès dans son usage.
Il s’agit donc d’abord de convertir les hommes à cet usage modéré de la dispute, et pour cela de les amener à discerner la dispute du mensonge.
Si nous défendons la vérité, pourquoi ne la pas défendre avec des armes dignes d’elle ? Ménageons ceux qui ne lui résistent qu’autant qu’ils la prennent pour le mensonge son ennemi. Un zele aveugle pour ses intérêts les arme contre elle ; ils deviendront ses défenseurs, si nous avons l’adresse de dessiller leurs yeux sans intéresser leur orgueil. Sa cause ne souffrira point de nos égards pour leur foiblesse ; nos traits émoussés n’en auront que plus de force ; nos coups adoucis n’en seront que plus certains ; nous vaincrons notre adversaire sans le blesser.
La dispute modérée est décrite comme un combat paradoxal : au lieu d’attaquer nos adversaires, nous les ménageons ; au lieu de blesser leur orgueil, nous dessillons leurs yeux ; au lieu de profiter de leurs faiblesses, nous les respectons. De même que le poison de la dispute se change en avantage, de même les armes du combat sont plus efficaces d’être plus émoussées, atteignent mieux leur cible si nous faisons preuve de plus de douceur. La métaphore du combat indique ici l’articulation profonde de la dispute à la polémique : la bonne dispute est une guerre à l’envers ; c’est la guerre à l’envers qui permet de mettre en œuvre ici une logique du pharmakon.
L’enjeu de cette modération, c’est la reconnaissance de l’adversaire comme un autre soi-même, bien en deçà d’ailleurs des prescriptions évangéliques :
« Vous avez entendu qu’il a été dit : Œil pour œil et dent pour dent. Eh bien ! moi je vous dis de ne pas tenir tête au méchant : au contraire, quelqu’un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, tends-lui encore l’autre ; veut-il te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui même ton manteau. » (Matthieu, 5, 38-40)
Modérer la dispute, c’est introduire la soumission évangélique à la brutalité de l’Autre dans l’économie du Talion : le Talion, c’est la dispute originaire et l’ancienne Loi ; l’Évangile modère le Talion, superpose la Grâce à la Loi, et révèle en quelque sorte la Loi par la modération de la Loi. La modération de la dispute, sorte de point d’aboutissement du processus de débordement anarchique que Formey a commencé par décrire à l’origine de l’humanité, constitue alors un véritable modèle social qui devient à son tour l’origine de la société policée :
Une dispute modérée, loin de semer dans la société la division & le desordre, peut y devenir une source d’agrémens. Quel charme ne jette-t-elle pas dans nos entretiens ? n’y répand-elle pas, avec la variété, l’ame & la vie ? quoi de plus propre à les dérober, & à la stérilité qui les fait languir, & à l’uniformité qui les rend insipides ? quelle ressource pour l’esprit qui en fait ses délices ? combien d’esprits qui ont besoin d’aiguillons ? Froids & arides dans un entretien tranquille, ils paroissent stupides & peu féconds. Secoüez leur paresse par une dispute polie, ils sortent de leur léthargie pour charmer ceux qui les écoutent. En les provoquant, vous avez réveillé en eux le génie créateur qui étoit comme engourdi. Leurs connoissances étoient enfoüies & perdues pour la société, si la dispute ne les avoit arrachés à leur indolence.
Le renversement du désordre de la dispute en charme de la conversation est aussi un renversement des causalités : la dispute était le produit, l’aboutissement catastrophique du défaut humain naturel, de la différence instituée par Dieu dans la répartition des lumières ; la dispute devient « une source d’agréments », le fondement, l’origine d’une société où ces défauts, ces inégalités sont réparés.
Elle agit comme pharmakon, comme un remède qui se répand par contagion et retourne la variété des insuffisances naturelles, source de discorde, en variété des délices de l’esprit : variété qui n’est plus de nature, mais de langage, variété non plus subie, mais produite. Son efficacité est celle du plaisir de l’esprit, une jouissance de la dispute modérée, qui met en œuvre l’énergie fondamentale de la pensée. Point de pensée sans dispute : on reconnaît ici le modèle des Lumières.
La dispute peut donc devenir le sel de nos entretiens ; il faut seulement que ce sel soit semé par la prudence, & que la politesse & la modération l’adoucissent & le temperent. Mais si dans la société elle peut devenir une source de plaisirs, elle peut devenir dans les sciences une source de lumieres. Dans cette lutte de pensées & de raisons, l’esprit aiguillonné par l’opposition & par le desir de la victoire, puise des forces dont il est surpris quelquefois lui-même : dans cette exacte discussion, l’objet lui est présenté par toutes ses faces, dont la plûpart lui avoient échappé ; & comme il l’envisage tout entier, il se met à portée de le bien connoître. Dans les savantes contentions, chacun en attaquant l’opinion de l’adversaire, & en défendant la sienne, écarte une partie du nuage qui l’enveloppe.
De même que la dispute règle le lien social, elle organise le développement des sciences. Dans les deux cas, elle fonctionne comme « sel », c’est-à-dire comme catalyseur : la métaphore se situe ici à l’interface de la rhétorique (le granum salis de la pointe ou, négativement, l’arena sine calce que Tacite reprochait à Sénèque) et de la chimie :
SEL & SELS, (Chimie & Médecine.) on comprend sous le nom de sel trois especes de substances ; les acides, les alkalis, & les sels neutres ; en réunissant les proprietés communes à ces trois classes, on trouve que les sels sont des corps solubles dans l’eau, incombustibles par eux-mêmes, & savoureux; il faut bien se défendre d’appeller sel tout ce qui se crystallise, sans quoi nous confondrions plusieurs corps très-différens entre eux. (XIV, 903-904, article anonyme)
On est loin ici du sel de cuisine et, malgré la défense liminaire, force est de constater que tout l’article ordonne la différenciation des sels à partir des différents modes de cristallisation. Le sel, c’est la base de la chimie : semer le sel n’a de sens que dans un contexte chimique, où il s’agit de précipiter une réaction. La cristallisation intellectuelle et sociale que déclenche le sel de la dispute forme le précipité de la société des Lumières, mais peut à tout moment dégénérer en réaction incontrôlée.
« Source de plaisirs », « source de lumières » : la chimie de la dispute transforme le discours en énergie, la parole en jouissance et en esprit. La structure rhétorique de la dispute, son cadre logique, ses formes argumentatives, se dissolvent en plaisir de liaison et d’intellection. Cette première transformation en amène une seconde : l’objet de la dispute cesse de se définir comme un objet verbal pour être considéré, à distance, comme objet visuel, offert à la variété des points de vue : « l’objet lui est présenté par toutes ses faces », « il l’envisage tout entier ». Objet qu’on manipule pour en considérer tous les aspects, la dispute devient irréductible au seul flux monologique du langage et se déploie en trois dimensions sur la scène et à la lumière de l’esprit.
Ce déploiement, ce basculement du paradigme verbal vers le paradigme visuel précipite alors le revirement de la dispute, de la lumière vers les ténèbres, de la raison éclairée vers l’aveuglement fanatique :
Mais c’est la raison qui écarte ce nuage ; & la raison clairvoyante & active dans le calme, perd dans le trouble & ses lumieres & son activité : étourdie par le tumulte, elle ne voit, elle n’agit plus que foiblement. Pour découvrir la vérité qui se cache, il faudroit examiner, discuter, comparer, peser : la précipitation, fille de l’emportement, laisse-t-elle assez de tems & de flegme pour les opérations difficiles ? dans cet état, saisira-t-on les clartés décisives que la dispute fait éclore ? C’étoient peut-être les seuls guides qui pouvoient conduire à la vérité ; c’étoit la vérité même : elle a paru, mais à des yeux distraits & inappliqués qui l’ont méconnue ; pour s’en venger, elle s’est peut-être éclipsée pour toûjours.
Ce que la dispute a contribué à faire apparaître à la lumière de la raison, elle le dérobe ensuite en déclenchant le trouble, les nuages, l’obscurité. La scène de la dispute produit à la fois, émanant d’elle comme action et faisant retour vers elle comme vérité, « ses lumières », « les clartés décisives » qui l’éclairent d’une part, « ce nuage », « le trouble », « le tumulte », l’éclipse qui l’obscurcit d’autre part. Face à la scène de la dispute, produit par elle, le rideau se change en lumière, puis la lumière en rideau, en une chaîne inexorable d’actions et de réactions.
Après une longue description des excès de la dispute, qui généralisent la méconnaissance, Formey finit par recourir à la métaphore de la contagion : c’est le mouvement du fanatisme.
Enfin l’emportement dans la dispute est contagieux ; la vivacité engendre la vivacité, l’aigreur naît de l’aigreur, la dangereuse chaleur d’un adversaire se communique & se transmet à l’autre : mais la modération leve tous les obstacles à l’éclaircissement de la vérité ; en même tems elle écarte les nuages qui la voilent, & lui prete des charmes qui la rendent chere. Article de M. Formey.
Au dernier moment, aux dernières lignes de l’article, alors que Formey en est arrivé aux excès ultimes de la dispute, le débordement s’arrête, l’excès laisse subitement la place à la modération, et la métaphore scénique des Lumières peut à nouveau faire tomber l’écran et restituer la clarté, la vérité, les charmes de la dispute.
Ce qui est extraordinaire dans cet article, c’est le revirement qui s’y opère, non comme un progrès définitif, mais au contraire comme une alternance perpétuelle des causalités et des luminosités. D’un côté, le charme de la conversation et l’émulation scientifique ; de l’autre, la catastrophe politique du fanatisme, la corruption consubstantielle des Lumières. La dispute est l’interface entre cet avers et cet envers des Lumières et constitue, par là, le principe de la polémique comme monde.
II. Dispositif de la dispute : dispute monologique et dispute dialogique
Nul doute que la dispute n’ait des résonances toutes personnelles, et familiales, pour le pasteur Formey, et le choix que Diderot fait de confier cet article à un descendant d’émigrés protestants français est lourd de sens. Le moment de la Réforme a été le moment du basculement de la dispute comme exercice théologique vers la polémique comme monde. Ce basculement implique à la fois une tolérance institutionnelle de la pluralité des points de vue et la prise en compte, la gestion d’un débordement polémique hors des cadres réglés de la dispute. Le conflit de la Réforme cristallise politiquement et idéologiquement ces exigences de transformation, que la fin du Moyen Âge portait déjà en elle, au travers notamment des mutations de la dernière scolastique et des exercices universitaires qui accompagnaient et nourrissaient son enseignement.
Ce basculement révolutionne les esprits, le rapport de l’homme à la parole, la manière dont la communauté accueille la contestation, la dissidence, la subversion. Il ne se traduit pas nécessairement pour autant par des transformations politiques immédiates. C’est pourquoi un tel basculement immatériel, pourtant décisif, ne peut être saisi par le seul examen historique et juridique des événements et des institutions. Il se manifeste d’abord dans la représentation qu’une communauté se fait, se donne de la dispute et de son débordement polémique, dans la manière dont elle articule cette représentation à son identité même. Pour saisir cette représentation, l’étude des représentations artistiques, visuelles, plastiques de la dispute s’avère donc essentielle.
Le Christ disputant contre les Docteurs

La dispute est d’abord théologique ; l’iconographie ancienne également. Le sujet sacré qui sert de matrice à tous les autres est celui du Christ disputant avec les Docteurs. Dans le livre d’heures d’Enkhuizen6, de la fin du XVe siècle, conservé à la bibliothèque bodléienne d’Oxford, l’enluminure du folio 39 représente des personnages assis en cercle et conversant. En haut à droite, un jeune homme vêtu de bleu, tient un livre. Sa barbe à deux pointes symbolise l’ancienne et la nouvelle loi : il porte, aux côtés du Christ, le nouvel enseignement, de la nouvelle génération7 ; en bas à gauche, un vieillard barbu, index de la main droite levé, lui porte la contradiction. Tout en haut au centre, Jésus enfant, dont les pieds nus dépassent de la tunique bleue, synthétise et conclut, énumérant ses arguments qu’il compte de son index gauche sur les doigts de sa main droite.
Le cercle que forment les disputants assis constitue la structure horizontale, apparemment égalitaire, du dispositif. Mais l’image se lit également verticalement, avec le Christ en haut, assis sur le siège magistral surélevé par une estrade, et les Docteurs sous lui, assis sur de simples bancs. Les couleurs des vêtements indiquent également une hiérarchie, du vert de la trahison et de l’hérésie vers le rouge de l’incarnation et enfin le bleu de la foi.
Dans cette hiérarchie, le sujet, Jésus parmi les docteurs, introduit cependant un renversement : dans la position d’autorité magistrale, il place un enfant aux pieds nus, alors que sur le banc de l’école ce sont les maîtres qui sont assis. La seconde perturbation, à peine perceptible sur cette enluminure, est mise en œuvre par les deux personnages en haut à gauche, le couple debout qui vient d’arriver par la porte qu’on distingue derrière lui et, de fait, ne participe pas à la docte assemblée : ce sont Marie, vêtue en moniale avec sa robe bleue et son mouchoir de cou, et le vieux Joseph, tête nue, appuyé sur son bâton.
Joseph et Marie ont enfin retrouvé leur fils, disparu depuis trois jours8 : ils viennent d’arriver dans le temple, mais Jésus ne semble pas les avoir remarqués.
On voit ici se dessiner le dispositif magistral de la dispute dans son organisation médiévale : la pluralité des discours s’y exprime horizontalement, sous le contrôle vertical du Christ. Ce contrôle est lui-même doublement perturbé : l’enfant enseigne aux docteurs, cette hiérarchie est une hiérarchie inversée ; l’enfant est cherché par ses parents, qui pourraient rompre le cercle qu’il institue. Le dispositif ne se réduit pas au double jeu, à la tromperie jésuitique des deux structures, horizontale et verticale ; il gère ces perturbations, il s’adapte souplement à elles et en tire parti : la valeur théologique de l’enseignement du Christ tient essentiellement à la manière dont il se nourrit de son propre débordement. Cette doctrine n’est pas la doctrine d’un docte, elle est à la fois divine et enfantine ; c’est un enseignement et c’est l’incartade d’un chenapan que ses parents viennent chercher. Le cercle et le siège magistral garantissent la perfection, la solidité de la Parole ; mais la perturbation du cercle permet, promet son ouverture au monde.

À partir de ces principes, le dispositif connaît toutes sortes de variations pour imager la double perturbation qui le constitue : dans la bible historiale d’Utrecht conservée à la bibliothèque royale Meermanno de La Haye (1430), Jésus est agenouillé au centre de la salle capitulaire où siègent les docteurs, il passe son examen universitaire9. Mais placé devant la colonne depuis laquelle rayonnent les nervures gothiques rouges qui soutiennent l’ensemble du plafond de la salle, le Christ devient la colonne. Marie et Joseph assistent à sa performance depuis la gauche de l’enluminure, au seuil de la synagogue, sur les marches de son entrée, derrière une colonne grise qui en compartimente les espaces : à l’espace sacré, de la représentation proprement dite, s’oppose l’espace profane, depuis lequel elle menace certes d’être interrompue, mais, aussi, elle est diffusée dans le monde.
Dans l’interprétation qu’en propose Duccio pour la Maestà de Sienne (1308-1311)10, pourtant antérieure de plus d’un siècle aux précédentes, Jésus assis sur une estrade tourne la tête vers ses parents, qui manifestent très démonstrativement leur joie d’avoir retrouvé leur fils : la compartimentation de l’espace, que rappellent les colonnes du fond, oppose bien encore le lieu de la dispute, à droite, avec son demi-cercle de docteurs, à l’irruption profane à gauche de Marie et de Joseph, hors-cercle. Mais cette structuration de l’espace est elle-même concurrencée par une nouvelle organisation, scénique, articulée autour de l’échange de regards entre les parents et le Christ, barré par l’écran des vieillards interposés. Duccio peint exactement le moment de la réplique de Jésus, rapportée dans l’évangile de Luc : « Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ? » (Luc, 2, 49).
Giotto, quant à lui, dans la chapelle Scrovegni de Padoue11, place Jésus à la même hauteur que les docteurs, mais installe derrière lui une abside flanquée de deux absidioles qui projette de fait l’Enfant à la place d’un Christ en Majesté. Jésus ne tourne pas franchement la tête vers sa mère qui lui tend les bras, mais esquisse un énigmatique mouvement des yeux : la scène est indiquée, mais n’est qu’esquissée.
Le mouvement de théâtralisation scénique de la dispute ne s’opère donc pas, dans un premier temps, de l’intérieur du cercle magistral, mais au contraire par la prise en compte d’un espace profane extérieur à la dispute, depuis lequel surgissent Marie et Joseph.

Lorsque le Tintoret réinterprète l’épisode en 154212, c’est précisément en prenant le point de vue profane de Marie qu’il présente le spectacle incroyable, incompréhensible qu’elle est censée avoir découvert en pénétrant dans le Temple après trois jours de recherches et d’angoisse. Marie, debout au premier plan à gauche, vêtue en femme du peuple d’une simple robe bleue et d’un fichu blanc sur la tête, avec ses gros bras, ses chevilles épaisses et ses pieds nus, sert d’embrayeur visuel par lequel le spectateur pénètre dans la scène. L’impression est d’un désordre indescriptible, ils s’agitent tous avec des livres énormes, disproportionnés : Marie est impressionnée par les livres, qui lui paraissent d’autant plus grands. Elle cherche des yeux son fils, elle ne le voit pas d’abord, il est tout au fond. Elle ne comprend qu’il préside le cercle magistral qu’au moment où, l’ayant aperçue, il tend les bras vers elle. Les retrouvailles de la mère et de l’enfant viennent brouiller la leçon médiévale du dispositif magistral inversé, dont on distingue encore la structure de référence.

Véronèse, dans la composition qu’il imagine en 156613, achève de déconstruire le dispositif gothique par compartiments : le supplément du réel (Joseph et Marie en plus de la leçon du Christ), qui semble venir parasiter la leçon symbolique chez Duccio et Giotto, devient le principe depuis lequel se déploie la scène. Véronèse installe la dispute dans une grandiose basilique de style palladien, au centre de laquelle le Christ assis sur une estrade de marbre prêche avec véhémence, l’index droit pointé vers le Ciel qu’il atteste à l’appui de son propos.
Le jeu architectural savant des colonnes ordonne une tripartition de l’espace : un premier espace à gauche est séparé de la prédication par un pied de colonne disposé au premier plan ; cet espace renvoie au lieu traditionnellement dévolu à l’arrivée de Marie et de Joseph, mais il est ici occupé par un groupe de docteurs en pleine discussion autour d’un livre ouvert : le système des compartiments gothiques est donc suggéré, mais éludé. Un second espace à droite est encadré, au fond, par les colonnes serrées d’une tribune fortement éclairée. Sur le fond de cette colonnade claire se détache le public de Jésus, qui l’écoute attentivement et vérifie dans un livre la validité de ce qu’il dit.
Sur la première marche de l’estrade, en bas donc, mais à équidistance des deux côtés du tableau, un sablier est installé qui mesure le temps de parole du Christ. Le sablier fait référence aux contraintes de l’exercice universitaire de la dispute : Véronèse peint à Venise, tout près de Padoue qui est alors une des universités les plus prestigieuses du monde. Le sablier fait ressortir le léger décalage du Christ vers la gauche, compensé à droite par l’arrivée de Marie, depuis la porte du fond qui désigne le point de fuite du tableau, son œil interne depuis lequel la scène se déploie. Jésus parlait, le temps s’arrête, Marie vient le chercher : le moment scénique condense les temporalités ; il les spatialise aussi.
Le doigt de Jésus pointé vers le Ciel est une innovation de la Renaissance : dans l’iconographie et plus globalement dans la culture médiévales, le Christ est le Ciel, qu’il n’a donc pas besoin d’attester. Ce doigt opère une scission entre le lieu et l’objet de la dispute, scission constitutive de l’espace scénique. Toute la composition répercute ce léger décalage : le Christ est à la colonne, comme déjà pour la Flagellation (dans la bible d’Utrecht, le Christ était la colonne) ; la parole du Christ est la parole de Dieu, mais le Christ attestant le Ciel se dissocie ainsi indirectement de lui ; le sablier est décalé par rapport à l’orateur, Marie par rapport au sablier… Enfin, l’ordonnance médiévale en demi cercle des docteurs écoutant l’enfant Jésus ne demeure visible que décalée, et paradoxalement déstructurée par la structure architecturale : les marches de la chaire au centre, la colonnade de droite, sont les pièces architecturales de l’ancienne ordonnance, mais ordonnent un espace qui n’a plus rien à voir avec elle. Le Christ parle depuis une chaire qu’encadrent deux colonnes placées au centre de l’édifice circulaire de cette étrange synagogue. Mais la chaire est vue de biais, de sorte que la symétrie des deux colonnes centrales ne se perçoit plus immédiatement, et qu’elle ne se trouvent plus d’ailleurs elles-mêmes au centre. La colonne de derrière se confond avec la colonnade en hauteur qui ouvre la circonférence de l’édifice sur l’extérieur (on distingue le ciel et les nuages entre les colonnes). Du coup la colonne de devant, placée au premier plan, seule et en pleine lumière, devient la colonne et prend une importance décisive dans la composition d’ensemble. Cette colonne, le Christ prêchant (plutôt que disputant), et la porte du fond, où se masse la foule, peuvent constituer trois centres, trois pivots possibles à partir desquels répartir les groupes de personnages et les systèmes d’articulation et d’opposition qu’ils constituent. Le milieu exact de la toile est indiqué par le sablier au pied du Christ, entre le Christ donc et la porte.
On constate le même brouillage de l’ordonnance médiévale dans la disposition des docteurs qui participent à la dispute. Tintoret maintient un groupe à gauche et un groupe à droite, de part et d’autre du Christ, mais de fait le Christ prêche devant le groupe des docteurs à droite, qui sont devenus des spectateurs, tandis que ceux de gauche, derrière lui, troublent et tentent d’empêcher la prédication. Le génie du Tintoret a consisté, à partir de cette structure différentielle simple, à généraliser la réprobation, à gauche comme à droite du Christ, et à varier les manifestations de ce refus : détournement du regard, plongée dans un livre, impassibilité, ironie… Le Christ ne sait plus où donner de la tête, il est débordé : de la main et de la jambe gauche, il indique qu’il s’adressait à son public à droite ; mais sa tête et son buste se tournent vers la gauche pour répondre à ses contradicteurs derrière lui.
Dans le texte évangélique, comme dans l’iconographie médiévale, il n’est jamais question d’approuver ou de désapprouver une parole qui serait nouvelle, mais de s’émerveiller de la maîtrise du savoir des Anciens par un enfant. Ici, ce n’est plus une docte assemblée où la parole circule à partir et autour du magister enfant ; c’est un prêche et sa contestation : d’un côté la théâtralisation d’une scène de prédication, de l’autre, le tumulte, la coulisse et le débordement d’une dispute.
Du public des docteurs spectateurs à droite se détache l’homme assis au premier plan, vêtu de bleu noir, la même couleur que celle de la tunique du Christ. À cause du jeu symétrique des couleurs, il fait figure d’opposant et émerge comme représentation d’une opinion contradictoire opposée à celle du protagoniste de la dispute : c’est lui que le Christ désigne de la main gauche tandis qu’il parle. Symétriquement, si l’on suit le regard du Christ, il s’adresse à l’homme au turban debout à gauche qui, tenant encore la main sur la poitrine dans la posture de l’orateur, vient à peine de finir de parler. Si Jésus n’est nullement assis au milieu des docteurs, comme le précise le récit de Luc et le représente l’iconographie médiévale, il n’est plus non plus en position magistrale, monologique et univoque, d’enseignement mais dans un jeu dialogique d’objections et de contadictions qui va bien au-delà de ce qu’évoque l’Évangile, « écoutant et interrogeant », audientem illos et interrogantem. Ce jeu permet à Véronèse d’inscrire le moment scénique du tableau dans une succession narrative : de gauche à droite, l’homme au turban achève son discours, le Christ lui répond et s’apprête à donner la parole à l’homme en noir assis à droite.
On sort donc du dispositif magistral médiéval, qui subsiste comme infrastructure architecturale de la scène, pour entrer dans le dispositif de la dispute moderne, fondée sur le face à face dialogique et l’équilibre des points de vue opposés. Un dispositif se défait, un autre émerge, ce qui donne l’impression d’un désordre, d’un brouillage dans la composition.
Catherine d’Alexandrie face aux philosophes
Il est vrai que Jésus dispute avec les docteurs, et non contre eux : l’épisode ne représente pas a priori le combat de deux doctrines opposées, même s’il a pu, rétrospectivement et allégoriquement, être compris et interprété comme la dispute de la nouvelle foi contre l’ancienne, et comme l’opposition de l’ancienne loi, longuement méditée par les sages, et de la nouvelle loi, immédiatement reçue par la révélation et la grâce, susceptible donc de s’incarner dans un enfant ou un très jeune homme.
Mais il ne s’agit en fait jamais d’opposer frontalement deux doctrines, deux points de vues opposés. La dispute de Catherine d’Alexandrie contre les cinquante philosophes païens réunis par l’empereur Maxence donne un exemple saisissant de ce paradoxe. L’histoire est censée se dérouler à Alexandrie au début du IVe siècle, même si la légende de Catherine n’est attestée qu’à partir du IXe siècle14. Jacques de Voragine la rapporte dans La Légende dorée. Maxence a déclenché la persécution des chrétiens à Alexandrie. Catherine, jeune princesse lettrée, se rend auprès de lui et entreprend de le convertir. Déconcerté, Maximien convoque les cinquante meilleurs « grammairiens et rhéteurs » de l’empire, qu’il invite à entendre Catherine et à la confondre par leurs arguments15. Mais c’est le contraire qui se produit : Catherine les convertit au christianisme et, du coup, les envoie au supplice.
Jacques de Voragine insiste sur le caractère paradoxal de cette dispute, à laquelle les professeurs de rhétorique convoqués daignent à peine, au début, assister, indignés d’un tel renversement des rôles :
« Ils demandèrent à l’empereur, pourquoi ils avaient été convoqués de si loin ; et César leur répondit : “Il y a parmi nous une jeune fille incomparable par son bon sens et sa prudence ; elle réfute tous les sages, et affirme que tous les dieux sont des démons. Si vous triomphez d’elle, vous retournerez chez vous comblés d’honneurs.” Alors l’un d’eux plein d’indignation répondit avec colère : “Oh ! la grande détermination d’un empereur qui, pour une discussion sans valeur avec une jeune fille, a convoqué les savants des pays les plus éloignés du monde, quand l’un de nos moindres écoliers pouvait la confondre de la façon la plus leste !” »
La dispute de sainte Catherine désigne ainsi clairement son modèle évangélique, la dispute de Jésus enfant avec les docteurs du Temple : c’est un dispositif magistral renversé, où non seulement les maîtres se trouvent temporairement placés en position de disciples, mais où l’élève vient renverser le savoir et les certitudes des maîtres.
On ne saurait trop insister sur ce point : le récit de Voragine n’oppose jamais deux discours, alors que le dispositif de la dispute suppose deux thèses, deux idéologies affrontées. La dispute est monologique, seule compte la parole de Catherine, elle seule est rapportée : ce n’est d’ailleurs pas à proprement parler à des philosophes, comme il sera dit dans les versions plus tardives de la légende, mais à des rhéteurs que Catherine est confrontée, c’est-à-dire à des techniciens du langage et du raisonnement, convoqués pour juger un exercice d’école. Et pourtant, quoique monologique, la dispute est profondément, intrinsèquement subversive : elle est l’exercice rhétorique, technique de l’école et elle est en même temps le renversement radical de cet exercice, sa subversion idéologique. La dispute met une compétence rhétorique, un jeu monologique normé, au service d’un renversement, d’une subversion, que porte le dispositif magistral renversé.
L’iconographie de la Dispute de sainte Catherine recourt aux mêmes modèles et connaît la même évolution historique que la Dispute de Jésus avec les docteurs. Il faut d’abord signaler une fresque de l’école romaine, peinte à la fin du XIIIe siècle pour l’église Sainte-Agnès-Hors-les-murs, et conservée à la Pinacothèque du Vatican16. Maximien, depuis son trône, y présente de sa main droite levée, Catherine, à gauche, aux rhéteurs, à droite. Catherine porte la main à la bouche, la parole est son arme. Le rhéteur qui s’avance face à elle, à droite, tient dans ses mains un livre, symbole du savoir mort des Païens. Ce face à face, tout à fait exceptionnel, n’est pas une représentation de la Dispute proprement dite : l’empereur séduit par Catherine est mis en avant, en position de départager deux parties aux prises. Le modèle convoqué ici est celui du jugement, que l’on retrouve par exemple dans les Jugements de Salomon.
En revanche, dans la fresque de Masolino da Panicale peinte dans la chapelle Barda Castiglioni de l’église Saint-Clément à Rome au début du XVe siècle17, le dispositif magistral est pleinement exploité. Les philosophes sont assis sur des bancs en demi cercle, leur séance est présidée par l’empereur qui siège en position de préséance, mais aussi de retrait. Cette présidence muette, ou morte, constitue la grande innovation par rapport aux Disputes de Jésus. Catherine, debout dans le demi-cercle, n’a pas de place dans le dispositif : elle est l’élément perturbateur, qui ne peut s’asseoir ni au banc des rhéteurs, ni sur le trône de Maxence, et pourtant captive, fédère toutes les attentions. Sa compétence rhétorique est signifiée par le jeu de ses mains énumérant méthodiquement ses arguments. À l’arrière-plan, à droite, par la fenêtre, Masolino a peint la séquence suivante, le supplice des philosophes convertis, que Catherine admoneste doctement tandis qu’ils périssent dans les flammes. En quelque sorte, cette fenêtre fonctionne comme une bulle : le discours de conversion de Catherine promet à ses auditeurs fascinés le martyre. Alors, dans la fenêtre-bulle, Catherine obtient la position de préséance, conduisant, dirigeant le martyre des philosophes en l’absence de Maxence. Le martyre parachève ainsi le renversement du dispositif magistral.
Dans la fresque de Bicci di Lorenzo18, peinte à peu près au même moment et conservée au musée Badini de Fiesole, Catherine fait face à l’empereur. Le dispositif, exposé latéralement et non plus frontalement, est en fait le même : l’empereur siège au centre et au-dessus des rhéteurs assis en demi cercle et tenant les livres ouverts de leur savoir éteint. Catherine s’avance un livre sous le bras et levant un doigt vers le Ciel qu’elle atteste : l’homme en vert, le sceptique, tente de l’arrêter. Pour représenter jusqu’en bas le drapé de son beau manteau rouge, l’artiste a interrompu la fabrique sur laquelle les rhéteurs du premier plan sont assis de dos. Catherine est l’interruption, elle est ce qui perturbe le dispositif magistral et, par cette perturbation, déclenche la dynamique de la dispute.
À la fin du XVe siècle, ce dispositif se défait, et la fresque du Pinturicchio19 pour la salle des Saints dans l’appartement Borgia du Vatican est un exemple saisissant de cette mutation décisive. Catherine en tunique bleue semée de croix d’or, drapée d’un manteau rouge, se détache à peine, dans la partie gauche de cette vaste composition cintrée, face au trône de Maxence entouré de sa cour : de ce côté on ne lit pas les livres, répandus ouverts sur les marches du trône. La cour de Maxence demeure fidèle à la religion de l’empereur, tandis que dans la partie droite le groupe qui lit des livres désigne les fidèles de la nouvelle religion. Le rapport au livre est donc désormais qualifié positivement.
Le demi-cercle du dispositif magistral est toujours là, mais en quelque sorte disséminé. Il n’est plus formé par les cinquante rhéteurs censés écouter Catherine, mais par la forme même de la fresque, que répercute, dans la composition, l’ordonnance architecturale du lieu. C’est en effet l’arc de Constantin, au fond et au centre de la composition, qui en quelque sorte préside à la Dispute, dont les assistants se répartissent en deux groupes latéraux. Les personnages du centre, Catherine à gauche, l’enfant au livre et le jeune homme qui rejoint les chrétiens, sont les protagonistes de la perturbation.
La Dispute n’est donc plus présidée par Maxence, l’éphémère empereur persécuteur des chrétiens, mais, symboliquement, par son successeur Constantin, vainqueur de Maxence au Pont Milvius. L’arc est surmonté d’un bœuf, emblème des Borgia, et la devise antique, « Pacis cultori », inscrite en or sur fond bleu sous le bœuf, devient le slogan politique du pape Alexandre VI. Toute la composition est d’ailleurs contaminée par la représentation de la scène politique du moment. C’est en Lucrèce Borgia, la fille du pape, que Pinturicchio a en effet peint Catherine, tandis que son éphémère mari, le bâtard Giovanni Sforza qu’elle vient d’épouser, apparaît au premier plan à gauche, en habit rouge et or d’apparat. Entre l’empereur et Catherine-Lucrèce, Pinturicchio a peint le prince Djem, coiffé du turban des Turcs : Djem, fils cadet de Mehmet II, le conquérant de Constantinople, était exilé à Rome sous la protection des Borgia, après avoir été détrôné par son frère Bajazet. Faut-il voir dans le jeune homme qui nous tourne le dos au premier plan et tend une main vers le livre qui lui est présenté, une représentation de César Borgia, fait cardinal, et que son père entendait malgré lui tourner vers la carrière ecclésiastique ?
Il est difficile d’interpréter le sens politique exact de cette fresque. Ce qui est sûr, c’est que le demi-cercle de la Dispute s’ouvre, s’élargit, et devient scène familiale et politique, qui n’est plus qu’accessoirement présidée, sur le côté, par un empereur fantoche, mais s’ordonne en revanche avec force à partir de l’arc de Constantin, lequel préfigure déjà un décor de fond de scène, avec le jeu tri- ou quadripartite des compartiments : en 1493 paraissait en effet à Lyon une édition illustrée du théâtre de Térence, où ce type de fond de scène était systématiquement utilisé20.
Dans la fresque du Pordenone pour la chapelle Sainte-Catherine de l’église Santa-Maria di Campagna, à Piacenza (1529-1530)21, l’empereur est installé en surplomb sur un balcon à droite, des spectateurs sont ajoutés au fond, tandis que sur ce qui devient la scène c’est l’effet de tumulte, d’effervescence — un vieillard consultant fébrilement un livre posé à terre, un autre à gauche tentant d’interrompre la sainte de ses deux mains ouvertes, un groupe à droite se retournant pour discuter — qui remplace l’ordonnance en demi cercle du dispositif magistral médiéval. La dramatisation de la scène défait le dispositif magistral et introduit une temporalité scénique du même ordre que celle à l’œuvre dans la Dispute de Véronèse : le vieillard de gauche, en manteau orange doublé et bordé de bleu, avançait ses arguments, Catherine lui répond en invoquant le Ciel, le vieillard de droite, en tunique et toque bleue fourbit en attendant ses arguments, qu’il énumère sur les doigts de sa main gauche. Depuis la tribune, en haut à droite, Maxence intervient lui aussi, tandis que les spectateurs au fond, bras croisés sur la poitrine, affichent leur incrédulité. Non seulement la dispute cesse d’être monologique, mais le désaccord domine : théâtralisation et dialogisation convergent vers l’expression d’une mésentente fondamentale.
L’étape suivante dans le processus d’intégration de la Dispute par le dispositif scénique est l’effacement de l’empereur Maxence : dans le dessin de Lodovico Cardi (1602-1603), conservé à Chicago22, comme dans l’esquisse de Johann Lucas Kracker (1775), qui se trouve à Budapest, Catherine est montée sur une estrade et environnée par le tumulte des rhéteurs qui lui sont opposés : à peine reconnaît-on l’empereur en haut à gauche, sous un dais dans le dessin de Cardi. A peine Catherine parle-t-elle ; elle s’expose. Derrière elle, Cardi, oubliant apparemment que Catherine fut condamnée à la roue et non au bûcher, a dessiné deux porteurs amenant les fagots qui alimenteront le feu d’ores et déjà allumé au fond. La Dispute et le martyre qui s’ensuivit fusionnent en une seule scène.
Dans l’édition de son Martyre de sainte Catherine, en 1643, Puget de la Serre fait graver cinq estampes illustrant les cinq actes de sa tragédie. Celle de l’acte IV23 représente la scène 4, où Catherine comparaît devant le philosophe Lucius en présence de l’empereur et de son épouse. Pour adapter l’histoire à la scène, Puget de la Serre a réduit les cinquantes rhéteurs à cette unique figure, qui permet l’instauration d’un face à face. Il faut comparer ce duel verbal sur les tréteaux de la scène (le dessinateur souligne la facticité théâtrale de la scène en représentant les tréteaux) avec le face à face du treizième siècle peint à fresque pour Sant’Agnese fuori le mura. L’empereur et sa femme, toujours placés au centre de la composition, non seulement ne sont pas surélevés, mais assistent en spectateurs à l’affrontement, en retrait, grâce au renfoncement que ménage le compartiment central du décor. Au 13e siècle, Maxence accueille de la main, présente Catherine ; au dix-septième, il se tourne vers elle pour manifester son intérêt. Le demi-cercle magistral subsiste architecturalement, mais de part et d’autre du tapis qui délimite l’espace restreint de la scène, c’est l’occupation des lieux qui est désormais en jeu : Le rhéteur occupe le coin arrière gauche du tapis, mais semble déjà reculer, tandis que Catherine s’avance par le milieu droit, prenant en quelque sorte possession du lieu. Cette occupation est surveillée de toutes parts : la même scène est vue de différents points de vue, point de vue des licteurs derrière le trône ; point de vue du soldat debout au premier plan à gauche, qui sert d’embrayeur visuel à la scène ; point de vue surplombant des statues en buste disposées sur la balustrade supérieure du décor.
Les premiers conciles
Sans doute la Dispute de Jésus avec les docteurs, ou la Dispute de sainte Catherine contre les cinquante meilleurs rhéteurs de l’empire romain peuvent-ils apparaître, à première vue, comme des épisodes circonstanciels dans le patrimoine culturel religieux occidental. Il n’en est pourtant rien. Le renversement du dispositif magistral qu’ils mettent en œuvre constitue le socle de la fabrique symbolique de nos sociétés.
Dans les premiers temps de l’Église, ce sont les Conciles qui fixèrent non seulement les canons du dogme mais les institutions de l’Église, qui elles-mêmes servirent de modèle aux institutions politiques laïques, ou au moins les influencèrent. Le concile est le dispositif où se décident et se transforment non seulement les articles de la foi, les prescriptions du licite et de l’illicite, mais les rapports de force politiques au sein de l’empire, puis de la société médiévale.
Or le fonctionnement du Concile, sa disposition même est celle de la Dispute et n’a donc rien à voir avec celle, judiciaire et beaucoup plus tardive, de l’Inquisition. Lorsque Arius et ses disciples sont mis en accusation et condamnés comme hérétiques, lors du premier concile de Nicée en 325, ce n’est pas à proprement parler un procès qui est intenté aux sectateurs d’une hérésie, puisque la loi est à faire, le dogme à fixer. Les plus grands théologiens du temps prennent la parole au concile et participent à cette élaboration dogmatique : même discordantes, les voix participent à la construction d’une seule Église. Les points de théologie qui sont mis en avant sont souvent extrêmement subtils et donnent l’occasion aux orateurs de déployer toute leur habileté et leur virtuosité rhétoriciennes : le concile n’est pas un procès ; l’objet avoué de ces joutes n’est ni d’accuser ni de se défendre, mais d’élaborer, d’éclaircir, de trancher collectivement tel ou tel point de doctrine. La condamnation voire l’exécution des membres de tel ou tel courant, parti, secte n’est donc en quelque sorte qu’un dommage collatéral de ce processus.

L’une des plus anciennes représentations du concile de Nicée est un dessin figurant dans une compilation de droit canon du début du IXe siècle, conservée à la bibliothèque capitulaire de Verceil, dans le Piémont24. Le concile y est présidé, sur un pied d’égalité, à gauche par l’empereur Constantin entouré de sa garde, à droite par un moine portant la tonsure, peut-être l’évêque Ossius de Cordoue, instigateur politique du concile de Nicée. Sous eux, les participants du concile, disposés en deux files parallèles, sont occupés à brûler les livres hérétiques ariens. La disposition n’est pas encore celle du demi-cercle magistral de la dispute, mais une organisation quadripartite de l’espace, fondée sur la symétrie de la gauche et de la droite (du pouvoir politique et du pouvoir théologique) et sur l’opposition du haut et du bas : en haut, Ossius indique la Bible comme seule référence, tandis qu’en bas tous les autres livres sont brûlés.
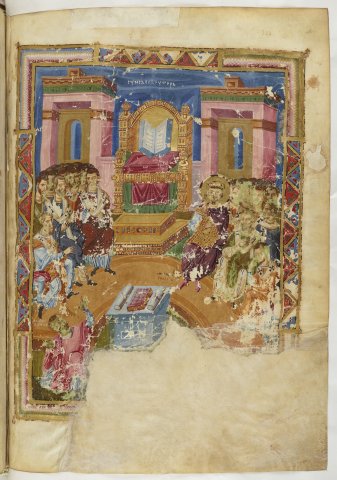
Quelques décennies plus tard, vers 880, une enluminure d’un manuscrit des Homélies de Grégoire de Naziance conservé à la bibliothèque nationale25 représente le concile de Constantinople selon une disposition toute différente : en haut au centre, présidant au concile, est installé un trône d’or sur lequel une bible est ouverte. Sous ce trône-tabernacle, les participants au concile sont assis en demi cercle, la forme du demi-cercle étant répétée au sol.
La disposition de base à partir de laquelle cette image est composée est celle du dispositif magistral, le magistère étant tenu ici par le livre posé ouvert sur le trône tabernacle. On remarque au centre du cercle des participants à la discussion conciliaire une table sur laquelle sont posés un livre et deux parchemins, contenant sans doute les formules de Nicée auxquelles les orateurs devaient probablement souscrire avant de prendre la parole. Chaque orateur vient à la table pour parler, comme un fidèle à la messe pour communier. Les orateurs ne s’opposent pas, ne se partagent pas : ils viennent à la table ; la table est le gage, la figure de cette communion monologique continuée.
Malheureusement, la partie inférieure du manuscrit est très abîmée : il est possible qu’en bas à gauche soient figurés Marcien de Lampsaque et Eleusius de Cyzique, chefs de file des opposants, quittant le concile. En haut à droite, Grégoire de Naziance, chef de file des partisans de Nicée, tout juste nommé évêque de Constantinople par Théodose contre son prédécesseur arien, est reconnaissable à son auréole. Mais il ne préside pas. Comme dans les représentations de Jésus parmi les docteurs, on assiste à un renversement du dispositif magistral, mais d’une autre manière : ce n’est pas le rapport des élèves et des maîtres qui est inversé, mais le rapport des disputants et du livre. Le livre n’est pas l’instrument de la Dispute, mais la Dispute — l’instrument du Livre. La Dispute produit la loi de l’Église sous le magistère du Livre.
Une enluminure du quinzième siècle représentant le concile de Nicée26 témoigne ensuite de la contamination du dispositif magistral par le jeu scénique. À gauche, la salle du concile est présidée, au fond et au centre, par l’empereur Constantin brandissant l’épée de justice. À partir de son trône, les participants sont disposés en demi cercle. Au premier plan, nous retrouvons la table-coffre, avec encrier, plume et registre, sur laquelle le secrétaire (Ossius de Cordoue?) consigne les débats. Aux mitres des évêques à gauche s’opposent les bonnets des hérériques à droite : déjà ce sont deux partis affrontés, non plus assis pour partager, élaborer des connaissances et des lois, mais affrontés face à face, discours contre discours, de part et d’autre du médiateur qui mesure et distribue la parole. Les deux rangs ne sont cependant symétriques qu’en apparence. Les évêques, placés à la droite de l’empereur, occupent l’intérieur de l’église, tandis que les Ariens, placés à sa gauche, se trouvent de fait du côté de la sortie, qu’on aperçoit au fond à droite. Enfin, hors de l’église, opposé à droite à l’espace magistral de la dispute, l’espace du réel donne la sanction du débat : c’est la mort ignominieuse de l’évêque hérétique Arius, qui avait semé la discorde à Nicée, et dont un diable attrape l’âme au moment où, assis aux latrines, il la voit s’échapper de son front.
Dans le même manuscrit, l’enluminure du concile de Séleucie27 obéit au même principe : tandis que saint Hilaire de Poitiers, reconnaissable à son auréole, assis au centre du demi-cercle magistral, récite dans un phylactère le psaume 24, Domini est terra et plenitudo, le commissaire de l’empereur Constance, Léonas, prend congé au deuxième jour pour courir favoriser les Ariens auprès de son maître. À droite, hors de l’église, il reçoit la sanction de ses manœuvres séditieuses en mourant damné, ayant abandonné la croix pastorale et le panier.
Ce jeu différentiel entre l’espace magistral et le réel peut être mis en relation avec l’entrée de Marie et de Joseph au Temple, dans les Disputes de Jésus avec les docteurs. Cette entrée, à la fin du Moyen Âge, se matérialise par le ménagement d’un compartiment à gauche, souvent séparé du lieu de la dispute par une colonne28.
Dans l’iconographie orientale, la représentation des conciles jour un rôle identitaire important : elle affirme la continuité et la présence historique de l’Église. La fresque du monastère de Suméla29, dans l’empire de Trébizonde (actuellement au nord est de la Turquie), représente au XIVe siècle le concile de Nicée comme une communion des saints dans l’enceinte fortifiée de la ville. Sous la présidence de Constantin et, à sa gauche, d’Ossius de Cordoue, les évêques sont disposés en demi cercle et entendent les orateurs disputer près de la petite table centrale30, où une bible est ouverte. En vert, portant un bonnet noir sans auréole, il faut reconnaître Arius débattant avec Eustathe d’Antioche, son adversaire le plus ardent. Derrière les saints, en haut de la fresque, en deux masses sombres et compactes, la masse des moines constitue le corps de l’Église, auquel il faut identifier l’espace fortifié du concile. Le demi-cercle magistral définit la dispute comme le corps social même du monde, comme ce qui constitue le lien social.
Les réveils nationaux des Balkans à partir du XVIIIe siècle donnent lieu à un renouveau de la peinture religieuse, et l’on voit apparaître de nouvelles représentations des conciles, comme dans les fresques du monastère Stavropoleos de Bucarest, qui datent de 172431. La fresque du concile de Nicée oppose bien deux groupes de part et d’autre de Constantin, lui-même appuyé d’une puissante armée dont ne sont visibles que les casques et les lances. Mais ces groupes sont indistinctement des grappes de saints, tenant ensemble le bandeau où s’inscrit le symbole de Nicée, le Credo : Πιστεύω εἶς ἔνα Θεὸν, Πατέρα, Παντοκράτορα… Le concile constitue et désigne la communauté ; sa représentation enveloppe le fidèle dans la sécurité et dans la force de l’appartenance à cette communauté. La dispute devient alors cet enveloppement.
Au monastère de Rila, en Bulgarie, la coupole des conciles32, peinte entre 1834 et 1837 par Dimitar Zograf dans l’exonarthex du catholicon de la Nativité, dispose la représentation naïve des disputes les plus acharnées autour du Christ Pantocrator, qui résume et incarne la doctrine vivante de l’Église. Les disputes des conciles sont l’image de l’Église militante et constituent les piliers sur lesquels la figure du Christ est assise. La fresque du premier concile de Nicée33 (325) met en scène la communauté des premiers Pères de l’Église, éclairée par le Saint Esprit et entourant la table de communion où se trouve la Bible, sous les auspices de Constantin, qui siège dans un trône tabernacle lui-même allégorique de l’Église. La dispute est bien unanime ici… De même, juste en dessous du Christ, la fresque du deuxième concile de Nicée (787) qui condamna l’iconoclasme déploie les fastes du couple impérial formé par Irène et par son fils Constantin VI, devant la table où sont déposés les deux emblèmes de l’orthodoxie restaurée, la croix et l’icône34. De part et d’autre de cette représentation triomphante, tous les patriarches sont des saints. À l’opposé, la fresque du deuxième concile de Constantinople (553) met en avant un hérétique nestorien à qui le Diable susurre à l’oreille les doctrines d’Origène35, et le concile de Chalcédoine (451) assiste à la sortie de deux partisans de la doctrine monophysite, Eutychès et Dioscore, que les diables aveuglent et tourmentent36. Mais ces représentations de l’hérésie ne sont pas plus dialogiques. Seule la fresque du concile d’Éphèse (431) oppose Nestorius d’Antioche à gauche, chevauché par un diable, à Cyrille, patriarche d’Alexandrie, debout au pied du trône de Théodose II et combattant la thèse de la dissociation hypostatique37. Nestorius contre Cyrille, livre contre livre, affrontent-ils deux discours, ou bien l’hérétique est-il plutôt circonvenu et défait ?
Réforme et Contre-Réforme
Au début du XVe siècle, le concile de Constance, à l’issue duquel Jean Hus et Jérôme de Prague furent condamnés pour hérésie et exécutés, est en quelque sorte le dernier concile avant la Réforme. Un dessin dans la Chronique du Concile de Constance d’Ulrich von Richental38 illustre les premières séances qui marquèrent l’ouverture du concile. Les docteurs en bas, les évêques et les cardinaux au-dessus d’eux et l’antipape Jean XXIII (partie gauche, en haut à droite) siègent dans la cathédrale de Constance, pendant la messe et en son lieu. L’empereur Sigismond n’est pas représenté : nous sommes bien au tout début du concile, avant son arrivée le 24 décembre 1414. Jean XXIII est arrivé à Constance le 28 octobre. Le jour de la Toussaint, le cardinal Zabarella, célèbre jurisconsulte, monte en chaire (en haut à gauche) et déclare que le concile commencé à Pise est transféré à Constance. Son rang de cardinal est reconnaissable à son habit rouge. À droite, à la fois dans le même lieu et lors de la séance suivante du 5 novembre, Jean de Verceil, procureur général de Cluny (en haut à droite, en habit de bénédictin), fait un sermon annonçant le programme du concile. La disposition est toujours celle du dispositif magistral en demi cercle, que le pape, qui va être déposé, ne préside plus exactement. Mais surtout, l’étrange porte ouverte en bas sur une lacune, sur le hiatus du chronotope (entre 28 octobre et 5 novembre, entre marge hors image et Vierge à l’enfant sur un pilier), pose le problème de l’articulation de la Dispute au Réel, tandis que, discrets et presque timides derrière la palissade de bois, les quelques paysans qui assistent au concile font apparaître une instance jusque-là absente de ce type de représentation : le public…
La première grande dispute protestante est la Dispute de Leipzig, qui opposa du 27 juin au 16 juillet 1519 Martin Luther au docteur Johann Eck, vice-chancelier de l’université d’Ingolstat, dans la grande salle du château de Pleissenbourg. Dispute et prêche ne sont toujours pas nettement différenciés : c’est pour prêcher que Luther avait été invité par le duc de Poméranie ; mais c’est dans un lieu non consacré que se tint la Dispute. Eck accusa Luther d’hérésie hussite : le lien avec le concile de Constance, qui avait rétabli l’unité de l’Église au prix de la condamnation de Jean Hus et de Jérôme de Prague, était donc dans tous les esprits. Nous ne disposons d’aucune représentation contemporaine de cette Dispute. La gravure de Gustav König, publiée à Londres dans The life of Martin Luther the German reformer, in fifty pictures, date de 185339. Elle oppose Eck à Luther face à face, émergeant du tumulte des docteurs assis et accroupis, sur fond d’un public attentif, selon un dispositif totalement anachronique : la représentation de la dispute comme tumulte, et comme tumulte auquel assiste un public, est liée à l’attraction du modèle scénique, qui ne se développe que progressivement au cours du XVIe siècle. Nous l’avons vue à l’œuvre dans la Dispute de sainte Catherine du Pordenone (A9118) et dans le Jésus parmi les docteurs de Véronèse (A9049). Le duc de Poméranie, qui préside aux débats dans son château, est bien assis au centre et sous un dais. Mais il apparaît comme écrasé par les deux orateurs affrontés debout, et noyé dans le tumulte par l’homme qui le surplombe, le coude appuyé sur son fauteuil, peut-être Carlstadt, qui secondait Eck dans la Dispute. D’inspiration protestante, la gravure met en valeur Luther, à droite, légèrement surélevé par rapport à Eck, à gauche. Luther parle, Eck écoute ; Luther est prêt à sortir de derrière son pupitre, quand Eck est barricadé derrière le sien. Mais Luther ne triomphe qu’à la condition d’une reconnaissance de l’égalité des deux paroles, des deux points de vues, d’une tolérance de cette égalité. La représentation d’un tel dialogue politique est totalement anachronique.
Pour les Disputes suisses, nous possédons une iconographie contemporaine. Par exemple la dispute de Bade, arrêtée par la Diète de la Confédération helvétique en 1526, a fait l’objet d’une aquarelle40. Le même docteur Johann Eck d’Inglostadt y défendait la cause de l’Église romaine contre Œcolampade, qui représentait les thèses de Zwingli. Merle d’Aubigné décrit ainsi la rencontre :
« Eck et Faber, accompagnés de prélats, de magistrats, de docteurs, couverts de vêtements de damas et de soie, et parés d’anneaux, de chaînes et de croix, se rendirent dans l’église. Eck monta fièrement dans une chaire magnifiquement ornée, tandis que l’humble Œcolampade, chétivement vêtu, dut se mettre en face de son superbe adversaire sur un tréteau grossièrement travaillé. » (Merle d’Aubigné, Histoire de la réformation du XVIe siècle, Paris, C. Meyrueis, 1860-1862, III, 11, 13, p. 34441.)
La belle chaire de prédication occupe le centre de l’illustration, sous la protection des statues des saints, vivement coloriées. Eck y prêche une foule compacte qui, occupant l’ensemble de l’église, ne regarde personne. Œcolampade, au fond à gauche, sur sa petite tribune nue, ne fait pas face à Eck, mais pendant au triptyque de la Vierge à droite. Il n’y a qu’un discours, celui d’Eck, dont l’objet est d’opposer l’hérésie protestante, à gauche, à la couleur et à la gloire de la Vierge et des Saints, à droite et en haut. On reconnaît ici le dispositif de la controverse tel que le développeront les Jésuites, et le définit le dictionnaire de Trévoux, qui concède rhétoriquement, horizontalement, l’affrontement idéologique (ici, Œcolampade face au triptyque), mais instaure une maîtrise verticale de l’espace : Eck tient la chaire et contrôle la parole, d’en haut, sur un public d’auditeurs passifs, nécessairement subjugués.
Il n’empêche : le public entre peu à peu comme donnée nouvelle dans l’économie de la dispute, et sa prise en compte va précipiter le processus de théâtralisation. L’ancien dispositif magistral perdure cependant, notamment lorsque la dispute se déroule dans un cercle plus restreint. C’est le cas par exemple du colloque qui se tint en 1529 entre les partisans de Luther et ceux de Zwingli au château de Marbourg, à l’invitation de Philippe de Hesse, seigneur du lieu. Bien que le colloque de Marbourg ne réunisse que des partisans de la Réforme, il oppose bien deux partis, autour de la querelle théologique sur la Présence réelle du Christ lors de l’Eucharistie. Comme lors des premiers conciles, la dispute jette les bases du dogme : elle est la machine symbolique qui institue les nouvelles églises. Pourtant, la gravure sur bois de 155742 qui représente ce colloque insiste d’abord sur le demi-cercle magistral : au centre, Philippe de Hesse, depuis son trône, préside aux débats. De part et d’autre de lui, les théologiens disputent assis sur des bancs, selon une disposition qui semble n’avoir pas bougé depuis l’école talmudique où Jésus avait semé le désordre. L’assemblée du colloque, réunie en assemblée de doctes, figure une totalité du savoir et du monde réformés : il n’y a qu’une parole.

Pendant ce temps, à Rome, l’Église organise sa contre-offensive et convoque en 1542 le Concile de Trente, qui va jeter les bases de la Contre-Réforme. Dans une fresque peinte en 1588 dans l’église Santa Maria in Trastevere de Rome43, Pasquale Cati a représenté ce Concile. Assis en demi-cercle dans un amphithéâtre, les participants ne délivrent plus une parole, mais assistent eux-mêmes à un spectacle, joué par quelques cardinaux vêtus de rouge sur l’estrade verte qui leur fait face. Sous l’estrade, un homme semble passer en jugement. La table conciliaire autour de laquelle on venait débattre se trouve désormais derrière l’accusé, qui ne voit pas ce que l’on consigne de ses dires. C’est un spectacle réglé, un dispositif parfaitement maîtrisé, mais la globalité monologique du savoir-monde de la dispute est perdue. Le spectateur de la fresque n’est plus intégré dans l’espace de la dispute, qu’il observe à distance, et comme par effraction : au deuxième plan à gauche, les deux gardiens qui se font face debout devant la porte fermée de l’amphithéâtre nous rappellent que ce qui se passe derrière est à la fois secret et de la plus haute importance. Nous ne voyons le concile dans toute sa spectaculaire vérité que parce que le concile ne voit pas que nous le regardons. De cette scène dérobée, abstraite, incompréhensible, le peintre nous propose alors un redoublement allégorique, au premier plan. À droite, brandissant un sceptre surmonté d’une croix, portant la tiare papale, s’avance l’Église triomphante, qui écrase l’Hérésie chevelue à ses pieds. À sa droite, tenant un enfant dans chaque bras, la Charité l’accompagne. Devant, au bout de l’estrade qu’elle occupe, Minerve casquée et tenant un faisceau, ainsi que l’Architecture, tenant une colonne et feuilletant des livres épars à côté d’un globe, symbolisent les arts concourant au triomphe de l’Église. Le spectacle allégorique, au premier plan, redouble le scénario judiciaire, caché mais à demi découvert derrière lui. Il y a une scène et une coulisse, ce que l’on veut montrer et ce que l’on ne veut que laisser deviner.
La dispute de Zürich, en janvier 1523, n’a évidemment pas les mêmes proportions que le concile de Trente, mais répond à un objectif similaire. Les partisans de Rome ont envoyé de Constance une délégation, menée par Jean Faber, qui assiste aux débats sans y participer. Le sujet de la Dispute est la question de l’autorité : il s’agit évidemment de contester l’autorité de l’Église. L’accusation d’hérésie contre Zwingli est rejetée et Zwingli jette les bases de l’église réformée suisse en publiant les 67 articles. Nous avons de cette dispute de Zürich une représentation tardive, qui date de 1600 environ44 : il y a peu de chances que le dessinateur y ait réellement assisté. Le centre de la grande salle de l’hôtel de ville de Zürich est vide, le public se masse sur les bords. Il y a donc bien un demi-cercle, mais retourné, tournant le dos au spectateur de l’image. Au fond de la salle se dresse la tribune où siègent les autorités municipales : mais un seul orateur officie devant eux. La dispute est désormais consciemment et délibérément organisée comme spectacle, mais un spectacle à une voix.
La célébration du jubilée de la Confession d’Augsbourg, en 1630, donne lieu également à une série de représentations de ce qui s’est produit un siècle plus tôt. Le dispositif théâtral-judiciaire se généralise. Dans la gravure de Georg Köler45, assis en cercle, ou en demi-cercle face à l’empereur, les participants délimitent un espace scénique dont notre œil doit franchir la barrière de dossiers de sièges pour y pénétrer. La Confessio augustana est lue à Charles Quint tandis que, derrière l’orateur, deux secrétaires prennent des notes. Dans la gravure de Johann Dürr46, le jeu allégorique favorise la persistance d’anciens modèles. Au centre, Charles Quint est assis sur une tribune ornée de l’aigle impériale bicéphale, entre deux colonnes symbolisant les colonnes d’Hercule, sur lesquelles on peut lire la traduction latine, Plus ultra, de la devise des Habsbourg, Plus Oultre. Devant lui, en demi-cercle, on compte neuf personnages, les sept princes luthériens et les représentants des deux villes impériales passées au protestantisme, Nuremberg et Reutlingen, identifiables aux écussons placés à terre à côté d’eux. À gauche, un des personnages lit la Confession.
On voit ici comment la représentation hésite entre le face à face des neuf opposants avec l’empereur catholique et le face à face des héros de la confession d’Augsbourg avec le spectateur de la gravure : le demi-cercle du dispositif magistral ne peut pas se retourner en jeu scénique à cause de l’opposition religieuse et politique des neuf et de leur empereur, opposition que figurent les saynètes de l’arrière-plan.
Ces représentations imaginaires d’événements qui se sont déroulés un siècle plus tôt concordent avec les représentations contemporaines du Synode de Dordrecht, qui en 1618 fixa les fondements institutionnels et théologiques de l’Église réformée néerlandaise. Il s’agissait pour les Calvinistes, majoritaires en Hollande, de mettre un terme à l’opposition des partisans d’Arminius, dont les thèses avaient été lues devant les États de Hollande en 161047. Les Remontrants, défenseurs du libre arbitre contre la prédestination radicale des Calvinistes, avaient treize représentants au synode ; leur chef de file était Simon Bishop. Ils étaient soutenus par le célèbre juriste néerlandais Hugo Grotius. Face à eux, les Contre-Remontrants avaient à leur tête Franciscus Gomarus, professeur à l’université de Leyde. Le synode fut un triomphe pour les Gomaristes, qui rédigèrent les Canons de Dordrecht, décidèrent la traduction de la Bible en néerlandais aux frais de l’état : Oldenbarnevelt, qui soutenait les Remontrants, fut condamné à mort et décapité le 12 mai 1619, à La Haye, à l’âge de 72 ans48.

Il existe une sorte de gravure officielle du Synode, réalisée pendant ses travaux par Hans van der Hellen, d’après un dessin de Jan Pietersz van der Venne49. Elle fut reproduite sur la médaille commémorative50 que reçurent les participants du Synode, pour lequel des délégations de toutes les nations protestantes avaient été invitées. La dispute basculait ainsi toujours un peu plus dans la sphère médiatique.
Nous retrouvons, dans la composition de van de Venne, une disposition en amphithéâtre du type du Concile de Trente, avec au premier plan l’écran d’une rangée de spectateurs profanes. Il y a même un chien qui déambule à la barrière… La table conciliaire, au centre, focalise les regards, même si, d’après les indications de la légende, elle n’est occupée que par des délégués parmi d’autres. L’assemblée devient une assemblée politique représentative, travaillant sous le regard et le contrôle du public. Cette organisation de l’espace se retrouvera dans les gravures françaises de l’époque révolutionnaire, représentant l’ouverture des États généraux (B5806), le serment du Jeu de Paume (B5389), les séances du Tribunal révolutionnaire pendant la Terreur (B4001, B4002, B4004, B4005, B5810). Dans la gravure de 1618, le toit en carène de bateau, et la disposition de la table centrale prolongeant la décoration du fond du temple qui suggère le Tabernacle, ordonnent l’ensemble de la composition en Croix : c’est la Vérité évangélique qui s’exprime à travers le synode. Dès la réédition de la gravure par Bernard Picart en 1729, le toit du temple disparaît et les spectateurs conquièrent une moitié de l’espace de la représentation. À l’époque révolutionnaire, le haut de l’image se vide, ou même est conquis par le peuple (B5389).

Le résultat du synode de Dordrecht ne fut pas un modèle de tolérance. Il y eut, en marge du synode, une guerre des images, dont témoigne par exemple, en 1622, ce panneau peint, probablement catholique, proposant une allégorie satyrique du synode de Dordrecht51, qu’explique un rébus en latin.
Parturiunt sectae
Cum catto, et Valachia balæna Bitannica rana,
Apostatisque ceteris :
Dordraci in synodo concordi mente laborant,
Nascatur ut discordia
Les sectes enfantent
Avec le chat et la Valachie, la baleine britannique, la grenouille,
et tous les autres apostats :
au synode de Dordrecht, tous ensemble d’accord ils travaillent
à faire naître la discorde
L’assemblée est présidée par une baleine sous un dais — c’est l’Angleterre. À gauche, siègent la Hollande en chat, et ce curieux rocher figurant la Valachie, une province roumaine où apparemment la Réforme s’était répandue. À droite, la Zélande est une grenouille et la maison d’Orange-Nassau — un singe. Au premier plan, à gauche, Barnevelt décapité tenant sa tête à la main est placé à côté d’une mère exsangue, peut-être l’Église réformée néerlandaise, qui se penche sur le berceau de la Discorde qu’elle a enfantée, tandis qu’assis à la table rouge centrale du synode, le secrétaire des débats, à son pupitre, prend sa tête dans ses mains. Il faut sans doute comprendre que le synode de Dordrecht, manipulé par une coalition hétéroclite de puissances étrangères et de factions nationales ridicules, a précipité les Provinces Unies dans la discorde.
La disposition de l’allégorie est celle du dispositif magistral et des anciens conciles, avec le renversement satirique qui substitue aux participants réels les animaux allégoriques. C’est donc bien l’ancien dispositif magistral inversé de la dispute qui est sollicité pour mettre en évidence le débordement de la dispute en discorde : le synode ne joue plus son rôle de construction et d’institution symbolique, le secrétaire ne peut plus en noter les conclusions. Sans doute cette impression d’injustice, d’inefficacité, et en même temps de ridicule futilité a-t-elle été ressentie à maintes reprises dans l’histoire de l’église depuis Nicée : mais jamais elle n’avait été représentée comme mise en échec de la dispute par la discorde sous la forme d’une naissance, qui est aussi la reconnaissance, l’émergence d’une pluralité des voix.
Une autre gravure satirique, datant de 1618, s’intitule « Rêve merveilleux des relations de M. van Olden-Barnevelt avec l’École52 ». Elle est donc du parti Gomariste contre les Remontrants. Barnevelt y préside, sous un dais ridicule duquel pendent des herbes mises à sécher, une dispute qui prend la forme du dispositif magistral, avec ses deux rangées de bancs placées sous l’autorité du maître. Mais la dispute scolastique, jugée d’un autre âge, devient synonyme de désordre et d’anarchie et est tournée en dérision : tandis qu’à gauche deux participants pèsent les arguments à la balance, au centre une échelle traîne par terre, ainsi qu’une mappemonde et une boussole. On parle vraiment de tout dans cette école !

Un siècle plus tard, lorsque, dans l’autre camp, Abraham van der Eyk peint, en 1721, une allégorie de la Dispute entre Remontrants et Contre-Remontrants53 dénonçant l’injustice faite à ceux qui avaient osé protester contre le dogme calviniste, la petite balance qu’on distinguait à peine dans la gravure gomariste de 1618 devient l’objet central, hypertrophié, de la scène. Contre les Remontrants, qui mettent dans la balance, à gauche, la Bible (on distingue « BIBLIA » sur le dos de la reliure) et les traités dûment scellés qui sont censés les protéger, les Contre-Remontrants s’avancent avec le seul livre des Canons de Dordrecht et l’épée de Maurice de Nassau, alors stadhouder des Provinces-Unies, instigateur et grand vainqueur politique du synode de Dordrecht. Maurice de Nassau, en habit d’apparat, portant la pourpre monarchique, fait pencher la balance, tandis qu’à droite Franciscus Gomarus s’agenouille pieusement : mais est-ce devant la bible, qui est bien éloignée de lui, ou devant le prince qui l’arrête du pied ?
En 1631, Pierre du Moulin, pasteur de l’Église réformée de Paris, publie un traité Du juge des controverses54, où il s’élève contre la pratique catholique de la Dispute :
« Ceste question en laquelle on dispute à qui appartient l’authorité souveraine de juger des poincts de la foi. A sçavoir si elle appartient à l’Escriture saincte, ou à l’Eglise Romaine, est une tache particuliere à ce siecle, & le plus haut attentat que l’ennemi de nostre salut ait jamais entrepris. Car sous d’autres mots ou dispute, quelle est la plus grande authorité, ou de Dieu parlant és Sainctes Escritures ou du Pape & de quelque peu de Prelats que le Pape authorise. Car comme par l’Escriture, nous n’entendons pas le papier, ni l’encre, ni les characteres, mais les enseignemens divins qui y sont contenus, que Dieu a prononcés de sa bouche en publiant sa Loi, & dictez à ses Prophetes, & que Jesus Christ a enseignez de sa bouche, & inspirez à ses Apostres. Aussi nos adversaires par ce mot d’Eglise, entendent l’Eglise Romaine : par l’Eglise Romaine, ils entendent le Pape, ou seul, ou avec quelque peu de Prelats, qu’il choisit selon sa volonté. Car ceux-là seuls jugent : Le peuple & le corps du clergé n’ont nulle part à ce jugement.
Le poinct donc du différent est, si Dieu parlant és Ecritures, est juge souverain des poincts de la foi. Ou si cette puissance souveraine & jugement infaillible appartient au Pontife Romain. » (I, 1, « De l’injustice des procédures de nos adversaires », p. 61-62)
Dans les disputes sur « les points de la foi », c’est-à-dire dans les affrontements théologiques entre catholiques et protestants, « nos adversaires », autrement dit les catholiques, se réclament de l’Église romaine, tandis que « nous », protestants, n’invoquons que l’Écriture sainte. La procédure catholique de la dispute, ici dénoncée, est une procédure de domination politique : c’est l’autorité du pape et des rares prélats qu’il a mandatés pour le représenter qui constitue l’autorité de référence, l’autorité qui juge, l’autorité à laquelle se soumettre. La dispute est désormais comprise et dénoncée comme une procédure de soumission dont le jeu des discours n’est que l’alibi rhétorique.
À cette procédure, Pierre du Moulin oppose la manière protestante, qui passe par la dématérialisation et la dépersonnalisation de l’instance du jugement : ce qui juge la dispute, c’est l’Écriture sainte, qui n’est ni papier, ni encre, ni caractères d’imprimerie, mais le contenu même des enseignements divins ; qui n’est pas un Pontife Romain, mais Dieu même parlant à travers les Écritures. Dans le demi-cercle de la dispute, le maître qui se situe en haut du demi-cercle en position de juge n’est plus ni une personne physique, ni même l’objet matériel sacré qu’est le Livre saint ; c’est une instance immanente, répandue dans « le peuple et le corps du clergé », un jugement public, et donc disséminé.
La revendication de la seule autorité des Écritures renoue avec les racines même de la dispute chrétienne, fondée, nous l’avons vu, sur le renversement du dispositif magistral. Lors des conciles, l’assemblée s’assemble autour d’une table où est exposée la Bible, et, en droit canon, le pape ne peut que se soumettre aux décisions conciliaires. Pourtant, les conciles sont toujours présidés, et leur présidence constitue même un enjeu politique majeur.
La nouveauté réside dans cette référence, presque incidente, au jugement public : pour les catholiques, seuls le pape et ses proches conseillers décident, « Car ceux-là seuls jugent : Le peuple & le corps du clergé n’ont nulle part à ce jugement. » Il faudrait donc que le peuple, que le corps du clergé produisent le jugement. Le germe se dessine d’une constitution politique, dont la dispute est le ferment.
III. La scission dialogique
L’analyse hegelienne
Dans La Phénoménologie de l’esprit, Hegel identifie le moment historique de l’âge classique et des Lumières au moment philosophique de l’esprit devenu étranger à lui-même par le processus de la culture. Autrement dit, le classicisme français serait le théâtre d’une scission de l’esprit dans la culture, et les Lumières feraient l’expérience culturelle de la conscience divisée, où nécessairement la dispute viendrait jouer un rôle majeur.
Culture doit s’entendre ici dans un sens extrêmement large, qui englobe la vie politique et le développement économique de la société, puisque les deux instances qui émergeraient progressivement de cette division seraient d’un côté le pouvoir absolu de l’État, de l’autre la richesse de la bourgeoisie montante. La sphère religieuse et théologique est totalement absente de ce développement, car Hegel fait de la Religion le moment de sa propre époque, qui suit le moment de l’Esprit, dont l’aboutissement est l’Aufklärung.
Cette scission de l’esprit, cette division de la conscience est à la fois une expérience intime et un phénomène social. Les deux figures successives en sont le courtisan, de Castiglione55 à La Bruyère, et l’intellectuel gueux, dont Diderot fait le portrait dans Le Neveu de Rameau. Le courtisan est un aristocrate dont l’idéal chevaleresque se divise en service du monarque et en quête de la richesse, nécessaire pour accomplir ce service. La cohérence de l’idéal médiéval est alors travaillée par une contradiction qui marque un déplacement de l’action éthique du chevalier vers la culture de l’esprit propre au courtisan. Avec les Lumières, ce qui n’était que cas de conscience et dilemmes moraux devient déchirement de deux consciences au sein de l’esprit, affrontement sans merci, l’une contre l’autre, de la conscience vile et de la conscience noble, dont le dialogue de Lui et de Moi, de Rameau le fou et de Diderot philosophe, sert à Hegel d’illustration. Il ne s’agit plus alors du service du roi contre la quête des richesses, mais de l’adhésion aux institutions et aux valeurs idéales de la société d’une part, de leur rejet radical et cynique d’autre part. Or ce rejet ne peut pas être simplement identifié au Mal contre le Bien : il y a une lucidité de la conscience vile, qui, au milieu de propos scandaleux et outranciers, voit et dit les vérités dérangeantes de notre monde ; réciproquement, il y a un aveuglement et une bonne conscience de la conscience noble, qui, derrière l’écran de fumée des protestations vertueuses et du credo humaniste, jouit égoïstement de ses avantages acquis et se satisfait très bien de ses beaux principes violés chaque jour.
L’analyse hegelienne décrit un processus dialectique : une division se crée dans l’esprit, qui est d’abord une contradiction morale, puis un conflit idéologique qui va déboucher sur la Révolution française et l’expérience de la Terreur. L’esprit devient étranger à lui-même : dans Le Neveu de Rameau, tantôt Lui fascine Moi qui se reconnaît en lui, tantôt il lui fait horreur et Moi le repousse avec indignation. Pour Hegel, ce déchirement qui traverse les valeurs universelles prônées par l’humanisme et par les Lumières ne se résout qu’au niveau supérieur de la Religion, par le passage de l’universel à l’éternel.
La dialectique hegelienne nous permet de comprendre, dans la représentation de la dispute, la transformation du dispositif magistral en dispositif scénique, et l’enjeu phénoménologique de cette transformation. La dispute est le principe de division, le ferment dialectique qui défait la forme éthique du dispositif magistral, le déborde et fait émerger progressivement, à partir de ce qui constituait un bloc éthique cohérent (le demi cercle magistral), l’affrontement de deux discours opposés, le noble et le vil, celui qui porte l’auréole et celui que le diable agite, l’orthodoxe et l’hérétique. Alors que la dispute dessine, très lentement, très progressivement, une nouvelle forme, dialogique, d’institution sociale, une reconnaissance, dans l’institution même, de la présence de deux discours opposés, le lieu, l’espace de la dispute se transforment. Ce n’est plus le Temple du Christ parmi les docteurs, ou l’un de ses avatars, la faculté de théologie (avec ses controverses), le concile (souvent tenu dans une église), les États-généraux (le premier, en 1302, se tient à Notre-Dame) ; c’est une scène de théâtre, affrontée à un public qui la regarde et la juge, une scène qui n’est plus présidée mais s’autonomise dans le jeu dialogique des discours opposés.
Cette transformation du dispositif magistral s’effectue par débordement. Hegel parle d’extranéation (Entfremdung56) :
« Mais cette extranéation arrive seulement dans le langage, qui se présente ici dans sa signification caractéristique. […] Dans le langage la singularité étant pour soi de la conscience de soi entre comme telle dans l’existence, en sorte que cette singularité est pour les autres. Le Moi comme ce pur moi, autrement que par le langage, n’est pas là57. »
Le simple fait de parler oblige la singularité de la conscience à frayer, à s’accommoder avec autrui. Le langage fait entrer la conscience dans l’existence, et c’est un premier débordement. Par ce qui est dit, cette conscience devient elle-même une représentation pour les autres, et n’existe même pour les autres qu’au travers de ce qui est dit : il n’y a pas de Moi pour les autres autrement que par le langage. L’extranéation, l’aliénation dans le langage, le débordement de l’intime dans la sphère sociale sont autant de manières de naturaliser un processus inhérent à la dispute. Elle n’extériorise pas seulement les pensées des interlocuteurs. Elle initie un mouvement qui ne s’arrêtera pas à la simple représentation de positions arrêtées, à des figures fixes d’intériorité. Ces positions, ces figures qui ont débordé par et dans le langage, prennent une existence autonome, étrangère aux consciences, aux intériorités qui les ont produites : elles s’objectivent dans le langage et servent d’appui, de socle à partir duquel accentuer le déchirement.
Le déchirement de la conscience en une conscience noble et une conscience vile est donc pensé à la fois comme un déchirement intérieur (à la base, le dilemme intime du courtisan) et comme un déchirement extérieur : Moi contre Lui, c’est le feu de la dispute, le tumulte social de l’altercation, et de là le jeu politique du conflit.
Subversion de la dialectique hegelienne : l’occupation dialogique
Le problème de la démarche hegelienne tient essentiellement au substrat historique et social sur lequel il appuie son modèle de développement dialectique de l’esprit. La scission de l’esprit, le déchirement de la conscience s’ordonnent d’abord exclusivement à partir d’un Moi aristocratique, auquel vient subrepticement se substituer le point de vue de l’intellectuel humaniste aux prises avec une réalité triviale désaccordée d’avec le monde idéal de ses lectures et des ses principes. Pas un mot, dans la description de cette division, de ce déchirement, du grand schisme qui a théologiquement coupé l’Europe en deux, et s’est répercuté dans toutes les consciences ; et quand Hegel évoque la richesse comme instance émergente qui tout à la fois, comme résultat, comme somme globale accumulée, accomplit le pouvoir de l’État et, comme processus d’acquisition, vient s’opposer à lui en introduisant l’exigence individuelle de jouissance58, on peut trouver le raccourci un peu commode, qui place dans un même mouvement logique l’essor des monarchies absolues, l’autonomisation d’une classe bourgeoise et le déplacement de la production des richesses des campagnes vers les villes et le commerce.
La force du modèle hegelien réside dans la superposition de phénomènes hétérogènes (intimes et publics, éthiques, politiques et économiques) concourant à un processus dialectique commun que, par le jeu même de la dialectique, aucune instance ne pilote, n’ordonne ni ne domine. Mais ce processus est pensé logiquement, comme le développement interne d’un discours, qui rencontre des contradictions, se retourne contre lui-même, opère des glissements, franchit des étapes, court d’une origine vers une fin. Ce discours n’est pas d’une personne, comme on a parfois tenté de l’y réduire en se focalisant sur un autre moment de La Phénoménologie de l’esprit, la dialectique du maître et de l’esclave. Ici, la notion même de personne est en jeu, dans sa division, son extranéation, son déchirement en voix opposées. Mais ce déchirement se ramène, somme toute, à un discours, au discours même de la dialectique, dont le travail de scission est identifié au travail même du langage.
Définir l’extranéation comme dispute, et le débordement polémique de la dispute comme constitutif de notre monde, semblait a priori s’inscrire dans ce modèle logocentrique de dialectisation. Mais le monde n’est pas un discours. C’est un espace organisé, ou, autrement dit, un dispositif. Dès lors que la dispute est pensée comme dispositif, avec une forme visuelle, une organisation de l’espace qui d’emblée, dès l’origine, s’inverse (comme dispositif magistral inversé) puis se renverse (comme spectacle ouvert à un public) et enfin se divise (comme face à face sans présidence), la dialectique hegelienne ne peut plus être modélisée comme discours, car l’enjeu même du processus dialectique est l’avènement d’une pluralité de discours dans l’espace de la représentation, indépendamment même du fait que cet espace, d’abord théologique, devient à la fois politique et intime. On ne peut pas penser une réelle pluralité de discours hétérogènes à partir d’un modèle discursif de pensée : tous les discours que pense Hegel constituent des moments du discours dialectique commun, c’est-à-dire du processus d’extranéation. C’est pourquoi Hegel met de côté le schisme protestant, qui a été pourtant l’expérience européenne la plus radicale et la plus visible de cette extranéation, dont l’origine est religieuse, et l’aboutissement, avec la Révolution française — politique.
L’esprit se développe à partir de l’espace de la dispute. Cet espace n’est pas destiné, au terme d’un processus, à se diviser. Dis-pute : il est toujours, dès l’origine, divisé. Ce qui apparaît au terme d’un long processus, c’est l’acceptation symbolique d’une division fondamentale au niveau du langage : il n’y a pas d’unicité du Verbe, l’espace public doit être travaillé par le débordement de discours hétérogènes, il faut accepter ce débordement non seulement comme un mal nécessaire, mais comme une conquête de l’esprit.
Occuper la position magistrale : Le Neveu de Rameau
Au moment de rédiger La Phénoménologie de l’esprit, qu’il publie en 1807, Hegel lit Le Neveu de Rameau dans la traduction de Gœthe, parue à Leipzig en 1805, alors que le texte était encore, en français, non seulement inédit, mais inconnu. Gœthe ne croyait pas en l’existence réelle de Jean-François Rameau, le neveu raté du célèbre Jean-Philippe Rameau, le plus illustre représentant de l’école française de musique du XVIIIe siècle. Son édition présente donc Rameau, Lui, comme une fantasmagorie de Diderot, de moi, et le dialogue comme un dialogue intérieur. Gœthe fournissait ainsi à Hegel un exemple idéal pour sa démonstration, la mise en scène concrète de la conscience du plus illustre représentant des Lumières françaises, se divisant en un Moi noble et un Lui vil, mais de telle manière que ce Moi et ce Lui, jamais totalement séparés l’un de l’autre, se frottent, s’échangent, se fascinent. Le fait qu’on puisse aujourd’hui attester de l’existence du Neveu, et même reconstituer sa biographie, n’ôte rien au génie de la lecture hegelienne, qui nous interdit désormais de ramener cette conversation impromptue dans un café à la confrontation rhétorique de deux discours séparés.
Le Neveu de Rameau se situe au moment de l’émancipation dialogique du dispositif de la dispute. Diderot est d’abord assis sur son banc, dans le jardin public du Palais-Royal ; il s’est promené, il regarde maintenant passer les promeneurs, et son esprit vagabonde. Du banc d’Argenson, nous passons subrepticement à l’intérieur du café de la Régence, et de la rêverie sur la promenade à la rêverie devant les joueurs d’échecs. Au commencement, il n’y a donc qu’une conscience, qu’une parole, qu’une méditation. Diderot ne définit d’ailleurs pas son texte comme un dialogue, mais comme une satire.
Le point de départ de la dispute est monologique. Ce n’est donc pas le choc de deux discours qui déclenche la dispute : ce choc en est l’aboutissement, non le principe. Au principe de la dispute, il y a une inversion :
« Ah, ah, vous voilà, Mr le philosophe, et que faites-vous ici parmi ce tas de fainéants59 ?
Ce n’est pas le Neveu qui vient faire tache dans une assemblée de doctes. C’est Diderot lui-même qui, au café, au milieu des joueurs d’échecs, n’est pas à sa place et s’encanaille. Le philosophe ne donne pas sa leçon, n’échange pas avec d’autres doctes ; il perd son temps, il s’amuse à regarder, il prend une leçon d’échecs, mais une mauvaise leçon. L’idée même de leçon est alors balayée. Moi vantait les mérites de M. de Bissy, que Lui récuse d’un trait :
« Lui. — Celui la est en joueur d’echecs, ce que Mademoiselle Clairon est en acteur. Ils scavent de ces jeux, l’un et l’autre, tout ce qu’on en peut apprendre.
Moi. — Vous etes difficile ; et je vois que vous ne faites grace qu’aux hommes sublimes. »
Le joueur que Moi invoque comme un maître n’est lui-même qu’un élève, qui ne sait des échecs que « ce qu’on en peut apprendre », qui n’a donc rien à apporter lui-même, de son crû, en matière de savoir, d’invention, d’enseignement. Pour dénigrer M. de Bissy, Lui le compare à Mlle Clairon, pourtant réputée alors comme l’une des plus grandes tragédiennes de son temps.
Ce faisant, il identifie l’espace trivial du café, où s’activent les pousse-bois, à l’espace de la scène : mais cette identification ne prend sens que comme subversion ultime du dispositif magistral, qui informe tout ce début de conversation. L’espace du café apparaît dès lors comme un médiateur imaginaire entre l’ancienne dispute, magistrale, de controverse, et la nouvelle dispute, scénique et dialogique. C’est à partir de ce statut mixte de l’espace de la représentation (qui est bien plus qu’un simple cadre énonciatif) que se développe le processus dialectique d’extranéation.
Ce qui va devenir le sujet central de la conversation se déduit en effet de cette discussion liminaire sur la position inversée du philosophe dans le dispositif magistral : non seulement Lui ne donne pas de leçon, mais il ne peut en recevoir, car le meilleur des joueurs d’échecs ici présents, M. de Bissy, ne sait de son jeu que ce qu’on en peut apprendre, c’est-à-dire rien, aucun supplément de savoir, qui mérite d’être spécialement enseigné par lui. Seuls Legal et Philidor sont des maîtres, car Lui ne fait « grace qu’aux hommes sublimes ».
La position du maître est celle de l’homme sublime, ou autrement dit de l’homme de génie, c’est-à-dire, par rapport à Rameau le fou, celle de son oncle, ce qui lui permet de s’insérer dans la conversation comme double du philosophe : Lui comme Moi, feint de s’amuser mais ne s’amuse pas « parmi ce tas de faineants », parce que la seule façon de s’amuser, c’est de se placer dans l’attraction de l’homme sublime, ou d’être lui.
Le feu d’artifice des répliques multiplie les identifications : s’agit-il seulement des échecs ? « Oui, aux echecs, aux dames, en poesie, en eloquence, en musique, et autres fadaises comme cela », précise Lui, qui glisse ainsi savamment de la situation réelle de Moi au départ (le philosophe s’amusant des parties d’échec qu’il observe au café de la Régence), à son équivalent verbal (la poésie, amenée par les dames, dames du jeu et objets de l’adresse lyrique ; puis l’éloquence, qui infléchit la poésie vers le propre de la dispute), puis à son équivalent musical, qui suggère la situation de Lui, pris entre son admiration pour le génie de son oncle et la dépréciation de ce génie, qui n’est que « fadaises » renvoyant à sa propre médiocrité.
Quand le philosophe lui demande ce qu’il a fait, Lui répond : « Ce que vous, moi, et tous les autres font : du bien, du mal et rien ». Il ramène sa singularité à une individualité commune qui l’égale à Lui, tandis que ce qu’il a fait, mêlant le bien et le mal, égalise les actions, les réduit à rien.
Mais cette égalisation n’est pas une pure stratégie perverse de Rameau le fou. Le philosophe lui aussi y prête la main. Alors qu’incidemment, Lui évoque sa barbe qu’il a fait raser, Moi lui rétorque :
« Moi. — Vous avez mal fait. C’est la seule chose qui vous manque, pour etre un sage. » (P. 8.)
Même dite ironiquement, cette remarque ramène Lui à la figure du sage, du docte que Lui a reproché à Moi de ne pas occuper décemment (« Ah, ah, vous voilà, Mr le philosophe, et que faites-vous ici parmi ce tas de fainéants ? »). Lui pourrait être le sage, et en même temps la barbe lui manque, défaut dérisoire et défaut décisif. Ce qui est en jeu, ce n’est donc pas le déchirement d’une conscience qui tantôt se divise entre un Moi noble et un Lui vil, tantôt se rassemble en une seule figure ambivalente ; c’est l’occupation de la position magistrale vacante (celle de l’homme sublime, de l’homme de génie), à laquelle ni Moi, ni Lui ne peuvent prétendre. Moi et Lui tantôt se déchirent devant cette position vide, tantôt se fondent dans un discours commun face à cette position. Le jeu n’est donc pas à deux, mais à trois figures, comme l’indique très explicitement le titre de l’œuvre Le Neveu de Rameau : en plus de Lui et de Moi, il y a l’oncle, cette place magistrale de l’oncle qu’il s’agirait d’occuper.
Le débordement propre à la dispute n’est pas essentiellement verbal : pantomimes
Aux trois figures du discours, Moi, Lui et l’homme de génie, correspondent trois formes d’expression, la forme noble du discours, sa parodie verbale, qui en constitue l’inversion cynique, et sa pantomime, qui renverse la dispute en spectacle. On retrouve ici les trois moments généalogiquement constitutifs du dispositif moderne de la dispute, la position magistrale, son inversion et son renversement.
Bien sûr, dans une première approche, on est tenté de définir l’expression privilégiée de Moi comme expression du discours noble ; Lui se manifesterait de son côté essentiellement par l’inversion cynique du discours noble, qu’il parodie ; enfin, l’oncle absent s’incarne parodiquement dans les pantomimes du Neveu, réintroduisant ainsi, dans le jeu verbal défaillant, le supplément génial de la musique. Toute la subtilité du Neveu de Rameau consiste cependant à ne pas identifier de façon rigide chaque figure à une expression. Le dispositif qui est à l’œuvre est un dispositif en pleine décomposition et recomposition. Le jeu des figures et des expressions exprime ce mouvement.
Ainsi, lorsque le Neveu confesse sa jalousie envers son oncle :
« J’étois donc jaloux de mon oncle ; et s’il y avoit eu a sa mort, quelques belles pieces de clavecin, dans son porte-feuille, je n’aurois pas balancé a rester moi, et a etre lui.
Moi. — S’il n’y a que cela qui vous chagrine, cela n’en vaut pas trop la peine.
Lui. — Ce n’est rien. Ce sont des moments qui passent.
(Puis il se remettoit a chanter l’ouverture des Indes Galantes, et l’air Profonds abymes, et il ajoutoit) :
Le quelque chose qui est la et qui me parle, me dit : Rameau, tu voudrois bien avoir fait ces deux morceaux la, tu en ferois bien deux autres… » (p. 16)
On voit ici naître, dans le discours, une différenciation dialogique, non entre Lui et Moi, mais entre Lui et son oncle, qui se manifeste d’abord par le chant, puis par l’entremise du « quelque chose qui est là et qui me parle » ; Moi, dans ce mouvement de dialogisation, joue le rôle de modérateur, il règle la dispute, il la préserve du débordement pathétique : « S’il n’y a que cela qui vous chagrine, cela n’en vaut pas trop la peine. »
La pantomime de Rameau ouvre alors un autre monde, dont la musique souligne à la fois la virtualité fictionnelle et la puissance de débordement : la pantomime est ce qui déborde de l’espace réglé de la dispute dans l’autre monde de la fiction. Cet autre monde est celui de la scène d’opéra, exotique ou infernale, où se jouent les Indes galantes de Rameau et, dans Le Temple de la gloire de Voltaire, musique de Rameau, l’air de l’Envie « Profonds abymes du Ténare, Nuit affreuse, éternelle nuit ».
Depuis la dispute, Lui indique, par la pantomime, la scène :
« On diroit : c’est lui qui a fait les jolies gavotes (et il chantoit les gavotes) ; puis avec l’air d’un homme touché, qui nage dans la joye, et qui en a les yeux humides, il ajoutoit, en se frottant les mains, tu aurois une bonne maison (et il en mesuroit l’etendue entre ses bras), un bon lit (et il s’y etendoit nonchalament), de bons vins (qu’il goutoit en faisant claquer sa langue contre son palais), un bon equipage (et il levoit le pié pour y monter), de jolies femmes (a qui il prenoit deja la gorge et qu’il regardoit voluptueusement) ; cent faquins me viendroient encenser tous les jours (et il croyoit les voir autour de lui ; il voyoit Palissot, Poincinet, les Frerons pere et fils, La Porte ; il les entendoit ; il se rengorgeoit, les aprouvoit, leur sourioit, les dedaignoit, les meprisoit, les chassoit les rapelloit ; puis il continuoit) : et c’est ainsi que l’on te diroit le matin que tu es un grand homme »
L’autre monde de la pantomime permet au Neveu de s’imaginer célèbre à l’égal, ou même plutôt à la place de son oncle. Mais ce n’est pas en un autre Lui idéalisé que Lui se projette et se figure au moyen de ses mimiques. Il mime d’abord le spectacle d’où naîtrait sa célébrité (« il chantait les gavottes »), puis les signes extérieurs de sa richesse, la grandeur de sa maison, le moelleux de son lit, c’est-à-dire l’espace scénique où théâtraliser son rêve. Lui se donne à voir regardant ce spectacle, dans lequel il n’entre que progressivement : il va monter dans son bel équipage, il lève déjà le pied ; il va jouir d’une jolie femme, il en prend déjà la gorge. La dernière saynète figure Rameau présidant une assemblée de journalistes véreux et abjects, dont il devient la vedette adulée. Cette saynète préfigure, sur le mode à la fois comique et triomphant, le récit ultérieur du dîner chez Bertin, qui a rassemblé les mêmes personnages, non pour aduler Rameau, mais, finalement, pour l’expulser.
Or qu’est-ce que cette scène, qui annonce l’épisode matriciel du Neveu de Rameau, sinon le renversement parodique du dispositif magistral, où le maître, mi Rameau génial, mi Rameau le fou, entend disputer ses élèves (« il les entendoit »), les approuve, les dédaigne, les chasse, les rappelle… ? Les protagonistes n’en sont certes ni les théologiens des conciles, ni les philosophes scolastiques de la controverse universitaire, mais les journalistes du nouveau monde, où la dispute se joue devant l’opinion publique. Il n’en demeure pas moins que ce jeu dialogique, ce débordement de la parole, abjecte et démocratique, vulgaire et libre, continue de se représenter, de se disposer dans l’espace magistral de la dispute. C’est cet espace qui en porte la logique dialectique de développement, non la parole même, que le Neveu au contraire doit interrompre, passer au mime pour passer dans l’autre monde de la modernité.
Danse macabre
Aucune filiation platonicienne, ni même socratique du dialogue philosophique ici. Le philosophe qui est mis en scène dans Le Neveu de Rameau est le philosophe hérité de la tradition médiévale, l’homme de la dispute, l’homme qui préside aux disputes. Lorsque Socrate est invoqué par Moi, c’est du héros qui but la ciguë qu’il s’agit, non de l’inventeur de la maïeutique. Au terme de leur conversation, ce n’est pas Socrate, mais Diogène que Lui et Moi évoquent, se demandant s’il faut l’incorporer dans la pantomime des gueux.
« Moi. — Cela est supérieurement executé, lui-dis-je. Mais il y a pourtant un etre dispensé de la pantomime. C’est le philosophe qui n’a rien et qui ne demande rien.
Lui. — Et ou est cet animal la ? S’il n’a rien il souffre ; s’il ne sollicite rien, il n’obtiendra rien, et il souffrira toujours.
Moi. — Non. Diogene se moquoit des besoins.
Lui. — Mais il faut etre vetu. […] Avec la diete austere de votre Diogene, il ne devoit pas avoir des organes fort indociles.
Moi. — Vous vous trompez. L’habit du Cynique etoit autrefois, notre habit monastique avec la meme vertu. Les cyniques étoient les Carmes et les Cordeliers d’Athenes.
Lui. — Je vous y prends. Diogene a donc aussi dansé la pantomime ; si ce n’est devant Periclés, du moins devant Laïs ou Phryné. » (p. 106-107)
Moi commence par défendre la position de préséance magistrale du philosophe, au-dessus, légèrement en dehors du demi-cercle de la dispute, ici parodié en pantomime des gueux, avec en arrière-plan la terrible référence aux danses macabres. Lui commence par énumérer tout ce que manque Diogène en s’excluant de la chaîne des besoins, jusqu’au manque ultime, le sexe auquel ses organes soumis à une diète trop sévères ne devaient guère s’adonner.
Le dialogue dérape alors : piqué au vif, le philosophe sort de la logique du discours austère et vertueux qu’il a tenu jusqu’ici pour défendre l’honneur viril de la philosophie. Il emprunte alors le point de vue abject et clairvoyant du Neveu pour identifier, sur le plan des prouesses sexuelles, Diogène aux pires caricatures des moines luxurieux, invoquant les Carmes et les Cordeliers de Boccace, de Marguerite de Navarre et du roman libertin.
Ce faisant, le modèle antique du philosophe est ramené à un modèle d’origine médiévale, la nudité grecque à l’habit monastique. Le détour des couvents lubriques est nécessaire pour réintégrer Diogène dans la pantomime, au prix d’un anachronisme : Diogène de Sinope (413-327) est contemporain d’Alexandre, non de Périclès (495-429), dont la courtisane puis l’épouse fut Aspasie, non Laïs, la maîtresse d’Alcibiade, ni Phryné, courtisane de Praxitèle. Laïs et Périclès sont contemporains l’un de l’autre, Phryné et Diogène également, mais à un siècle de distance. Peu importent ces légers anachronismes, l’essentiel est la logique qu’ils pointent, qui n’est pas de l’exemplum, d’une histoire venant illustrer une thèse, une démonstration, mais du dispositif, qui agence des figures dans un espace, indépendamment des différences temporelles. C’est espace est à la fois de controverse monastique, de danse et de sexe, espace du corps et espace de l’allégorie, espace monde.
Sortant d’entre les Carmes et les Cordeliers, Diogène délaisse Périclès pour entrer dans la danse avec les femmes d’Alcibiade et de Praxitèle. C’est avec elles qu’il donne et reçoit des leçons, c’est dans le sexe avec elles que, débordant la dispute dont il s’est exclu, il entre à la fois en pantomime et en démocratie.
Notes
Voir J. Carreyre, article Le Courrayer du Dictionnaire de théologie catholique (2005). L’article est très documenté mais malheureusement aussi un peu orienté…
Gabriel Naudé (1600-1653), bibliothécaire de Mazarin, fut notamment l’auteur des machiavéliennes Considérations politiques sur les Coups d’État (Rome, 1639), où il justifiait la Saint-Barthélémy.
3Bayle suit en cela Naudé, mais ajoute une note sur la folie : « La pensée que Sénèque attribuë à Aristote, qu’il entre toujours un grain de folie dans le caractere des grans esprits, nullum magnum ingenium sine mixtura dementia, n’est point juste à l’égard de Cardan ; ce n’est point pour lui qu’il faut dire que la folie est mêlée avec le grand esprit : il faut prendre la chose d’un autre sens, & dire que le grand esprit est mêlé avec la folie ; le grand esprit ne doit être considéré que comme l’appendix & l’accessoire de la folie. » La formule est reprise par Moi au début du Neveu de Rameau : « Tout en convenant avec vous que les hommes de génie sont communément singuliers, ou, comme dit le proverbe, qu’il n’y a pas de grands esprits sans un grain de folie, on n’en reviendra pas ; on méprisera les siècles qui n’en auront point produit. »
Voir E. Rodocanachi, La Réforme en Italie, Paris, A. Picart, 1920-1921 et le compte-rendu de Henri Busson dans la Revue d’histoire de l’Église de France, 1922, vol. 8, n°39, p. 203.
Les Controverses de Sénèque le Père, ou Sénèque le Rhéteur, sont des exercices de rhétorique judiciaires.
Utpictura18, notice A9050.
Faut-il y voir une figure de Jean-Baptiste, dit aussi le Précurseur ?
« Et il advint, au bout de trois jours, qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. » (Luc, 2, 46)
Utpictura18, notice A9052.
Utpictura18, notice A9048.
Utpictura18, notice A9047.
Le tableau est conservé au musée du Duomo, à Milan. Utpictura18, notice A9134.
Le tableau est conservé à Madrid, au musée du Prado. Utpictura18, notice A9049.
Dès la Renaissance, les protestants soulignent l’accumulation des impossibilités historiques de cette légende : « De mesme trempe est Se Catherine, fille d’un roi d’Alexandrie en Egypte nommé Costus, du temps de l’Empereur Maxence, laquelle convertit la roine Faustine & 50. Philosophes. Les histoires ne parlent point de Roi d’Alexandrie, & jamais en Egypte n’y eut de roi Costus, ni de roine Faustine. Alors l’Egypte estoit sous l’Empereur Romain. » (Pierre du Moulin, Du Juge des controverses, Geneve, Pierre Aubert, 1631, « Des controverses », p. 533)
« Catherine, fille du roi Costus, fut instruite dans l’étude de tous les arts libéraux. L’empereur Maxence avait convoqué à Alexandrie les riches aussi bien que les pauvres, afin de les faire tous immoler aux idoles, et pour punir les chrétiens qui ne le voudraient pas. Alors, Catherine, âgée de 18 ans, était restée seule dans un palais plein de richesses et d’esclaves ; elle entendit les mugissements des divers animaux et les accords des chanteurs ; elle envoya donc aussitôt un messager s’informer de ce qui se passait. Quand elle l’eut appris, elle s’adjoignit quelques personnes, et se munissant du signe de la croix, elle quitta le palais et s’approcha. Alors elle vit beaucoup de chrétiens qui, poussés par la crainte, se laissaient entraîner à offrir des sacrifices. Blessée au cœur d’une profonde douleur, elle s’avança courageusement vers l’empereur et lui parla ainsi : “La dignité dont tu es revêtu, aussi bien que la raison, exigeraient de moi de te faire la cour, si tu connaissais le créateur du ciel, et si tu renonçais au culte des dieux.” Alors debout devant la porte du temple, elle discuta avec l’empereur, à l’aide des conclusions syllogistiques, sur une infinité de sujets qu’elle considéra au point de vue allégorique, métaphorique, dialectique et mystique. Revenant ensuite à un langage ordinaire, elle ajouta : “Je me suis attachée à t’exposer ces vérités comme à un savant : or, maintenant pour quel motif as-tu inutilement rassemblé cette multitude afin qu’elle adorât de vaines idoles ? Tu admires ce temple élevé par la main des ouvriers ; tu admires des ornements précieux que le vent envolera comme de la poussière. Admire plutôt le ciel et la terre, la mer et tout ce qu’ils renferment, admire les ornements du ciel, comme le soleil, la lune et les étoiles : admire leur obéissance, depuis le commencement du monde jusqu’à la fin des temps ; la nuit et le jour, ils courent à l’occident pour revenir à l’orient, sans se fatiguer jamais : puis quand tu auras remarqué ces merveilles, cherche et apprends quel est leur maître ; lorsque, par un don de sa grâce, tu l’auras compris et que tu n’auras trouvé personne semblable à lui, adore-le, glorifie-le : car il est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs.” Quand elle lui eut exposé avec sagesse beaucoup de considérations touchant l’incarnation du Fils, l’empereur stupéfait ne sut que lui répondre. Enfin revenu à lui : “Laisse, ô femme, dit-il, laisse-nous terminer le sacrifice, et ensuite nous te répondrons.” Il commanda alors de la mener au palais et de la garder avec soin ; il était plein d’admiration pour sa sagesse et sa beauté. En effet elle était parfaitement bien faite, et son incroyable beauté la rendait aimable et agréable à tous ceux qui la voyaient. Le César vint au palais et dit à Catherine : “Nous avons pu apprécier ton éloquence et admirer ta prudence, mais occupés à sacrifier aux dieux, nous n’avons pu comprendre exactement tout ce que tu as dit : or, avant de commencer, nous te demandons ton origine.” A cela Catherine répondit : “Il est écrit : Ne te loue pas ni ne te déprécie toi-même, ce que font les sots que tourmente la vaine gloire. Cependant j’avoue mon origine, non par jactance, mais par amour pour l’humilité. Je suis Catherine, fille unique du roi Costus. Bien que née dans la pourpre et instruite assez à fond dans les arts libéraux, j’ai méprisé tout pour me réfugier auprès du Seigneur J.-C. Quant aux dieux que tu adores, ils ne peuvent être d’aucun secours ni à toi, ni à d’autres. Oh! qu’ils sont malheureux les adorateurs de pareilles idoles qui, au moment où on les invoque, n’assistent pas dans les nécessités, ne secourent pas dans la tribulation et ne défendent pas dans le péril !” Le roi : “S’il en est ainsi que tu le dis, tout le monde est dans l’erreur, et toi seule dis la vérité : cependant toute affirmation doit être confirmée par deux ou trois témoins. Quand tu serais un ange, quand tu serais une puissance céleste, personne ne devrait encore te croire ; combien moindre encore doit être la confiance en toi, car tu n’es qu’une femme fragile !” Catherine : “Je t’en conjure, César, ne te laisse pas dominer par ta fureur ; l’âme du sage ne doit pas être le jouet d’un funeste trouble, car le poète a dit : “Si l’esprit te gouverne, tu seras roi, si c’est le corps, tu seras esclave.” L’empereur : “Je m’aperçois que tu te disposes à nous enlacer dans les filets d’une ruse empoisonnée, en appuyant tes paroles sur l’autorité des philosophes.” Alors 1’empereur, voyant qu’il ne pouvait lutter contre la sagesse de Catherine, donna des ordres secrets pour adresser des lettres de convocation à tous les grammairiens et les rhéteurs afin qu’ils se rendissent de suite au prétoire d’Alexandrie, leur promettant d’immenses présents, s’ils réussissaient à l’emporter par leurs raisonnements sur cette vierge discoureuse. On amena donc, de différentes provinces, cinquante orateurs qui surpassaient tous les mortels dans tous les genres de science mondaine. » (Jacques de Voragine, La Légende dorée, trad. J.-B. M. Roze, GF II 387sq.)
Utpictura18, notice A9102.
Utpictura18, notice A5749.
Utpictura18, notice A9060.
Utpictura18, notice A9044.
Utpictura18, notice A5087.
Utpictura18, notice A9118.
Utpictura18, notice A9117.
Utpictura18, notice A5539.
Utpictura18, notice A9098.
Utpictura18, notice A9100.
Vincent de Beauvais, Speculum historiale, trad. Jean de Vignay, Paris, Bnf, ms français 51, folio 130. Utpictura18, notice A9097.
Utpictura18, notice A9122.
Par exemple dans la bible d’Utrecht, La Haye, 78D38 II, fol. 147 v° (1430, notice A9052), ou dans la Maestà de Duccio à Sienne (1308-1311, notice A9048).
Utpictura18, notice A9101.
Cette petite table se trouve également dans l’enluminure des Homélies de Grégoire de Naziance analysée plus haut (notice A9100).
Utpictura18, notices A9106 et A9107.
Utpictura18, notice A9142.
Utpictura18, notice A9148.
Utpictura18, notice A9146.
Utpictura18, notice A9145.
Utpictura18, notice A9144.
Utpictura18, notice A9143.
Utpictura18, notice A9096.
Utpictura18, notice A9095. Le livre est réédité à Philadelphie en 1909.
Utpictura18, notice A9094.
La mise en scène par Merle des circonstances de cette dispute est caractéristique du principe monologique qui la gouvernait originellement : « Depuis longtemps, l’opinion publique réclamait une dispute ; il n’y avait plus que ce moyen de calmer le peuple. “Convainquez-nous par la sainte Écriture, avaient dit les conseils de Zurich à la Diète, et nous nous rendrons à vos invitations. — Les Zuricois, disait-on partout, vous ont fait une promesse : si vous pouvez les convaincre par la Bible, pourquoi ne le faites-vous pas ? Et si vous ne le pouvez pas, pourquoi ne vous conformez-vous pas à la Bible ?” Les colloques tenus à Zurich avaient exercé une influence immense ; il fallait leur opposer une conférence tenue dans une ville romaine, en prenant toutes les précautions nécessaires pour assurer la victoire au parti du pape. Il est vrai qu’on avait déclaré ces disputes illégitimes ; mais on trouva moyen d’échapper à ces difficultés : “Il ne s’agit, dit-on, que d’arrêter et de condamner des doctrines pernicieuses de Zwingle.” Ceci convenu, on chercha un fort athlète, et le docteur Eck s’offrit. » (Histoire de la Réformation au XVIe siècle, op. cit., III, 11, 13, p. 340.)
Utpictura18, notice A9058.
Utpictura18, notice A9116.
Voir Utpictura18, notice A9128.
Utpictura18, notice A9126.
Utpictura18, notice A9125.
47Le 14 janvier 1610, Johan van Oldenbarnevelt, Grand Pensionnaire de Hollande, lit devant les États une Remonstratio en 5 articles rédigée par un ami d’Arminius, Johan Uytenbogaert. Les articles étaient les suivants : « Dieu a prédestiné les croyants au salut ; | le Christ est mort pour tous les hommes ; | la foi qui sauve n’est pas produite par le libre arbitre ; | mais la grâce de Dieu n’est pas invincible ; | il n’est pas sûr qu’un élu ne puisse pas rechuter. » Sur cette Remonstratio, dont l’enjeu n’était pas seulement religieux, mais politique, voir Jean Robert Armogathe, « Histoire des idées religieuses et scientifiques dans l’Europe moderne », Annuaire de l’École Pratique des Hautes Études, n°115, 2008, p. 293-297, §15sq. Voltaire a tourné en dérision cette dispute dans l’Essai sur les mœurs, chap. 187 « De la Hollande au XVIIe siècle », éd. R. Pomeau, Garnier-Bordas, 1990, t. 2, p. 729.
Cette histoire est passée au théâtre : John Fletcher et Philipp Massinger, The Tragedy of Sir John van Olden Barnevelt, 1619 ; Antoine-Marin Le Mierre, Barnevelt, tragédie composée dans les années 1770, publiée à Lyon en 1784, jouée en 1790, puis censurée ; Fallet, Barnevelt, ou le stathoudérat aboli, tragédie en 3 actes, 1794. À ne pas confondre avec le Barnwell du Marchand de Londres de Lillo, dont Diderot, et à sa suite Mercier et La Harpe, font un Barnevelt de drame bourgeois.
Utpictura18, notice A9108. La gravure a été copiée en 1729 par Bernard Picard (voir B5899), qui met en valeur les spectateurs au 1er plan.
Utpictura18, notice B5900.
Utpictura18, notice A9110.
Wonderlijcken Droom Vande School-houdinghe van Mr. Ian van Olden-barnevelt. Utpictura18, notice A9111.
Utpictura18, notice A9109.
Du Juge des controverses, traité auquel est défendue l’authorité & la perfection de la Saincte Escriture, contre les usurpations & accusations de l’Eglise Romaine. Par Pierre du Moulin, Ministre de la parole de Dieu en l’Eglise de Sedan, & Professeur en Theologie. A Geneve, Chez Pierre Aubert Imprimeur ordinaire de la Republique & Academie, M. DC. XXXI. Avec permission & privilege.
Baldassare Castiglione, Il Cortegiano, Venise, 1528.
L’allemand forme un substantif à partir de entfremden, devenir étranger.
Hegel, Phénoménologie de l’esprit, VI. L’Esprit, B. L’esprit devenu étranger à soi-même, la culture, a) Le monde de l’esprit devenu étranger à soi, II. Le langage comme l’effectivité de l’extranéation ou de la culture, trad. Jean Hyppolite, Aubier, 1941, t. 2, p. 69.
« Quoique la richesse soit bien ce qui est passif et nul, elle n’en est pas moins essence spirituelle universelle, elle est le résultat, qui incessamment devient, du travail et de l’opération de tous, un résultat qui ensuite se dissout à son tour dans la jouissance de tous. »
Diderot, Le Neveu de Rameau, éd. J. Fabre, Droz, « Textes littéraires français », 1977, p. 7.
Référence de l'article
Stéphane Lojkine, “Polemics as a World”, lecture at the Tel-Aviv university, Nadine Kuperty's course about Fears and Violences in the French Ancient Regime, December 2011.
Critique et théorie
Archive mise à jour depuis 2008
Critique et théorie
Généalogie médiévale des dispositifs
Entre économie et mimésis, l’allégorie du tabernacle
Trois gouttes de sang sur la neige
Iconologie de la fable mystique
La polémique comme monde
Construire Sénèque
Sémiologie classique
De la vie à l’instant
D'un long silence… Cicéron dans la querelle française des inversions (1667-1751)
La scène et le spectre
Dispositifs contemporains
Résistances de l’écran : Derrida avec Mallarmé
La Guerre des mondes, la rencontre impossible
Dispositifs de récit dans Angélique de Robbe-Grillet
Disposition des lieux, déconstruction des visibilités
Physique de la fiction
Critique de l’antimodernité
Mad men, Les Noces de Figaro
Le champ littéraire face à la globalisation de la fiction
Théorie des dispositifs
Image et subversion. Introduction
Image et subversion. Chapitre 4. Les choses et les objets
Image et subversion. Chapitre 5. Narration, récit, fiction. Incarnat blanc et noir
Biopolitique et déconstruction
Biographie, biologie, biopolitique
Flan de la théorie, théorie du flan
Surveiller et punir
Image et événement

