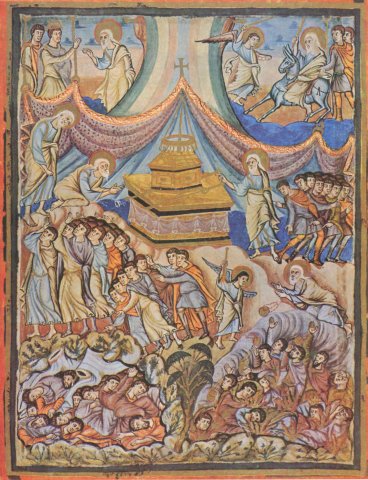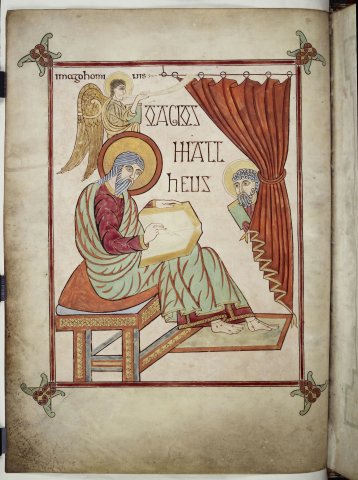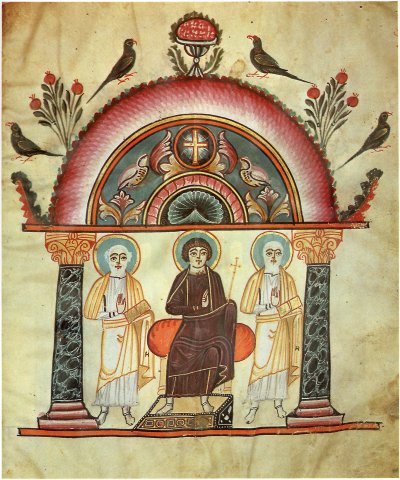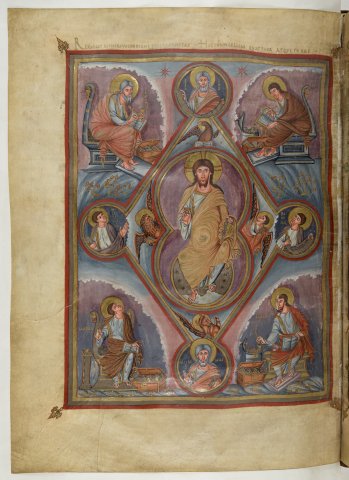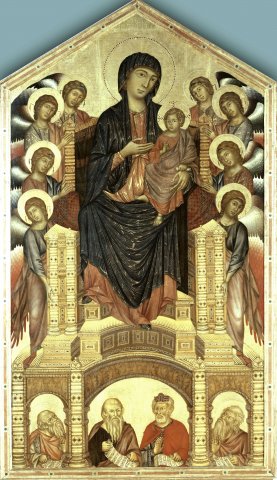Contradiction, rareté, pauvreté
A première vue, le tabernacle semble être un motif iconographique sans intérêt. Et s’il existe un objet qui symbolise tout ce qu’il y a de plus éloigné de l’image, c’est bien le tabernacle, qui n’a de valeur qu’en tant qu’il contient les tables de la Loi, où est inscrit entre autres l’interdit biblique de la représentation1.
Certes, le tabernacle apparaît dès le Moyen Âge dans les cycles narratifs illustrés ou peints, lorsqu’il s’agit de représenter telle ou telle scène biblique où il intervient. Une enluminure de la Bible de Charles le Chauve représente très exceptionnellement l’arche au centre sous la tente du tabernacle où prient Moïse et Aaron. Autour sont figurées diverses scènes de l’histoire des Hébreux. Dans la Bible de Naples, au livre de l’Exode, la construction du sanctuaire dans le désert sur les instructions de Moïse donne lieu à une première enluminure (f° 39v°), qui représente le tabernacle comme une petite tour rose à quatre piliers surmontée d’un toit pointu, que les ouvriers érigent en tirant sur une corde. Une seconde enluminure2 présente Moïse agenouillé en prière devant le tabernacle rose, surmonté de la tête de Dieu qui apparaît posée sur un nuage blanc. Sur cet objet fonctionnel, somme toute assez pauvre iconographiquement, il y a peu à dire.
De l’objet au dispositif
L’allégorie du tabernacle n’est pas un thème iconographique. Nous verrons qu’elle se traduit par des images aux sujets très divers. Ce qui est en question à travers elle, c’est le statut même de l’image. La conquête par l’image de son autonomie sémiologique et médiologique, le fait qu’elle se constitue en objet, en support symboliquement séparé du sujet qu’elle représente, que ce sujet soit biblique ou non, passe par l’identification de l’image au tabernacle, puis par la transformation de la signification symbolique qui lui est dévolue : des tables de la Loi au Christ, du Christ à l’Église, de l’Église à la Vierge, l’image tabernacle en changeant de sens change de statut. Elle s’éloigne peu à peu de l’ancienne Loi pour s’installer de plus en plus exclusivement dans la Chair ; elle cesse d’être essentiellement l’objet d’une contemplation mystique, d’un face à face avec le principe symbolique, le fondement de la Loi, pour devenir le point d’aboutissement d’un regard pris au piège de ce qui devient dispositif.
Alors l’allégorie du tabernacle s’estompe, mais ses instruments géométraux demeurent. Longtemps après que le dispositif moderne de la peinture d’histoire classique s’est constitué, la technicisation et l’objectivation de l’image conserve la trace de son origine tabernaculaire : la séparation, que matérialise le rideau du tabernacle, entre le Saint et le Saint des Saints, divise l’espace en espace ouvert du visible et espace restreint, inaccessible, des vérités invisibles. Elle lègue au dispositif moderne de la représentation son organisation géométrale : le tabernacle perdure en quelque sorte sous la forme du dispositif d’écran qui règle les scènes picturales et romanesques classiques ; de façon plus diffuse enfin, il s’universalise en la structure du signe linguistique, puis sémiotique, marquée par la coupure entre le signifiant et le signifié.
I. Économie et similitude
L’incarnation, première image
L’Église des premiers siècles n’avait pas de doctrine constituée sur les images3. Elle a vécu dans une contradiction latente entre l’interdit biblique et la pratique de la décoration des églises et de l’adoration des icônes.
Cette contradiction occupe le devant de la scène à Byzance lors de la crise iconoclaste aux huitième et neuvième siècles, crise dont les controverses ont fourni à l’Église l’appareil théorique qui lui faisait jusque-là défaut. Plus discrètement, une réflexion sur l’image se développe parallèlement en Occident, avant que les deux traditions n’y soient fondues au douzième siècle : Jean Scot Érigène avait commenté Denys l’Aréopagite au ixe siècle ; mais il faut attendre 1150 pour que De la foi orthodoxe de Jean Damascène soit traduit en latin. Les idées de Jean Damascène sont reprises presque aussitôt dans les Sentences de Pierre Lombard, le grand manuel théologique d’alors, puis dans la Somme théologique de Thomas d’Aquin. Par cette médiation, qui est aussi un détournement, se diffuse dès lors en Occident le discours iconophile byzantin.
La justification byzantine des images s’appuie avant tout sur le mystère de l’incarnation. Si les images étaient interdites dans l’ancien testament, c’est que Dieu n’avait pas encore jugé les hommes prêts à contempler sa face, qui ne se révélait à eux qu’indirectement, au travers d’une nuée, dans les songes, ou par la médiation d’un ange. La vision de Dieu est ici identifiée à la révélation de Dieu, le voir à un savoir. Le regard ne relève pas d’une phénoménologie, mais d’une métaphysique.
Pour les Byzantins iconophiles, l’incarnation de Dieu le Père dans son Fils a constitué historiquement une révolution sémiologique : le Fils est l’image du Père ; Dieu a créé une image de lui-même ; il a permis que, par la grâce, le chrétien contemple sa Face. L’incarnation est, historiquement, la création de la première image proprement dite.
Les images artificielles
On est loin a priori de la fabrication des images par les hommes. Tout un cheminement se fait, dans la pensée patristique, depuis l’évocation paulinienne du Christ comme image4 jusqu’à la célébration de l’icône par l’Église lors du Triomphe de l’orthodoxie. Ce n’est que très progressivement que tend à s’imposer l’identification de ce qu’on appelle image naturelle (dont l’exemple le plus achevé est l’incarnation) et image artificielle (les images au sens moderne du terme).
Augustin avait marqué sa réticence en distinguant d’abord imago et ad imaginem, le Christ image du Père et l’homme créé à l’image de Dieu5 ; l’image fabriquée de mains d’homme, enfin, est encore plus frappée par la dissemblance, par l’hétérogénéité vis-à-vis de son modèle. Augustin assigne bien un statut symbolique à l’image, mais en tant que catégorie immatérielle, qu’élément du discours sur le mystère de la Trinité. Comme objet, l’image sent l’hérésie.
Le culte des icônes se développe donc en marge des institutions de l’Église ; il croise en Orient la question politique de la représentation du pouvoir : l’empereur envoie à ses gouverneurs de Provinces, aux cours des royaumes qui lui sont affidés, son image. Le portrait, symboliquement, porte l’efficace de son prototype ; on se prosterne devant lui comme devant l’empereur même. L’image de l’empereur figure également sur la monnaie : elle diffuse la présence du monarque sur tout l’espace économique dans lequel elle circule. Enfin, les premières icônes célèbres sont les icônes achiropiites, non faites de main d’homme, où la Face du Christ est censée être venue s’imprimer miraculeusement. Ces icônes seront utilisées par les empereurs byzantins dans leurs campagnes militaires contre les Perses mazdéens puis intégrées au Trésor impérial de Constantinople. Elles signifient la présence du Dieu vivant, à la tête des armées affrontées aux infidèles, ou au mur des villes assiégées de l’empire. L’image matérialise la présence politique du souverain, terrestre ou céleste. La société byzantine assigne ici un statut symbolique à des images matérielles ; mais elle n’assume pas leur dissemblance, leur artificialité ; ce ne sont pas à proprement parler des re-présentations ; indissolublement liées à leur modèle par la légende de leur création indicielle ou par le rite impérial qui les consacre, ce sont des objets magiques.
Paradoxalement, la crise iconoclaste n’a pas essentiellement consisté à proscrire les images au sens moderne du terme, mais plutôt à tenter d’établir une coupure entre l’image et le prototype, en réservant la production des images artificielles à l’espace profane et politique. Dans cet espace, on ne constate pas de différenciation iconographique majeure entre iconodoules et iconoclastes. Avant la crise, sous Justinien II (685-695 et 705-711), les monnaies étaient frappées à l’effigie de l’empereur d’un côté, désigné comme servus Christi, et du Christ de l’autre, désigné comme rex regnantium6. Sous Anastase II et Théodose III, le Christ disparaît, momentanément remplacé par l’ancien symbole de la Croix de la victoire élevée sur un piédestal7. Le Christ réapparaît dans les monnaies de Léon III (714-741), le premier empereur iconoclaste8 : comme symbole politique, le Christ peut continuer d’être imprimé.
En revanche, c’est en détruisant à la porte de Chalcé l’effigie du Christ qu’il fait remplacer par le symbole de la Croix que Léon III ouvre les hostilités iconoclastes9. La Porte de Bronze du Palais, construite par Constantin le Grand, le fondateur du christianisme impérial, excède la sphère du politique : c’est l’icône protectrice de la ville, constituant la ville comme cité du Christ, qui est ici visée. L’icône n’est pas l’insigne du pouvoir impérial chrétien, comme sur la monnaie ; plus qu’un signe, elle est l’idole religieuse aux pouvoirs magiques qui se dresse à la défense de la ville : la croix sur le piédestal tente de signifier une efficacité combattante équivalente, l’image idolâtre en moins.
C’est dans le même esprit que Léon III fait détruire les images des conciles œcuméniques sur les murs et les voûtes du Milion, et leur substitue, au grand scandale des iconophiles, une image représentant son cocher favori10 : en toute bonne conscience, il manipule l’image publicitaire à des fins politiques. La distinction iconoclaste entre les images s’inscrit ainsi, en quelque sorte, dans le prolongement direct des distinctions et des réticences augustiniennes.
La tentative que firent les empereurs iconoclastes pour laïciser l’image échoua. Les théologiens byzantins iconophiles élaborèrent alors une justification de l’image chrétienne dont Marie-José Mondzain a montré qu’elle était articulée autour du concept d’économie11.
Économie
Le mot est employé dans des contextes si différents qu’il se manifeste non seulement comme concept opératoire, mais comme signe d’appartenance idéologique, comme symptôme culturel. Quel que soit son champ d’application, rhétorique, politique, théologique, l’économie consiste à articuler souplement deux registres a priori hétérogènes, à établir une continuité logique entre eux. L’économie est l’adaptation habile d’un registre élevé, spirituel ou idéologique, à un registre trivial, terrestre ou matériel. L’économie articule la sphère du symbolique avec la sphère du réel ; elle organise un continuum du réel au symbolique.
L’art de l’économie est donc un art de la superposition. Dans un espace matériel, dont elle organise et explique les différentes parties, l’économie assigne à chacun des éléments concrets, visibles, une signification symbolique, toujours rapportée au même mystère, qui est le mystère de l’incarnation. L’économie articule ainsi l’infinie diversité du réel à l’unité du symbolique.
L’image ne se réduit plus ni à la modélisation abstraite de l’œuvre du Créateur (création ad imaginem, incarnation comme imago), ni à la sacralité magique de l’idole. Elle excède la pure symbolicité. Elle superpose au mystère de la foi qui la sous-tend l’organisation géométrale d’un espace donnant chair à ce mystère. Parce qu’elle opère cette superposition, parce que dans un même mouvement elle ordonne un espace concret (dispositio) et répartit dans cet espace les éléments abstraits qui signifient le mystère (dispensatio), l’économie est l’ancêtre du dispositif12.
Toute la spéculation byzantine sur l’image étant centrée sur le mystère de l’incarnation, l’icône par excellence est toujours l’icône du Christ. Regarder, adorer l’icône, c’est voir en elle le prototype, refaire dans l’autre sens l’opération de l’incarnation13. Précisément parce qu’elle a acquis sa légitimité en triomphant des prétentions séparatistes des iconoclastes, l’icône ne fonctionne jamais comme un objet autonome. Ce qui la rattache à sa dimension matérielle de support pictural, c’est son identification économique à la chair, c’est-à-dire au corps de Marie14, dont le Christ a tiré sa chair. Symptômatiquement les icônes orthodoxes ne sont dites icônes ni de Marie, ni de la Vierge, mais de la Théotokos, la génitrice de Dieu15 : elle est constamment pensée dans sa relation avec la chair du Christ et ne se donne pas à voir dans l’icône comme une personne autonome. La théotokos est la circonférence du Christ, χώρα τῶν ἀχώρων, περιγραφὴ τῶν ἀπεριγράπτων16 : la dimension visible de l’icône ne peut être séparée du mystère invisible de l’incarnation.
Dédaignant l’autonomie du support, l’icône byzantine se déploie dans un univers de formes stylisées qui disent sa similitude avec le mystère qu’elle porte, mais jamais sa ressemblance avec les personnages qu’elle représente. L’icône ne fait pas œuvre d’imitation, mais de dissemblance. Augustin avait déjà suggéré que, dès que l’on sort de l’image prise comme filiation, la création d’une image constitue une dégradation du modèle :
« C’est en raison, comme nous l’avons dit, d’une ressemblance imparfaite que l’homme est appelé à l’image17. » (De Trinitate, VII, vi, 12.)
Jean Damascène, qui parle lui des icônes faites de main d’homme substitue la différence (διαφορὰν) à l’inégalité augustinienne (imparem similitudinem), restaurant la dignité de l’image :
« L’image est donc une ressemblance qui caractérise son prototype avec cela qu’elle comporte une certaine différence avec l’archétype18. » (Jean Damascène, Discours sur les images, I, 9.)
Mais ce faisant, il distingue deux niveaux dans l’image, l’un fondé sur le rapport au prototype (le modèle physique), l’autre sur le rapport à l’archétype, le modèle de tous les modèles, le Christ saisi comme hypostase, c’est-à-dire comme articulation de l’humanité et de la divinité. Dire que l’image est une caractérisation de son modèle signifie certes étymologiquement qu’elle en porte l’empreinte et rappelle que le modèle de toute icône est indiciel (monnaie, achiropiite), mais ce χαρακτηρίζον exprime aussi qu’elle stylise la ressemblance et, par là, qu’elle la déréalise.
La différence, elle, est repoussée du prototype à l’archétype, de la ressemblance physique à l’hétérogénéité spitituelle. Du point de vue du trait, l’image déréalise donc le prototype qu’elle réduit à un caractère, qu’elle stylise. Par cette réduction, elle fait valoir la différence spirituelle entre le support stylisé et l’archétype devant lequel ce support s’abolit. Ainsi, hors de tout espace géométral, de toute mimésis du réel, l’icône est faite pour la contemplation et l’adoration mais se dérobe au regard :
« En contemplant sa figure corporelle, nous nous représentons, autant qu’il est possible, la gloire de sa divinité. […] si nous pouvons à travers des paroles sensibles et avec les oreilles du corps, comprendre les choses spirituelles, nous pouvons aussi par la contemplation corporelle parvenir à la contemplation spirituelle19. » (Discours sur les images, III, 12, trad. française Anne-Lise Darras-Worms, in Le Visage de l’invisible, Migne, 1994, p. 74.)
Abolir l’écrin : les achiropiites
La question du support, si elle n’est jamais tranchée, demeure pourtant latente dans l’économie byzantine de l’icône. Les icônes achiropiites sont des images imprimées sur des supports sans la main de l’homme. Qu’est-ce que cette impression ?
La miniature d’un manuscrit de L’Échelle céleste de Jean Climaque20 apporte quelques éléments de réponse. Elle représente deux Saintes Faces légèrement dissemblables. Celle de gauche comporte, en bas, des franges, et est imprimée sur un tissu blanc à motifs rouges. Il s’agit d’un achiropiite sur tissu, le Mandylion d’Édesse, apporté à Constantinople en 944. Celle de droite constitue en quelque sorte le négatif de la première, comme le marque l’inversion des couleurs et la position symétrique de la tête. Elle représente le Keramion, qui vient de Syrie et constituerait une copie miraculeuse, sur la tuile ou la brique, du Mandylion. Les deux achiropiites furent conservés dans la chapelle du Grand palais jusqu’à son pillage par les Croisés en 1204.
La légende de la miniature, ΠΛΑΚΕΣ ΠΝ(ΕΥΜΑΤ)ΙΚΑΙ, planches spirituelles, fait allusion au texte de Jean Climaque : il a tracé, nous dit le manuscrit, les divins préceptes sur les cœurs purs de ses auditeurs comme sur des feuilles de papier ou, mieux, sur des planches spirituelles. L’expression πλακὲς πνευματικαὶ identifie donc le texte de Climaque aux images du Christ, le livre écrit aux icônes achiropiites21.
D’autre part, l’image, par son caractère double ainsi que par sa légende, renvoie aux tables de la Loi, toujours représentées comme deux « plaques », et qui furent imprimées miraculeusement pour Moïse sur le Sinaï de la même façon que le Mandylion et le Keramion sont des impressions miraculeuses. A la Loi mosaïque correspond la Loi de la nouvelle alliance, aux deux tables, les deux faces du Christ.
Parce que le Christ est la table de la Loi, la Vierge, qui circonscrit le Christ, est l’arche d’alliance :
« On dit aussi qu’il existe une image de l’avenir, celle qui esquisse de façon énigmatique ce qui se produira, comme l’arche pour la sainte Vierge et Mère de Dieu22. » (Discours sur les images, I, 12, op. cit., p. 44.)
De là, par métonymie, l’image, qui est d’abord thématiquement image du Christ, est identifiée au tabernacle : elle est le degré zéro du support, l’enveloppe qui cache le Décalogue, l’écrin qui visualise l’invisibilité de la Loi.
Un passage du De tabernaculo23 de Bède le Vénérable montre comment, en Occident aussi, c’est d’abord sine manibus que se présente de façon légitime l’image. Le prototype de l’image sine manibus s’est manifesté dans le miracle du mont Sinaï :
« Et je te donnerai, dit-Il, les tables de pierre – la Loi et les commandements que j’ai écrits – pour que tu les leur apprennes (Ex. xxiv, 12). Cela ressemble à ce passage de l’Évangile que nous avons cité plus haut, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé (Mt. xxviii, 20)24. […] Et de fait Daniel lui aussi vit le Seigneur sous la figure d’une pierre taillée dans la montagne anéantir sans les mains25 la pompe du royaume de ce monde pour que son royaume seul demeure sans fin, et Pierre26 exhorte ses fidèles en disant Et vous, comme des pierres vives, soyez édifiés en demeures spirituelles27. »
Le rapprochement paraît a priori plutôt abrupt : ce qui relie en fait le songe de Nabuchodonosor et le don des tables de la Loi, c’est sine manibus : dans les deux cas, la vérité du mystère divin s’est révélée sans qu’il y ait recours aux mains de l’homme. La Loi a fait image sine manibus, elle a produit un objet achiropiite. Il n’est pas question ici de dissocier l’image (les tables, le songe, l’icône) de son modèle : l’image est indiciellement liée au modèle qui l’imprime, elle confond réalité vivante, dans le monde, et architecture idéale, dans l’esprit. De même qu’on ne peut dissocier l’image de son modèle, Pierre identifie, par le nom même que Jésus lui a donné, édifice symbolique de l’Église et réalité corporelle des fidèles, ses pierres vives. L’icône achiropiite s’inscrit dans le prolongement des pierres vives et échappe par là à sa relégation comme image artificielle.
L’image se définit donc par l’identité, ou tout du moins par la fusion entre le modèle, archétype ou prototype disent les Grecs, et sa figuration sur un support. Le terme de Sainte Face (πρόσωπον en grec, vultus en latin, volt et vout en langues d’oc et d’oïl) contient une ambiguïté très significative : il désigne à la fois le visage réel du Christ et sa représentation sur l’image28. L’idée même de re-présentation est étrangère à la première image médiévale.
Célébrer le support : les enluminures
Pourtant, si la décoration des Églises et la fabrication des icônes obéit pour l‘essentiel à cette dissolution du support dans l’au-delà mystique qu’il rend visible, la pratique de l’enluminure des textes sacrés ne peut se plier à ce type d’abstraction : contrairement aux images-idoles qui frisent toujours le paganisme, les illustrations du Livre mettent en valeur un support légitime, un objet qui occupe dans la pratique religieuse une place tout à fait orthodoxe. L’image célèbre alors le plus saint des supports : enveloppant le texte de la Loi qu’est la Bible, elle se constitue en arche (les livres illustrés sont promenés lors des processions29), en tabernacle.
Ici se dessine la différenciation historique du statut de l’image à Byzance et en Occident. L’image byzantine est d’abord une icône renvoyant à la Face même du Christ ; parce qu’elle n’est pas délimitée comme un objet indépendant, qu’elle n’existe pas en dehors de la σχέσις la reliant au prototype, que pourtant elle s’offre familièrement à une adoration sans entraves, l’icône byzantine fonctionne comme un fétiche. En Occident, en revanche, le modèle du Livre a prévalu. L’image illustre le Livre ou, dans l’église, tient lieu du Livre. C’est au nom de cette conception des images que Grégoire le Grand, dans une lettre célèbre, légitime leur présence dans les églises.
« de Grégoire à Sérénus, évêque de Marseille,
Il faut par ailleurs que je te parle de ceci : la nouvelle nous est parvenue il y a peu que votre communauté, voyant qu’il y avait des gens qui vouaient un culte (adoratores) aux images, a brisé ces images dans les églises et les a jetées dehors. Bien sûr nous vous avons loué d’avoir mis tout votre zèle à empêcher qu’on ne voue un culte (adorari) à aucun objet fait de main d’homme (manufactum), mais nous avons jugé que vous n’auriez pas dû briser ces images. Si on recourt à la peinture dans les églises, c’est pour que ceux qui ne savent pas lire puissent lire du moins en regardant sur les murs ce qu’ils ne sont pas capables de lire dans les livres (in codicibus). Donc ta communauté aurait dû préserver ces images tout en interdisant au peuple de leur vouer un culte, en t’arrangeant pour que les illettrés aient un endroit où rassembler le savoir de l’histoire [sainte] mais que le peuple succombe le moins possible au culte des peintures30. »
On n’a souvent retenu de ce texte que la conception réductrice de l’image comme Bible des illettrés. L’essentiel n’est pas là : le mur peint est conçu comme une page de Livre. L’ut pictura poesis de la Renaissance s’inscrit dans cette tradition : l’image occidentale s’assujettit ici, pour échapper à l’interdit, à une logique textuelle. Elle ne représente pas la Face du Christ, mais son histoire.
Traditionnellement, les livres des Évangiles portent, au début de chacun d’eux, l’image de son auteur, accompagnée en principe du symbole qui permet de l’identifier. Dans le Book of Lindisfarne, Matthieu est représenté assis de profil, écrivant son texte.
L’artiste s’est inspiré d’Esdras travaillant à la nouvelle rédaction de la Bible, que l’on pouvait voir dans le Codex Grandior de Cassiodore ou dans le Codex Amiatinus de Florence qui le copie fidèlement31. Mais il évacue presque toute suggestion de perspective : l’espace de l’image devient un espace abstrait, sur lequel déployer le jeu symbolique des similitudes. Matthieu est désigné par une inscription plus ou moins transcrite du grec, O Agios Mattheus (saint Matthieu). Comme dans l’icône byzantine, ce Matthieu ne ressemble pas à une personne réelle et ne signifie que par l’inscription qui le désigne. Tel est le régime de l’économie, absolument anti-mimétique. Au-dessus de Matthieu un homme portant des ailes déroule de sa bouche le phylactère du commencement du texte. On devrait y trouver les premiers mots, liber generationis, mais le phylactère est blanc, comme le livre. L’image est le texte, qui n’a pas besoin donc d’être inscrit. Cet homme ailé est le symbole canonique de Matthieu, emprunté à la vision d’Ézéchiel. Le texte d’Ézéchiel, dans la Vulgate, parle de similitudo hominis, de facies hominis (Ez. i, 5), mais les évangiles médiévaux, pour désigner cet homme en tant que symbole de l’évangéliste, recourent à l’expression imago hominis.
Derrière le rideau, à droite, un autre personnage, portant un livre et une auréole, semble regarder Matthieu. On peut penser qu’il faut l’identifier à Ézéchiel, dont l’exégèse chrétienne a interprété la vision du tétramorphe comme préfiguration des quatre évangélistes. Ézéchiel porte une auréole simple tandis que celle de Matthieu est bicolore. Le rouge de l’incarnation qui la circonscrit rappelle que Matthieu, par la grâce de l’incarnation, a eu accès clairement, face à face, aux mystères qui n’apparaissaient que comme énigmes et songes à Ézéchiel. Ézéchiel regarde de derrière le rideau qui sépare le Saint du Saint des Saints, où se trouve Matthieu, et avec lui le lecteur chrétien qui lira cet évangile. L’image fonctionne bien comme tabernacle, avec sa séparation intérieure qui distingue, mais articule dans le même temps, les deux espaces du Saint et du Saint des Saints. Le Saint est le lieu périphérique, enveloppant, du visible, de l’image énigmatique, où se déploient les visions des prophètes. Le Saint des Saints est le lieu de la révélation, du Verbe incarné, où apparaît la Face de Dieu, la vérité même du texte. L’articulation du texte et de l’enluminure est l’articulation du Saint et du Saint des Saints, mise en abyme dans l’enluminure même.
Mais ces deux espaces demeurent sans profondeur, en raison même de leur économie. L’illusion s’y défait pour ramener l’œil à la matérialité de la surface : le siège de Matthieu figure un A ; son auréole, un O. Le texte qu’écrit Matthieu relie le A et le O. L’évangéliste est l’alpha et l’oméga, c’est-à-dire le Christ même32. L’image fonctionne toujours comme page écrite du Livre, dont elle condense, sur sa surface, la totalité.
Dans l’Évangile d’Echternach, la stylisation est accentuée. Le personnage portant le livre, avec l’inscription Liber generationis ihû χρί (Iesu Christi) est à la fois Matthieu et son symbole. La chaise sur laquelle il est assis reproduit le A, mais fait corps avec lui : le A de la chaise est le cadre dans lequel s’inscrit le personnage. Quant à son corps, il s’ornemente, se stylise pour devenir combinaison de trois omégas. La chaise, le corps, l’évangéliste, son symbole et son livre, ainsi superposés, ne font qu’un. C’est une véritable quintessence de la similitude. L’ensemble est cerné de quatre carrés à motifs géométriques évoquant les quatre évangélistes. Il s’agit de rappeler que cette image est une page des Évangiles, à la fois page singulière et condensation en une page de tous les Évangiles. La similitude procède moins par métaphores que par métonymies ; de l’homme au Livre qu’il tient, du Livre au Christ qui l’incarne ; mais aussi de l’image de Matthieu à l’évangile de Matthieu, puis à l’ensemble des évangiles.
Le tabernacle comme cadre de l’image
Dans le codex aureus de Cantorbéry, l’identification de l’image, en tant que support, au tabernacle, est figurée par les deux colonnes, le fronton et le rideau ouvert, derrière lequel trône Matthieu. Cet encadrement tabernaculaire de l’image des évangélistes, ou du Christ et des apôtres est très courant dans les manuscrits médiévaux, en Orient33 comme en Occident.
Il indique clairement l’ouverture, après la venue du Christ, du Saint des Saints aux fidèles. C’est de là que parlent les Évangélistes. L’image ne peut exister qu’après que le rideau du Saint des Saints s’est déchiré, s’est ouvert. Cette effraction constitutive de l’image demeurera une caractéristique fondamentale et persistante de tous les dispositifs iconiques dans notre culture même en dehors de tout contexte, de toute signification chrétienne : la modélisation physique du regard comme pyramide visuelle, comme cône coupé à la base par l’image, prendra alors le relais de l’ouverture christique du rideau du Saint des Saints.
Le tabernacle est figuré par un demi-cercle posé sur un rectangle et les tables de la Loi reproduisent en général cette même forme parce que le demi-cercle est la figure du monde (imago mundi), c’est-à-dire du Christ. En conjoignant les colonnes du tabernacle et le demi-cercle qui les couronne, on indique par contiguïté métonymique la similitude de l’ancien tabernacle, construit par Moïse, et du nouveau, constitué par l’incarnation du Christ. Cosmas Indicopleustès, au vie siècle, propose toute une méditation sur cette forme du rectangle et du demi-cercle34, expliquant que le rectangle est lui-même divisé en trois étages, par lesquels s’opère la translation économique, du visible vers l’invisible, du terrestre vers le céleste.
L’enluminure de saint Luc, dans l’Évangile présumé de saint Augustin, suit à la lettre ce programme : on y distingue d’abord non pas deux, mais bien les quatre colonnes qui, dans le tabernacle, supportent le voile séparant le Saint du Saint des Saints. De part et d’autre de Luc, des scènes de l’Évangile sont dessinées entre les colonnes et réparties en trois étages. L’étage supérieur figure à gauche l’Annonciation (i, 26) et le Christ parmi les docteurs (ii, 41), à droite l’enseignement du Christ (iv, 15sq). Cet étage est le point de départ de la translation économique : il évoque le mystère de l’incarnation et l’enseignement du Christ, par lesquels le fidèle accède au Saint des Saints, à la vérité de Dieu.
L’étage médian évoque à gauche le Christ en barque sur le lac Tibériade, à droite le lavement des pieds par la pécheresse (vii, 36) et peut-être Marie-Madeleine aux pieds des deux hommes éblouissants annonçant la résurrection (xxiv, 4). Les pieds sont l’élément commun aux scènes, en tant que figure de l’humanité, de l’humilité du Christ d’une part, de sa divinité d’autre part. L’étage médian est celui du passage, de l’articulation entre la chair et l’esprit.
L’étage inférieur enfin évoque à gauche la résurrection de Lazare (xvii, 19), à droite la Cène et la prière au mont des oliviers (xxii, 39). Dans chacune de ces scènes, la résurrection est en question. L’étage inférieur ouvre sur l’invisible, qui depuis l’image demeure problématique.
L’ensemble du programme iconographique ne doit donc pas simplement être lu comme un résumé en images de l’histoire, mais comme le mouvement même de la contemplation et de l’adoration, qui part de la réalité visible de l’incarnation pour aller vers la vérité invisible de la résurrection.

Le personnage de Luc n’écrit pas. L’œil vague, le menton appuyé sur son poing droit, il médite, désignant la nature du regard à porter sur l’image. Le livre ouvert aux rubans dénoués porte l’inscription suivante : Fuit ho/mo mis/sus i[n] d[e]s[ert]o / cui nom/en erat / Joh[annes], un homme fut envoyé dans le désert et son nom était Jean. C’est le résumé du début de l’évangile de Luc. Mais là aussi le texte inscrit ouvre à une bipartition de l’espace tabernaculaire : Jean prêchant dans le désert préfigure le Christ, dont l’enseignement est mis en images entre les colonnes. Le texte parle de Jean ; l’image montre le Christ. Le texte demeure énigmatique ; l’image, substituée ici au rideau qui est absent entre les colonnes, est l’écran sur quoi se révèle clairement la vérité de Dieu.
Le saint Luc de l’Évangile présumé de saint Augustin présente donc en quelque sorte un compromis entre la lecture économique de l’image, projetée vers un archétype invisible (cette lecture va devenir la lecture byzantine par excellence) et le jeu des similitudes qui, dans l’enluminure, célèbre l’identité du texte et de l’image, fondus en un support fonctionnant à la fois comme surface du Livre et espace du tabernacle. En Occident, cette conception de l’image comme jeu des similitudes va se développer indépendamment de la spéculation économique byzantine : au lieu d’être excusé par l’économie et de se dissoudre dans l’au-delà d’une contemplation mystique, le support est célébré dans sa matérialité même. Le cœur de la méditation exégétique va se déplacer de l’incarnation, sujet central des spéculations byzantines, vers la passion, qui est le moment de l’autonomisation de la chair christique. L’image elle aussi s’autonomise dans l’identification au tabernacle : elle n’est plus alors l’image de Dieu (comme les achiropiites des Grecs), renvoyant à un archétype qui la dissout ; elle contient Dieu et sa sacralité s’identifie au support lui-même.
Le principe de réversion : Bède le vénérable
Jean Wirth a montré quelle place essentielle occupait Bède le vénérable en Occident dans la pensée et la légitimation de l’image35. Bède écrit juste après la fabrication du Book of Lindisfrane, juste avant celle du Book of Kells ; il est contemporain du codex aureus. Bède est anglais : les codes iconographiques qu’il connaît et qu’il inspire sont ceux de ces manuscrits insulaires. Nous avons déjà cité son De tabernaculo ; dans le De templo Salomonis, dont la méditation tourne toujours autour du même support (le Temple est une métonymie du tabernacle), il soulève la contradiction du récit de l’Exode, où Dieu interdit par le Décalogue de fabriquer des images, et ordonne de construire des images pour y installer le Décalogue. Cette contradiction est soulevée au même moment par Jean Damascène, à l’autre bout de la Chrétienté.
« Mais réponds à ma question : Dieu est-il le seul Dieu ? Oui, dis-tu, me semble-t-il, le seul législateur. Pourquoi donne-t-il donc des ordres contradictoires ? Sans doute les chérubins participent-ils de la création. Pourquoi donc ordonne-t-il que des chérubins gravés et sculptés de main d’homme ombragent le propitiatoire ? La raison en est, c’est évident, qu’on ne peut pas fabriquer une image de Dieu en tant qu’il est incirconsciptible et infigurable, ni de quiconque comme d’un Dieu, afin qu’on n’adore pas la créature comme un Dieu. mais il ordonne de fabriquer une image des chérubins – qui sont circonscriptibles, eux, et se tiennent, comme c’est le rôle des serviteurs, près du trône divin – une image qui ombrage, comme un serviteur, le propitiatoire. Il convenait en effet à l’image des liturgies célestes d’ombrager l’image des mystères divins. Et que sont selon toi, l’arche, la cruche, le propitiatoire ? N’ont-ils pas été fabriqués par une main ? Ne sont-ils pas des ouvrages de main d’homme ? N’ont-ils pas été façonnés à partir de la matière, qui est vile, comme tu le dis ? Qu’est-ce que le tabernacle tout entier ? N’était-ce pas une image ? N’était-ce pas une ombre et un exemple ? Le divin Apôtre nous parle en effet, lorsqu’il décrit les prêtres de la Loi, de ceux qui adorent Dieu par une figure et une ombre des choses du ciel, ainsi que Moïse en fut averti, lorsqu’il devait dresser le tabernacle : “Tu auras soin de faire tout selon le modèle qui t’en a été montré sur la montagne” (He. viii, 5). Or la Loi n’était pas une image, mais l’ombre d’une image ; c’est ce que dit l’Apôtre lui-même : Car la Loi est l’ombre des biens à venir, non l’image même des choses (He. x, 1). Donc, si la Loi interdit les images, tout en étant cependant elle-même l’esquisse d’une image, que pouvons-nous dire ? Si le tabernacle est une ombre et la figure d’une figure, comment la Loi peut-elle interdire de peindre des images ? Or il n’en est pas ainsi, cela n’est pas ; mais il faut dire plutôt : Il y a un temps pour chaque chose (Qo. iii, 1)36. » (Discours sur les images, I, 15, op. cit., pp. 45-46.)
Jean Damascène résout cette contradiction par l’introduction de l’ombre, typique de la pensée économique : l’ombre permet d’adapter la Loi, l’interdit du Décalogue, au support, le tabernacle. Entre la lumière de Dieu et l’ombre du tabernacle, l’image fait écran ; entre le divin incirconscrit et la matière circonscrite, le mystère de l’incarnation opère le passage. Penser le tabernacle non comme image, mais comme ombre, permet de sauver l’interdit judaïque jusqu’au moment de l’incarnation. L’image est alors identifiée à la matière, à la couleur, à la chair, tandis que les contradictions du texte de la Loi sont renvoyées à l’ancien monde et aux erreurs des Juifs :
« Tu vois donc que la matière a de la valeur et que c’est seulement pour vous qu’elle n’en a pas. Est-il rien de plus vil que les poils de chèvre et les couleurs ? L’écarlate, la pourpre, l’hyacinthe ne sont-elles pas des couleurs ? Regarde aussi l’image des chérubins. Comment donc prétends tu interdire au nom de la Loi ce que la Loi a ordonné de faire ? Si, à cause de la Loi, tu interdis les images, veille à respecter le sabbat et la circoncision ; car la Loi ordonne ces choses sans limitation aucune37 » (Discours sur les images, I, 16, op. cit., p. 49)
Ce n’est pas du tout dans l’esprit de cette opposition du texte, nœud de toutes les erreurs et contradicitons, et de l’image, support de la pensée économique, que Bède traite la contradiction de l’Exode :
« Il faut noter en cet endroit qu’il y a des gens qui pensent que selon la Loi de Dieu il est interdit de sculpter ou de peindre des représentations (similitudines) soit d’hommes soit de n’importe quels animaux dans l’église ou dans n’importe quel autre lieu parce qu’Il a dit dans le décalogue : Tu ne feras pas pour toi une sculpture ni aucune représentation (similitudinem) de ce qui est dans le ciel au dessus, ni de ce qui est sur la terre au dessous, ni de ce qui est dans les eaux sous la terre (Ex. xx, 4). Ces gens n’auraient jamais eu une telle opinion s’ils s’étaient souvenus d’une part de l’œuvre de Salomon, qui fit faire, à l’intérieur du temple, des palmes et des chérubins avec différentes ciselures et sur ses colonnes des grenades et un filet, et sur la fameuse mer d’airain, douze bœufs et des reliefs historiés ; et puis sur les bases des bassins, comme on le lit dans la suite, il a fait des lions avec des bœufs, des palmes, des chars et des roues avec des chérubins et différentes sortes de peintures ; [ils n’auraient pas eu cette opinion] si d’autre part ils avaient considéré les œuvres de Moïse lui-même qui, sur l’ordre du Seigneur, fit d’abord des chérubins sur le propitiatoire et ensuite un serpent d’airain dans le désert, à la vue duquel le peuple était sauvé du venin des serpents venimeux. Or s’il était permis d’élever un serpent d’airain sur un bâton qui donnait la vie aux fils d’Israël lorsqu’ils le regardaient, pourquoi n’est-il pas permis que l’élévation du Seigneur notre Sauveur sur la croix, par laquelle Il vainquit la mort, soit rappelée à la mémoire des fidèles par la peinture, ou encore ses autres miracles et guérisons, par lesquels Il triompha merveilleusement de celui-là même qui devait causer Sa mort, alors que le spectacle de ces choses fournit habituellement à ceux qui le regardent beaucoup de compassion (multum compunctionis) et à ceux qui ne savent pas lire il déploie pour ainsi dire la lecture vivante de l’histoire du Seigneur38 ? »
La justification de l’image par Bède est saisissante d’abord pour ce qu’elle ne dit pas, à une époque exactement contemporaine des écrits de Jean Damascène : ce n’est pas le passage de l’ancienne à la nouvelle alliance, ce n’est pas l’incarnation et l’économie de la chair qui justifie l’image. Bède n’établit pas de différence entre l’ancien et le nouveau testament. C’est au contraire par la bible des Juifs elle-même qu’il justifie l’image, dans la similitude entre d’une part le temple de Salomon, le tabernacle de Moïse et le serpent d’airain et d’autre part le Christ sur la croix. Cette similitude n’articule pas l’image à un mystère de l’invisible, mais au contraire à des objets matériels, concrets. L’image est le temple, le serpent, la croix. Elle ne suscite pas une vision au-delà d’elle-même, mais une compassion, compunctio, qui est déchirure en elle-même. La compunctio est l’ancêtre du punctum39.
D’autre part, l’image n’est pas pensée comme figure, comme Face, mais comme histoire : pandere vivam historiæ lectionem, elle déploie la lecture vivante d’une histoire.
Bède n’a visiblement pas en tête le modèle de l’icône byzantine, mais bien plutôt celui du Livre illustré, où se mêlent image et écriture :
« Car la peinture s’appelle en grec zographia, c’est-à-dire écriture vivante. S’il a été permis de faire douze bœufs d’airain qui, portant la mer posée sur eux, regardaient trois par trois les quatre régions du monde, qu’est-ce qui interdit de peindre de la même manière que les douze apôtres instruisaient dans leurs voyages toutes les nations en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, de dessiner en une écriture vivante, pour ainsi dire, devant les yeux de tous. S’il ne fut pas contraire à la même Loi de faire dans la mer d’airain des reliefs dans un cercle de dix coudées, comment pouvait-on croire contraire à la Loi de sculpter ou de peindre les histoires des saints et des martyrs du Christ sur des tables (in tabulis) qui, par leur œuvre de conservation de la Loi divine, ont mérité d’atteindre à la gloire d’une éternelle reconnaissance40 ? »
L’image est la célébration du Livre. Elle est une modalité de l’écriture. Le recours au mot tabula pour désigne le support de la peinture et l’idée que cette tabula fait œuvre de conservation de la Loi divine (per custodiam divinæ legis) identifient implicitement l’image aux tables de la Loi41. Le jeu métonymique fait par ailleurs glisser l’identification à l’arche, au tabernacle, au temple.
Après cette légitimation pratique de l’image, à partir des objets que la Bible elle-même promeut, c’est-à-dire à partir des images que porte le texte même, Bède en revient aux termes de la Loi (verba legis) pour retourner le texte contre lui-même :
« Mais si nous examinons plus attentivement les termes de la Loi, il apparaîtra peut-être qu’il n’est pas interdit de fabriquer des images d’objets ou d’êtres vivants, mais que ce qui est absolument prohibé, c’est de les fabriquer en vue de pratiquer l’idolâtrie. Enfin, le Seigneur au moment de dire sur la montagne sainte, Tu ne feras pas pour toi une sculpture ni aucune représentation, fit précéder cette parole de, Tu n’installeras pas de dieux étrangers en ma présence ; ensuite il joignit à cela, Tu ne feras pas pour toi une sculpture ni aucune représentation de ce qui est dans le ciel au dessus, ni de ce qui est sur la terre au dessous, ni de ce qui est dans les eaux sous la terre ; puis il conclut ainsi, Tu ne les adoreras ni ne les honoreras. Par ces paroles il est explicitement déclaré que les hommes n’ont pas le droit de fabriquer ces représentations quand ce sont des impies qui se mettent à en faire pour vénérer des dieux étrangers et quand ce sont des païens plongés dans l’erreur qui s’en procurent pour les honorer et les adorer. D’ailleurs à ce que je pense, pas la moindre lettre de la Loi divine n’a interdit que ces choses soient fabriquées de façon ressemblante, sans quoi le Seigneur même, quand les pharisiens le tentaient en lui parlant de l’argent qu’il fallait payer à César, sur lequel ils disaient que le nom et l’image de César étaient gravés, ne leur aurait jamais répondu, Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu (Mt. xxii, 21), mais il aurait plutôt corrigé leur erreur en disant, Il ne vous est pas permis de fabriquer l’image de César sur une monnaie frappée avec votre or, car la Loi divine interdit de tels reliefs. Et de fait ce serait l’endroit pour le dire s’il le pensait, au moment où les pièces lui étaient présentées, si sur ces pièces l’image de César était une cause d’idolâtrie, et si elle n’avait pas plutôt été façonnée pour signifier (ad indicium) son pouvoir de roi42. »
Bède distingue ici trois sortes d’images, non tant par leur nature que par leur usage : les images fabriquées pour les cultes païens sont seules interdites ; les images profanes, comme les effigies des monnaies, sont légitimées par leur usage politique ; les images sacrées, enfin, auraient mauvaise grâce à être interdites alors qu’elles célèbrent le culte chrétien.
Alors que le texte biblique interdisait toute représentation, toute similitudo dans le latin de la Vulgate, Bède affirme que, dans la mesure où il n’en est pas fait un usage idolâtre, on peut légitimement fabriquer des images similiter, de façon ressemblante. Similiter reprend similitudo ; l’exégèse chrétienne annule l’interdit vétéro-testamentaire.
La pièce de monnaie à l’effigie de César reprend un exemple augustinien, mais le détourne de son premier sens. Augustin insistait sur la différence de nature entre l’image artificielle que produit la monnaie et son modèle, l’empereur, pour dissocier nettement ce type d’image du Christ-image situé au cœur du mystère théologiquement central de la Trinité43. Bède au contraire légitime l’image sacrée par l’image profane. Ce faisant, en quelque sorte il désacralise et banalise toute image. L’image n’est rien d’autre qu’une pièce de monnaie. Elle s’autonomise comme objet.
Le principe de superposition : The Book of Kells
Bède n’abandonne pas pour autant le caractère indiciel de l’image, central dans le culte byzantin des achiropiites. Mais en le généralisant il contribue à lui conférer une dimension technique. L’indicialité de la monnaie frappée à l’effigie de César (et éventuellement à celle du Christ, question brûlante à Byzance), suggère implicitement la comparaison : la monnaie reproduit l’empreinte44 de son prototype, comme les Saintes Faces des achiropiites. Ce n’est donc pas par hasard que Bède fait apparaître ici le terme d’indicium : la monnaie a été façonnée ad indicium regiæ potestatis, c’est-à-dire comme signe indiciel du pouvoir du roi. L’image dit la puissance de la Loi, elle en porte l’empreinte. Il ne s’agit pas ici de l’humilité de l’incarnation, mais de la puissance régalienne du Souverain, non l’enfant dans les bras de la Vierge, mais le Christ trônant en majesté.
On est passé, dans le texte de Bède, de compunctio à regia potestas, de la passion à la majesté. Symboliquement, l’image chrétienne s’inscrit toujours dans cette tension qui en Occident n’est pas essentiellement celle du verbe et de la chair, mais bien plutôt celle du religieux et du politique, conjoints dans la même technicité indicielle de l’empreinte.
L’image signifie donc aussi le règne temporel du Christ sur le monde. Bède y insiste : il évoque d’abord les bœufs d’airain regardant quattuor mundi plagas, les quatre régions du monde, puis les apôtres euntes, parcourant le monde pour l’évangéliser, enfin, implicitement, la circulation des monnaies-images dans le monde.
Ainsi se prépare une superposition qui n’est pas celle de l’économie byzantine, superposition dans et par l’image de l’espace du monde terrestre et du tabernacle christique.
Dans le Book of Kells45, par exemple, les motifs géométriques ordonnent de façon obsédante l’espace rectangulaire de l’image comme espace quadripartite, figurant les quatre régions du monde. Au verso du folio 290, les symboles des quatre évangélistes sont ainsi répartis dans quatre triangles qui disent les quatre points cardinaux et suggèrent l’activité évangélisatrice de ceux qui, après eux, portent la bonne parole aux quatre coins du monde. Alors que Byzance est installée dans un monde désormais clos, habité par la concurrence théologique des autres monothéismes, l’Occident évangélise et vit dans le face à face avec les cultures païennes.
Les quatre régions du monde, que les héritiers des quatre évangélistes continuent de parcourir le Livre à la main, sont divisées sur l’image par une croix oblique. Ce n’est pas le signe ecclésial de la croix. C’est le χ du nom du Christ46 : l’image célèbre le Verbe, le texte évangélique s’identifiant, se condensant en quelque sorte, dans le χ du nom du Fils. Ce qui est ici superposé, c’est l’espace matériel du monde et l’écriture de la Loi.
Si l’on y regarde de plus près, on s’aperçoit que les symboles des évangélistes, l’homme de Matthieu en haut, le bœuf de Luc en bas, le lion de Marc à gauche, l’aigle de Jean à droite, sont disposés à la manière du geste par lequel le chrétien se signe : l’image est militante, évangélisatrice. Le losange central stylise la mandorle où est inscrit le Christ : le Christ figure ici non comme Face, comme chair, mais comme décoration ornementale, vers quoi converge également l’ornementation de l’écriture. Le Christ est l’indicium regiæ potestatis superposé à l’espace du monde que visualise l’image. Quant aux décors en spirales sur les deux rectangles latéraux, on les retrouve sur le corps du Christ dans la crucifixion d’Athlone47 : ils renvoient eux aussi au Christ, non à celui de l’incarnation, mais à celui de la Loi. De la même façon, les décors sur les deux carrés, en haut et en bas, dessinent en creux une croix rhomboïde noire. Eux aussi sont un indice du Christ.
L’image précède immédiatement une représentation de Jean. Pour cette raison, on peut penser qu’elle interprète les symboles des quatre évangélistes non pas tant comme ceux de la vision d’Ézéchiel, mais plutôt comme la vision des quatre vivants dans l’Apocalypse (Ap. iv, 7). Cette vision débouche en quelque sorte sur celle du tabernacle :
« Alors s’ouvrit le temple de Dieu dans le ciel et son arche d’alliance apparut dans le temple. » (xi, 19.)
L’image est le temple et le losange central constitue l’arche christique. L’ensemble, avec ses coins rouges renforcés, peut figurer le Livre lui-même.
Quant au portrait de Jean, s’il porte les attributs du scribe comme dans les portraits d’évangélistes que nous avons vus plus haut, il n’écrit pas mais brandit le Livre, dans un même geste militant que le signe de croix induit par la disposition des symboles des évangélistes au folio précédent.
Jean est en même temps le Christ : les trois étoiles sur son auréole évoquent la Trinité. L’espace de l’image est circonscrit par trois fois quatre motifs géométriques : quatre rectangles, quatre croix, quatre coins48. Trois est le chiffre de la Trinité, quatre celui des évangélistes et des quatre coins du monde. Trois fois quatre articule la puissance abstraite du Dieu trinitaire et l’espace concret du monde. Cet espace est à la fois celui du Livre et le corps même du Christ comme en témoigne la figure du crucifié que l’on distingue derrière l’image : ses mains à droite et à gauche, ses pieds percés en bas, sa tête auréolée en haut, malheureusement endommagée au dix-neuvième siècle. Le Christ porte l’image, ou plus exactement l’image se superpose au Crucifié : elle est bien à la fois surface et espace ; le corps du Christ s’ouvre pour délivrer le Livre. L’image est un corps-tabernacle.
Organisation diagrammatique de l’espace : la Bible de Vivien
Dans un style très différent, la Bible de Vivien obéit au même jeu de similitudes qui identifie l’image à un tabernacle christique. Dans le Frontispice des Évangiles49, le Christ est assis sur la sphère céleste qui contient le monde. On identifie la sphère aux deux fois trois étoiles qui la constellent. Le Christ porte l’hostie dans sa main droite bénissant et tient dans sa main gauche le livre. Il est inscrit dans une double mandorle qui figure sa double nature, divine et humaine, et son double royaume, céleste et terrestre. Le royaume terrestre, où figure la sphère du monde, est identifié à la partie basse du corps. La mandorle est elle-même entourée du tétramorphe. Derrière chacun de ces emblèmes est représenté un prophète de l’Ancien Testament : on peut lire à partir du haut et dans le sens des aiguilles d’une montre ESAIAS (Isaïe), HIÉZECHIEL (Ézéchiel), HIEREMIAS (Jérémie), DANIEL, dont les visions ont été interprétées au Moyen-âge comme préfigurations de la venue du Christ. Enfin, dans les quatre angles figurent les quatre évangélistes.
Nous avons affaire ici de façon plus caractérisée encore que dans les images du Book of Kells à une composition diagrammatique50 : l’abandon de la perspective antique se traduit, dans l’organisation de l’espace iconique, par le recours à un étagement de plans rigoureusement délimités. Chacune des cellules ainsi cloisonnées entretient avec les autres cellules une relation de similitude ; la correspondance symbolique des figures est redoublée par la répétition des formes géométriques des cellules. L’ensemble, qui est idéalement quadripartite (losange dans un rectangle ici, carré oblique dans un carré droit ailleurs), constitue ce que l’on appelle une composition diagrammatique.
Chacun des quatre évangélistes regarde son image dans le tétramorphe : Matthieu baisse les yeux vers l’homme-ange, puis Luc est face à face avec le bœuf, puis Marc lève la tête vers le lion, enfin Jean se penche vers l’aigle. Chacun des attributs rend à son personnage son regard, sauf le lion, qui est tourné vers le Christ. Aux coins du losange, chacun des quatre prophètes présente sa vision. Les quatre visions sont ainsi ramenées à une seule image qui est celle du Christ. Pourtant la symétrie de la composition n’est pas totale. L’Évangile qui figure en premier dans la Bible est celui de Matthieu, en haut à droite sur l’image. A gauche, saint Jean est le seul à poser les pieds sur un socle joint au losange du diagramme. La parole de Jean, qui est la dernière dans les Évangiles, ouvre à cause des énigmes de l’Apocalypse à la lecture mystique des visions des prophètes, qui correspond au deuxième cercle de l’image. L’œil dessinera dans l’espace un signe de croix en parcourant dans l’ordre des textes bibliques les médaillons d’Isaïe en haut, de Jérémie en bas, de Daniel à droite, d’Ézéchiel à gauche. La main d’Ézéchiel fait accéder à l’espace du tétramorphe, car cette allégorie vient d’une interprétation anagogique de la vision d’Ézechiel51. A gauche encore, le lion ne regarde pas Marc mais le Christ, indiquant le terme du mouvement concentrique que doit suivre le regard pour déchiffrer le programme de cette image.
Le Christ siège littéralement sur le monde. Il tient l’hostie, qui est le corps du Christ, et le Livre, c’est-à-dire le Verbe, dont il constitue l’incarnation : hostie, corps du Christ et Livre constituent une similitude, ils sont une même image52.
De la similitude à l’allégorie
Le jeu des similitudes, en développant des systèmes d’équivalences symboliques de plus en plus complexes, a précipité l’image dans l’allégorie. L’allégorie est ici l’art de dire autrement toujours la même chose, de délivrer toujours non pas le message, mais l’objet contenu dans le tabernacle. L’allégorie est le tabernacle, c’est-à-dire l’écrin, l’habillement qui entoure et, par là, désigne la Loi. La Loi est le seul objet véritablement digne d’être représenté, à condition que ce soit sous la forme enveloppée de l’allégorie, qui préserve à sa manière l’interdit de la représentation53.
Le déploiement horizontal de l’image allégorique, avec ses réseaux de similitudes, s’oppose à la projection verticale de l’image économique, toujours prête à se dissoudre dans le face à face du fidèle avec le prototype. Face à l’économie de la déchirure, l’image allégorique est une surface de similitudes, la surface même du rideau du Saint des Saints ; l’institution de l’image allégorique consiste donc en quelque sorte à faire faire surface à l’invisible, c’est-à-dire non seulement à faire advenir dans le visible tous les éléments du système symbolique, mais encore à tisser entre eux un réseau de relations susceptible d’ordonner géométralement l’espace de l’image. La généralisation de l’allégorie dans l’image se traduit par une spatialisation des structures symboliques54.
Économie de l’incarnation, allégorie de la passion : Bède
Pour Bède le vénérable, si le paradigme de toute image est le tabernacle, celui-ci ne se conçoit que comme articulation d’un espace matériel et d’un espace symbolique. Ainsi les quatre anneaux d’or de l’arche sont interprétés systématiquement selon un double registre :
« Et quatre anneaux d’or que tu placeras aux quatre angles de l’arche ; que deux anneaux soient d’un côté, et deux de l’autre. Les quatre anneaux d’or sont les quatre livres des Évangiles, qui sont à juste titre d’or vu l’éclat de la sagesse dont ils resplendissent, et à juste titre sont comparés à des cercles car éternelle est la sagesse même de Dieu qu’ils prêchent, ne commençant à aucun moment ni ne cessant d’être l’éternelle divinité que le Christ homme a reçue. C’est pourquoi, quand approche l’heure de sa passion, Il implore Son Père en disant : Et maintenant, illumine moi, mon père, auprès de toi, de la lumière que j’avais auprès de toi avant que le monde n’existe (Jn. xvii, 5). L’arche a quatre angles car le sacrement qui célèbre l’incarnation du Seigneur ne cesse d’être célébré dans toutes les régions du monde où se déploie la sainte Église. Et au travers de ces mêmes angles quatre anneaux sont posés car aux quatre coins du monde l’évangile du Christ est prêché pour le salut des cœurs des fidèles55. »
Le cercle signifie à la fois l’éternité de la sagesse divine et l’Évangile compris comme objet. Les quatre cercles renvoient aux quatre points cardinaux du monde et aux quatre Évangiles, c’est-à-dire au message du Christ. Le moment d’articulation de ces deux espaces n’est pas celui de l’incarnation, mais celui de la passion, de la prière au Père du Fils prêt d’être abandonné sur la croix. Le système exégétique qui déploie ces similitudes prend comme support central le moment d’éclipse de la Lumière : à l’or des anneaux correspondent les ténèbres de la passion, entre la lumière éternelle d’avant l’incarnation et la lumière de la résurrection. L’espace allégorique suppose en quelque sorte cette éclipse préalable. Il se déploie dans le moment pour ainsi dire « anti-économique » de l’abandon du Christ à son humanité. L’éclipse de la Lumière, l’abandon du Fils, consacrent l’autonomie spatiale de l’image.
Il n’est qu’à comparer avec l’exégèse de Jean Damascène, méditant sur le même objet, l’arche couverte d’or :
« Voilà pourquoi Dieu a ordonné que l’arche soit faite d’un bois incorruptible, qu’elle soit couverte d’or au dedans et au-dehors et qu’y soient déposées les tables, le rameau et la cruche d’or remplie de manne (Ex. xxv, 10) : c’est le mémorial des choses passées et la préfiguration des choses futures. Qui pourra affirmer que ce ne sont pas là des images et des hérauts à la voix perçante ? En outre, ces objets n’ont pas été placés sur les côtés du tabernacle mais exposés aux yeux du peuple tout entier, afin qu’en le regardant, ce soit au Dieu qui se manifeste à travers eux que l’on rende prosternation et adoration. Il est clair que ce n’est pas ces objets que l’on adore, mais à travers eux, c’est pour le mémorial des miracles qu’on fait cela, et c’est au Dieu qui a fait des merveilles qu’on adresse la prosternation. Car les images étaient placées pour le mémorial et elles étaient honorées non pas comme des dieux, mais parce qu’elles rappelaient le souvenir de l’action divine56. » (Discours sur les images, I, 17, op. cit., p. 50.)
Alors que Bède, faisant travailler les similitudes, arrime son objet dans un espace diagrammatique chargé de symboles, Jean Damascène dissout l’icône dans l’ὑπόμνησις, le processus de remémoration. Prise entre ce qu’elle commémore et ce qu’elle préfigures, l’arche ne signifie rien en elle-même ; elle est le truchement par quoi Dieu se rend visible. L’arche est un symbole de l’incarnation ; elle adapte économiquement l’invisibilité incirconscriptible de Dieu à la visibilité de l’icône.
Chez Bède, toute est visible : la matérialité de l’entre-deux où se déploie l’allégorie est soulignée par le regroupement des évangélistes deux par deux : Matthieu et Luc d’une part, Marc et Jean d’autre part :
« Deux anneaux sont sur un côté et deux autres sur l’autre car deux évangélistes assistaient à l’enseignement du Sauveur prêchant en chair et faisant les miracles ; les deux autres vinrent à la foi en Lui après sa résurrection et son ascension dans les cieux ; ou bien parce que, quand ils sont figurés par quatre animaux, il y en a deux qui désignés par l’homme et le veau57 portent les traces de ses souffrances et de sa mort, et il y en a deux autres qui préfigurés par le lion et l’aigle arborent les insignes de la victoire par laquelle il anéantit la mort. C’est comme homme devenu mortel par l’incarnation que le Seigneur est apparu, et c’est comme veau, de la même façon, offert pour nous sur l’autel de la croix, qu’Il s’est manifesté, et Il est devenu lion en triomphant courageusement de la mort, et aigle en s’élevant dans les cieux. Une autre raison pour laquelle deux anneaux sont d’un côté et deux de l’autre, c’est que deux évangélistes par leur figure suggèrent l’enlèvement58 de l’humaine fragilité au sein du Seigneur et les deux autres la victoire par laquelle Il a triomphé de cette même fragilité qu’Il a enlevée et de la mort. Car de même que le côté gauche de l’arche comportait deux anneaux parce qu’il y avait deux évangélistes qui figuraient l’incarnation et la passion du Seigneur59, de même à son côté droit se trouvaient deux anneaux car il y a également deux évangélistes qui expriment Sa résurrection et Son ascension60, ce qui touche de façon figurée à la gloire de la vie future61. »
L’arche étant le Christ, les quatre anneaux sont les quatre évangélistes qui eux-mêmes équivalent au Christ. Mais ces équivalences symboliques dessinent dans le même temps un espace iconographique type qui est l’espace même des images que nous avons analysées dans le Book of Kells, l’Évangile d’Echternach ou la Bible de Vivien. Au centre est l’arche christique, figurée par la mandorle, le trône ou le losange à motifs géométriques ; sur les côtés sont les quatre évangélistes qui bordent l’image. Le Christ sur la croix était présent, encadrant l’image, au folio 291 du Book of Kells.
Mais les évangélistes n’ordonnent pas seulement un espace ; selon Bède, ils déploient également une temporalité : les deux premiers précédèrent historiquement la Passion puisqu’ils assistèrent à l’enseignement du Christ ; les deux derniers suivirent la passion, sans connaître historiquement le Christ. Les deux premiers signifient l’incarnation par leurs symboles, le Christ fait homme et le Christ fait agneau (Bède, de façon assez cocasse, parle d’un veau pour essayer de concilier le symbole de Luc, le bœuf, avec l’agneau mystique), qui tous deux renvoient à la chair. Les deux derniers, au contraire, toujours par leurs symboles, signifient la résurrection, la force du lion suggérant la victoire sur la mort et l’envol de l’aigle, l’ascension du Christ.
L’espace allégorique central, dévolu au Christ de la passion, est donc encadré par les deux mystères qui temporellement le circonscrivirent, l’incarnation avant et la résurrection après. Reste à décrire ce qu’est en soi, au centre, l’arche christique :
« Et tu placeras dans l’arche le Témoignage que je te donnerai (Ex. xxv, 16), car nous ne devons croire et dire, à propos du Fils incarné de Dieu, que ce qu’Il a jugé digne de révéler par les auteurs des saintes écritures. Si tu veux savoir quel était ce Témoignage que Moïse a reçu du Seigneur pour le placer dans l’arche, écoute l’apôtre : Derrière le second voile, dit-il, était le tabernacle que l’on appelle Saint des Saints, comportant un autel des parfums en or et l’arche du Testament entièrement recouverte d’or dans laquelle se trouvait une urne d’or contenant la manne, le baton d’Aaron qui avait bourgeonné et les tables du Testament (Hbr. ix, 3-4). L’urne d’or dans l’arche contenant la manne est l’âme sainte contenant dans le Christ toute la plénitude de la divinité qu’il porte en lui. Le bâton d’Aaron qui avait bourgeonné après avoir été taillé est son pouvoir invaincu duquel le prophète dit : Le bâton d’équité est le bâton de ton règne (Ps. xliv, 762)63. »
Curieusement, Bède s’attache, dans l’arche, aux emblèmes du pouvoir : le baton d’Aaron, la manne du magistère spirituel et les tables de la Loi. On retrouve ici les attributions du Christ en majesté, de ce même Pantocrator qui se déploie dans les absides des églises byzantines et romanes. Mais le jeu allégorique ouvre la perspective d’un glissement futur : c’est la crucifixion, le dénuement du Christ abandonné à son humanité, qui est amené à occuper le devant de la scène. Une fois encore, Bède procède, sous le couvert des similitudes, à un retournement : l’imploration initiale du Clarifica me est recouverte par la proclamation d’une potestas invicta.
II. Spatialisation , féminisation
L’allégorie en peinture prend donc son essor à partir du moment où elle s’inscrit dans un espace. Le diagramme en constituait les prémisses. Au douzième siècle, cet espace fait l’objet de toute une spéculation. En s’inspirant du De Noe et arca d’Ambroise de Milan (quatrième siècle), Hugues de Saint-Victor, dans le Libellus de formatione arche, traité allégorique sur l’arche de Noé, propose un mode d’emploi pour peindre (au sens propre) l’arche. Un jeu subtil d’inclusions et de subdivisions lui permet, à partir de l’arche, de décrire l’univers tout entier et la hiérarchie des hommes. L’espace se compartimente et se colore de couleurs symboliques. Adam le Prémontré, dans le De triplici tabernaculo (1180-1), reprend la même méthode pour décrire le temple de Jérusalem, dont le pavement reproduit l’image du Christ. Dans ces textes apparaît la notion de champ (campus), c’est-à-dire d’un espace conçu conjointement comme espace géométral dont l’architecture est décrite minutieusement et comme espace symbolique renvoyant au fondement christique de l’image64.
Pourtant ce moment de la spatialisation de l’image, de la réflexion sur la mise en espace, est aussi celui d’un basculement de la représentation vers le féminin, qui constitue l’évolution la plus spectaculaire de l’art roman.
Ce basculement s’opère en plusieurs étapes : on voit d’abord apparaître une figure allégorique de l’Église, identifiée à la fois au tabernacle et à la cité de Dieu. Puis cette Église allégorique est elle-même personnifiée par la Vierge Marie. Enfin Marie devient l’allégorie du tabernacle.
Le tabernacle, allégorie de l’Église : Bède
Bède le Vénérable avait déjà suggéré d’identifier le tabernacle à la communauté des élus :
« Donc le Tabernacle qui fut montré à Moïse sur la montagne est cette cité supérieure et patrie céleste dont on croit qu’elle fut érigée à ce moment là par les seuls anges saints, après la passion puis la résurrection et l’ascension dans les cieux du médiateur entre Dieu et les hommes, et il y reçut la multitude illustre et abondante des âmes saintes65. »
Dans le commentaire du Cantique des Cantiques, c’est l’Épouse qui est identifiée à l’Église :
« Livre 1 : La Synagogue désire que le Seigneur vienne en chair et, emplie du zèle que donne la grâce, elle court à sa rencontre.
[…] Je suis noire mais belle comme les tabernacles de Cedar, comme les peaux de Salomon66 : on distingue ainsi noire comme les tabernacles de Cedar, belle comme les peaux de Salomon.
En effet la sainte Église est assez souvent obscurcie par l’affliction où la plongent les infidèles, comme si elle était l’ennemie générale du monde entier, accomplissant la parole du Seigneur, Et vous serez en bute à la haine de tous à cause de mon nom. C’est toujours sous cet aspect que du point de vue de son Rédempteur elle est convenable, comme si c’était ainsi qu’elle était vraiment digne que le Roi de paix trouve bon d’aller la voir. Et il faut noter que Cedar, par son nom même qui évoque les ténèbres, fait penser aux hommes pervers ou aux esprits immondes, de même que Salomon, qui signifie celui qui fit la paix, renvoie également par le mystère de son nom à ces paroles de l’Écriture, Son empire se multipliera et la paix n’aura pas de fin sur le trône de David et sur son royaume.
De même qu’on dit que l’Église est noire comme les tabernacles de Cédar, et il faut prendre cela non pas pour la vérité mais pour le jugement des ignorants qui pensent qu’elle fournit en son sein un asile aux vices et aux esprits malins, de même l’Église est appelée belle comme les peaux de Salomon, et on prend cela pour une vérité exemplaire car, comme Salomon avait l’habitude de se fabriquer des tentes avec les peaux des animaux morts, ainsi le Seigneur rassemble à lui l’Église en prenant les êtres qui ont su renoncer aux désirs de la chair. (Livre 1, chapitre 1, §467.)
L’Église est donc à la fois tabernacle de Cédar et peaux de Salomon, à la fois lieu d’ombre et de ténèbres comme Église militante en bute aux infidèles et lieu de paix comme communauté des fidèles débarrassés des désirs de la chair. L’Église est vue du dehors comme ombre de Cédar et vue du dedans comme paix de Salomon68. Ce jeu des deux points de vue initie un avers et un envers de l’espace tabernaculaire où se tisse le réseau des similitudes.
Tabernaculum, mansio, tentorium : il y a là un espace restreint où la lumière se retourne en ombre. Les peaux cousues ensemble pour former la Tente figureront désormais l’assemblée des fidèles, c’est-à-dire l’Église comprise non comme institution, mais comme chair, comme peuple, non comme principe d’autorité mais comme principe de communauté. La figure christique et régalienne continue de s’éloigner ; un autre principe symbolique se met en place.
Maison de Dieu et corps de reine : le rouleau d’Exultet
On voit d’abord apparaître des allégories de l’Église, comme celle du rouleau d’Exultet69. L’Église siégeant sur l’église identifie le corps impérial de la femme en majesté à l’architecture de l’édifice sacré. Les bougies allumées sur les candélabres derrière la femme assise évoquent les langues de feu qui apparurent à la Pentecôte et se posèrent sur les apôtres, les emplissant de l’Esprit Saint70. La Pentecôte dans la tradition juive est la fête du don de la Torah au mont Sinaï, qui donnait lieu à une procession et à une assemblée du peuple au Temple (Chavouot) : après sa destruction, l’installation matérielle des tables de la Loi est identifiée au don spirituel de la Loi au peuple juif, c’est-à-dire à l’installation de la Loi dans la communauté71.
Cette identification est déjà présente dans les psaumes et dans Isaïe : « le Sinaï est au sanctuaire » (Ps. lxvii, 18) peut se comprendre comme les tables de la Loi, données au mont Sinaï, sont dans le Temple de Sion, c’est-à-dire dans la communauté. De même, « de Sion vient la Loi et de Jérusalem la parole de Yahvé » (Is. ii, 3) peut se lire comme la Loi est au milieu de Sion, c’est-à-dire du peuple juif, et le Verbe est dans Jérusalem, c’est-à-dire dans la cité du peuple élu. La Pentecôte chrétienne identifie de même le tabernacle à l’Église comme communauté des fidèles ; elle la représentera donc par la communion des apôtres autour de la Vierge trônant qui figure cette communauté, bien que la Vierge ne soit pas mentionnée dans le récit des Actes des apôtres72. Le rideau noué à la porte ouverte de l’église évoque le rideau séparant le Saint du Saint des Saints dans le Temple, rideau qui se déchire au moment de la mort du Christ. Avant l’Incarnation et la Résurrection, on ne pouvait voir Dieu que dans le nœud de l’énigme ; mais l’épreuve de la Passion ouvre le fidèle à la grâce qui permet de contempler Dieu face à face : le rideau est donc noué mais la porte ouverte, l’image célèbre le passage de l’énigme, figurée en bas par l’édifice de la Loi, à la vision, figurée en haut par le corps féminin de la grâce. Corps féminin et non corps christique. Les bras ouverts de cette figure féminine, mais aussi le médaillon sur la poitrine (où devrait apparaître le Christ) pourraient évoquer la position d’orante de la Vierge des Blachernes (dite aussi Vierge du signe), l’un des types byzantins les plus célèbres de la Théotokos.
Identifications à la Vierge
Bernard de Clairvaux (1091-1153) identifie explicitement la maison de Dieu, autrement dit l’Église, à la Vierge :
« La Sagesse s’est construite une maison (Pr. ix, 1). Comme on comprend la sagesse de nombreuses façons, il faut se demander quelle sagesse s’est construite une maison. On parle en effet de sagesse de la chair, qui est l’ennemie de Dieu (Rm. viii, 7), et de sagesse de ce monde, qui est bêtise auprès de Dieu (1Co. iii, 19). L’une et l’autre, selon l’apôtre Jacques (Jc. iii, 15), sont terrestres, animales, diaboliques. De telles sagesses, soit de la chair, soit du monde, ne construisent rien ; elles détruisent plutôt toutes les maisons qu’elles habitent. Or il existe une autre sagesse, qui vient d’en haut ; elle est d’abord pudique, et enfin pacifique ; elle est elle-même le Christ, vertu de Dieu et sagesse de Dieu, dont l’Apôtre dit : « il est devenu pour nous et par Dieu la sagesse et la justice et la sanctification et la rédemption » (1Co, i, 30).
C’est pourquoi cette Sagesse, qui est de Dieu et qui est Dieu, venant du sein de Dieu vers nous s’est construite une maison, à savoir sa propre mère la Vierge Marie, dans laquelle elle a taillé sept colonnes73. […]
Nous aussi, si nous voulons devenir la maison de la Sagesse, il est nécessaire que nous soyions dressés sur sept colonnes, c’est-à-dire que par notre foi et nos mœurs nous nous préparions pour elle74. »
La Sagesse constructive est le Christ, qui s’est construit la Vierge comme maison. Ainsi se prépare l’identification de Marie au tabernacle.
Ecclesia, église abbatiale de Prüfening, vers 1125.
L’identification de l’Église à la Vierge donne naissance aux allégories d’Ecclesia, comme celle du plafond en coupole de l’église abbatiale de Prüfening75, restaurée au dix-neuvième siècle. Sur l’inscription circulaire, on lit : Virtutum gemmis pr[a]elucens virgo perennis sponsi juncta thoro sponso conregnat in [a]evo, « resplendissant des joyaux des vertus la vierge immortelle unie au lit nuptial règne avec l’époux pour les siècles ». L’expression Virgo perennis identifie depuis Ambroise la Vierge à l’Église. L’allégorie de l’Église, tenant d’une main l’étendard de la foi, de l’autre la sphère céleste qui contient le monde, est par cette inscription identifiée aux épousailles mystiques de Dieu avec la communauté des fidèles ; ce n’est pas un hasard si, parallèlement au développement de ce thème iconographique, l’exégèse biblique du douzième siècle accorde la première place au Cantique des Cantiques.
De la réversion exégétique à la subversion par l’image : la figure
Mais il y a plus : cette Vierge-Église trônant et inscrite dans une mandorle circulaire est entourée du tétramorphe jusqu’ici réservé en principe au Christ. L’union de l’Épouse avec l’Époux n’est pas représentée, comme souvent par ailleurs76, par le Christ et la Vierge siégeant côte à côte.
Sponsi juncta thoro, elle est unie au trône conjugal ; le siège même désigne l’Époux. Identifié, réduit au cadre architectural de l’image, le Christ s’absente pour constituer le dispositif des futures Maestà. La base de ce dispositif repose sur un « glissement de fonction » hautement subversif : la Vierge-Église usurpe, comme l’a montré Jean Wirth, une place qui devait revenir au Christ. Ce n’est plus le Christ pantocrator, image du chef tout puissant, mais la figure féminine populaire représentant la communauté qui trône dans l’église et devant laquelle le chef devra s’incliner. La Vierge-Église se rapproche peu à peu de l’allégorie du tabernacle. Ce glissement, cette subversion se marque dans l’image par une sorte de flottement du trône d’Ecclesia. Malgré la ressemblance avec le frontispice des Évangiles, dans la Bible de Vivien, que nous avons étudié plus haut, nous n’avons plus affaire ici à un dispositif diagrammatique. Deux types d’espaces s’articulent ou s’affrontent. La mandorle et le tétramorphe relèvent d’une pure géométrie, tandis que le trône devient le lieu unique, focal de l’architecture symbolique, rachitecture spectaculaire parce que transgressive. Le tétramorphe n’est plus une similitude du personnage central qui, par cette dissemblance, devient figure. A la compartimentation symbolique du diagramme s’oppose un nouveau dispositif, fondé sur le jeu, sur le flottement entre le cadre christique et le trône marial. Image écrin et image structure entrent en concurrence, initiant, entre Christ et Vierge, un dédoublement symbolique.
Le jeu différentiel peut être assumé par l’opposition des faces d’un chapiteau, comme dans le chapiteau du chœur de l’église Notre-Dame-du-Port à Clermont où l’assomption de la Vierge, qui occupe deux faces, est mise en relation avec les portes du paradis sur les autres faces. L’église est elle-même conçue comme une image du paradis, dont le fidèle doit éprouver comme la prémonition quand il y pénètre77. La Vierge étant une image de l’église, elle devait être mise en relation logiquement avec le paradis dont les portes s’ouvrent ici pour exposer un autel et une lampe et dont les architectures suggèrent la Jérusalem céleste, voire l’arche de Noé, plutôt que le jardin primordial. Le chapiteau articule donc d’un côté la Vierge tirée du tombeau – son âme emmaillotée est tenue par le Christ comme une mère tient un enfant – et de l’autre côté les portes d’un paradis représenté à la fois comme Arche, Cité et Temple, l’autel avec le rideau évoquant le Saint des Saints dans le tabernacle. Or le Christ portant sur ses genoux l’âme de sa mère, iconographie courante dans la tradition byzantine, constitue bel et bien une représentation inversée de la Vierge à l’enfant. C’est lui qui fait écrin, comme en réplique de la théotokos. D’un côté du chapiteau, le Christ porte la Vierge ; de l’autre, la Vierge est identifiée au Paradis-tabernacle, qui porte et contient la loi du Christ. Alors, du Christ écrin, on passe à la Vierge architecture.
D’autre part, comme dans l’Ecclesia de Prüfening et bien que le propos soit complètement différent, on constate un dispositif fondé sur l’inversion, sur le déplacement, et non plus sur la similitude : les portes du paradis, qui marquent la royauté triomphante de la Vierge, s’opposent à l’Assomption, où celle-ci est récupérée dans le sein du Christ.
Ce qui n’est que suggéré dans ces allégories du douzième siècle va devenir l’objet d’une spéculation théologique intense dans les siècles suivants.
L’architecture allégorique : Jean Algrin
Nous avons vu comment, déjà chez Bède, les pelles Salomonis du début du Cantique des cantiques (I, 4) étaient identifiées à la communauté des âmes ayant renoncé à la chair. Plus tard, chez Bernard de Clairvaux ou Albert le Grand, cette communauté ecclésiale est figurée par la Vierge. Jean Algrin78, dans son commentaire du Cantique des Cantiques, prêtant à Marie sa propre exégèse d’elle-même, la définit explicitement comme tente de Cédar, et son ventre comme pelles Salomonis :
« de même que les peaux ont contenu l’arche symbolique, de même moi dans mes entrailles c’est l’arche véritable que j’ai contenue, c’est-à-dire le Christ, dont la chair est symbolisée par l’arche79. »
Pourtant l’identification du tabernacle au Christ demeure encore l’identification majeure chez Algrin :
« Triplicité du tabernacle.
Il y a trois tabernacles, un matériel, un mystique et un moral, à savoir le tabernacle de Moïse, le tabernacle du Christ, le tabernacle de quiconque est juste. Le tabernacle de Moïse fut une construction formée de divers ornements. Le tabernacle du Christ est l’Église. Le tabernacle du juste est l’âme de quiconque a la foi. Le premier fut fabriqué de bois de séthim imputrescible, le second de saints infatigables, le troisième de vertus. Moïse éleva le sien dans le désert, le Christ dans le monde, le juste dans son âme. Moïse a placé dans son tabernacle l’arche ; le Christ, dans le sien, sa propre chair ; le juste, sa conscience. L’arche de Moïse est dorée de l’or le plus pur au dedans et au dehors. La chair du Christ est dorée à l’intérieur de sa divinité, à l’extérieur, de l’éclat de ses miracles. La conscience du juste resplendit à l’intérieur de la splendeur de sa pureté, à l’extérieur, de ses œuvres de charité. Donc dans le tabernacle du Christ, qui est l’Église, trouvent place les chœurs qui louent Dieu pour stimuler la dévotion et délivrer les actions de grâces. L’apôtre enseigne comment on doit louer Dieu… (Livre X, chapitre 7, Que voyez-vous dans la Sunamite, sinon les chœurs des camps80 ?) »
On voit se mettre en place ici les grilles de lecture exégétique qui marquent la fin de la similitude. L’interprétation du texte biblique, et du même coup la lecture de l’image, sera d’abord littérale, constatant la matérialité de l’objet, puis anagogique, ramenant l’ancien au nouveau testament, et la diversité des histoires à l’unité de la figure du Christ, enfin mystique, intériorisant pour le fidèle le message figuré par le Christ. L’image se construit alors, plus que jamais, dans le jeu d’une extériorité et d’une intériorité : pure extériorité de l’objet, puis extériorité et intériorité de la figure, enfin pure intériorité de la conscience mystique. Ce jeu intellectuel est porté par la forme concrète du tabernacle, par cette circularité qui délimite un dehors et un dedans, dont Bède avait déjà souligné les potentialités symboliques.
Penser par l’image : Albert le Grand
Mais c’est avec Albert le Grand (1193-1280) que le tabernacle marial prend pour la première fois tout son essor. Dans le Mariale, il identifie explicitement l’Église à la Vierge et la Vierge au tabernacle :
« Livre iv, De la sanctification de Marie, chapitre 28, « Marie tabernacle ».
Le psaume Le Très-Haut a sanctifié son tabernacle (Ps. xlv, 5) parle de la sanctification de la Vierge. Le tabernacle est la même chose que cette cité, c’est-à-dire la Vierge dans laquelle le Très-haut est venu s’armer des armes de notre mortalité. C’est ce tabernacle que le Très-haut a sanctifié, car il l’a purifiée dans le ventre de sa mère du péché originel afin qu’elle naisse totalement propre81.
Il est intéressant qu’Albert le Grand parte du psaume xlv, qui célèbre la présence de Dieu dans le Temple, protégeant la ville de Jérusalem. Le point de départ de la méditation sur le tabernacle, qu’il s’agit d’amener, de détourner vers l’identification à Marie, est l’évocation de la cité de Dieu, civitas illa. C’est parce que le tabernacle est cette cité et que cette cité est figurée par Marie que, par transitivité, Marie devient tabernacle.
La médiation de la cité, entre le tabernacle et Marie, prépare le plein déploiement du tabernacle comme dispositif, c’est-à-dire comme articulation d’un espace géométral, ordonné par la circonscription de la tente, des remparts, du ventre, et d’une signification symbolique : le don de la Loi, l’existence de la cité de Dieu, l’hypothèse de l’immaculée conception. Cette fois le dispositif ne se dissout pas dans la contemplation mystique d’un au-delà spirituel de l’image : fortement arrimé à sa matérialité d’objet, le dispositif du tabernacle se définit d’abord comme espace vacant et jamais directement comme chair incarnée. De l’incarnation (armavit se armis nostrae mortalitatis) Albert le Grand glisse d’ailleurs aussitôt à la question plus controversée qui fait l’objet de livre iv : Marie était-elle sainte dès sa conception ou fut-elle sanctifiée par l’annonciation ? En optant pour l’immaculée conception de Marie, Albert le Grand met en avant la sacralité principielle de l’espace tabernaculaire, avant même le moment de l’incarnation, en deçà donc de l’articulation symbolique qu’il instaure. Le ventre-tabernacle est d’abord un espace vierge, tota munda.
Ce n’est pas un hasard si l’allégorie du tabernacle s’oriente alors essentiellement vers le commentaire des psaumes, dont le texte est littéralement hanté par les métaphores spatiales : tantôt roc, tantôt refuge, Dieu habite dans son temple. Restait à donner une signification mariale à cette habitation :
« Livre X : Des édifices par lesquels Marie est figurée dans la Bible.
Le tabernacle, dont le Psalmiste dit, parlant au Christ, Seigneur, qui habitera dans ton tabernacle, c’est-à-dire dans la sainte Vierge ? C’est comme s’il disait : personne si ce n’est toi seul. Pour cette raison il est dit Le prince, lui, siégera en elle (Ez. xliv, 3). Le prince lui, pour dire que ce ne sera pas un autre. De la même façon le tabernacle est le corps du Christ. Mais qui y habitera qui soit capable d’imiter dignement la passion ? Autant dire pas grand monde et même personne. Et de fait c’est lui-même qui invite ton épouse à cette habitation, dans le Cantique des cantiques, ton épouse, c’est-à-dire ton âme animée par la foi, lui disant Viens ma colombe cachée au creux des rochers, en des retraites escarpées (Ct. ii, 14). De même , Va dans le rocher, terre-toi dans la poussière82 (Is. ii, 10). Le Christ a un tabernacle multiple. On lui dit donc, [au pluriel], Comme tes tabernacles sont un lieu plaisant, Seigneur de vertus (Ps. lxxxiii, 2).
Le premier tabernacle et le plus digne est le corps qu’il a tiré de la Vierge. Le second est le corps même de la Vierge. Le troisième, l’Église militante. Le quatrième, l’Église triomphante. Le cinquième, le corps du juste. Le sixième, toute pratique religieuse bien ordonnée. Procédons maintenant par ordre83. »
Ici encore, Albert le Grand part d’une similitude plus traditionnelle, identifiant le tabernacle au corps du Christ. Mais la Vierge est ce corps puisque c’est d’elle qu’il a tiré sa chair. La réduction qui consiste à ramener la pluralité du quis habitabit et du princeps à la seule personne du Christ pourrait relever d’une pensée économique. Mais ce Christ est aussitôt identifié à la passion, qui nous ramène à la multiplicité de la Chair : le tabernacle est certes le corps du Christ, mais de là le corps de tout chrétien qui, par le Cantique des Cantiques, célèbre les noces de son âme fidèle, fidelem animam, avec son corps purifié, devenu corpus justi.
Curieusement, le tabernacle défini comme habitation n’est pas ici le ventre dans lequel s’installe le Christ. Identifié à la Vierge, puis à, l’épouse du Cantique des Cantiques, puis à l’âme du chrétien, il s’image comme colombe réfugiée dans le rocher de Dieu, figure récurrente des Psaumes.
Or par cette image le contenant et le contenu ont été inversés : du Christ dans la Vierge, on est passé à la Vierge dans le Christ, d’abord colombe dans le rocher, puis âme dans le corps du juste. Le glissement de l’incarnation vers la passion a permis de ramener le Christ-image vers le corps, d’arrimer le tabernacle à la matérialité du dispositif. La contradiction métonymique est alors résolue par le déploiement codifié des sens de l’allégorie : nous étions remontés du multiple à l’un ; nous redescendons de l’un au multiple ; c’est le tabernaculum multiplex, justifié par le pluriel dans la citation des Psaumes.
Le retournement du tabernacle comme Christ (sens 1) en tabernacle comme Vierge-Église (sens 2 à 4), puis le retour au corps christique du juste (sens 5) permet d’aboutir au tabernacle comme contenu : religio est le contenu de l’Église.
Le va-et-vient du Christ à la Vierge dans ce texte où se mettent en place les dispositifs de l’allégorie mariale est symptômatique du flottement métonymique qui caractérise la pensée exégétique et, de là, le système de signification de l’image. Dans le déploiement des similitudes, toujours, ça se retourne. Un principe de réversion, échappant en quelque sorte à la maîtrise institutionnelle du texte, transpose la subversion primitive de l’image chrétienne, bravant l’interdit du Décalogue, dans le mouvement même, iconique, de la pensée. L’illogisme flagrant de cet enchaînement d’images bibliques nouées par Albert le Grand autour de ce nouveau principe symbolique marial que la Bible n’avait pas prévu, trouve sa cohérence dans une logique de l’image héritée de cette subversion primitive. Le dispositif allégorique, avec ses parcours de sens, installe la construction intellectuelle hors de l’enchaînement démonstratif. Albert le Grand juxtapose, ordonne citations et images ; il ne les enchaîne pas. Son style même, abrupt, coupé, littéralement intaduisible, dénote son dédain du discours. Le Mariale est une composition diagrammatique ultime, dont le principe symbolique vacille.
Le premier tabernacle est donc christique. Mais c’est déjà le corps de Marie que l’imaginaire du texte met en œuvre. Les psaumes identifient le soleil à Dieu : quia sol et scutum Dominus deus (Ps. juxta Hebr. lxxxiii, 12). Mais ce soleil bouclier de l’imago clipeata devient, dans l’exégèse du psaume xviii, épiphanie du corps virginal84 :
« Il est question du premier tabernacle au psaume xviii, Dans le soleil il posa son tabernacle… ce qui s’explique de différentes façons, selon les différentes propriétés du soleil : le soleil en effet distingue les saisons et figure une bonne action. Si j’ai vu le soleil alors qu’il brillait, dit Job (Jb, xxxi, 2685). Le soleil se définit comme révélation car il est lui-même l’œil du monde. Il se définit aussi par son éclat et par ses changements d’état, lui qui se lève et se couche (Qo, i, 586), et par son bouillonnement et son incandescence. De là vient que pendant le jour il ne te brûle pas. Il se définit par son agilité, sa luminosité, son incorruptibilité. C’est selon chacun de ces modes que le Christ a posé dans le soleil son tabernacle, c’est-à-dire dans la Vierge éclatante comme le soleil, quand Il a tiré d’elle sa nature humaine, et qu’Il lui a accordé la faculté, par la parole de Dieu, de concevoir et d’engendrer, comme le dit Jean Damascène.
C’est selon la révélation, quand Il a été reconnu à son aspect comme un homme (Ph. ii, 7) Après cela il a été vu sur terre, &c (Ba. iii, 3887).
C’est selon le temps, quand d’éternel il s’est fait temporel, sans abandonner ce qu’il était, mais en prenant ce qu’auparavant il ne possédait pas, à savoir la chair.
C’est selon le changement d’état, car il a éprouvé la faim (Mt. iv, 2), la fatigue (Jn. iv, 6), la soif (Jn. ix?), le sommeil, &c.
C’est selon l’exercice, car il s’est exercé à de nombreuses reprises aux bonnes actions, prêchant et guérissant les malades le jour, priant la nuit.
C’est selon l’agilité, quand il a marché sur la mer.
C’est selon la luminosité quand il a été transfiguré et que sa face a resplendi comme un soleil (Mt. xvii, 2).
C’est selon l’incandescence et le bouillonnement de la Passion, quand le soleil se tenant au midi brûlait la terre (Si. xliii, 3).
C’est son propre corps et les apôtres eux-mêmes. (Voir le chap. x, exposé des prérogatives de Marie.)
C’est selon son incorruptibilité, quand surgissant d’entre les morts il cesse d’être mortel.
C’est selon l’éclat éternel, quand dans l’ascension le soleil est élevé au ciel.
Notons au passage que dans ces trois versets du psaume sont notées beaucoup de choses qui touchent au Christ :
La première est l’incarnation. D’où, Sur le soleil il posa son tabernacle. (Ps. Xviii, 5.)
La seconde est la sortie du ventre et la nativité. D’où, Lui-même comme un époux s’avançant hors de sa chambre. La troisième est l’humilité de la passion. D’où, Il se dressa comme un géant pour courir sur la route. (Ps. Xviii, 6.)
La quatrième est l’éternité de son géniteur. D’où, Au plus haut du ciel est son lever. La cinquième est son ascension. D’où Et le terme de sa course. La sixième est l’égalité du Père et du Fils. D’où atteint au plus haut. La septième est la mission du Saint Esprit. D’où Elle est celle qui se dérobe à sa chaleur88. (Ps. xviii, 7.)89 »
A la faveur des inexactitudes du texte des psaumes traduit d’après la Septante, Dieu ne dresse pas sa tente pour le soleil, mais son tabernacle dans le soleil. Les mots se désarticulent de leur insertion syntagmatique pour tisser des réseaux de convergences iconiques. Ce n’est même pas le mot tabernaculum, ni le thème de la demeure, du sanctuaire, qui motive les relations qu’Albert le Grand établit entre les références bibliques qu’il convoque. Il aurait pu, citant quis habitabit in tabernaculo tuo (Ps. xiv, 1), conforter cette citation par quis stabit in loco sancto eius (Ps. xxiii, 3) ; partant de quam dilecta tabernacula tua (Ps. lxxxiii, 2), il pouvait enchaîner avec dilexi decorem domus tuæ et locum habitationis gloriæ tuæ (Ps. xxv, 8) ; l’invitation d’Isaïe à se cacher dans la poussière, abscondere in fossa humo (Is. ii, 10) pouvait être ramenée au tabernacle des psaumes : abscondit me in tabernaculo in die malorum (Ps. xxvi, 5).
Au lieu de cela, Albert le Grand suit l’image du soleil jusqu’à sembler oublier un moment l’objet de son chapitre. Les citations de Job et de l’Ecclésiaste répercutent l’image au mépris du contexte où elles sont prises. Ce qui se tisse ici n’est plus le réseau des similitudes qui venaient toujours buter au même terme christique, mais une succession de réseaux en étoiles dont le centre, toujours, varie : du tabernacle, on passe au soleil, prétexte à la déclinaison de tous ses modes ; du soleil, on en vient à l’exégèse des versets 5 à 7 du psaume xviii, lus comme une histoire du Christ ou plus exactement comme une déclinaison de ses attributs. Le texte fait donc image, condensant dans le médaillon de trois versets l’ensemble du message évangélique. L’image exégétique défait dans un premier temps les enchaînements discursifs du texte biblique ; dans un second temps elle rétablit une autre logique, qui est celle du dispositif allégorique : tout se passe comme si, dans un premier temps, Albert le Grand, éparpillant les références bibliques, purifiait, nettoyait l’espace textuel, le désémiotisant pour le constituer en tabernacle ; dans un second temps il étage dans le dispositif ainsi préparé les éléments d’une taxinomie : multiplicité du tabernacle, modes d’être du soleil, attributs du Christ. Le morcellement syntagmatique du texte suit toujours une déclinaison des modes, mais le cœur de ces déclinaisons, le sujet auquel elles se rapportent, varie désormais.
Le passage du tabernacle christique au tabernacle marial ne marque donc pas un simple changement thématique des significations de l’image ; il consacre une révolution sémiologique qui affecte le principe symbolique lui-même. La similitude établissait des équivalences symboliques entre des objets, des chaînes d’égalités aboutissant invariablement au Christ. L’allégorie qui se déploie ici procède par étoilements de sens. Son objet central est irréductible au Verbe. Marie n’est pas un nom, mais une figure. Le Mariale tente de rattraper par la prolifération du texte cette irréductibilité. Ramener l’image du Christ pour la voir revenir à la Vierge, tel est le mouvement incessant du texte, qui se construit comme circonscription d’un centre vide, de cet uterus virginalis qui cristallise désormais la résistance de l’image à la textualisation :
« Le second tabernacle est le ventre de la Vierge, qui est nommé tout à fait proprement tabernacle puisque la Vierge elle-même dit90 : Celui qui m’a créée s’est reposé dans mon tabernacle (Si. xxiv, 8) Voir l’explication ci-dessus, où elle est désignée comme repos. Et c’est de ce tabernacle qu’il est dit dans Isaïe C’est un tabernacle qui ne pourra jamais être déplacé (Is. xxxiii, 20), comprenez [qui ne pourra jamais] être utilisé à autre chose que pour le Fils de Dieu.
Et remarquez que le tabernacle, au sens propre, est à l’usage des militaires et des voyageurs : de même que le soldat qui part au combat s’arme dans sa tente, de façon à sortir en armes pour la bataille, de même le Christ, s’apprêtant à combattre le diable pour défendre son épouse déshéritée, l’Église, dans le ventre de la sainte Vierge comme dans un tabernacle s’est attaché une armure de chair humaine, comme le lui avait demandé le Psalmiste au nom du genre humain, disant : Prends les armes et le bouclier, dresse-toi à mon aide (Ps. xxxiv, 2), alors entrant tout armé en lutte avec le diable il combattit dans la Passion, et il le transperça alors que sa main était fixée à la croix, car c’est là qu’était cachée sa force (Ha. iii, 4). D’où la parole de Job, Sa prudence a transpercé l’orgueilleux et arraché au diable la proie qu’il avait dévorée (Jb xxvi ?), comme on chante à l’époque de Pâques. Et c’est ce que dit Job parlant de la personne du Christ : Je broyais le moulin de l’injuste et, j’ôtais la victime de ses dents (Jb. xxxix ?91)92. »
Le glissement thématique est particulièrement net ici. Alors que le mot tabernacle permettait jusque là de s’abstraire de l’objet matériel, la tente, pour accéder à la vérité mystique, le réceptacle de la Loi, c’est précisément l’image de la tente que suit Albert le Grand : tente du soldat, tente du voyageur, elle unit des thèmes hétérogènes par sa seule cohérence iconique. L’image est l’espace marial où dérouler la scène christique : cette scène du combat n’est pas celle de l’incarnation, mais bien celle de la passion.
L’allégorie comme parcours initiatique : Thomas d’Aquin
Le sujet du livre iv du Mariale d’Albert le Grand est repris par Thomas d’Aquin (1227-1274) à l’article 2 de la question 27, dans la troisième partie de la Somme théologique. La question est Utrum Beata Virgo sanctificata fuerit ante animationem, si la Vierge était sainte avant l’annonciation. Après avoir exposé les arguments d’Ambroise, d’Anselme et de Paul en faveur de cette thèse, Thomas d’Aquin prend le parti contraire d’Albert le Grand tout en se réclamant de la même allégorie du tabernacle :
« Mais le fait que les choses de l’ancien Testament sont une figure du nouveau milite contre cette thèse : selon le verset 11 du chapitre x de la première épître de Paul aux Corinthiens, tous ces événements qui leur arrivaient constituaient des figures. Or quand on parle de sanctification du tabernacle, comme au verset 5 du psaume xlv, le Très-Haut a sanctifié son tabernacle, il semble que l’on signifie la sanctification de la Mère de Dieu, qui est dite tabernacle de Dieu, selon l’expression du verset 6 du psaume xviii, Dans le soleil il posa son tabernacle. Du tabernacle il est dit en outre, aux versets 31 et 32 du chapitre xl de l’Exode, Quand tout fut achevé, le tabernacle du Témoignage ouvrit les nuées et la gloire de Dieu le remplit. De même, la Vierge ne fut pas sanctifiée avant que tout ce qui touchait à elle fût accompli, à savoir ce qui touchait à son corps et ce qui touchait à son âme93. » (Somme théologique, III, Q.27, a.2.)
Le tabernacle est désigné par Thomas d’Aquin comme une figure ; il se manifeste dans l’ancien testament comme une figure du message des Évangiles. La pratique de la lecture anagogique n’est certes pas une invention de Thomas d’Aquin. Mais le glissement d’imago vers figura change complètement le statut de l’image. Celle-ci ne fonctionne plus comme similitude mais comme préfiguration ; elle n’est plus l’objet focal de l’adoration, mais plutôt un intermédiaire à partir duquel effectuer une translation de sens. Thomas subit ici visiblement l’influence de la pensée économique byzantine. Mais la tradition occidentale a désormais fixé l’autonomie du support. Figura est un compromis entre cette matérialité principielle de l’image occidentale et le mouvement de translation vers le prototype hérité de Byzance.
Il est intéressant d’autre part de voir apparaître la figure du tabernacle au moment où Thomas d’Aquin récuse l’idée d’une sainteté essentielle et originelle de la Vierge Marie, idée à laquelle l’Église finira, tardivement, par consentir, jusqu’à adopter le dogme de l’immaculée conception. Marie n’est sainte qu’à l’issue de tous les événements miraculeux de son existence, postquam cuncta eius perfecta sunt, de même que le tabernacle n’est devenu saint, ne s’est empli de la gloire de Dieu qu’une fois sa construction achevée. Marie devient une architecture. Le face à face avec la figure de Marie n’est plus un face à face immédiat avec Dieu, comme devant les achiropiites. La divinité de la figure demande à être construite ; comme figura, l’image devra organiser ce processus de construction, le figurer matériellement, géométralement, par un trajet du regard.
III. Majestés et Miséricordes
Dès le treizième siècle, on voit apparaître des sculptures de Vierges-tabernacles qui, en s’ouvrant, présentent une image du Christ.
Montée et descente du regard : l’allégorie dialectique
Quant aux Maestà94, elles installent la Vierge sur un trône aux architectures somptueuses, en souvenir des allégories médiévales d’Ecclesia. Telle est la Maestà de Cimabue95, à la fin du treizième siècle, dont les quatre prophètes, en bas du trône, rappellent non plus l’identité entre les visions vétéro-testamentaires et l’histoire de la nouvelle alliance, comme au frontispice des Évangiles de la Bible de Vivien, mais la hiérarchie entre le fondement prophétique et la construction chrétienne de l’édifice de l’Église.
Sur les quatre rouleaux que tiennent les personnages, on peut lire, de gauche à droite : « le Seigneur a créé quelque chose de nouveau sur la terre, la femme recherchera son mari96 » (Jr. xxxi, 22) ; « Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre97 » (Gn. xxii, 18) ; « C’est le fruit sorti de tes entrailles que je mettrai sur ton trône98 » (Ps. cxxxii, 11) ; « Voici, la jeune femme sera enceinte, elle va enfanter99 » (Is. vii, 14). On peut ainsi identifier les prophètes auteurs des textes qu’ils tiennent, Jérémie et Isaïe aux extrémités, puis David, à qui s’adresse la phrase du psaume qu’il tient (sur sa tête, Cimabue peint la couronne des rois d’Israël), enfin Abraham, à qui s’adresse la phrase de la Genèse.
Jérémie et Isaïe lèvent les yeux vers la Vierge dont ils annoncent la venue, femina sur la banderole de Jérémie, virgo sur celle d’Isaïe. La Vierge désigne de sa main droite le Christ bénissant, qui tient dans sa main gauche le rouleau du texte biblique. Cette main pendante, relayée par celle de la Vierge, puis par le pied de l’enfant, ramène l’œil vers le bas, où Abraham et David sont tournés vers le spectateur pour lui annoncer l’avènement du Christ, semen sur la banderole d’Abraham, fructus sur celle de David. Le mouvement de l’œil est celui de la progression dans la compréhension du texte biblique, identifié au mouvement ascendant puis descendant de la dialectique platonicienne. L’esprit s’élève d’abord de la lecture littérale à l’anagogique, et l’œil devant la peinture de Cimabue s’élève des prophètes du soubassement vers le mystère de l’Incarnation en haut de l’image. Là, l’esprit se détache du texte pour contempler le mystère devenu entièrement visible sur la surface de l’image. Puis il redescend vers le texte, revient vers Abraham et David, mais pour accéder cette fois à la signification mystique du Pentateuque.
Abraham légèrement tourné vers la droite et David plus nettement vers la gauche croisent leurs regards en dehors de la peinture, juste devant elle. Ils accompagnent le mouvement de recul du spectateur, qui envisage cette fois la totalité architecturale de la peinture. Alors lui apparaît l’étagement du dispositif : La Vierge à l’enfant est assise sur l’Église, qui elle-même repose sur la Synagogue. Le trajet du regard révèle alors, au-delà de l’étagement architectural, un dispositif concentrique, curieusement figuré par la courbure inversée des marches du trône : au cœur du tabernacle se trouve l’ancienne Loi, et non la Vierge, dont le trône brise, ouvre les cloisons pour rendre pleinement visible ce qui dans la Synagogue était dérobé au regard.
L’icône est donc ici un espace concentrique, coupé en deux ; elle se constitue de l’effondrement de l’ancien tabernacle. Dès lors, le trajet du regard qui pénètre la Loi depuis le mystère de l’incarnation suppose un retournement : comme figure, la Vierge en majesté en constitue le pivot. Nouveau rideau fait chair du Saint des Saints, elle excède l’architecture : elle ouvre le passage du regard au-delà de l’interdit, elle retourne le dedans invisible de la Loi en dehors d’architecture rompue, offerte par effraction au regard. Dans ce retournement se joue la constitution phénoménologique moderne du regard, fondée sur l’entrelacs et le chiasme.
A cause de ce nouveau principe de réversion, l’allégorie ne dit plus désormais autrement ; elle dit autre chose, elle ouvre un passage d’un discours vers un autre discours, elle ménage la possibilité d’une subversion : l’allégorie est une économie de la subversion. Elle la règle, la tempère. Mais on ne doit pas oublier que l’intronisation de la Vierge à la place ou même aux côtés du Christ correspond à une mise en cause radicale des fondements institutionnels de l’autorité100 : l’instauration de cette nouvelle dynamique du regard fait advenir à l’image un dédoublement symbolique latent dans l’image depuis les débuts du christianisme.
Le manteau-écran des Miséricordes
Parallèlement à ces Majestés tabernaculaires se développe au quinzième siècle l’iconographie des Vierges de miséricorde101 dont le manteau peut être identifié à la tente du tabernacle.
L’articulation du motif, commun à Byzance et à l’Occident, du Christ-tabernacle, avec le motif spécifiquement occidental des Vierges de miséricorde est spectaculairement illustrée par une enluminure de l’Évangile du prince Vasak102 datant du treizième siècle et située à la frontière culturelle des deux mondes : Vasak et ses fils agenouillés sont enveloppés dans le manteau ouvert d’une Vierge de miséricorde. Ils font face au Christ, lui-même assis dans un tabernacle. L’ensemble est relié par un rideau rouge, tendu et noué autour des architectures et constituant par là, avec les quatre colonnes effectivement représentées, la macro-structure englobante d’un tabernacle unique, identifié à l’image.
Près de deux cents ans plus tard, le panneau de Pietro di Domenico sa Montepulciano ne se contente pas de camper la Vierge au centre de l’image, faisant du Christ un accessoire du dispositif. Ouvrant son manteau pour protéger les pénitents en procession et les fidèles, comme l’Ecclesia de Prüfening, cette Vierge représente l’ensemble de la communauté, pour laquelle elle intercède. L’intérieur de son manteau est fourré comme l’indiquent les petits rectangles blancs. On retrouve le même manteau fourré de l’intérieur dans des enluminures du treizième et du quatorzième siècle localisées dans des endroits très différents103, dans une Charité de saint Martin de la France du nord ou dans une Vierge à l’enfant d’Angleterre. Peut-on parler dès lors de mode vestimentaire et d’une empreinte réaliste, ou ne faut-il pas recourir plutôt à l’interprétation symbolique ? Comment ne pas penser aux bandes d’étoffes et aux peaux de la tente du tabernacle, non pas tant celles que décrit l’Exode104, mais plutôt les pelles Salomonis mises en avant par l’exégèse mariale du Cantique des Cantiques ? Le tabernacle est pelles Salomonis, ces peaux assemblées pour former une tente qui figure la communauté des fidèles.
Or Marie-tabernacle ne figure-t-elle pas cette communauté, de même que saint Martin partageant son manteau désigne l’Église comme communauté du partage ? Chaque fois le vêtement est représenté comme pelles Salomonis pour orienter la lecture de l’image vers le tabernacle mystique. Dans chacune de ces images, ce vêtement-tente tend à délimiter un espace sacré, à désigner le lieu du symbolique105.
Quant à la ceinture qui coupe littéralement d’un long trait noir vertical la robe d’or de la Vierge d’Avignon, elle suggère la fente miraculeuse, impossible, du ventre d’où provient le fils qu’elle tient dans ses bras et, par là, renvoie au type iconographique des Vierges parturientes, dont la Pinacothèque du Vatican possède un exemple de l’école florentine.
Ces deux motifs sont repris par Piero della Francesca pour sa Madonna del parto. L’intérieur de la tente est cousu de peaux et la jeune femme de sa main droite désigne le mystère du ventre. Les deux anges qui ouvrent la tente évoquent les deux chérubins du propitiatoire.
Cette fois le Christ a disparu. On voit par là comment la Vierge de miséricorde, prenant en Occident la succession du type byzantin de la Vierge des Blachernes, en détourne radicalement l’économie : portant au devant d’elle l’imago clipeata du Christ qu’elle adore, la Vierge des Blachernes est le support de l’incarnation dont le mystère est désigné dans le médaillon.
Elle est bien en quelque sorte, logiquement, le tabernacle du Christ, mais elle n’est pas formellement identifiée dans l’iconographie (ni d’ailleurs dans les textes) à l’objet, à l’espace que constitue le tabernacle. Elle s’abolit devant le médaillon qu’elle porte, elle s’efface en établissant le lien entre le visible qu’elle désigne et l’invisible qu’elle a reçu.
En Occident, c’est le Christ qui fait le lien. C’est lui, dans la Vierge d’Avignon, qui ouvre les bras selon la pose de la Vierge des Blachernes. C’est lui, dans la Madonna del parto, qui depuis la fente désigne in absentia l’invisible.
Le Christ est relation et la Vierge devient personne : l’autonomisation du support va de pair avec l’émancipation de celle qui le figure. La Vierge ne tend pas à s’abolir au moment de la contemplation de l’image ; elle n’ordonne plus un « enchâssement de formes closes106 ». Au contraire, elle fixe et elle ouvre un espace de représentation, elle est cet espace ouvert. Le tabernacle ouvert du manteau marial désigne la scène de ce qui est malgré tout donné à voir. La fente désigne ici cette coupure du malgré tout constitutive du nouveau dispositif d’effraction. Ce n’est plus ce rideau triomphalement ouvert entre l’ancien et le nouveau testament ; c’est une ouverture qui cultive sa clandestinité, son interdiction pour l’œil. La subversion ordonne désormais géométralement, par l’écran du rideau tabernacle ou de ce qui le métaphorise, le dispositif iconique.
Vers un tabernacle scénique
On retrouve le même symbolisme de la tente et des anges dans la Vierge Médicis de Rogier van der Weyden, exactement contemporaine de celle de Piero. Exécutée pour Côme de Médicis, la peinture porte en bas les armoiries de Florence. À gauche, saint Pierre portant la clef du Paradis et saint Jean-Baptiste, dont la tunique brune évoque l’habit en poil de chameau, sont les saints protecteurs des fils de Côme ; à droite, saint Côme tenant l’urinal et saint Damien, une cuiller dans la main droite, sont les patrons des médecins et, probablement à cause de l’homonymie en italien, des Médicis.
La Vierge installée au centre sur un hexagone à trois marches (on retrouve les trois marches du trône de Cimabue) est encadrée par une tente qui s’ouvre à la manière des manteaux des Vierges de Miséricorde. Les pans de la tente sont portés par des anges de la même blancheur grise, comme pour indiquer qu’ils ne font pas partie des personnages vivants, mais bel et bien du tabernacle : la grisaille indique le caractère figural du tabernacle et de ses chérubins, qui s’oppose à la vérité mystique des cinq personnages vivement colorés. Au fond de la tente, un brocart à motifs de grenade évoque peut-être le rideau séparant le Saint du Saint des Saints. Ce brocart est quadrillé par les marques d’un soigneux pliage après le repassage. On retrouve ce quadrillage aussi bien derrière les Vierges italiennes que flamandes de l’époque. Comme dans le cas des petits rectangles de fourrure blanche, on peut douter qu’il s’agisse là d’une simple notation mimétique indiquant une observation minutieuse des détails les plus pratiques de la réalité quotidienne. Ce quadrillage pourrait faire écho encore une fois aux pelles Salomonis du Cantique des Cantiques par quoi la Vierge, en tant que figure de la communauté des chrétiens, est identifiée au tabernacle lui-même.
Sur la fresque de Piero della Francesca comme sur le panneau de Rogier van der Weyden, l’espace symbolique de la représentation est la tente du tabernacle. C’est dans cet espace que vient s’incarner l’image divine. Dans l’iconographie byzantine et romane, la nature sacrée de l’imago était figurée par la mandorle, dont on a vu qu’elle renvoyait d’abord au Christ en tant que le Christ est image. De la même façon, le tabernacle désigne certes d’abord la nature de l’image tout entière ; mais il constitue bientôt un espace restreint, limité, à l’intérieur de l’image : par la figuration du tabernacle, l’image met en abyme et géométralise son économie.
Le motif du trône, de la tente, du rideau, vient alors se substituer à celui de la mandorle pour figurer une circonscription qui n’est plus exclusivement symbolique, c’est-à-dire pour rétablir la bipartition spatiale sur l’abolition de laquelle pourtant l’image chrétienne s’était jusque-là légitimée et construite. La séparation n’est certes plus celle du Saint et du Saint des Saints ; elle devient celle du tabernacle et du monde, autrefois identifiés, ouvrant à la distinction de l’espace sacré et de l’espace profane. Parce qu’il est désormais séparé du monde, cet espace sacré ne se définit plus essentiellement comme celui de l’imago théologique. L’autonomisation du support se parachève ainsi, déréalisant paradoxalement le lieu du tabernacle, désormais identifié à l’espace restreint, irréel, de la scène théâtrale. Tabernacle, dans la Septante et chez les Pères grecs, se dit σκηνὴ. Du clipeus de la mandorle christique, on a glissé à la Tente-ventre de l’incarnation puis de la passion ; on s’achemine maintenant vers la Tente-lit à côté de laquelle (et non plus dans laquelle) dérouler la scène de l’annonciation107.
Sous l’or symbolique, le bois figural : Bernardino de’Busti
On peut suivre, dans l’exégèse du psaume xlv par Bernardino de’Busti108, cette évolution de l’image qui décale Marie par rapport au tabernacle devenu l’accessoire spatial de la scène d’annonciation :
« La quatrième figure se trouve au chapitre xxv de l’Exode, à propos du fait que l’arche de l’ancien testament était de bois de séthim imputrescible. Par cette arche était figurée la Vierge Marie dans laquelle ne furent pas cachées les tables de la Loi, mais Dieu même qui donna la Loi. Par cette arche nous tenons entre autres quatre bénéfices. […]
Ambroise parle de cette arche dans un sermon. L’arche renfermait à l’intérieur d’elle-même les tables du Testament. Quant à Marie, elle portait l’héritier du Testament. L’arche rayonnait au dedans et au dehors d’un scintillement d’or. Et la sainte Vierge resplendissait au dedans et au dehors de l’éclat de sa virginité. L’arche était ornée d’or pur ; la Vierge, d’or céleste. Ainsi parlait Ambroise. Nous pouvons, quant à nous, ajouter que l’arche fut faite de bois imputrescible ; quant à la Vierge, préservée de toute la putrescence des péchés, elle fut conçue immaculée109.
[…] Non seulement la sainte Vierge est dite cour intérieure et habitation, ou encore maison de Dieu, mais elle est aussi appelée tabernacle du saint esprit, rempli de toute la sainteté dont parle David au psaume xlv, Le Très-haut sanctifia son tabernacle. Le mot tabernacle veut dire la maison dédiée à Dieu […]. L’église est dite tabernacle du Christ […] et pour cette raison c’est bien plus ainsi que doit être nommée la sainte Vierge, que l’on nomme également chambre du Christ110. » (Mariale, 5e sermon sur le nom de Marie.)
En apparence, Bernardino de’Busti reprend les équivalences symboliques traditionnelles qui identifiaient le tabernacle à l’Église, au corps du Christ et de là à la Vierge. Pourtant le point de départ de l’identification n’est pas le tabernacle mais l’arche en bois de sethim recouvert d’or. Ambroise avait insisté sur l’or. Bernardino de’Busti met l’accent sur le bois. L’image des Vierges de bois couvertes d’or et de pierreries que l’on vénérait et sortait en procession comme des arches dans les grands centres de pélerinage constitue ici le référent implicite. La Vierge n’est pas tente mais arche de bois que l’on recouvre ensuite d’une tente, le fameux manteau-cloche des Majestés.
En apparence toujours, Bernardino de’Busti revient ensuite à l’incarnation. Mais il ne désigne par Marie comme uterus virginalis, comme l’avait fait Albert le Grand. Pour lui elle est atrium, habitatio, thalamus christi : ces allégories se trouvaient déjà chez Albert le Grand. Elles vont désormais faire scène, visualiser le lieu de la rencontre avec l’ange, la chambre où Marie et Gabriel échangent leurs répliques au moment où la peinture envahit littéralement d’Annonciations les églises.
Vers le dispositif concentrique : Jaime Perez de Valence
Le commentaire que Jaime Perez de Valence111 propose du psaume xlv va dans le même sens. Il part de l’image architecturale de la cité de Dieu :
« Marie est dite tabernacle de Dieu112.
Explication du psaume xlv, Dieu notre refuge113
Pour comprendre ce psaume, il faut remarquer en second lieu que toute l’Église chante et attribue ces deux versets à la Vierge Marie à cause des quatre mystères qui y sont inscrits et rappelés, lesquels ne conviennent proprement qu’à la seule Vierge Marie.
Le premier mystère, selon la parole du prophète, c’est que Le courant du fleuve réjouit la cité de Dieu. Le second, c’est que Le Très-Haut a sanctifié son tabernacle. Le troisième, c’est que Dieu en son milieu ne sera pas déplacé. Le quatrième, c’est que Dieu l’aidera au matin à la première lueur (Ps. xlv, 5-6)114. Certes, ces quatre mystères peuvent se dire de toute l’Église. Cependant ils se vérifient d’abord, principalement et proprement par la médiation115 de la Vierge Marie qui fut la première des habitants de cette cité et le premier membre de l’Église selon Augustin (1er sermon de la nativité de la Vierge), comme au chapitre iv du Cantique des Cantiques, Tu es toute belle mon amie et il n’y a pas de tache sur toi (Ct. iv, 7), se dit de toute l’Église épouse du Christ par la médiation de la Vierge Marie ; car c’est pour elle seule que cela se vérifie ; elle seule fut sans tache ; ainsi chacun de ces quatre mystères se vérifie pour toute l’Église par la médiation de la Vierge Marie qui fut l’aurore et le premier membre de l’Église116. »
Marie est à la fois l’Église, la cité de Dieu et le premier de ses membres, de ses habitants. On voit ici travailler le jeu métonymique qui caractérise la pensée de la similitude. Pourtant la métonymie n’associe plus des objets exégétiques. Elle est l’instrument de la mise en espace, de la modélisation architecturale du Verbe. Marie est l’espace tabernaculaire et elle est dans cet espace. Marie est la médiation qui permet d’aller du tabernacle comme principe symbolique au tabernacle comme espace géométral. Elle est ce principe ; elle est dans cet espace.
Dans la spatialisation, un flottement demeure, dû au travail de la métonymie qui propage la contradiction logique jusque dans l’évocation de l’incarnation :
« La seconde conclusion, c’est que le Très Haut fils de Dieu n’a pas seulement réjoui et irrigué l’âme de la Vierge d’un fleuve copieux de grâces pour habiter en elle par la grâce, mais encore qu’il a sanctifié tout son corps et son âme pour habiter en elle par la chair et tirer d’elle sa chair117, ce qui apparaît clairement par ce qu’il dit ensuite, le Très-Haut a sancrifié son tabernacle. Il faut ici remarquer, comme il a été dit au prologue du quatrième traité, que le tabernacle est quadruple, à savoir un tabernacle compris comme personne, comme mère, comme mystère et comme ministère118. »
Le verset du psaume xlv est ici rattaché à la fois à l’annonciation et à l’incarnation. Le Christ est évoqué d’abord avec l’image crue d’une éjaculation divine associant le gratia plena de la salutation angélique au flumen gratiæ de la semence ; puis il devient image utérine du fœtus tirant sa chair de la chair de Marie : ut ex ea carnem assumeret. Il est l’enfanteur et l’enfanté, il est au dehors et en dedans, il apporte le supplément de la grâce et il retire, il extrait la chair.
La contradiction est résolue, comme chez Albert le Grand, par l’installation des images dans une architecture allégorique. Mais la multiplicité du tabernacle ne renvoie plus à une déclinaison des modes ; elle se hiérarchise en un parcours qui mime la montée puis la descente du cheminement dialectique : de la personne du Christ au mystère de son incarnation, puis de ce mystère à la pratique matérielle du service de Dieu.
L’architecture devient le modèle dominant. L’image n’est chair qu’en tant que la chair est architecture :
« Car le tabernacle, temple de Dieu, figurait en premier l’humanité du Christ. Et celle-ci se vérifie par cette première raison. C’est aussi pour cette raison que le Christ appelle temple son corps (Jn. ii, 18) quand il dit j’ai détruit ce temple et je le réédifierai en trois jours119. […]
Pour cette raison tout ce temple qui fut fabriqué par Salomon fut véritablement une figure du Christ, partie par partie. Et de fait dans ce temple il y en avait trois : au milieu, le Saint des Saints, par quoi était figurée la divinité qui se cachait dans le Christ ; en second lieu, il y avait dans ce temple la cour des prêtres, par quoi était figurée l’âme du Christ ; en troisième lieu, il y avait là la cour du peuple par quoi était figurée la chair du Christ. Et ainsi tout ce temple figurait exactement la personne du Christ. […] On doit dire la même chose du tabernacle que fabriqua Moïse. » (Introductions au livre des Psaumes, ive traité120.)
La bipartition tabernaculaire, sur laquelle se fondait l’économie de l’icône byzantine, devient ici tripartition divinité-âme-corps, ou divinité-prêtres-peuple, qui identifie le Christ aux trois ordres de la société. Cette tripartition spatiale correspond d’autre part au passage temporel du tabernacle au temple, puis du temple au Christ.
Quoi qu’il en soit, quel que soit le sens envisagé, il ordonne un dispositif d’étagement (et non d’écran). D’autre part, il s’agit ici de figura, non de similitudo : la référence biblique évoquée (Jn. ii, 18) renvoie d’abord à la destruction du temple en tant qu’elle préfigure la mort du Christ, puis à sa reconstruction/résurrection. Tel est le vacillement principiel propre à la figure : nous avions vu, chez Bède, l’éclipse de la Lumière au moment de la passion constituer le sens de l’or des anneaux de l’arche ; le même défaire-refaire est ici invoqué. Mais cette fois il ne s’agit plus de consacrer l’autonomie du support par un anéantissement momentané de la Lumière, par ce vacillement mystique qui désigne le mystère de la foi ; le vacillement du temple est matériel et concerne le support lui-même ; c’est le vacillement du support, c’est lébranlement des murs même du Temple qui désigne le double mystère de l’incarnation et de la résurrection. Le support n’est pas habité par un sens ; il est le sens.
L’architecture signifie. En elle les objets ne sont plus juxtaposés, mais articulés. Le passage de la bipartition à la tripartition marque le passage d’une sémiologie de la contiguïté à une sémiologie de la relation. Tout un système de relations et de médiations se met en place. Le règne de la métonymie fait place au règne de la métaphore :
« Par ces deux chérubins sur lesquels siégeait l’arche de Dieu, Salomon121 entrevit comment le Christ devait être l’intermédiaire entre les deux testaments et siéger sur eux.
Par le fait que l’arche était installée à l’intérieur du tabernacle, Salomon entrevit comment le Christ, Dieu véritable et homme, devait être installé dans le ventre de la Vierge Marie et, par voie de conséquence, [il entrevit] toute l’Église, dans laquelle habite le Christ. Mais il faut par ailleurs remarquer que de même que cette arche figurait l’humanité du Christ, de même le tabernacle figurait la Vierge Marie, et l’Église. Dans ce tabernacle, Salomon considéra sept mystères. » (Explication du Cantique des Cantiques, II122.)
Les deux chérubins du propitiatoire, souvent représentés dans l’iconographie occidentale comme deux anges tenant le voile du Saint des Saints, sont dans la peinture les signes les plus frappants d’une référence au tabernacle. En faisant de ces deux chérubins les métaphores des deux testaments, entre lesquels l’arche, métaphore du Christ123, établit sa médiation, non seulement Jaime Perez annule le jeu séculaire entre visible et invisible (tout ici est figuré), mais il dissout l’identification principielle du Christ à l’image. Le Christ n’est plus image mais medius, articulation, relation. Cette relation n’est pas la relation économique au Père ; elle est, dans le dispositif visible de l’image, ce qui relie de façon dynamique les parties, ce qui les met en scène.
Le tabernacle devient alors une scène de la vie du Christ :
Par la décoration du tabernacle, dans la variété des tissus et des fleurs, Salomon eut la vision prémonitoire du décor des différentes vertus dont le Christ orna sa mère, de laquelle il devait tirer sa chair, et en qui non seulement comme dans un tabernacle de fiançailles124, mais encore comme dans un tabernacle maternel il devait s’humaniser, car la Vierge Marie fut d’abord l’épouse avant que d’être la mère du Christ, car elle conçut d’abord le Christ en esprit par la grâce, avant de le concevoir en chair, comme dit Augustin dans son livre De la sainte virginité. De la même façon, pour ce que l’arche d’alliance fut placée dans le tabernacle matériel [?] Salomon eut la vision prémonitoire de la façon dont le Christ Dieu et homme devait être placé, et qu’il devait être porté charnellement pendant neuf mois dans le ventre de la Vierge Marie elle-même, sa mère.
Ainsi, pour ce que Dieu, siégeant sur l’arche d’alliance au-dessus des chérubins, parlait à Moïse et dans et du tabernacle, et par Moïse à tout le peuple, Salomon eut la vision prémonitoire de la manière dont le Verbe divin se tenant sur l’arche d’humanité et à l’intérieur du ventre de la Vierge devait sanctifier Jean-Baptiste dans le ventre de sa mère, et le même Christ installé dans le ventre de sa mère la fit évangéliser, quand elle dit Mon âme magnifie le Seigneur… car le Fils parlait par la bouche de Sa mère, de la même façon qu’autrefois Il avait parlé par la bouche des prophètes.
Ainsi, parce que la nuée protégeait ce tabernacle, qu’elle le dirigeait et conduisait toute l’armée, et qu’il pleuvait continûment de la manne pour la nourriture et la réparation des forces de ce peuple, Salomon eut la vision prémonitoire de la manière dont le Saint-Esprit devait circonscrire d’ombre125 la Vierge dans son annonciation, et dont la Vierge Marie devait recevoir le Verbe divin envoyé par le Père comme un pain, un vin et une manne cachés pour la vie, le salut et la réparation des forces de tous les fidèles. […]
Et il apparaît encore clairement que le tabernacle de Moïse préfigurait non seulement le tabernacle maternel du Christ que fut la Vierge Marie mais aussi le tabernacle mystique, qu’est l’Église tout entière126.
Le Christ orna sa mère de vertus, il fut porté par elle neuf mois, il évangélisa par sa bouche : le tabernacle est rideau orné, réceptacle et Verbe, mais ce n’est pas essentiellement comme objet qu’il est considéré ici. Les scènes évoquées articulent progressivement l’intériorité du tabernacle avec une extériorité : Dieu parle et intra tabernaculum et de tabernaculo, et à l’intérieur face à face avec Moïse et de l’intérieur pour le peuple à qui il est interdit d’entrer ; de même le Christ parle en la Vierge, mais celle-ci évangélise à l’extérieur.
Ce que figure le Christ ici devient essentiellement non plus le mystère du Saint des Saints mais la relation de cet intérieur et de cet extérieur, relation qui fait scène. Jaime Pérez évoque alors explicitement l’annonciation, in sua annunciatione, nettement dissociée de l’incarnation. Par l’évocation du pain et du vin, la réception du Verbe en Marie est désormais identifiée à la célébration de l’eucharistie. Contrairement au mystère statique de l’incarnation, l’annonciation est relation, trajet de la lumière du Saint-Esprit. Le passage de la Vierge de l’incarnation (la Majesté) à la Vierge de l’annonciation, mise en scène dans un espace marqué par le trajet, l’adresse, achève de constituer l’image en dispositif. Le dispositif assume complètement désormais, au sein de l’image, le cheminement du sens.
L’allégorie du tabernacle s’ordonne alors en un édifice exégétique complet, auquel Jaime Perez de Valence confère les quatre sens prévus par la lecture allégorique et codifiés par exemple chez Dante :
« Le tabernacle compris comme personne est l’humanité même du Christ dans laquelle le verbe de Dieu habite sous la forme d’une personne, dans l’unité de l’hypostase. Et ce tabernacle, le Très-Haut l’a sanctifié à l’instant même de l’incarnation car il l’a rempli de l’esprit de sa sagesse et de son intelligence.
Le second tabernacle, compris comme mère, fut la Vierge Marie elle-même, dont le Christ a tiré sa chair et dans laquelle pendant neuf mois il a habité selon la chair, Marie dans l’âme de qui déjà au premier instant de sa création il avait habité par la grâce.
Le troisième tabernacle, compris comme mystère, c’est toute l’Église et la religion chrétienne, dans laquelle Dieu habite par la foi que le Christ, dans le baptême, a sanctifiée en lui-même, comme le dit Jean au chapitre xvii, je me sanctifierai moi-même en eux127.
Le quatrième tabernacle est le Temple où s’accomplit le ministère et toute église qui est dédiée au service de Dieu et à l’administration des sacrements de l’Église. Ces églises sont en effet sanctifiées et consacrées par les évêques.
Et c’est ainsi que l’on doit dire que le tabernacle et la cité de Dieu se disent premièrement de l’humanité du Christ, deuxièmement de la Vierge Marie, troisièmement de tous les fidèles qui constituent l’Église, et enfin de toute église matérielle128. »
Les quatre sens du tabernacle selon Jaime Perez semblent reprendre grosso modo ceux d’Albert le Grand : le corps du Christ, le corps de la Vierge, l’Église (militante et triomphante réunies) et la religio ordinata. Pourtant le corpus justi manque ici, et la pratique personnelle de la religio n’est pas exactement le tabernaculum ministeriale, qui des sacrements de l’Église glisse à l’église saisie dans sa matérialité architecturale.
Le trajet vers l’ascèse mystique est ici remplacé par un mouvement d’intégration institutionnelle. De l’hypostase formée par la double nature du Christ, on passe au fonctionnement institutionnel de l’Église, de toute église. Il s’agit d’articuler le christianisme comme principe symbolique (centré sur l’humanité du Christ) et comme institution (manifestée par le service de Dieu dans l’église). Le modèle architectural est un modèle d’intégration symbolique ramenant la subversion principielle de l’image à l’espace consacré de l’église matérielle.
Mais cet étagement des significations allégoriques du tabernacle peut se lire également comme une récapitulation historique des modèles iconographiques : l’allégorie est alors archéologie du rapport théologique que la culture entretient avec l’image ; le tabernacle personnel renvoie à la Sainte Face, le maternel est la théotokos, le mystique évoque les Ecclesiæ en majesté, le tabernaculum ministeriale ou materiale ramenant à l’espace géométral dans lequel est installée l’image et par lequel elle est légitimée institutionnellement.
Jaime Perez revient alors à ce qui constitue désormais l’allégorie traditionnelle et canonique, identifiant le tabernacle à Marie :
« De là, c’est à juste titre que par tabernacle du Très-Haut on entend la Vierge Marie prise aussi bien comme corps que comme âme. Car de même que cette arche du Testament dans laquelle étaient les tables de la Loi et la verge d’Aaron et l’urne contenant la manne figurait l’humanité du Christ (l’humanité du Christ est l’arche de la divinité129 dit l’apôtre dans l’épître aux Hébreux, chapitre ix), de même le tabernacle de Moïse figurait la Vierge Marie. Car de même que l’arche du Testament fut placée dans ce tabernacle, comme il apparaît clairement au chapitre xl de l’Exode, de même le Christ tout entier fut placé et reposa dans le ventre de la Vierge comme dans un tabernacle matériel130. »
La systématisation des inclusions fait apparaître à nouveau une organisation ternaire de l’espace : la Loi est dans l’arche, l’arche dans le tabernacle ; de même le Verbe est dans le Christ, et le Christ dans la Vierge. Cet espace concentrique demeure encore incertain dans la Maestà de Cimabue ; mais c’est lui qui ordonne la Vierge de miséricorde de Pietro di Domenico da Montepulciano, la Vierge de l’enfantement de Piero della Francesca, la Vierge Médicis de Rogier van der Weyden : le Christ est dans les bras (ou le ventre) de la Vierge, elle-même inscrite dans le tabernacle (ou le manteau). Il n’est plus question ici de trajet interne : ces espaces concentriques s’ouvrent devant le spectateur ; c’est cette nouvelle relation qui compte désormais.
IV. La scène comme déconstruction du tabernacle
Il peut paraître pour le moins paradoxal d’identifier la représentation de la Vierge en majesté avec l’image prise dans la dimension subversive que lui a léguée la théologie médiévale. Quoi de plus institutionnel, quoi de plus rhétorique et canonique que ces Vierges de la Renaissance italienne qui semblent toutes identiques ? Face à la montée de la Réforme, qui ravive l’iconoclasme chrétien, les Madonnes sagement assises paraissent bien conservatrices. Pourtant une nouvelle révolution sémiologique est ici à l’œuvre qui va superposer le modèle théâtral au vieux modèle tabernaculaire dans la conception même de ce qu’est une image. Même catholique, l’image se laïcise.
Prenons pour exemple la Sainte Famille du retable de San Zaccaria, peinte par Véronèse au début de sa célébrité. Ce n’est pas la première fois que Véronèse s’attaque à ce type de tableau. Vers 1546-1548, il avait peint sur un modèle similaire le Retable Bevilacqua-Lazise pour la chapelle Avanzi de l’église San Fermo Maggiore à Vérone. En bas figuraient les donateurs, Giovani Bevilacqua-Lazise et sa défunte épouse Lucrezia Malaspina ; puis Jean-Baptiste et un évêque en tiare ; enfin, dans une niche isolant le quart supérieur gauche du tableau, la Vierge à l’enfant accompagnée de deux anges musiciens. L’évêque montre de la main la donatrice et regarde la Vierge : il oriente l’élévation du regard. La Vierge tend le Livre vers Jean-Baptiste, lui-même tourné vers le donateur : de ce côté, donc, s’organise la descente du regard. Un double mouvement se dessine, comme dans le Cimabue. Le retable est mis en abyme dans le tableau, qui distingue trois espaces correspondant à trois hauteurs différentes : l’espace profane, où prient les donateurs ; plus haut, l’espace intermédiaire, où se trouvent les saints ; enfin, l’espace tabernaculaire qu’encadre l’architecture où trône la Vierge. Le rideau, presque toujours présent derrière elle, rappelle qu’il s’agit ici du Saint des Sains.
Cette hiérarchie, liée aux codifications traditionnelles de l’exégèse biblique et au guidage très ritualisé de la lecture des images qu’elles impliquent, avait conduit le Titien au même étagement du dispositif iconique de son Retable Pesaro, dans les années 1520131. Mais dès le retable Giustinian, en 1551, Véronèse va modifier profondément l’organisation géométrale de ce qui se présente au premier abord comme une variation sur le même thème.
La Vierge quitte son cadre architectural, qui est symboliquement coupé en haut à gauche. Véronèse avance pour elle, sur le devant, un piédestal depuis lequel organiser une communication entre l’espace supérieur, dévolu à la Sainte Famille, et l’espace inférieur, où sont peints les saints. Le piédestal n’est plus un trône ; c’est déjà un tréteau de scène. La Vierge (en haut à droite) et sainte Catherine (en bas à gauche) se regardent ; Jésus se penche vers elle. La main portée sur le cœur dans un geste oratoire, Catherine s’adresse à la Vierge : ceci est une scène de théâtre, où l’œil circule en rond, sans hiérarchie, et où l’étagement symbolique est fortement atténué.
Dans le Retable de San Zaccaria, l’évolution se poursuit : en haut du tableau, légèrement décalée vers la droite, la Vierge est assise et présente l’Enfant sur ses genoux. Elle s’inscrit dans un espace certes toujours fortement architecturé : mais les lignes horizontales délimitant les étages de lecture ont quasiment disparu et le fond incurvé, tendu d’un rideau de damas d’or à motifs de grenades, ouvre sur un ciel qui abolit l’intériorité de l’espace tabernaculaire. Véronèse avait utilisé la lumière naturelle qui tombait sur l’autel de la sacristie de l’église et éclairait le ciel au-dessus de la tenture. Ce ciel a aujourd’hui disparu sous les repeints.
Sur les épaules de la Vierge, un chérubin qui n’est constitué que d’une tête étend un lourd châle de franges. Tous ces éléments renvoient à l’iconographie des Maestà du treizième et du quatorzième siècle. L’abside avec sa colonne cannelée désigne le tabernacle ; le châle tendu par le chérubin renvoie au rideau séparant le Saint du Saint des Saints. Le tabernacle est là comme forme mais il ne fonctionne plus comme espace, comme support géométral du dispositif symbolique. Aux pieds de la Vierge, debout sur un piédestal de marbre qui rappelle celui du retable Giustinian, tournant le dos au spectateur, un garçonnet nu recouvert d’une peau de bête et portant la Croix figure Jean-Baptiste. Dans la tradition grecque, il se nomme Jean le Précurseur et l’on comprend mieux, ainsi, sa position. Le dispositif d’étagement persiste malgré l’effacement des lignes, la Vierge portant au-dessus d’elle la nouvelle alliance du Christ, mais se tenant elle-même au-dessus de ce qui n’est qu’une introduction à cette alliance, la prédication de Jean dans le désert qui mènera Jésus au baptême. Jean-Baptiste lui-même se trouve au dessus des trois saints qui se tiennent sur un sol identifié à la base du tableau.
Mais cet étagement est lui-même pris dans une nouvelle dynamique. Ceci n’est pas une Maestà, mais une Sacra conversazione, que Véronèse ne traite plus selon l’horizontalité traditionnelle, statique, qui prévalait encore dans le retable Giustinian. Entre Joseph à droite, Jésus et Jean, semble s’établir un dialogue animé, familial, intime, en complet décalage avec l’immobilité hiératique de Marie. Le dispositif allégorique est tiré vers la scène théâtrale, avec le jeu d’effraction qu’elle suppose : la scène se joue dans la fiction qu’elle n’est pas regardée, dans une intimité de convention que le regard du spectateur vient briser. Cette fiction est symbolisée par la position retournée de Jean, qui ignore effrontément le spectateur, ou plutôt qui marque que ce que celui-ci regarde est interdit de regard. L’interdit biblique de la représentation devient interdit géométral du regard constitutif de la scène. La dynamique théâtrale de la représentation vient se superposer à son économie théologique ; elle l’évincera bientôt.
En dessous de cette scène d’intimité qui se dévoile impudiquement à nos yeux, Véronèse a placé trois saints, de droite à gauche, Jérôme, auteur de la Vulgate qu’il tient dans les mains, reconnaissable à son habit rouge de cardinal et au lion vers lequel il se retourne, dont on aperçoit la gueule sombre à la bordure du tableau132 ; puis François d’Assise tonsuré et en robe de bure, montrant les stigmates dans ses mains ; enfin Justine portant la palme du martyre. Les saints, qui constituent le soubassement de l’ensemble du dispositif, ne jouent pas du tout le même rôle que les prophètes de la Maestà de Cimabue. Eux n’annoncent ni ne prophétisent rien ; ils témoignent de ce qui s’est passé, ils portent la vision de la scène qui nous est présentée. Cette vision est marquée par la coupure, par le hiatus symbolique entre le monde, que le spectateur partage avec les saints, et la scène, à laquelle l’œil n’accède que par effraction. Ce hiatus est figuré par la palme du martyre que tient Justine, interposée entre son regard et la scène. François tend la main à Jean-Baptiste, auquel il est peut-être ainsi symboliquement associé ; mais Jean-Baptiste se détourne, ne le voit pas ; ces deux mondes ne communiquent pas ; enfin Jérôme, quoique appuyé sur le piédestal, se retourne vers son lion qui l’empêche ainsi d’entrer dans la conversation.
Mais cette coupure n’a rien à voir avec l’ancien dispositif d’étagement. Elle n’ordonne pas des niveaux de lecture ; elle modélise l’espace iconique à partir d’une certaine idée qu’on se fait, à la Renaissance, du fonctionnement du regard. Le matériau théologique n’est plus essentiellement structurant.
Le tabernacle n’est plus l’instrument d’un parcours initiatique du texte biblique. Il est désormais placé en représentation, théâtralement exhibé, offert en spectacle aux saints et, par leur truchement, aux fidèles. Mais dans le même temps il fait mine de se soustraire aux regards, comme pour marquer sa séparation d’avec le monde. Le tabernacle devient scène et, par là, cesse d’être compris comme tabernacle même s’il en conserve les attributs. Une coupure s’instaure alors entre la dimension du réel, où est renvoyé l’œil du spectateur, et la dimension du symbolique, identifiée à l’espace restreint, interdit, de la scène. Mais cet espace même, malgré les vestiges d’une posture hiératique de la Vierge, est contaminé par le réel, évacue le texte biblique et tend à se fondre dans l’intimité familière du monde. L’allégorie se défait donc au profit de la mimésis. Ce n’est plus une Vierge qui signifie le tabernacle ; c’est une conversation qui représente une famille.
Une douzaine d’années plus tard, Véronèse peint un Mariage mystique de sainte Catherine pour l’église Santa Caterina de Venise, qu’il est intéressant de comparer au Retable de San Zaccaria car c’est sensiblement le même décor qui a été réutilisé. On reconnaît en effet les deux colonnes corinthiennes cannelées qui entouraient la sacra conversazione et dont seule celle de gauche était visible dans le tableau de jeunesse. Sur les marches, les rinceaux de feuillages sculptés sont de même style que ceux qui se trouvaient derrière la colonne visible de la Sainte famille. Quant au piédestal sur lequel était grimpé Jean–Baptiste, on le distingue cette fois derrière le dos de la Vierge, qui est descendue sur les marches, qui s’est rapprochée et qu’un léger sourire a dans le même temps humanisée.
L’angle de perspective a été complètement revu. En prenant la scène de côté, et non plus de face, Véronèse estompe l’architecture. Ce qui fait écrin pour la scène, ce n’est plus l’édifice allégorique de l’Église, mais d’un côté le chœur des anges musiciens, de l’autre la nuée volante des putti portant la palme du martyre de Catherine et la couronne de la royauté de Marie, qu’elle porte depuis son couronnement par le Christ lors de l’Assomption.
La Vierge à l’enfant est cette fois détournée en scène de rencontre. Si, symboliquement, Catherine épouse le Christ, dont la petite main glisse bien l’anneau sur son annulaire droit, géométralement, le dispositif organise le face à face des deux femmes : Marie soutient la main de Catherine. Elles ne se regardent pas mais leurs silhouettes, les couleurs complémentaires de leurs vêtements se répondent.
Il faut opposer, à ce titre, cette composition du Mariage mystique de sainte Catherine à celles que Véronèse avait peintes dans sa jeunesse. Dans les tableaux de New Haven et de Tokyo, tous deux datés de 1547, Catherine et Jésus, presque tête contre tête, se regardent intensément, ce regard constituant le point focal de la composition. Le fond jaune d’or à gauche et la couronne des chérubins, dans le tableau de New-Haven, indiquent la différence du monde céleste avec le monde terrestre, figuré à droite par l’échappée vers un paysage aux vastes horizons.
Rien n’indique, dans la version de l’église Santa Caterina de Venise, la différence de nature entre le monde, auquel appartient Catherine, et le ciel, d’où vient la Vierge, si ce n’est le foisonnement ailé d’un écrin angélique désormais intégré dans le ciel naturel. Le caractère mystique de cette rencontre est rendu par la seule théâtralité de la scène, par les expressions des spectateurs au-dessus de la Vierge et derrière les deux femmes. Cette disposition des spectateurs transgresse complètement les hiérarchies symboliques, pour lesquelles seul Dieu et éventuellement le Christ sont au-dessus de la Vierge. En revanche la scène théâtrale de la Renaissance admet des spectateurs sur son pourtour.
Mais le détournement le plus spectaculaire est celui de l’usage des tissus. Le rideau-tabernacle est cette fois jeté sur les colonnes : tenu à rien, invraisemblablement plaqué sans anges qui le portent, il vient colorer, habiller une pure architecture. A-t-il encore une signification autre que décorative ? Quant au manteau jaune d’or de Catherine, il est ouvert et déployé à la manière des manteaux de Vierges de miséricorde. Véronèse oppose un type de Vierge à un autre type, il puise dans un répertoire de formes. Ce manteau porte-t-il un sens ou déploie-t-il la seule magnificence d’un habit de fête ?
Le manteau jaune et le rideau rose se répondent, tabernacle contre tabernacle. Mais leur fonction symbolique est désormais complètement détournée et réinvestie par la peinture : ils circonscrivent dans la toile un espace logiquement aberrant, l’espace scénique de la rencontre entre Marie et Catherine, qui n’est ni terrestre, ni céleste. Cet espace hétérogène, nous ne devrions pas le voir : complètement à droite, le jeune homme qui porte le lourd brocart jaune dont Catherine est enveloppée tend la tête par dessus pour voir quand même le passage d’anneau qui lui est dérobé. Il métaphorise le regard du spectateur qui jouit de ce plaisir interdit de contempler l’impossible. A la vision mystique de l’imago s’est substituée la jouissance transgressive du regard porté sur la scène picturale.
On continue jusqu’au dix-huitième siècle, dans la peinture d’histoire, y compris dans les sujets les plus profanes, à représenter un rideau, lointain héritier de l’allégorie du tabernacle, pour délimiter, sur la toile, l’espace restreint de la scène proprement dite. L’allégorie du tabernacle aura donc servi de médiation entre l’image comprise comme similitude au début du Moyen-âge et l’image traitée comme mimésis à l’époque classique. L’allégorie a pris le relais de l’économie en instituant d’abord une compartimentation diagrammatique de l’espace dans la représentation, puis en ransmuant le diagramme en étagement architectural et enfin en espace concentrique. Ce travail de spatialisation du symbolique accompli par l’allégorie a préparé le passage pour l’image du modèle tabernaculaire au modèle de la scène, qui initie sémiologiquement la coupure mimétique. Cette coupure s’est historiquement manifestée d’abord comme séparation entre le dehors et le dedans de la tente, c’est-à-dire non pas entre le réel et son imitation, mais d’abord entre la Loi et ce qui l’enveloppe, entre le signifié et le signifiant.
Stéphane Lojkine
Centre d’étude du dix-huitième siècle (Cedim)
Université Paul-Valéry, Montpellier
Janvier-mars 2001
Notes
« Tu ne feras pour toi ni sculpture, ni toute image de ce qui est dans les cieux en haut, sur la terre en bas, et dans les eaux sous terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. » (Ex. xx, 4-5 ; Dt. v, 8-9.)
f°40 r°, voir également f°53r°.
On ne signale qu’une laconique condamnation des images au synode local d’Elvire en Espagne, liée probablement à la polémique anti-juive (entre 305 et 312) : picturas in ecclesia esse non debere, ne quod colitur et adoratur in parietibus depingatur, « il ne doit pas y avoir de peintures dans l’église, de façon que ce qui y est révéré et adoré ne soit pas peint sur les murs » (canon 36 ; voir André Grabar, L’Iconoclasme byzantin, le dossier archéologique, Flammarion, « Idées et Recherches », 1984 : « Champs », 1998, p. 111 et p. 128).
« Il est l’image du Dieu invisible », imago Dei invisibilis (Col. i, 15) ; « Resplendissant de sa gloire, effigie de sa substance », splendor gloriæ et figura substantiæ ejus (He. i, 3). Pour le texte de la Vulgate, voir Biblia sacra juxta vulgatam versionem, éd. Robert Weber et Roger Gryson, Deutsche Bibelgesellschaft, 1969, 1994.
Parlant de l’homme, saint Augustin écrit : « Mais cette image de Dieu n’était pas parfaitement égale à son modèle (non omnino æqualis fiebat illa imago Dei) car elle n’est pas née de Dieu, mais créée par Dieu, précisément dans le but d’être un symbole (huius rei significandæ causa) ; aussi est-elle une image qui est à l’image de (ita imago est ut ad imaginem sit) ; autrement dit, c’est une image qui n’atteint pas à l’égalité, mais à une ressemblance approximative (quadam similitudine accedit). » (Saint Augustin, De Trinitate, l. VII, ch. vi, §12, trad. M. Mellet et Th. Camelot, Bibliothèque augustinienne, DDB, 1955, t. XV des Œuvres complètes, p. 551.) Voir également De diversis quæstionibus, 83, qu. 51 (DDB, t. X, pp. 132sq.). La distinction entre imago et ad imaginem conduit la théologie grecque à présenter l’homme comme image de l’image, εἰκων εἰκόνος (Clément d’Alexandrie, Strom. V, 14, 94 ; Origène, In Joann. Comm., II, 3).
A. Grabar, op. cit., pp. 52-53 et figures 12 à 19 ; Marie-José Mondzain, op. cit., pp. 194-197.
A. Grabar, op. cit., pp. 178-179 et figures 20 à 22.
A. Grabar, op. cit., pp. 165sq. et figures24-25.
A. Grabar, op. cit., pp. 184-185.
A. Grabar, op. cit., pp. 212, 220, 250.
Marie-José Mondzain, Image, icône, économie. Les sources byzantines de l’imaginaire contemporain, Seuil, L’ordre philosophique, 1996.
Sur dispositio et dispensatio, voir J. Moingt, Théologie trinitaire de Tertullien, Paris, Aubier, 1966, III, 4, 852-932 et Marie-José Mondzain, op. cit., pp. 41-42, 64.
La relation de l’image au modèle, de l’icône au prototype, est la σχέσις. Voir Nicéphore, Antirrhétiques, I, 277c-278d et Marie-José Mondzain, op. cit., p. 114.
L’économie définit ainsi « un espace vierge et utérin », « une matrice qui ne vaut que par ses bords ». C’est la χώρα. Marie-José Mondzain, op. cit., p. 131, 199.
De même le russe bogomater, qui traduit littéralement théotokos, est le terme qui désigne les icônes. S’il n’est pas rare de trouver ἡ παρθένος pour désigner la Vierge dans les écrits théologiques, le terme est presque toujours associé à θεοτόκος, qui n’a guères son équivalent en latin.
Marie-José Mondzain, op. cit., pp. 123-125, 198-203.
« Sed propter imparem, ut diximus, similitudinem dictus est homo ad imaginem. » (Saint Augustin, De Trinitate, op. cit., p. 551.)
Εἰκὼν μὲν οῦν ἐστιν ὁμοίωμα χαρακτηρίζον τὸ πρωτότυπον μετὰ τοῦ καί τινα διαφορὰν ἔχειν πρὸς τὸ ἀρχέτυπον. (Die Schriften des Johannes von Damaskos Besorgt von Bonifatius Kotter, Berlin, N. de Gruyter und Co., 1969, t. III, 1975.)
Θεωροῦντες δὲ τὸν σωματικὸν χαρακτῆρα αὐτοῦ ἐννοοῦμεν ὡς δυνατὸν καὶ τὴν δόξαν τῆς θεοτήτος αὐτοῦ· […] ῞Ωσπερ οῦν διὰ λόγων αἰσθητῶν ἀκούομεν ὠσὶ σωματικοῖς καὶ νοοῦμεν τὰ πνευματικά, οὕτω καὶ διὰ σωματικῆς θεωρίας ἐρχόμεθα ἐπὶ τὴν πνευματικὴν θεωρίαν. (III, 12, 21 et 27.)
Nous nous appuyons pour cette miniature sur la description d’André Grabar, op. cit., pp. 56-58.
Cette identification n’est pas de la meilleure orthodoxie augustinienne. Voir Jean Wirth, L’Image à l’époque romane, Cerf, Histoire, 1999, p. 38.
Πάλιν εἰκὼν λέγεται τῶν ἐσομένων αἰνιγματωδῶς σκιαγραφοῦ͂σα τὰ μέλλοντα, ὡς ἡ κιβωτὸς τὴν ἁγίαν παρθένον καὶ θεοτόκον καὶ ἡ ῥάβδος καὶ ἡ στάμνος...
Le De tabernaculo a été écrit vers 729-731.
Ce sont les dernières phrases de l’Évangile de Matthieu : Jésus ressuscité apparaît aux apôtres en Galilée et leur confie leur mission.
Allusion au songe de Nabuchodonosor, deviné et interprété par Daniel. C’est la parabole de la pierre d’achoppement : « Tu regardais ; soudain une pierre se détacha sans que main l’eût touchée, vint frapper les pieds de fer et d’argile de la statue et les brisa. Alors se brisèrent… » videbas ita donec abscisus est lapis sine manibus et percussit statuam in pedibus eius ferreis et fictilibus et comminuit eos. Tunc contrita sunt… (Dn, ii, 34-35). Le contrivisse de Bède reprend le contrita sunt de Daniel.
Première épître de Pierre, ii, 5.
« Daboque tibi, inquit, tabulas lapideas et legem ac mandata quae scripsi ut doceas eos. Huic simile est illud evangelii quod supra posuimus, docentes eos seruare omnia quaecumque mandaui uobis. […] Nam et Danihel uidit dominum in figura lapidis excisi de monte sine manibus contriuisse pompam regni mundialis ut regnum ipsius solum sine fine permaneat, et Petrus fideles ammonet dicens : Et uos tamquam lapides uiui superaedificamini domus spirituales. » (Bedae venerabilis de tabernaculo et vasis eius ac vestibus sacerdotum libri III in Corpus christianorum, series latina, Bedae venerabilis opera, pars II, opera exegetica, 2a, cura et studio D. Hurst, Turnholti, Brepols, 1969, livre I, p. 6, l. 48-66.)
Voir Jean Wirth, op. cit., p. 43.
Voir J. Cl. Bonne, « De l’ornemental dans l’art médiéval », L’image : Fonctions et usages des images dans l’Occident médiéval, Cahiers du Léopard d’or, n°5, 1996, p. 223.
« Gregorius Sereno episcopo Massiliensi,
Praeterea indico dudum ad nos peruenisse, quod fraternitas uestra quosdam imaginum adoratores aspiciens easdem ecclesiis imagines confregit atque proiecit. Et quidem zelum uos, ne quid manufactum adorari possit, habuisse laudauimus, sed frangere easdem imagines non debuisse iudicamus. Idcirco enim pictura in ecclesiis adhibetur, ut hi qui litteras nesciunt saltem in parietibus uidendo legant, quae legere in codicibus non ualent. Tua ergo fraternitas et illa seruare et ab eorum adoratu populum prohibere debuit, quatenus et litterarum nescii haberent, unde scientiam historiae colligerent, et populus in picturae adoratione minime peccaret. » (S. Gregorii magni Registrum epistularum libri xiv, éd. Dag Norberg, Corpus Christianorum, Series latina, CXLa, Turnholti, Brepols, 1982, livre ix, lettre 209, p. 768.)
Carl Nordenfalk, L’Enluminure au moyen âge, Skira, 1988, pp. 37 et 39.
On retrouve le même jeu du A et du O, toujours dans l’Évangile d’Echternarch, au folio illustrant le symbole de Marc, imago leonis. Le cadre rouge dans lequel est inscrit le lion bondissant figure en haut à gauche un A aux mêmes formes rectangulaires, à droite un O carré. Le A et le O sont reproduits symétriquement, à l’inverse donc, en bas. Voir Carl Nordenfalk, op. cit., p. 30.
Voir par exemple le Christ entre deux apôtres, dans l’Évangile d’Etchmiadzin de 989, Erevan, Maténadaran, n°2374, f°6, in Sirarpie Der Nersessian, L’Art arménien, Flammarion, 1977, 1989, p. 89.
Cosmas Indicopleustès, Topographie chrétienne, trad. française et notes par Wanda Wolska-Lonus, 3 vol., Sources chrétiennes n°141, 159 et 197, Paris, Cerf, 1968-1973. Cosmas vivait à Alexandrie au vie siècle. La description du tabernacle se trouve dans le t. 2, livre V, §20sq.
Jean Wirth, op. cit., p. 30-31.
Λέγε μοι ἐρωτῶντι· Εἷς θεὸς ὁ Θεός; Ναί, φήσεις, ὡς ἔμοιγε δοκεῖ, εἷς νομοθέτης. Τί οῦν νομοθετεῖ τὰ ἐναντία; Οὐ γὰρ ἔξω τῆς κτίσεως τὰ χερουβίμ. Τί οῦν προστάττει χερουβίμ γλυπτὰ ἀνθρώπων χερσὶν τεκταινόμενα σκιάζειν τὸ ἱλαστήριον; ῎Η δῆλον, ὡς θεοῦ μὲν ὡς ἀπεριγράπτου καὶ ἀνεικάστου ποιεῖν εἰκόνα ἀμήχανον ἤ τινος ὡς θεοῦ, ἵνα μὴ ὡς θεὸς λατρευομένη προσκυνῆται ἡ κτίσις. Τῶν δὲ χερουβὶμ ὡς περιγραπτῶν καὶ τῷ θείω̣̣ θρόνω̣̣ δουλοπρεπῶς σκιάζουσαν τὸ ἱλαστήριον; Οὐ χειρότευκτα; Οὐκ ἔργα χειρῶ͂ν ἀνθρώπων; Οὐκ ἐξ ἀτίμου, ὡς σὺ φὴς, ὕλης κατεσκευασμένα; Τί δὲ ἡ σκηνὴ ἅπασα; Οὐχὶ εἰκὼν ἦν; Οὐ σκιὰ καὶ ὑπόδειγμα; Φησὶ τοιγαροῦν ὁ θεῖος ἀπόστολος περὶ τῶν κατὰ τὸν νόμον ἱερέων διεξιών· « Οἵτινες ὑποδείγματι καὶ σκιᾷ λατρεύουσι τῶν ἐπουρανίων, καθὼς κεχρημάτισται Μωσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν. ῞Ορα γάρ φησι, ποιήσεις πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει. » ̓Αλλ ̓ οὐδὲ εἰκὼν ἦν ὁ νόμος, ἀλλ ̓ εἰκόνος προσκίασμα· φησὶ γοῦν ὁ αὐτος ἀπόστολος· Εἰ οῦν ὁ νόμος εἰκόνας ἀπαγορεύει, αὐτὸς δὲ εἰκόνος ἐστὶ προχάραγμα, τί φήσομεν; Εἰ ἡ σκηνὴ σκιὰ καὶ τύπου τύπος, πῶς μὴ εἰκονογραφεῖν ὁ νόμος διακελεύεται; ̓Αλλ ̓ οὐκ ἔστιν οὕτω ταῦτα, οὐκ ἔστι· « καιρὸς » δὲ μᾶλλον « τῷ παντὶ πράγματι ».
̓Ιδοὺ δὴ ὕλη τιμία καὶ καθ ̓ ὑμᾶς ἄτιμος. Τί γὰρ τριχῶν αἰγείων εὐτελέστερον καὶ χρωμάτων; καὶ οὐ χρώματα τὸ κοκκίνον καὶ ἡ πορφύρα καὶ ἡ ὑάκινθος; ̓Ιδοὺ δὴ καὶ ὁμοίωμα χερουβίμ. Πῶς οὖν διὰ τὸν νόμον ἀπαγορεύειν φής, ὃ ποιεῖν ὁ νόμος προσέταξεν; Εἰ διὰ τὸν νόμον τὰς εἰκόνας ἀπαγορεύεις, ὥρα σοι καὶ σαββατίζειν καὶ περιτέμνεσθαι· ταῦτα γὰρ ἀπαχωρήτως ὁ νόμος κελεύει. (I, 16, 79-86.)
« Notandum sane hoc in loco quia sunt qui putant lege Dei prohibitum ne uel hominum, uel quorumlibet animalium siue rerum similitudines sculpamus aut depingamus in ecclesia uel alio quolibet loco eo quod in decalogo legis dixerit : Non facies tibi sculptile neque omnem similitudinem quae est in caelo desuper et quae in terra deorsum nec eorum quae sunt in aquis sub terra. Qui nequaquam hoc putarent, si uel Salomonis opus ad memoriam reuocassent quo et in templo intus palmas fecit et cherubim cum uariis celaturis et in columnis illius mala granata et rete in mari quoque hoc aeneo duodecim boues et scalpturas histriatas sed et in basibus luterum ut in sequentibus legitur leones cum bubus palmas axes et rotas cum cherubim et uario picturarum genere fecit, uel certe ipsius Moysi opera considerassent qui iubente domino et cherubim prius in propritiatorio et postea serpentem fecit aeneum in ligno quem aspicientes filii Israhel uiuerent, cur non licet exaltationem domini saluatoris in cruce qua mortem uicit ad memoriam fidelibus depingendo reduci uel etiam alia eius miracula et sanationes quibus de eodem mortis auctore mirabiliter triumphauit cum horum aspectus multum saepe compunctionis soleat praestare contuentibus et eis quoque qui litteras ignorant quasi uiuam dominicae historiae pandere lectionem ? » (Bedae venerabilis de templo liber II, Corpus christianorum, Series latina, Brepols, 1969, p. 212, l. 809-832.)
Roland Barthes, La Chambre claire. Note sur la photographie, 1980, §18, in O.C., Seuil, t. 3, p. 1137 et S. Lojkine, Les Trois temps de la représentation, I, 1, pp. 15-19.
« Nam et pictura Graece ζωγραφία, id est uiua scriptura, uocatur. Si licuit duodecim boues aeneos facere qui mare superpositum ferentes quattuor mundi plagas terni respicerent, quid prohibet duodecim apostolos pingere quomodo euntes docerent omnes gentes baptizantes eos in nomine patris et filii et spiritus sancti uiua ut ita dixerim prae oculis omnium designare scriptura ? Si eidem legi contrarium non fuit in eodem mari scalpturas histriatas in gyro decem cubitorum fieri, quomodo legi contrarium putabatur si historias sanctorum ac martyrum Christi sculpamus siue pingamus in tabulis qui per custodiam diuinae legis ad gloriam meruerunt aeternae retributionis attingere. » (De templo, II, p. 213, l. 832-843, suite de la citation précédente.)
Voir note 27 le texte du De tabernaculo que nous citions.
« Verum si diligentius uerba legis attendamus, forte parebit non interdictum imagines rerum aut animalium facere sed haec idolatriae gratia facere omnimodis esse prohibitum. Denique dicturus in monte sancto dominus, Non facies tibi sculptile neque omnem similitudinem, praemisit, Non habebis deos alienos coram me, ac deinde subiunxit, non facies tibi sculptile neque omnem similitudinem quae est in caelo desuper et quae in terra deorsum nec eorum quae sunt in aquis sub terra, atque ita conclusit, non adorabis ea neque coles. Quibus uerbis aperte declaratur quod illae similitudines fieri prohibentur ab hominibus quae in uenerationem deorum alienorum facere solent impii quaeque ad colendum atque adorandum gentilitas arrabunda repperit. Ceterum similiter haec fieri nulla ut reor legis diuinae littera uetuit, alioquin et dominibus temptantibus se Pharisaeis de tributo Caesari reddendo in quo nomen et imaginem Caesaris expressam esse dicebant nequaquam ita responderet, Reddite quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo, sed potius eorum corrigeret errorem dicens, Non licet uobis in percussura auri uestri imaginem facere Caesaris quia talem scalpturam lex diuina prohibet. Esset namque locus ut ostenso sibi numismate census hoc diceret, si in eo Caesaris imago causa idolatriae et non ad indicium magis regiae potestatis esset deformata. » (De templo, II, p. 213, l. 844-866, suite de la citation précédente.)
« Parmi nous en effet il y a images et images. Un fils est l’image de son père, homme comme lui. Mais ton image dans un miroir est bien loin de toi. Elle est autrement dans ton fils et autrement dans un miroir. Elle est en ton fils dans l’égalité d’une même nature ! Qu’elle est loin, dans un miroir, d’avoir ta nature et cependant c’est ton image, si différente qu’elle soit d ecelle que porte ton fils. L’image de Dieu dans la créature est aussi fort différente de ce qu’elle est dans son Fils, dans son Fils qui est son égal, le Verbe même de Dieu par qui tout a été fait. Reçois donc cette divine ressemblance que tu as perdue par tes crimes. L’image de l’Empereur n’est-elle pas aussi sur la monnaie autrement que dans son fils ? Il y a image de part et d’autre, mais elle est imprimée différemment sur la monnaie, différemment dans le fils ; il y a aussi sur un sou d’or une autre image de l’Empereur. Et toit, tu es la monnaie de Dieu ; mais tu l’emportes sur la monnaie proprement dite, parce que tu as l’intelligence et une sorte de vie, parce que tu peux connaître Celui dont tu portes l’image et à l’image de qui tu as été créé ; au lieu que ta monnaie ignore qu’elle est ornée de l’image de l’Empereur. » (Saint Augustin, Sermon ix sur les dix commandements, in œuvres complètes, tome VI, traduction française par l’abbé Raulx, Bar-le-duc, 1866, p. 45.) On notera de quelle façon oblique, dans ce sermon sur les dix commandements, l’interdit de l’image est abordé.
ἀπόμαγμα, σφραγίς, ἀντιβολὰ ( ?). Voir Marie-José Mondzain, op. cit., p. 126, citant Denys de Fourna.
Bernard Meehan, The Book of Kells, Thames and Hudson, Londres, 1994, 1997.
Cette croix se trouvait déjà dans l’iconographie romaine comme symbole des quatre coins du monde.
Jean-Claude Bonne, art. cit., pp. 229-230 et fig. 5, p. 246.
On peut tenter de pousser l’interprétation plus loin encore : les rectangles peuvent être identifiés au tabernacle, les croix au Christ, les coins aux régions du monde. D’autre part, la superposition du coin, du rectangle et de la croix imite le motif byzantin de la Croix de la victoire érigée sur un piédestal, que l’on pouvait voir notamment au revers des monnaies impériales.
Nous nous appuyons pour ce frontispice sur les analyses de Jean Wirth, op. cit., p. 48 et pp. 82-84.
Voir Carl Nordenfalk, L’Enluminure, Skira, 1988, p. 66 et Jean–Claude Bonne, art. cit., p. 233.
Voir la description des chérubins de la Vision du char de Yahvé au début du livre d’Ézéchiel (I, 5-10).
Tout est représenté et, pour cette raison, l’image n’obéit pas à un fonctionnement économique.
L’absence du recours économique à l’incarnation oblige à maintenir le voile, qui tombe au contraire dans la tradition byzantine.
Ce passage de la déchirure économique au « faire surface » des similitudes trouve encore un écho dans le dispositif de la scène romanesque classique. Voir S. Lojkine, « La déchirure et le “faire surface” », La Scène, dir. Marie-Thérèse Mathet, L’Harmattan, 2001, pp. 223-239.
« Et quattuor circulos aureos quos pones per quattuor archae angulos ; duo circuli sint in latere uno et duo in altero. Quattuor circuli aurei quattuor sunt euangeliorum libri qui merito aurei sunt propter claritatem sapientiae qua fulgent merito circulis comparati quia aeterna est ipsa Dei sapientia quam praedicant neque incipiens extempore neque esse desinens aeterna diuinitas quam homo Christus accepit. Unde imminente hora suae passionis precatur patrem dicens : Et nunc clarifica me tu pater apud temet ipsum claritate quam habui prius quam mundus esset [16] apud te. Quattuor autem angulos habet archa quia sacramentum dominicae incarnationis per omnes mundi plagas in quibus sancta ecclesia dilatatur celebrari non desinit. Et per eosdem angulos quattuor circuli sunt positi quia in cunctis mundi finibus euangelium Christi saluandis fidelium cordibus praedicatur. » (De Tabernaculo, op. cit., livre I, p. 15, l. 418-432.)
Διὰ τοῦτο προσέταξεν ὁ θεὸς γενέσθαι κιβωτὸν ἐκ ξύλων ἀσήπτων καὶ καταχρυσῶσαι ταύτην ἔσωθεν τε καὶ ἔξωθεν καὶ ἐνθεῖναι τὰς πλάκας, τὴν ῥάβδον, τὴν στάμνον τὴν χρυσῆν ἔχουσαν τὸ μάννα πρὸς ὑπόμνησιν τῶν γεγονότων καὶ προτὺπωσιν τῶν μελλόντων. Καὶ τίς οὐκ ἐρεῖ ταῦτας εἰκόνας διαπρυσίους τε κήρυκας; καὶ ταῦτα οὐκ ἐκ πλαγίων ἔκειτο τῆς σκηνῆς, ἀλλὰ κατενώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ, πρὸς ἃ βλέποντες τῷ δι ̓ αὐτῶν ἐνεργήσαντι θεῷ προσέφερον τὴν ποσκύνησιν καὶ τὴν λατρείαν. Δῆλον οὐχ ὡς αὐτοῖς λατρεύοντες, ἀλλὰ δι ̓ αὐτῶν εἰς ὑπόμνησιν τῶν θαυμάτων ἀγόμενοι καὶ τῷ τερατουργῷ θεῷ τὴν προσκύνησιν νέμοντες. Εἰκόνες γὰρ ἦσαν πρὸς ὑπόμνησιν κείμεναι, τιμώμεναι οὐχ ὡς θεοί, ἀλλ ̓ ὡς θείας ἐνεργείας ὑπομνησιν ἄγουσαι. (I, 17, 8.)
Il semble que le veau permette à Bède d’amalgamer en un symbolisme unique le bœuf, symbole de Luc, et l’agneau, symbole du Christ de la passion.
assumptio désigne ordinairement après la mort de la Vierge, son enlèvement dans les cieux. Il s’agit ici en fait du Christ, comme on le verra plus loin. Nous ne traduisons pas par assomption à cause du participe assumpta qui suit.
Matthieu, symbolisé par l’homme, figure l’incarnation ; Luc, symbolisé ici par le veau, lui-même identifié à l’agneau mystique, figure la passion.
Marc, symbolisé par le lion, figure la victoire sur la mort, donc la résurrection ; Jean, symbolisé par l’aigle, figure par son envol l’ascension. Jean est le dernier des quatre évangélistes et figure donc le dernier des événements de la vie du Christ.
« Duo autem circuli in latere uno et duo sunt in altero uel quia duo euangelistae discipulatui saluatoris in carne praedicantis et miracula facientis adhaerebant, duo autem alii post resurrectionem ascensionemque eius ad caelos ad fidem eius uenerunt, uel quia in figura quattuor animalium duo qui per hominem et uitulum designati sunt passionum et mortis eius indicia praetulerunt duo uero illi qui per leonem et aquilam praefigurati sunt uictoriae qua mortem destruxit insignia demonstrarunt. Homo quippe dominus per incarnationem mortalis factus apparuit, uitulus uero idem oblatus pro nobis in altari crucis extitit, idem leo mortem fortiter subigendo, aquila ad caelos ascendendo factus est. Atque ideo duo circuli in latere uno et duo sunt in altero quia nimirum duo euangelistae per suam figuram assumptionem in domino humanae fragilitatis et duo alii uictoriam qua de eadem assumpta fragilitate ac morte triumphauit insinuant. Nam quasi laeuum latus archae duos habuit circulos cum euangelistae duo incarnationem domini ac passionem figurarent, similiter lateri dextero duo inerant circuli quod aeque duo euangelistae resurrectionem atque ascensionem eius quae ad futurae gloriam uitae pertinent figuraliter exprimunt. » (De tabernaculo, op. cit., l. I, p. 16, l. 432-452, suite de la citation précédente.)
Dans la version de la Vulgate d’après les Hébreux (et non dans celle d’après la Septante, qui donne directionis au lieu d’æquitatis).
« Ponesque in archa testificationem quam dabo tibi?, quia illa solummodo de incarnato Dei filio loqui et credere debemus quae nobis ipse dominus per auctores sacrae scripturae [17] reuelare dignatus est. Si autem uis scire quae sit illa testificatio quam in archa ponendam a domino Moyses accepit, apostolum audi : Post uelamentum autem, inquit, secundum tabernaculum quod dicitur sancta sanctorum aureum habens turibulum et archam testamenti circumtectam ex omni parte auro in qua urna aurea habens manna et uirga Aaron quae fronduerat et tabulae testamenti. Vrna ergo aurea in archa habens manna anima est sancta in Christo habens in se omnem plenitudinem diuinitatis. Virga Aaron quae excisa fronduerat potestas est inuicta sacerdotii illius de qua dicit propheta : Virga aequitatis uirga regni tui. » (De tabernaculo, op. cit., l. I, p. 16, l. 453-476, suite de la citation précédente.)
Voir Jean Wirth, op. cit., pp. 183-186 et pp. 382-394.
« Tabernaculum ergo quod Moysi in monte monstratum est superna est illa ciuitas et patria caelestis quae illo quidem tempore ex solis extitisse creditur angelis sanctis post passionem uero resurrectionem et ascensionem in caelos mediatoris Dei et hominum et multitudinem praeclaram et copiosam sanctarum recipit animarum. » (De tabernaculo, op. cit., p. 12.)
Dans la Bible de Jérusalem : « Je suis noire et pourtant belle, filles de Jérusalem,/comme les tentes de Qédar, /comme les pavillons de Salma »?. Qédar et Salma seraient deux tribus d’Arabes nomades.
« Nigra sum sed formosa sicut tabernacula Cedar sicut pelles Salomonis, ita distinguitur ut nigra sit sicut tabernacula Cedar formosa sicut pelles Salomonis. Ita est enim saepius obscurata afflictionibus infidelium sancta ecclesia quasi generalis mundi totius esset inimica impleto verbo quod ait ei dominus : Et eritis odio omnibus propter nomen meum, ita semper in conspectu est sui redemptoris decora quasi uere digna sit quam ipse rex pacis inuisere dignetur. Et notandum quod Cedar ipso iam nomine quod tenebras sonat uel peruersos homines uel immundos spiritus insinuat sicut Salomon quoque qui interpretatur pacificus etiam mysterio nominis ipsum indicat de quo scriptum est : Multiplicabitur eius imperium, et pacis non erit finis super solium Dauid et super regnum eius. Et cum dicitur nigra esse ecclesia sicut tabernacula Cedar sicut non pro ueritate sed pro aestimatione insipientium ponitur qui eam putant mansionem in se uitiis uel malignis spiritibus praebere, cum uero formosa sicut pelles Salomonis appellatur sicut pro ueritate exempli ponitur quia sicut Salomon tentoria sibi de mortuorum pellibus animalium solebat facere ita dominus ecclesiam sibi de illis congregat animabus quae desideriis nouerant renuntiare carnalibus. » (In Cantica Canticorum libri VI ; liber I, Sinagoga dominum uenire in carne desiderat ac uenienti deuota caritate occurrit, i, 4 ; Corpus Christianorum, Series latina, cxixb, Bedae opera, pars ii, 2b, Turnholti, Brepols, 1983, p. 196, lignes 227-246 .)
Le commentaire de Bède suit de très près celui de Grégoire le Grand sur le même verset. Voir Sancti Gregorii expositiones in Canticum Canticorum, I, 4, §32, Corpus Christianorum, Series latina, t. 144, recensuit Patricius Verbraken O.S.B., Turnholti, Brepols, 1963, pp. 32-33.
Voir Jean Wirth, op. cit., p. 91. Jean Wirth souligne la représentation littérale de siéger dans cette image ; l’identification à la Pentecôte est une hypothèse que nous proposons.
Actes des apôtres, ii, 1-4.
Dictionnaire encyclopédique du judaïsme, dir. Geoffrey Wigoder, Bouquins, Cerf/Laffont, 1996, article Chavouot.
La Vierge apparaît dans la Pentecôte de Duccio (début du quatorzième siècle, Sienne, Musée de l’œuvre de la Cathédrale).
Ces colonnes, dont Bernard de Clairvaux explique dans le développement que nous coupons qu’elles symbolisent la Trinité et les quatre vertus cardinales, font peut-être écho à la colonne de nuée du discours de la Sagesse (Si. xxiv, 5-14), où apparaît justement le tabernacle (requievit in tabernaculo meo).
I. Sapientia aedificavit sibi domum etc. (Pr. ix, 1). Cum multis modis sapientia intelligatur, quaerendum est, quae sapientia aedificavit sibi domum. Dicitur enim sapientia carnis, quae inimica est Dei (Rm. viii, 7), et sapientia huius mundi, quae stultitia est apud Deum (1Cor. iii, 19) ; utraque ista secundum Jacobum apostolum (Jc. iii, 15) terrena est, animalis, diabolica… Nulla talis sapientia, sive carnis, sive mundi, ædificat, immo destruit quamcumque domum inhabitat. Est ergo alia sapientia, quae desursum est, primum quidem pudica, deinde pacifica ; ipsa est Christus Dei virtus et Dei sapientia, de quo Apostolus : Qui factus est inquit nobis sapientia a Deo et justitia et sanctificatio et redemptio (1Cor. i, 30).
II. Hæc itaque Sapientia, quae Dei erat et Deus erat, de sinu Patris ad nos veniens aedificavit sibi domum, ipsam scilicet matrem suam virginem Mariam, in qua septem columnas excidit. […]
IV. […] Nos quoque si eiusdem Sapientiae fieri domus volumus, necesse est, ut eisdem septem columnis extruamur, id est, ut fide et moribus ei præparamur. » (Sermones de diversis, Sermon 52, in Saint Bernard et Notre Dame, texte latin et trad. de l’intégrale des œuvres mariales de saint Bernard, Paris-Montréal, 1985, 423p.)
Voir Jean Wirth, op. cit., p. 433.
Par exemple dans la mosaïque de l’abside de Sainte-Marie-du-Trastevere (1140). Voir Jean Wirth, op. cit., p. 434.
Voir Jean Wirth, op. cit., p. 100 et p. 326.
Jean Algrin, Alegrin ou Halegrin, archevêque de Besançon, fut élevé à la dignité de cardinal en 1227 et envoyé par le pape comme légat en Espagne (Claude Fleury, Histoire ecclésiastique, éd. 1770, t. 16, 79, 59). Sur l’identification de Marie au tabernacle, voir Giovanni Pozzi, « Maria Tabernacolo », Italia medioevale e umanistica, XXXII (1989), p. 287. Voir également H. Damisch, Un souvenir d’enfance par Piero della Francesca, Seuil, Librairie du XXe siècle, sept 1997, pp. 97-98 et Giovanni Pozzi, La Parola dipinta, Milano, Adelphi Ed., 1981.
« sicut pelles arcam typicam continuerunt, sic ego intra mea viscera veram arcam continui, Christum videlicet, cuius caro significatur per arcam » (In Canticum Canticorum, Patrologie latine, 206, 84).
« Caput septimum. Quid videbis in Sunamite : nisi choros castrorum. / [titre marginal :] Tabernaculum triplex. / Tria sunt tabernacula. Materiale, mysticum, & morale, scilicet. Tabernaculum Mosi. Tabernaculum Christi. Tabernaculum cuiuslibet iusti. / Tabernaculum Mosi fuit ex diversis ornamentis conveniens structura. / Tabernaculum Christi, Ecclesia est. / Tabernaculum iusti, quaelibet fidelis anima. / Unde fit ex lignis sethim imputribilibus. Aliud ex sanctis infatigabilibus. Tertium ex virtutibus / Moses suum erexit in eremo : Christus in mundo / Iustus in animo. Posuit Moses in tabernaculo suo arcam. Christus in suo carnem propriam. Iustus conscientiam. Arca Mosi deauratur auro purissimo intus & exterius. Caro Christi deauratur intus divinitate : exterius miraculorum claritate. Conscientia iusti interius splendet splendore puritatis : exterius vero operibus charitatis. In tabernaculo igitur Christi, quod est Ecclesia, habent locum chori laudantes deum ad excitandam devotionem : & dandam gratiarum actionem. Quo[modo] aut[em] laudare debeant deum : docet Apostolus. … CAR. » (Cantica canticorum cum duobus Co[m]mentariis plane egregiis, altero venerabilis patris. F. Thomæ Cistertien[sis]. Monachi : altero lõge reuerendi Cardinalis M. Io[h]anis Halgrini ab Abbatisvilla. Vênundantur Iodoco Badio Ascensio. Anno ad calculum Romanum M. D. XXI. Le texte est signé tantôt CAR. (le cardinal Algrin) tantôt THO. (le père Thomas). Liber. X. Fo CXLII. La ponctuation est omise lorsqu’elle correspond à un changement de ligne, que nous notons alors par une barre oblique.)
Liber iiii / De sanctificatione marie / Titulus xxviii / De sanctificatione beate virginis dicit ps[almista]. Sanctificavit tabernaculum suum altissimus. / Tabernaculum idem quod civitas illa id est beata virgo in quam altissimus armavit se armis n[ost]re mortalitatis. / Hoc tabernaculum sanctificavit altissimus. q[uo]n[iam] eam in utero matris purgavit ab originali ut tota munda nasceret. (Opus insigne de laudibus beate marie virginis. alias Mariale appellatu[m], éd. 1493, Strasbourg, Martin Flach, in folio, lettres gothiques, Cote Bnf Rés. D-2052. Fo. lxxxvi v°.)
La prophétie d’Isaïe annonce la colère de Dieu, car le pays, en s’enrichissant, s’est corrompu et rempli d’idoles : et repleta est terra eius idolis, opus manuum suarum adoraverunt (Is. ii, 8).
« Tabernaculum, de quo dicitur Christo a Psal. Domine quis habitabit in tabernaculo tuo, id est, in beata Virgine ? Quasi diceret : Nullus nisi tu solus. Propter quod dicitur. Ezech. 44. Princeps ipse sedebit in ea. Princeps ipse quasi non alius. Item tabernaculum corpus christi. Sed quis ibi habitabit per dignam passionis imitationem ? Quasi diceret : Rarus aut nullus. Tamen ad hanc habitationem inuitat ipse. Cantic. 2. sponsam tuam, id est, fidelem animam dicens : Veni columba mea in foraminibus perræ, in caverna maceriæ. Item Isa.2. Ingredere in petram, abscondere in fossa humo. Habet Christus multiplex tabernaculum. Unde dicitur ei : Quam dilecta tabernacula tua [276] Domine virtutum, &c. Primum et dignius corpus quod sumpsit de Virgine. Secundum ipsum corpus Virginis. Tertium, Ecclesia militans. Quartum, Ecclesia triumphans. Quintum, Corpus justi. Sextum, religio quælibet ordinata. Et de singulis prosequemur. » (Beati Alberti Magni Ratisbonensis episcopi, ordinis praædicatorum, Super Missus. Quaest. CCXXX. De laudibus B. Mariæ, Lib. XII. Biblia Mariana. Omnia recognita per R.A.P.F. Petrum Iammy, sacræ Theologiæ Doctorem, Conuentus Gratianopolitani, eiusdem Ordinis, nunc primum in lucem prodeunt. Operum Tomus Vigesimus. Lugduni, Sumptibus Claudii Prost. Petri & Claudii Rigaud, Frat. Hieronymi Delagarde. Ioan. Ant. Huguetan. Via Mercatoria. M.DC.LI. Cum privilegio regis. In folio. Cote Bibliothèque ENS. Sfsc820 F°, p. 275.)
Albert le Grand identifie à nouveau plus bas, dans le même développement donc, le soleil au Christ (Mt. xvii, 2). C’est dire le flottement…
Job fait son apologie. Alors qu’il n’a succombé à aucune tentation, pas même à la lumière du soleil, Dieu l’a plongé dans le malheur.
Propos désabusés de l’Ecclésiaste sur l’inéluctabilité du cours des choses.
En fait ce n’est pas Dieu, mais la voie de la connaissance (via disciplinae) qui est apparue sur terre, avec la révélation de la Loi au peuple juif. Le texte de la Vulgate, qui porte visus est au masculin, permet de voir dans ce verset une préfiguration de l’incarnation.
Albert le grand modifie le texte de la Vulgate, nec est qui se abscondat a calore eius, pour faire apparaître dans le psaume l’image de la Vierge de l’Annonciation.
« De primo dicit Psal. 18. In sole posuit tabernaculum suum, &c. Et hoc multipliciter exponitur, secundum quod multæ sunt proprietates solis : sol enim tempora distinguit, figurat bonam operationem. Iob. 31. Si vidi solem cum fulgeret. Habet in se manifestationem : quia ipse oculus mundi. Habet etiam claritatem, habet mutabilitatem, qui oritur sol & occidit. Ecclæ. 1. Feruorem & exustionem. Unde per diem sol non uret te. Habet agilitatem, luciditatem, & incorruptibilitatem. Secundum omnes istos modos posuit Christus in sole tabernaculum suum, id est in Virgine clara ut sol, quando de ea naturam assumpsit humanam, & virtutem verbi Dei susceptiuam simul & generatiuam eidem indulsit, sicut dicit Damascenus. Id est, in manifestatione, quando habitu inuentus est ut homo. Phil. 2. Bar. 3. Post hæc in terris visus est, &c. Id est in tempore, quando æternus factus est temporalis, non relinquens quod erat, sed assumens quod prius non habebat, scilicet carnem. Id est, in mutabilitate : quia esuriit. Matth. 4. fatigatus est. Ioan. 4. sitiit. Ioan. 9. dormiuit, &c. Id est, in exercitatione : quia exercitauit se multipliciter in bona operatione, prædicans & sanans infirmos de die, & orans de nocte. Id est, in agilitate, quando super mare ambulauit. Id est in luciditate, quando transfiguratus est et resplenduit facies eius vt sol. Matth. 17. Id est, in passionis exustione & feruore, quando sol in meridiano existens exurebat terram. Eccli. 43. Id est, corpus proprium & ipsos Apostolos. Quære 10. prærogatiua Mariæ expositionem. Id est, in incorruptibilitate, quando resurgens ex mortuis iam non moritur. Id est in æterna claritate, quando in ascensione eleuatus est sol in cœlum. Et nota quod hic in tribus versiculis notantur multa circa Christum. Primum est incarnatio. Vnde, In sole posuit tabernaculum suum. Secundum. natiuitas ex vtero. Vnde, Et ipse tanquam sponsus procedens de thalamo suo. Tertium, humilitas passionis. Vnde, Exultavit vt gigas ad currendam viam. Quartum, æterna eius genitura. Vnde, A summo cœlo egressio eius. Quintum, ascensio. Vnde, Et occursus eius. Sextum æqualitas Patris et Filii. Vnde, Usque ad summum eius. Septimum, Missio Spiritus sancti. Vnde. Haec est quae se abscondat a calore eius. » (Albert le Grand, op. cit., p. 276, suite de la citation précédente.)
C’est en fait le discours de la Sagesse.
Nous n’avons pas pu identifier ces deux prétendues références à Job.
« Secundum tabernaculum uterus virginalis, qui propriissime tabernaculum dicitur sicut ipsamet dicit : Qui creauit me requieuit in tabernaculo meo. Quære expositionem paulo supra ubi ipsa dicitur requies : et de hoc tabernaculo dictum est Isa. 33. Hoc est tabernaculum quod nunquam poterit transferri, scilicet ad alios usus quam ipsius Filij Dei. Et nota, quod tabernaculum proprie est militantium & peregrinantium : sicut enim miles pugnaturus armatur in tabernaculo, scilicet ut armatus exeat ad conflictum, sic Christus cum diabolo pugnaturus [2e col.] pro sponsa sua exhæreditata, scilicet Ecclesia, in vteri beatæ Virginis velut in tabernaculo armaturam humanæ carnis sibi adaptauit, sicut ipsum ex parte generis humani rogauerat Psal. dicens : Apprehende arma & scutum, & exurge in adiutorium mihi, & armatus ingrediens cum diabolo in passione dimicauit, & percussit eum manu cruci affixa, quia ibi abscondita est fortitudo eius. Abac. 3. Vnde Iob 26. Prudentia eius percussit superbum & excussit prædam quam diabolus deuorauerat, sicut canitur in tempore paschali. Et hoc est quod dicit Iob in persona Christi 39. Conterebam molas iniqui, & de dentibus illius auferebam prædam. » (Albert le Grand, op. cit., p. 276, suite de la citation précédente.)
« Sed contra est quod ea quæ fuerunt in veteri Testamento, sunt figura Novi : secundum illud I Cor. 10, 11 : Omnia in figura contingebant illis. Per sanctificationem autem tabernaculi, de qua dicitur in Ps. 45, 5, Sanctificavit tabernaculum suum Altissimus, videtur significari sanctificatio Matris Dei, quæ tabernaculum Dei dicitur Ex. 40, 31-32 : Postquam cuncta perfecta sunt, operuit nubes tabernaculum Testimonii, et gloria Domini implevit illud. Ergo et Beata Virgo non fuit sanctificata nisi postquam cuncta eius perfecta sunt, scilicet corpus et anima. »
Si l’influence byzantine est généralement soulignée dans les descriptions des Maestà italiennes peintes, il ne faut pas oublier parallèlement, dans le domaine de la sculpture, l’essor des Vierges de Majesté françaises à partir de l’Auvergne : la Vierge de Majesté de Notre-Dame-du-Port de Clermont-Ferrand date du début du douzième siècle. Mais la plus célèbre, à partir de laquelle s’est développé ce culte roman spécifique, est la Majesté de sainte Foy de Conques. La sainte contient sa propre relique et fonctionne bien comme un tabernacle. Comme lui elle est mobile, ce qui permet les processions. Voir Sophie Cassagnes-Brouquet, Vierges noires, éd. du Rouergue, 2000, pp. 74-79.
Voir Monica Chiellini, Cimabue, Scala, 1988, trad. française Laura Meijer, p. 49.
Creavit.Dominus.novum super.terramfEmin a.circumdabit viro. Jérémie annonce la reprise des relations d’amour entre Israël et son époux Yahvé. Israël sera successivement identifié, dans la lecture allégorique, à la communauté des chrétiens, puis à l’Église qui symbolise cette communauté, puis à la Vierge qui figure l’Église. (Nous indiquons toujours en italiques l’écart entre notre traduction d’après la Vulgate, que reproduit Cimabue, et le texte français de la Bible de Jérusalem).
Insemi ne.tuo.b enedic entur.o mnesg ente s. La Vulgate porte : et benedicentur in semine tuo omnes gentes terræ. Ces paroles concluent la bénédiction de l’ange à Abraham après le sacrifice d’Isaac. Une lecture anagogique du verset identifiera in semine tuo à la semence de Dieu dans le ventre de Marie.
De fruct u.ventri s.tui.pon am.super.sedem tuam (Le dernier mot en fait n’est plus lisible. Dans la Vulgate, c’est le psaume 131). Ce psaume messianique célèbre l’anniversaire de la translation de l’arche de Qiryat-Yéarim à Jérusalem, sous le règne de David (1S. vi ; la scène a été peinte par le Tintoret vers 1544 et se trouve au Kunsthistorisches Museum de Vienne). Yahvé a promis à David que le Messie serait son descendant. Mais le ventre de David dont parle le psaume peut être lu aussi bien comme le ventre de Marie, que les deux généalogies des Évangiles font descendre de David.
Ecce vIrgo.cOnc ipietet.pariet filium. Le dernier mot disparaît sous les doigts du prophète.
Jean Wirth, op. cit., pp. 423-442.
Voir P. Perdrizet, La Vierge de miséricorde, étude d’un thème iconographique, Paris, 1908.
Sirarpie Der Nersessian, op. cit., p. 145.
Voir également, dans le Psautier de Westminster, le manteau du roi recevant l’hommage d’un chevalier (Londres, British Library, ms. royal 2AXXII, folio 219v°, vers 1240 ; François Avril, L’Enluminure à l’époque gothique, « Bibliothèque de l’Image », 1995, p. 30).
La couleur dominante est le rouge et non le blanc : « Quant à la demeure, tu la feras de dix bandes d’étoffe de fin lin retors, de pourpre violette et écarlate et de cramoisi. Tu les feras brodées de chérubins » (Ex. xxvi, 1.) ; « Tu feras des bandes d’étoffes en poil de chèvre pour former une tente au-dessus de la Demeure. Tu en feras onze » (xxvi, 7) ; « Tu feras pour la tente une couverture en peaux de béliers teintes en rouge, et une couverture en cuir fin, par-dessus » (xxvi, 14).
En dehors des Vierges de Miséricorde, le manteau-tente marial apparaît également autour des Vierges noires, que l’on habille à partir du quinzième siècle d’un ample vêtement qui les recouvre complètement, tête comprise. Dans ce vêtement sont pratiquées deux petites ouvertures, pour le visage de la Vierge et pour la tête de Jésus. La fonction du manteau tabernacle, écrin délimitant un espace sacré autour de la Vierge, cesse d’être comprise au dix-septième siècle ; les Majestés sont alors sculptées d’emblée avec leur manteau, ce qui donne naissance au type de l’idole-cloche, comme par exemple la Vierge Noire en manteau du Puy-en-Velay (monastère Sainte-Claire, Haute Loire), qui date de la fin du dix-huitième siècle. Voir Sophie Cassagnes-Brouquet, op. cit., pp. 119-122 et p. 166.
Marie-José Mondzain, op. cit., p. 121.
Voir par exemple l’Annonciation du Maître au brocart d’or, de la fin du quinzième siècle, Museu Nacional de Arte Antiga, Lisbonne. La Vierge est encore inscrite dans une tente tabernacle, mais l’ange Gabriel lui apporte sur un philactère le Salut de l’Annonciation. La tente s’identifie désormais au ciel de lit de la chambre mariale.
Bernardino de’Busti, théologien de la deuxième moitié du quinzième siècle, prend l’habit des Frères mineurs au couvent de Legnano.
La Vulgate propose deux versions des Psaumes, Liber Psalmorum juxta Septuaginta emendatus et Liber Psalmorum juxta hebraicum translatus. C’est dans le texte le moins fidèle à l’original hébraïque qu’apparaît le tabernacle : sanctificavit tabernaculum suum Altissimus.
Bernardino de’Busti prend donc parti pour l’immaculée conception comme Albert le Grand.
« Mariale, Sermo V de nominatione Mariæ
.L. […] Quarta figura habetur Exodi. 25°. De archa veteris testamentis que erat de lignis setim imputribilibus. Per hanc autem archam figurabatur virgo maria in qua non fuerunt recondite tabule legis : sed ipse legis dator deus. Per quam archam quattuor inter alia habemus beneficia. […] De hac Archa inquit Ambrosius in quodam sermone. Archa intrinsecus portabat testamenti tabulas. Maria autem testamenti gestabat heredem. Illa intus forisque auri nitore radiabat. sed sancta Maria intus forisque virginitatis splendore fulgebat. illa serreno ornabatur auro. ista celesti. hec Ambrosius. Nos autem addere possumus : illa de lignis imputribilibus facta est. Ista ab omni peccatorum putredine preservata immaculata concepta est. […]
.S. Non solum autem beata virgo dicitur atrium et habitatio sive domus dei sed etiam appellatur tabernaculum spiritus sancti omni sanctitate repletum de quo psalmo 45° inquit david sanctificavit tabernaculum suum altissimus. tabernaculum .n. dicitur domus deo dedicata .c°. primo et ibi archi. de sen. et re indi. et propter hoc : ecclesia dicitur tabernaculum christi .c°. ne forsitan. de peni. di. prima et ideo multo magis sic debet nominari beata virgo : Quae etiam nominatur thalamus christi. » (Le père Bernardino de Busti, Mariale de excellentiis Regine celi, Mediolani, per Leonardum Pachel, in-4°, 1493. Le livre n’est ni paginé, ni folioté. Des lettres dans le corps même du texte servent de repères, auxquels renvoie la table alphabétique au début de l’ouvrage. Cote Bnf Rés. D-6718. Tabernaculum spiritus sancti est beata virgo. tertia pars in sermone 5° pars 5a.S.)
Jaime ou Jacobus ou Jacques Perez de Valence (en Espagne), 1408( ?)-1490, ermite de Saint-Augustin, vicaire général de l’ordre en 1461, évêque de Christopolis en 1492 (Fleury : Chrysople ; 24, 117, 38).
Maria dicitur tabernaculum dei. (Titre dans la table au début d el’ouvrage.)
Expositio psalmi xlv, Deus noster refugium, fo. lxxvi, c.i. (Titre dans le corps du texte. Les alinéas ne sont pas dans le texte.)
Comme Bernardino de’Busti, Jaime Pérez suit la version d’après la Septante. Voir note 110. La succession linéaire des versets devient étagement allégorique comme chez Albert le Grand.
L’emploi de ratio dans ce texte, que nous traduisons vaille que vaille par médiation, pourrait bien renvoyer à l’économie des Pères byzantins.
« Ad cuius intelligentiam est secundo advertendum quod tota ecclesia cantat et attribuit istos duos versiculos virgini marie propter quatuor mysteria ibi notata et memorata que proprie soli virgini Marie conveniunt.
Primum est quod dicit propheta fluminis impetus letificat civitatem dei. Secundo quod sanctificavit tabernaculum suum altissimus. Tertium quod deus in medio eius non commovebitur. Quartum quod adjuvabit eam deus mane diluculo. Que quidem quatuor mysteria licet dicantur de tota ecclesia : tamen primo et principaliter et proprie verificantur ratione virginis marie que fuit prima civis huius civitatis : et primum membrum ecclesie secundum Augustinus in primo sermone de nativitate virginis marie sicut illud canticorum iiii Tota pulchra es amica mea : et macula non est in te dicitur de tota ecclesia sponsa christi ratione virginis marie : quod de sola ipsa verificatur. que sola fuit sine macula. Ita pariter ista quatuor verificantur de tota ecclesia r[ati]one virginis marie que fuit aurora et primum membrum ecclesie. » (Jacobi Perez de Valentia […] Expositio tam lucida quam castigata in cantica novi veterisque testamenti : simul cum cantico sanctorum Augustini & Ambrosii : Te deum laudamus. Parisiis. Apud Franciscum Regnault. In vico sancti Jacobi. Ad signum [l’enseigne] Elephantis. [Ajouté à la main :] anno 1533. Maria dicitur tabernaculum dei. fo. lxxvi. co.i.)
L’Incarnation du Verbe dans la Chair du Christ accomplit l’habitation de Dieu dans la cité de Dieu : le passage de l’esprit à la chair suppose l’installation dans un espace et la matérialisation de cet espace. Jaime Perez suit ici le raisonnement « économique ».
« Secunda conclusio quod altissimus filius dei non solum letificavit et irrigavit animam virginis copiosissimo flumine gratiarum ut in ea habitaret per gratiam, sed etiam sanctificavit totum ejus corpus et animam, ut in ea habitaret per carnem et ex ea carnem assumeret, quod patet per hoc quod subdit sanctificavit tabernaculum suum altissimus.
Unde est notandum sicut dictum est in prologo tractatus iiii quod tabernaculum dei est quadruplex, scilicet tabernaculum personale et maternale et mysticale et ministeriale. » (Jaime Perez de Valence, Expositio…, fo. Lxxxvi. Suite du texte notes 120 et 122.)
C’est la scène de Jésus chassant les marchands du temple, où les trois jours peuvent signifier symboliquement la résurrection. Le texte porte en fait solvite templum hoc et in tribus diebus excitabo illud, détruisez ce temple et en trois jours je le remettrai d’applomb.
« A Nam tabernaculum, sive templum Domini primo figurabat humanitatem Christi. Et ideo primo de illa verificatur. Et ideo Christus corpus suum templum appellat. Io.é. quando dixit : solvi templum hoc & in triduo reædificabo illud. […]
B Ideo totum illud templum per Salomonem fabricatum vere fuit figura Christi secundum partes suas. Nam in illo templo erant tria, quia in medio erant sancta sanctorum, per quod figurabant divinitas quae in Christo latebat, secundo erat in illo templo atrium sacerdotum, per quod figurabatur anima Christi : tertio erat ibi atrium populi per quod figurabatur caro Christi. Et sic totum illud templum recte figurabat personam Christi. […] Hoc idem est dicendum de tabernaculo quod fabricavit Moyses. » (D. Jacobi Parem de Valentia Christopolani Episcopi, doctissimae et plane divinae explanationes in centum & quinquaginta Psalmos Davidicos. In Cantica officiali, seu serialia, & Evangelica, quae in Ecclesiasticis officiis decantatur. In Canticum Sanctorum Ambrosii, & Augustini… Venetiis, apud Floravantem à Prato. MDLXXXVI. Cote Bnf Impr. A 5259, Prologi in Psalterium. Tractatus IIII. p. 53.)
Salomon était censé être l’auteur du Cantique des Cantiques
« B Per illa autem duo cherubin in quibus sedebat arca domini, praevidit [Salomon] qualiter Christus debebat esse medius inter duo testamenta, & sedere super ea. Per hoc autem, quod illa arca fuit resposita intra tabernaculum praevidit Salomon qualiter Christus verus Deus, & homo erat reponendus in utero virginis Mariae, & ex consequenti totam ecclesiam, in qua habitat Christus. Sed iterum est advertendum quod sicut illa arca figurabat humanitatem Christi, ita tabernaculum figurabat virginem Mariam, & ecclesiam. In quo tabernaculo Salomon consideravit septem mysteria… » (Jaime Perez de Valence, Explanationes…, Expositio in Canticum. II. p. 1338.)
Le tabernacle marial dont le Christ a tiré sa chair est une métonymie du Christ. L’arche, qui contient matériellement la Loi comme le Christ la contient spirituellement est une métaphore du Christ.
Allusion aux fiançailles de l’Époux avec l’Épouse, sujet du Cantique des Cantiques. Ces fiançailles sont interprétées entre autres, dans l’exégèse médiévale, comme celles du Christ avec l’Église, qui est alors comprise comme un tabernaculum sponsale.
obumbrare, écho des méditations byzantines sur l’Incarnation, qui établit un pont entre le monde spirituel, tout de lumière, et le monde matériel, tout d’ombre. L’icône, ou autrement dit le corps du Christ, se situe à l’interface de l’ombre et de la lumière, de la réalité visible et de la spiritualité de l’invisible. (Jean Damascène.)
« Per ornatum autem tabernaculi ex varietate cortinarum, & florum prævidit Salomon ornamenta diversarum virtutum quibus Christus ornavit matrem suam, de qua debebat carnem assumere, & in qua non solum tanquam in tabernaculo sponsali, sed etiam tanquam in tabernaculo materno debebat specialiter humanari, quia virgo Maria prius fuit sponsa quam mater Christi, q[ui]a prius concepit Christum mente par gratiam, quam carne, ut inquit Augustinus in libro de sancta virginitate. Item per hoc quod illa arca foederis fuit posita in illo materiali tabernaculo ve. le. praevidit Salomon qualiter Christus Deus, & homo debebat reponi, & per novem menses carnaliter portari in utero virginali ipsius beatae Mariae matris suae. Item per hoc, quod Deus sedens in arca foederis super cherubin, & intra tabernaculum, & de tabernaculo loquebatur Moysi, & per Moysen toti populo praevidit Salomon qualiter verbum divinum existens in arca humanitatis, & intra uterum virginis debebat sanctificare Ioannem Baptistam in ventre matris suae, & idem Christus existens in utero matris fecit eam evangelizare, quando dixit : Magnificat anima mea dominum &c. quia filius loquebatur per os matris, sicut ante fuerat locutus per ora prophetarum. Item, per hoc quod illa nubes protegebat illud tabernaculum, & dirigebat, & ducebat totum exercitum, & pluebat iugiter illud manna ad cibum, & refectionem illius populi, praevidit Salomon qualiter spiritus sanctus debebat obumbrare virginem Mariam in sua annunciatione, & qualiter virgo Maria debebat recipere verbum divinum missum a patre tanquam panem vinum, & mana absconditum ad vitam, & salutem, & refectionem omnium fidelium.
D Et etiam patet qualiter illud tabernaculum Moysi non solum praefigurabat tabernaculum Christi maternum, quae fuit virgo Maria : sed etiam tabernaculum mysticum, quae est tota ecclesia. » (Jaime Perez de Valence, Explanationes…,, p. 1341, A.)
Pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité, et pro eis ego sanctifico me ipsum ut sint et ipsi sanctificati in veritate, Jean, 17, 19. Dans cette prière de Jésus qui suit la Cène et précède son arrestation, il n’est pas question explicitement du baptême. Noter le glissement de pro eis, qui désigne le Christ comme médiateur et renvoie à l’économie de l’Incarnation, à in eis, qui désigne le Christ comme lieu, comme espace pour ainsi dire architectural de l’Église.
« Tabernaculum personale est ipsa humanitas christi in qua verbum dei habitat personaliter in unitate suppositi. Et hoc tabernaculum sanctificavit altissimus in ipso instanti incarnationis quia implevit eum spiritu sapientiae et intellectus. Secundum tabernaculum scilicet maternale fuit ipsa virgo maria de qua carnem christus assumpsit et in qua per novem menses secundum carnem habitavit, in cuius anima jam a primo instanti creationis habitaverat per gratiam.
Tertium tabernaculum scilicet mysticale est tota ecclesia et religio christiana : in qua deus habitat per fidem quam deus christus per baptismum sanctificavit in se ipso : ut ipse ait Jo xvii ego sanctificabo meipsum in eis.
Quartum tabernaculum est templum ministeriale et quelibet ecclesia ad cultum dei et ministerium ecclesiasticorum sacramentorum dedicata. Iste enim ecclesie sanctificantur et consecrantur per episcopos. Et sic est dicendum quod tabernaculum et civitas dei prius d[icuntur] de humanitate christi. Secundo de virgine maria. Tertio de tota ecclesia fidelium. Ultimo de qualibet ecclesia materiali. » (Jaime Perez de Valence, Expositio…, suite de la note 126.)
Le chapitre 9 ne dit rien de tel. Il décrit le tabernacle du Temple, qui symbolise la première alliance et la pratique religieuse de l’Ancien Testament. Celle-ci est alors opposée à l’alliance du Christ : métaphoriquement, le Christ a traversé le « premier » tabernacle, il a fait tomber pour les chrétiens cet obstacle entre le Saint et le Saint des Saints. Ils ont désormais, par la grâce, directement accès à Dieu.
« Unde recte per tabernaculum Altissimi intelligitur virgo Maria quantum ad corpus et animam. Nam sicut illa arca testamenti in qua erant tabule legis et virga aaron et urna mãne figurabat humanitatem christi. ut inquit apostolus ad Hebraeos nono quod humanitas christi est arca divinitatis. Ita pariter tabernaculum moysi figurabat virginem mariam. Nam sicut arca testamenti fuit reposita in tabernaculo illo ut patet Exo xl ita pariter totus christus fuit repositus et requievit in utero virginali tanquam in tabernaculo materiali. » (Jaime Perez de Valence, Expositio…, suite de la note 128.)
Titien n’installe pas de rideau derrière la Vierge, mais la couvre d’un voile blanc qui remplit la même fonction. Nous avions vu, dans les Miséricordes, comment le vêtement pouvait tenir lieu, métonymiquement, de tabernacle.
Le lion fait tache dans cette composition flamboyante, de la même manière que le porc des visions d’Antoine placé au centre, au bas du Retable Giustinian. L’apparition de ces taches horrifiantes marque l’installation dans la peinture d’une dynamique proprement scopique.
Référence de l'article
Stéphane Lojkine, « De l’allégorie à la scène : la Vierge-tabernacle », L’Allégorie de l’Antiquité à la Renaissance, dir. Brigitte Pérez-Jean et Patricia Eichel-Lojkine, Champion, 2004, p. 509-531 (publication partielle)
Critique et théorie
Archive mise à jour depuis 2008
Critique et théorie
Généalogie médiévale des dispositifs
Entre économie et mimésis, l’allégorie du tabernacle
Trois gouttes de sang sur la neige
Iconologie de la fable mystique
La polémique comme monde
Construire Sénèque
Sémiologie classique
De la vie à l’instant
D'un long silence… Cicéron dans la querelle française des inversions (1667-1751)
La scène et le spectre
Dispositifs contemporains
Résistances de l’écran : Derrida avec Mallarmé
La Guerre des mondes, la rencontre impossible
Dispositifs de récit dans Angélique de Robbe-Grillet
Disposition des lieux, déconstruction des visibilités
Physique de la fiction
Critique de l’antimodernité
Mad men, Les Noces de Figaro
Le champ littéraire face à la globalisation de la fiction
Théorie des dispositifs
Image et subversion. Introduction
Image et subversion. Chapitre 4. Les choses et les objets
Image et subversion. Chapitre 5. Narration, récit, fiction. Incarnat blanc et noir
Biopolitique et déconstruction
Biographie, biologie, biopolitique
Flan de la théorie, théorie du flan
Surveiller et punir
Image et événement