Dans le monde académique, la critique a bonne presse : il faut donner des références critiques, avoir lu toute la critique, toujours s'appuyer sur la critique… La théorie en revanche éveille le soupçon : qu'est-ce que c'est que cette, que ces théories ? Il serait plus prudent, plus agréable, plus modeste de ne pas s'embarrasser de théorie… Lorsqu'elle n'est pas identifiée à une insupportable cuistrerie (du flan), la théorie s'entend comme une idéologie au pire sens du terme, un dogmatisme : Le structuralisme, le marxisme, la psychanalyse sont de dangereuses théories, ou des théories désuètes, elles ont fait beaucoup de mal. Travailler sans théorie, c'est travailler librement, avec toute l'indépendance et l'ouverture d'esprit requise d'un bon chercheur. On s'appuiera cependant sur une abondante critique. Mais peut-il y avoir une critique qui elle-même ne s'appuierait sur aucune théorie ? Ou encore l'absence de théorie n'est-elle pas la pire, la plus totalitaire des théories ? Considérant qu'une étude des relations entre texte et image sollicite nécessairement l'interrogation critique des théories de la représentation, on se propose dans cette rubrique d'aborder quelques notions clefs et d'interroger la notion de dispositif qui les sous-tend.
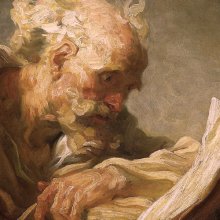
Critique et théorie
Stéphane Lojkine, 2008

